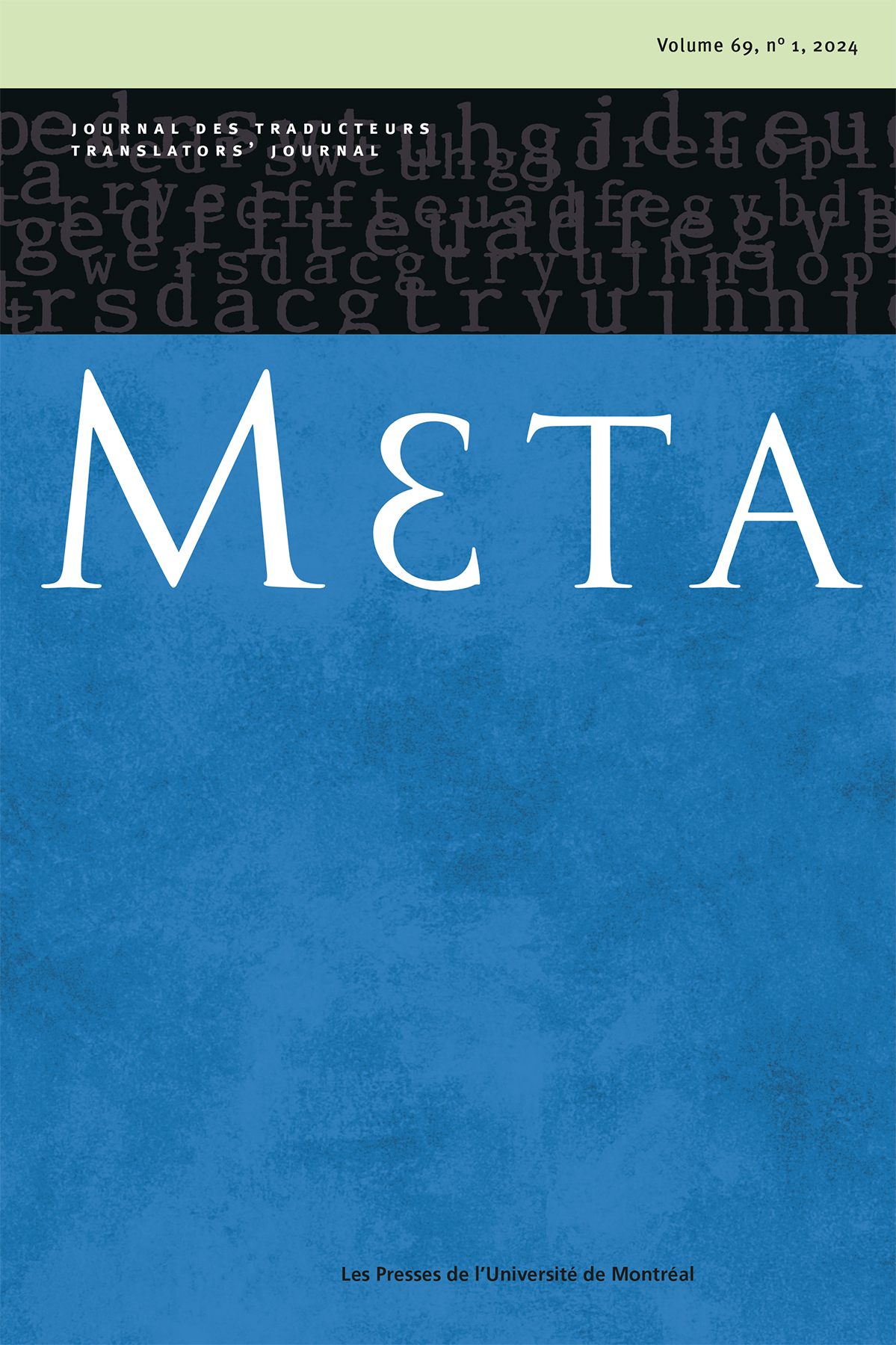Abstracts
Résumé
Cet article propose une étude sur le recueil de poèmes en deux langues Atemnot (Souffle court) (2016) de Marina Skalova, auteure trilingue née en 1988 à Moscou. Si cette auteure écrit surtout en français, son plurilinguisme s’inscrit dans toute son oeuvre, qui offre une matière féconde à qui s’intéresse aux questions que posent l’écriture bilingue et l’autotraduction. Cette étude prend pour point de départ l’interrogation sur ce qu’instaure le rapport entre les poèmes en allemand et en français de Atemnot (Souffle court) et aborde les poèmes en deux langues comme des « seuils réciproques ». L’article met en évidence la façon dont les poèmes de Atemnot (Souffle court) travaillent cette question et entrent en résonance avec deux oeuvres plus récentes de l’auteure, Exploration du flux et Silences d’exils.
Mots-clés :
- autotraduction,
- écriture bilingue,
- traduction de la poésie,
- migration,
- Marina Skalova
Abstract
This is a study of Atemnot (Souffle court) (2016), a collection of poems in two languages by Marina Skalova, a trilingual author born in 1988 in Moscow. Although the author writes mainly in French, her plurilingualism is part of her work, which offers fertile material for those interested in the issues raised by bilingual writing and self-translation. This study takes the relationship between Atemnot (Souffle court) poems in German and French as its starting and approaches the poems in the two languages as “reciprocal thresholds.” This study highlights the way in which Atemnot (Souffle court) probes this issue and resonates with two of the author’s more recent works, Exploration du flux and Silences d’exils.
Keywords:
- self translation,
- bilingual writing,
- poetry translation,
- migration,
- Marina Skalova
Resumen
Este artículo presenta un estudio del poemario en dos idiomas Atemnot (Souffle court) (2016) de Marina Skalova, autora trilingüe que nació en Moscú en 1988. Si bien Skalova escribe principalmente en francés, su multilingüismo impregna toda su obra, la cual constituye un interesante material de estudio sobre las cuestiones que plantea la escritura bilingüe y la autotraducción. Esta investigación toma como punto de partida el interrogante sobre cómo se establece la relación entre los poemas alemanes y franceses de Atemnot (Souffle court) y aborda los poemas en dos lenguas como “umbrales recíprocos”. El artículo destaca cómo los poemas de Atemnot (Souffle court) enfocan esta cuestión y hacen eco en dos de sus obras más recientes, Exploration du flux y Silences d’exils.
Palabras clave:
- autotraducción,
- escritura bilingüe,
- traducción de poesía,
- migración,
- Marina Skalova
Article body
Le bilingue est celui qui s’est approprié deux mondes, qui a deux langues également siennes. Mais il peut à chaque instant dire, à propos de l’une des deux : « l’autre langue ». Telle évidence ici ne l’est plus là-bas – il suffit de passer le seuil. Ce qui n’a pas d’explication ici en a besoin là-bas. Et vice-versa.
Jurgenson 2014 : 54
1. Introduction
Auteure trilingue née en 1988, Marina Skalova écrit essentiellement en français, mais son plurilinguisme s’inscrit dans toute son oeuvre. Son premier ouvrage publié, Atemnot (Souffle court)[1], est un recueil de poèmes qui a paru sous forme bilingue allemand-français en 2016. L’écriture bilingue et l’autotraduction sont deux domaines désormais abondamment étudiés par la recherche en traductologie ou en littérature, et l’oeuvre de Marina Skalova, aussi jeune soit-elle, offre une matière féconde à qui s’intéresse aux questions que posent ces deux pratiques d’écriture. Cette étude propose une réflexion sur le recueil de poèmes en deux langues Atemnot (Souffle court), en prenant pour point de départ l’interrogation sur ce qu’instaure le rapport entre les poèmes en allemand et en français. Nous explorerons la notion de seuil et chercherons à comprendre comment les poèmes de Atemnot (Souffle court) la travaillent et entrent en résonance, à travers elle, avec deux oeuvres plus récentes de l’auteure qui explorent la question migratoire, Exploration du flux et Silences d’exils. Marina Skalova offre elle-même un riche matériau réflexif sur son plurilinguisme et son travail créatif, qui nourrira la réflexion.
2. Marina Skalova : parcours et oeuvres
Née à Moscou (Huynh 2017 ; Collin 2017), Marina Skalova a grandi en France et en Allemagne. Arrivée en France à l’âge de trois ans, sa famille déménage en Allemagne lorsqu’elle a six ans. Si elle maîtrise le russe, le français et l’allemand, elle a gardé une relation plus orale à sa langue « maternelle », le russe (Huynh 2017). Elle écrit surtout en français, la langue dans laquelle elle a été le plus longtemps scolarisée, mais aussi en allemand. Skalova a été formée à l’écriture à l’Institut littéraire suisse de Bienne et vit depuis quelques années à Genève. Son oeuvre traite des questions liées à la difficulté d’épouser une identité, au déracinement qui s’inscrit dans le corps et dans la ou les langues, au sentiment de pouvoir parler plusieurs langues, mais d’avoir « une expérience trouée de chacune d’entre elles » (Collin 2017). Après Atemnot (Souffle court), publié en 2016 chez Cheyne, paraît Amarres, en 2017 à L’Age d’Homme, récit sur l’errance d’un homme étranger sur une île, suivi de Exploration du flux, au Seuil en 2018, texte en prose incantatoire sur les flux en puissance dans le monde d’aujourd’hui, migratoires, financiers, linguistiques, corporels ou encore communicationnels et informatiques. En 2019, elle publie une pièce de théâtre rédigée durant une résidence au Théâtre de Poche de Genève, La Chute des comètes et des cosmonautes (L’Arche), qui sera montée dans ce même théâtre à l’hiver 2019, dans une mise en scène de Nathalie Cuenet[2]. Cette pièce évoque le trajet Berlin-Moscou d’un père d’origine russe immigré en Allemagne et de sa fille, leurs mondes qui s’affrontent avec, en arrière-plan, la chute de l’URSS et la perte des idéologies. En 2020, paraît Silences d’exils (éditions d’en bas), en collaboration avec la photographe Nadège Abadie, ouvrage issu du travail élaboré durant des ateliers d’écriture et de photographie avec des migrants. Reflet de l’expérience humaine et artistique de ces rencontres, ce livre tisse les voix et les réflexions des migrants à celles de l’auteure et de la photographe. Marina est également traductrice du russe et de l’allemand vers le français (notamment de Katja Brunner, Thomas Köck, Dorothee Elmiger, Maria Stepanova, Galina Rymbu) et, dans une moindre mesure, du français et du russe vers l’allemand (Varlam Chalamov, Luba Jurgenson).
3. Plurilinguisme littéraire, écriture bilingue et autotraduction chez Skalova
Le plurilinguisme, l’autotraduction et l’écriture bilingue sont trois domaines des études littéraires qui ont pris leur essor ces deux dernières décennies, et de très nombreuses publications ont vu le jour, comme en témoigne la bibliographie sur l’autotraduction de plus de 200 pages dirigée et régulièrement mise à jour par Gentes (Gentes 2020 ; voir aussi Anokhina et Rastier 2015 ; Ceccherelli et al. 2013 ; Cordingley 2013 ; Ferraro et Grutman 2016 ; Sperti 2017). Selon la définition d’Anokhina et Sciarrino, Skalova est une auteure plurilingue :
Nous désignons comme écrivain plurilingue une personne qui, lors de son écriture, utilise au moins deux langues dont on peut trouver les traces – explicites ou implicites – soit dans des oeuvres publiées, soit dans des documents de travail qui accompagnent son processus créatif (les brouillons, les notes, le journal d’écriture, etc.) même si l’oeuvre publiée a une apparence monolingue.
Anokhina et Sciarrino 2018 : 15, italique dans l’original
Si les autres oeuvres de cette auteure sont rédigées en français, le recueil Atemnot (Souffle court) présente des poèmes écrits en deux langues, le français et l’allemand, dans une forme de plurilinguisme présentant donc des traces explicites. Selon ces mêmes auteurs (Anokhina et Sciarrino 2018 : 19), « un duo de langues cache souvent une multiplicité linguistique bien plus grande à l’oeuvre ». Chez Skalova, une troisième langue est présente dans son oeuvre de manière implicite ; il s’agit du russe, sa langue maternelle. En effet, des notes de rédaction et des versions antérieures de poèmes de Atemnot (Souffle court) existent en russe (le russe disparaît toutefois totalement dès les versions tapuscrites)[3], mais elle n’a rien publié dans cette langue. À ce sujet, elle dit : « Mais je n’ai jamais écrit en russe, probablement parce que j’ai une relation très orale à ma langue maternelle, peut-être aussi parce que dès l’enfance, c’était la langue de mes parents, et qu’écrire en français ou en allemand me permettait de m’approprier un espace à moi » (Huynh 2017).
Ce qui motive l’usage d’une pluralité de langues dans le travail littéraire de Skalova dans Atemnot (Souffle court) n’est ni une nécessité politique ou sociale, ni une nécessité faisant entrer en jeu la dimension des rapports de force entre les langues en présence[4], mais d’une part la donnée migratoire, à savoir l’émigration de sa famille de la Russie vers la France, puis vers l’Allemagne, et d’autre part la dimension littéraire et créative dans ce contexte de cohabitation intérieure de plusieurs langues (Collin 2017). On peut émettre l’hypothèse que le fait d’avoir vécu quelques années à Bienne en Suisse, ville bilingue, a pu favoriser cette cohabitation des langues à l’intérieur du processus créatif et des textes qu’elle a conçus durant cette période (Atemnot (Souffle court) a été écrit, du moins en partie, pendant sa formation à l’Institut littéraire suisse[5]). On ajoutera que, dans l’article d’Anokhina et Sciarrino cité plus haut, les auteurs relèvent une « conscience métalinguistique » particulière aux écrivains plurilingues, qui peut être définie comme « habileté à réfléchir sur le langage […] » (2018 : 28-29). Le cas de Skalova semble confirmer cette disposition autoréflexive observée chez les auteurs plurilingues : la confrontation entre les langues et la difficulté de trouver des repères stables et une identité définie dans cette cohabitation de trois langues est manifestement thématisée dans son oeuvre (plus particulièrement dans Atemnot (Souffle court) et dans Silences d’exils) et dans les entretiens qu’elle a menés (Huynh 2017 ; Collin 2017).
Si, comme le décrit Grutman dans l’article « Écriture bilingue et loyauté linguistique » (2000), une méfiance à l’égard du bilinguisme a longtemps dominé, les nombreuses études parues récemment dans les domaines de l’écriture plurilingue, de la traduction et de l’autotraduction ne cessent désormais de valoriser les différentes formes de pratique littéraire plurilingue. Dans le domaine de la poésie, l’autotraduction et l’écriture bilingue sont souvent considérées comme deux modalités d’écriture difficiles à distinguer l’une de l’autre, parce qu’elles peuvent en quelque sorte avoir lieu simultanément, si le travail se fait de poème en poème. On nomme ainsi cette pratique « écriture parallèle en deux langues » (Anokhina 2015 : 39) ou « écriture simultanée en deux langues » (Anokhina et Sciarrino 2018 : 26). Les dimensions de traduction et d’écriture sont coprésentes. Avec Oustinoff (2002 : 33), on nommera cette pratique « autotraduction créatrice », qui recoupe pratique de traduction et de réécriture donnant lieu à une création autonome. Dans la mesure où nous mettrons l’accent sur l’écriture bilingue, l’autotraduction et le plurilinguisme, nous ne convoquerons pas la littérature secondaire du champ de la traduction de la poésie. Pour des références en la matière, notamment les travaux d’Henri Meschonnic, nous renvoyons à notre article « La traduction de la poésie aujourd’hui, quelles perspectives théoriques ? Quelques repères » (Vischer 2017).
En ce qui concerne la pratique d’écriture de Skalova, on peut se demander si celle-ci est plutôt de l’ordre de la traduction ou de l’écriture en deux langues. Dans l’introduction au recueil, elle écrit : « J’ai conçu Atemnot (Souffle court) comme un recueil bilingue en français et en allemand. […] Le recours à la traduction permet, pour moi, de mettre en résonance les langues, en introduisant toujours de légères variations […] » (Skalova 2016 : 7). Les deux modes d’écriture sont donc bien coprésents, sans que l’auteure ne thématise la différence entre l’un et l’autre. Les poèmes sont traduits, mais pas seulement ; les poèmes sont réécrits, mais pas seulement ; et les allers-retours d’un poème dans une langue au poème dans l’autre langue sont fréquents. En effet, dans l’entretien radiophonique avec Collin (2017), Skalova s’exprime au sujet de la création de Atemnot (Souffle court) et révèle que certaines sections du livre ont été écrites davantage sur le mode « écriture bilingue » et d’autres plutôt sur le mode « autotraduction », avec plus ou moins d’allers-retours entre le français et l’allemand (Collin 2017). Elle explique également que certains poèmes sont nés d’abord en allemand, et d’autres d’abord en français. Les allers-retours d’une version à l’autre étaient répétés dans un travail portant autant sur les sonorités que sur le sens (Collin 2017).
S’il est bien question d’autotraduction, elle est envisagée comme traduction-réinvention, sans rapport de subordination entre les textes (entretien personnel, 17 avril 2019). Pour aborder ce recueil, nous partirons du constat d’une pratique simultanée de l’écriture bilingue et de l’autotraduction créatrice, sans la nécessité de devoir trancher en faveur de l’une ou de l’autre, et des réflexions récentes de Samoyault (2020) sur la traduction, qui nous permettront de mieux comprendre ce que le rapport entre les poèmes en français et en allemand peut instaurer.
4. Atemnot (Souffle court)
Atemnot (Souffle court) est structuré en quatre sections : « Figures du corps » ; « Nuit(s) / nacht(s) » ; « Ce(ux) qu’on foule aux pieds » ; « Territorien ». Tous les poèmes sont faits de vers courts, incisifs, de quelques mots. La tonalité d’ensemble est plutôt sombre, les poèmes disent un rapport douloureux au corps, au langage, aux espaces à franchir sans que l’on puisse se les approprier. La violence du corps intime se conjugue à celle du rapport à l’autre et au corps de l’autre, comme le territoire du corps s’associe aux territoires et aux frontières géographiques et politiques, à l’errance, la non-appartenance. La violence du monde extérieur vient heurter le corps et l’être intime, comme celle du corps et du monde intérieur vient frapper le réel. La porosité entre les deux renvoie davantage aux limites réciproques qu’à la possibilité d’un échange. Le langage s’inscrit également dans un rapport au manque, à la fissure (« la langue se fend ») (Skalova 2016 : 22) ; les mots sont flous (25), filaments (24), ils s’engouffrent (24), « les paroles claquent/comme des gifles » (35). L’entretien radiophonique avec Collin (2017) révèle que l’auteure est partie de la sensation de se sentir étrangère dans la langue et dans le corps. La coprésence des deux langues renvoie à l’impossibilité de s’installer dans l’une d’elles, à une altérité marquant la différence et la limite. On reconnaîtra l’influence du poète Antoine Emaz, dans le motif de la respiration, le parti pris non lyrique, l’absence d’effet, le dépouillement métaphorique, la concision des vers et dans l’usage du pronom impersonnel on ; celle du poète Bernard Noël pour le rapport au corps (Collin 2017) ; et celle de Paul Celan, de façon plus profonde, moins directement perceptible, pour le rapport à l’errance, la radicalité de l’inadéquation au monde et à l’autre, et l’exigence d’une parole épurée. Dans ce recueil, la nuit (ou les nuits) domine(nt), et cependant une énergie circule, énergie du souffle qui passe entre les poèmes, d’une langue à l’autre.
Les thématiques décrites ci-dessus s’articulent autour du bilinguisme de l’ouvrage, qui est structurel. Partant de considérations éditoriales et paratextuelles, on constate tout d’abord que le livre est publié chez un éditeur français, Cheyne, que le poème français est situé en haut à gauche de la page, en romain, tandis que le poème allemand vient ensuite, décalé sur la droite, en italique. Il le prolonge, mais de façon décalée, avec un écart et une inclinaison différente. Le choix de placer le français d’abord est probablement dû au lectorat de réception première du texte, déterminé par la maison d’édition. Dans l’entretien privé déjà mentionné, Skalova explique qu’elle avait également envoyé son manuscrit à des éditeurs de l’aire germanophone, et qu’il n’y avait donc pas de choix de prédominance d’une langue sur une autre. On peut constater que le choix de supprimer les majuscules aussi en allemand (qui en comprend d’une manière générale beaucoup, étant donné que les substantifs en portent une), probablement dans une optique unificatrice, puisqu’aucune majuscule et aucun point ne figurent dans aucun des poèmes, fait glisser typographiquement l’allemand vers le français. Cependant, le titre du recueil présente quant à lui la tendance inverse : le mot principal du titre est en allemand, « Atemnot », tandis que le titre français est placé à la deuxième ligne, dans une police plus petite, et entre parenthèse, « (Souffle court) ». Dans l’entretien radiophonique avec Collin (2017), Skalova explique que ce titre renvoie à l’étrangeté et à la langue étrangère, et à la respiration, au souffle du poème. Le lecteur francophone ne connaissant pas l’allemand est en effet d’emblée face à un mot qu’il ne comprend pas et ne sait pas prononcer (en témoigne la prononciation du titre par Collin durant l’entretien, qui prononce le « e » et le « o » ouverts, alors qu’ils devraient être fermés). Souffle court n’a pas le même sens que Atemnot, qui est beaucoup plus fort, puisqu’il signifie une urgence respiratoire qui peut être vitale. Par ailleurs, par un détour des langues et des cultures, le titre en allemand renvoie à un film français, À bout de souffle, de Godard (1960), puisqu’il en rappelle le titre allemand (Ausser Atem[6]). Un film qui, comme ce recueil, parle de l’essoufflement des corps et des êtres dans la tentative de se rejoindre. Comme l’écrit De Montety (2017), le titre est tout à la fois le souffle manquant « des corps pris dans l’apnée amoureuse, dans le leurre des mots ou dans l’errance territoriale ».
Les titres des sections jouent également avec la prédominance de l’une ou l’autre langue, ou le parallélisme. Pour « Figures du corps », l’auteure précise (entretien personnel, 17 avril 2019) que ce sous-titre ne lui semblait pas traduisible en allemand. Pour « Nuit(s) / nacht(s)[7] », on peut relever un jeu de miroirs dans l’usage de deux mots courts commençant par la même lettre, et dans le choix donné quant à une lecture au singulier ou au pluriel. La troisième, « Ce(ux) qu’on foule aux pieds » (presque citation d’un titre de poème de Victor Hugo) joue aussi sur une lecture optionnelle, mais uniquement en français. Enfin, pour la dernière, « Territorien », l’auteure n’a d’autre explication que le fait que l’allemand se soit imposé (entretien personnel, 17 avril 2019).
Dans l’introduction à Atemnot (Souffle court), Skalova évoque la conception du recueil et dévoile la façon dont elle appréhende l’écriture et la traduction :
J’ai conçu Atemnot (Souffle court) comme un recueil bilingue en français et en allemand. Ces deux langues sont mes langues d’écriture, sans pour autant être mes langues maternelles. L’écriture a toujours été liée pour moi à l’expérience de l’étrangeté, de l’entre-deux. Dans ce texte, la parole s’éveille dans les deux langues, se reflète dans le miroir toujours légèrement déformé que l’autre lui tend, soulignant ainsi l’altérité et l’instabilité de chaque langage. Le recours à la traduction permet, pour moi, de mettre en résonance les langues, en introduisant toujours de légères variations, tout en ne s’installant réellement dans aucune d’entre elles. La traduction met en lumière les hésitations, les incertitudes, montre à quel point les assises de chaque langue sont vacillantes. Aucune langue ne suffit vraiment pour dire ce qu’il y aurait à dire. D’autant plus quand elles sont deux ; quelque chose se dérobe, fait défaut.
Skalova 2016 : 7-8
Cette vision de l’écriture et de la traduction comme expérience de l’étrangeté, de l’instabilité de chaque langage, de l’incertitude, du vacillement, de l’insuffisance et de la dérobade est une vision partagée par plus d’un auteur-traducteur aujourd’hui, notamment Pierre Lepori, nourri par la pensée de la traduction de Derrida et Renken (voir Vischer 2014), et de De Toledo, qui a développé une pensée de l’« entre-des-langues » (De Toledo 2014).
5. Le rapport entre les poèmes en deux langues
Un article élogieux de De Montety (2017) publié dans Recours au poème commence ainsi : « Atemnot (Souffle court) est sûrement un livre sur la faiblesse et la beauté de la traduction ». Alors que l’on s’attendrait à trouver, comme il en est dans la plupart des articles positifs qui s’intéressent à la traduction, le terme de force, c’est son envers qui est convoqué, la faiblesse. L’auteur de la critique ne s’attarde pas sur ce terme, mais il est clair à la lecture de l’article qu’il ne s’agit nullement d’un jugement de valeur sur le travail de traduction, et qu’il est à prendre au sens large : ce livre mettrait en valeur un aspect de l’acte de traduire qui, de manière générale, pourrait être perçu négativement. En traduction, écrit De Montety, « il n’y a pas d’équivalence […], alors forcément l’équilibre se dérobe parfois » (2017. Mais la faiblesse de la traduction, dans ce cas tout particulièrement, serait également sa force : l’autre texte ne dit et ne fait jamais la même chose, et c’est de tout ce qui résiste d’un poème à l’autre, d’une langue à l’autre, que la puissance poétique se dégage. Ce point de départ dans la différence et l’altérité montre que ce qui est en jeu dans les poèmes de Skalova se situe, plus encore que pour une traduction (au sens classique du terme), dans le rapport entre les deux langues et les deux poèmes.
Reprenant l’introduction de Skalova à Atemnot (Souffle court) à la lumière de cette réflexion, on peut constater que ce qu’elle décrit est la manifestation de l’impossibilité à dire dans une langue et en traduisant dans une autre langue[8]. L’auteure met en lumière ce que ni l’écriture ni la traduction ne peuvent : elle décrit le vacillement, le dérobement, l’instabilité, l’hésitation, l’incertitude, l’incomplétude des langues et du passage d’une langue à l’autre. Les poèmes en deux langues mettent ainsi au jour les espaces de résistance propres à la traduction et l’écriture bilingue par ce qui a lieu dans le rapport entre les poèmes. Ce rapport, nous le nommerons dans un premier temps et provisoirement « face-à-face ». Dans ce face-à-face, chaque poème manifeste ce que l’autre ne dit pas ou ne peut pas dire, ou ce qui ne veut pas se dire dans l’autre langue ; ce rapport est révélateur de manques réciproques.
La réflexion que mène Samoyault dans le chapitre « La traduction agonique » de son ouvrage Traduction et violence (2020) permettra d’approfondir la définition de ce rapport. Pour définir « la traduction agonique » (le terme d’agonisme est repris aux écrits de Chantal Mouffe et indique « une négativité impossible à déraciner » [cité dans Samoyault 2020 : 52]), Samoyault utilise ces termes : « la traduction agonique est ainsi celle qui laisse en jeu les forces de conflit inhérentes à la traduction, entre les langues, entre l’esprit et la lettre, entre l’original et la traduction, entre différentes options qui se proposent et parmi lesquelles il faut choisir, et qui s’en sert pour affirmer une position, pour prendre une décision » (2020 : 52-53). Chez Skalova, « laisser en jeu les forces de conflit inhérentes à la traduction » signifie, d’une part, affronter et accepter de travailler avec la distance entre ses deux langues d’écriture :
Je pense qu’écrire en deux langues fait d’abord rejaillir la distance d’une langue à l’autre. Pour moi, cela souligne surtout les écarts entre elles, ce qui fait que les visions du monde qu’elles portent ne se recoupent pas, qu’elles demeurent étrangères l’une à l’autre, mais incarnent une multiplicité possible.
Huynh 2017
D’autre part, c’est faire l’expérience d’une double limite : celle qui distingue une langue de l’autre, et celle qui met face à l’impossibilité d’entrer pleinement dans l’une d’elles, puisque l’autre est toujours là : « On ne s’installe jamais dans une langue, l’usage de l’une renvoie aux limites de l’autre » (Collin 2017). On notera que cette expérience de distance et de limite entre les langues qui s’inscrit dans le rapport entre les poèmes s’avère en lien étroit avec les thématiques abordées dans le recueil : que ce soit la distance qui s’amorce dans le langage par son incapacité à dire ou celle qui se creuse entre soi et son propre corps, entre soi et l’autre, entre soi et le monde, les écarts sont là, dans ces territoires qui s’entrechoquent. Cependant, comme nous le verrons ci-dessous dans les analyses de huit poèmes du recueil, c’est du face-à-face également qu’émerge la richesse sémantique et sonore de chacun des poèmes : mettant au jour les différences entre les deux langues et les deux poèmes, il permet à de nouvelles significations d’apparaître. En effet, l’acceptation du face-à-face est dynamique, puisque celui-ci permet le déploiement de tout son potentiel de différenciation, qui n’exclut pas certains rapprochements et l’« irrigation » de la matière poétique : « ce qui rapproche [les langues], ce sont alors les homophonies, les résonances de sons… » (Huynh 2017). De Montety écrit : « Ici les deux langues sont un peu l’une l’autre, s’irriguent, pompent leurs sangs que le poème rend compatibles […] » (2017). C’est cette notion de circulation entre les poèmes qui va nous permettre de définir de façon plus précise le rapport entre eux. Plutôt que dans une relation de « face-à-face », il nous semble en effet que les poèmes s’inscrivant dans un écart nous poussent de seuil en seuil, de façon réciproque, chaque poème devenant le seuil de l’autre.
Dans l’article « La mémoire est dans les seuils », Samoyault (2015 : 83) cite un passage de Benjamin (Paris, capitale du XIXe siècle) qui nous semble particulièrement fécond pour la réflexion que nous souhaitons mener à partir de la notion de seuil : « Le seuil (die Schwelle) est une zone, et plus précisément une zone de transition. Les idées de mutation et de transition, de passage d’un état à un autre, de flux, sont contenues dans le terme même de schwellen (gonfler, enfler, dilater) […] » (Benjamin 1989 : 852). Les notions de transition et de mutation sont également présentes chez Waldenfels, qui insiste sur le brouillage spatial qu’instaure le seuil, et sa capacité à se confondre avec le temps :
Die Schwelle ist schwer zu verorten, im strengen Sinne ist sie gar nicht zu verorten. Sie bildet ein Ort des Übergangs, einen Niemandsort, an dem man zögert, verweilt, sich vorwagt, den man hinter sich lässt, aber nie ganz. […] Im Überschreiten der Schwelle befindet man sich nicht mehr hier und noch nicht dort, Ort und Zeit berühren sich.
Waldenfels 1999 : 9
[Le seuil est difficile à situer ; au sens strict, on ne peut pas le situer. Il constitue un lieu de transition, un « lieu de personne » où l’on hésite, où l’on s’attarde, où l’on s’aventure ; qu’on laisse derrière soi, mais jamais complètement. […] En franchissant le seuil, on ne se trouve plus ici et pas encore là, le lieu et le temps se touchent.] (notre traduction littérale)
Cette zone d’ouverture et de fermeture à la fois, que nous appellerons « espace du seuil », nous paraît évoquer de façon intéressante le rapport qui s’instaure entre les poèmes dans Atemnot (Souffle court). Tout d’abord, le poème dans une langue est comme la porte d’entrée vers le poème dans l’autre langue, son seuil ; ensuite, chaque poème permet d’entrer dans l’autre en signifiant qu’il n’est pas l’autre et, dans un même mouvement, qu’il n’existe pas seul sans l’autre. Dans la relation qui s’instaure entre les deux, cet espace du seuil est tout à la fois la possibilité d’accéder à l’autre poème, ce qui le relie à l’autre, et la distance, la limite. Le seuil dit en effet aussi la distance entre les deux poèmes : être sur le seuil, c’est être en dehors, ne pas être entré, être sur la limite ; être au bord de, au-devant de. Les deux poèmes se tiennent au-devant l’un de l’autre. Le dialogue entre les deux poèmes s’instaure en creux : à travers ce que l’un n’a pas et que l’autre a, à travers ce que l’un ne dit pas et que l’autre dit. Le substantif Schwelle contient l’idée de transition, de passage, de flux et de mutation. Ces quatre termes décrivent d’autres traits essentiels du rapport entre les poèmes : l’espace à parcourir de l’un à l’autre, par le déplacement d’une langue à l’autre, décrit bien d’une part une transition, un « passage d’un état à un autre », d’autre part une transformation, ou mutation, celle des sonorités, des sens déployés par le tissu de l’autre langue, par l’intermédiaire d’un flux (terme au coeur du troisième ouvrage de Skalova, Exploration du flux), un mouvement circulatoire ou, dans Atemnot (Souffle court) plus particulièrement, respiratoire. Cependant, comme le précise Nouss dans l’article « La traduction : au seuil », l’intérêt de la notion de seuil, par rapport au terme de passage, par exemple, réside dans sa bidirectionnalité : « Mais il y a plus, car l’expérience du seuil se fait dans les deux sens : pour pénétrer dans un espace clos et pour en sortir » (2014). Par ailleurs, comme le souligne ce même auteur :
le seuil vient brouiller l’opposition binaire entre dedans et dehors puisqu’il en indique le lien dialectique. De surcroît, il s’empare de l’affect porté par le dehors et en infuse le dedans. Lorsque, venant de l’extérieur, je suis sur le seuil, j’investis le dedans du même effroi qui me gagne lorsque, sur le seuil et venant de l’intérieur, je considère le dehors.
Nouss 2014
C’est ainsi en raison de la bidirectionnalité et du brouillage possible entre le dedans et le dehors que la notion de seuil nous paraît féconde ; c’est cette dernière qui nous permettra d’appréhender l’analyse des poèmes[9].
6. Les poèmes en deux langues comme « seuils réciproques »
Le choix des poèmes analysés a été effectué de façon à rendre compte de la façon la plus complète possible des différentes modalités de l’« espace du seuil » dans ce recueil. Afin de tenir compte des limites imposées par le format d’un article de revue, seuls huit poèmes ont été retenus, qui seront abordés au moyen d’une analyse comparative. Dans le contexte d’une pratique d’écriture bilingue, la méthode comparative semble pertinente, elle sera abordée en plaçant les deux éléments de chaque binôme dans un rapport « non hiérarchique » (Heidmann 2005 : 104 et plus généralement Merkle 2009). Le septième poème en deux langues de la section « Nuit(s) / Nachts(s) », ainsi présenté dans le recueil[10], nous permettra de proposer une première analyse :
Lorsqu’on observe ces deux poèmes qui évoquent la question du dire et du non-dire, on constate tout d’abord que la structure du poème est très similaire en français et en allemand. On peut ensuite prendre acte de quelques différences ou déplacements sémantiques : les silences est die stille[11] en allemand, qui évoque le silence au sens d’une absence d’éléments sonores et dont le sens est plus large que schweigen, qui désigne l’absence de parole, qui est lui aussi présent dans le poème, mais comme déplacé tout à la fin, dans son emploi à l’infinitif. Le masculin pluriel en français a pour pendant un féminin singulier en allemand, qui désigne une notion plus précise. Le verbe, associé à silences, déplier, est entwirren en allemand, qui signifie démêler, dénouer. La différence la plus notable, et qui nous semble intéressante ici, concerne le point de vue et l’adresse : dans le poème en français, le sujet est impersonnel et il n’y a pas d’adresse (« séparer/ce que l’on ne peut pas dire ») ; dans le poème en allemand, une adresse en du (tu) est présente, qui implique un sujet implicite en je (« unterscheiden/was du nicht sagen darfst »). Dans le dernier vers du poème en français, « de ce qui doit rester tu », le tu peut être lu comme un appel au du du poème en allemand, qui suit graphiquement le poème en français. Ce tu est ainsi comme sur le seuil de l’autre poème, il ouvre à un dialogue explicite, où ce que « l’on ne peut pas dire » est « was du nicht sagen darfst », ce que « tu n’as pas le droit de dire ». Ce qui demeure difficile ou impossible à dire – le verbe pouvoir contient les deux – est exprimé de façon plus précise à travers le verbe dürfen, qui signifie « avoir l’autorisation ». L’espace du seuil place le lecteur tantôt face à un poème désincarné, sans adresse et sans sujet (et qui impliquerait plutôt un je sous-entendu), tantôt face à un poème ancré par son adresse nette à un du et une tonalité plus péremptoire. Dans la circulation d’un poème à l’autre, la réciprocité du seuil ouvre à une perception double : elle invite à lire une transformation, dans un mouvement d’ouverture qui à la fois s’offre et accueille, et de face-à-face, qui implique bien un dialogue, mais aussi une distance infranchissable entre les deux langues, les deux univers sonores et sémantiques, les deux poèmes. Soit un autre poème bilingue (de la section « Ce(ux) qu’on foule aux pieds ») :
La structure, cette fois, n’est pas tout à fait identique, puisque le poème en français présente quatre vers, et le poème en allemand cinq, et que le rapport entre les éléments s’organise de manière différente d’un poème à l’autre. On constate ensuite une inversion dans la place des deux termes clés du poème : mort, peur et angst, tod, créant comme un chiasme d’un poème à l’autre[12]. Ainsi, c’est la peur qui est là d’abord en allemand, tandis que c’est la mort qui s’impose d’abord en français (même si la peur est aussi présente dans le verbe craindre). Le poème en français se termine par un autre mot central, verrou, ouvrant ainsi l’espace du seuil entre les deux poèmes : le verrou permet de fermer ou d’ouvrir, il contient les deux mouvements de distance et de rapprochement, comme une porte-seuil, il ferme ou ouvre à la respiration, premier substantif du poème en allemand. Le rapport entre les deux poèmes contient donc à la fois la violence de ce qui ferme, une absence de mouvement, comme cette peur qui bloque le souffle, une limite, et la possibilité que quelque chose circule, se déplace de poème en poème, le poème en allemand se terminant par dazwischen schieben, qui peut signifier s’intercaler, et non par verrou, comme dans le poème en français. Si le rapport entre les deux poèmes peut être l’expérience d’une limite, dans ce cas, elle est aussi liée à ce à quoi le poème nous confronte, et que Samoyault place au centre de l’expérience de traduction :
Par ce que la traduction fait avec des fragments et des morceaux qu’elle recompose dans un autre langage, elle est au plus près de l’expérience d’une limite, celle qui permet de regarder la mort en face et de prendre en charge la transmission et la survie d’une autre manière, dans une forme d’apprivoisement de l’affrontement.
Samoyault 2020 : 52
L’affrontement de la mort est bien là, et le rapport entre les textes, jouant sur les décalages et les basculements, pourrait être perçu comme de l’ordre d’un « apprivoisement ».
L’espace du seuil est aussi celui du corps : du rapport entre le monde extérieur et le corps, de la limite et de la porosité entre les deux ; du rapport entre le corps du sujet et le corps de l’autre, de la limite et de la porosité entre les deux. Là, le seuil est la limite et le point de rencontre ou de non-rencontre, parfois même de l’affrontement. Chez Skalova, en effet, le rapport à l’autre corps est vécu dans une certaine violence, l’assiègement du corps pouvant donner lieu, comme dans ces poèmes de la première section, « Figures du corps »[13], à une désintégration de la chair et un amenuisement du souffle :
Comme les deux corps se font violence, les deux langues du poème se font face, dans toute leur altérité : l’une par ses sonorités douces, le français, qui expriment la fragilité (allitérations en « s », en « f » et en « l »), l’autre, l’allemand, par ses sonorités fortes et cassantes (assonances en « ö », allitérations en « t » et en « r »). Suivant le mouvement sonore, certains choix lexicaux laissent aussi entrevoir, en allemand, un sens plus fort (zerspringt [éclate] pour s’étoile [2016 : 15]) ou un ancrage plus déterminé (un verbe conjugué en allemand, fröstelt [frissonne], pour un adjectif en français frêle [2016 : 17]). L’amenuisement du souffle, c’est également celui de la langue, ou plus simplement la difficulté de l’émergence de la parole, comme en témoignent ces vers des poèmes de la page 25 : « les mots émergent flous/de leur sommeil de glaise » / « worte verschwommen/aus lehmigem schlaf » [les mots deviennent flous/sortant de leur sommeil de glaise] (2016).
L’espace du seuil est ainsi également celui de la langue, des langues : dans Silences d’exils, la situation des migrants parlant plusieurs langues et devant faire l’apprentissage du français suscite chez Skalova des réflexions sur la façon dont les langues cohabitent et sont délimitées l’une par rapport à l’autre :
Lorsqu’on arrive au bord d’une langue, est-ce qu’on passe aussitôt la frontière de la suivante ?
Skalova et Abadie 2020 : 23Comment dire l’espace qui s’étend entre deux langues ?
Est-ce qu’on peut le circonscrire, le délimiter, le dessiner ?
Serait-ce une clairière dans la forêt ?
Ou plutôt la lisière qui la borde ?
L’image qu’elle cherche pour exprimer cet espace entre les langues est proche de celle du seuil, à savoir un espace qui ouvre et qui ferme à la fois, et qui délimite un passage. Le rapport entre les langues (le russe, surtout parlé – mais les archives révèlent que certains poèmes étaient à l’origine en russe –, l’allemand, le français) dans l’être intime instaure un rapport au langage déplacé, décentré, qui n’a de cesse de chercher à se définir. Dans les poèmes en regard, ce rapport révèle la limite et la porosité entre les langues et la capacité à y faire face pour les reconnaître et les transformer. Les poèmes de la section « Ce(ux) qu’on foule aux pieds » mettent au jour ce rapport :
Dans ces poèmes, la langue est brisée par la violence du corps, corps bilingue qui ne peut vivre dans ses deux langues, peut-être. La langue se fend, se divise en deux, comme chacun des poèmes se divise en deux fois deux vers, et comme le double poème se divise en deux langues. Si le travail sur les sonorités révèle ici des échos (notamment la prédominance du son « ˈʃ », en allemand comme en français), la fissure se cristallise aussi dans le passage d’une langue à l’autre, marquée par la virgule au milieu du troisième vers du poème en allemand, la métaphore oeuvrant par l’apposition et l’ellipse du verbe.
L’espace du seuil est aussi celui du rapport entre corps et langue : l’écriture se forge à travers un corps. Dans l’expérience de traduction, le traducteur traduit avec son propre corps, qui n’est pas celui de l’auteur. Santschi, écrivaine et traductrice, écrit : « […] une langue est un corps physique, une attitude au monde, un passé, un présent. […] Traduire c’est donc, par fatalité, interposer un corps autre, celui du traducteur, entre l’original et la traduction » (1985 : 57). Lorsqu’un auteur écrit en deux langues et/ou s’autotraduit, il est face à deux langues et deux corps qui à la fois cohabitent et s’affrontent. Écrire en deux langues, c’est écrire avec deux corps, le corps physique étant ressenti différemment dans chaque langue : la façon dont on vit la langue dans le corps, et dont on la prononce, fait intervenir deux identités corporelles différentes. Dans Au lieu du péril, Jurgenson, Russe d’origine qui a écrit toutes ses oeuvres en français, explique que les deux corps du bilingue ne sont pas perceptibles par autrui :
Le bilingue ne peut pas être vu en entier par les autres. Je tends à l’autre ma main russe ou française, jamais les deux à la fois. On ne parle pas le « bilingue », sauf avec soi-même. […] L’un des deux corps est toujours un corps astral, on le promène avec soi, mais on ne peut le faire voir, juste le raconter, le mimer. Et le corps incarné est à tout moment prêt à se rétracter, à se retirer dans son immatérialité pour laisser place à l’autre.
2014 : 14[14]
Ainsi, c’est bien l’écriture et la langue, les langues, qui mettent au jour cette dualité. En effet, si, sur le plan métaphorique cette fois, écrire dans deux corps, c’est-à-dire deux langues, est également une expérience de la différence (on écrit chaque fois avec le corps propre à la langue, sa matière, ses sons, ses sens), le poème – sa corporéité (matière, sons, sens) – se transforme d’une langue à l’autre. Dans Traduction et violence, Samoyault reprend le lien qu’établit Derrida, dans Shibboleth. Pour Paul Celan, entre traduction et différence : l’arbitraire d’une différence (de prononciation d’un mot dans le cas étudié par Derrida) peut s’avérer déterminant en ce que cette différence est susceptible de devenir « ce qu’il faut savoir reconnaître et surtout marquer pour faire le pas, pour passer la frontière d’un lieu ou le seuil d’un poème, se voir accorder un droit d’asile ou l’habitation légitime d’une langue. Pour ne plus y être hors la loi » (Derrida 1986 : 50). Skalova se sent illégitime (ou « hors la loi ») dans l’une et l’autre de ses langues d’écriture et de traduction, de nombreux propos en témoignent : « Chez moi [l’impression de ne pas savoir écrire] s’enracine dans la conscience claire et limpide de n’être en possession d’aucune langue de façon suffisante pour pouvoir l’écrire. […] En réalité, toutes les langues que je connais, je les parle avec des trous » (2016 : 23). Et ces trous ne se comblent jamais :
Alors, traduire c’est comme construire des passerelles en bois pour renforcer la terre boueuse et passer d’un trou au suivant. Traduire ne répare pas les trous. Les passerelles que l’on met sur la boue sont elles-mêmes glissantes, elles enfoncent la terre à des endroits inattendus. Traduire fait prendre conscience d’encore bien plus de trous. Traduire rend les choses à la fois plus solides et plus boueuses.
Skalova 2016 : 24
Même traduire ne semblerait donc pas un moyen d’accéder à une légitimité ; cependant, la prise de conscience de la complexité qu’ouvrent les différences entre les langues devient source de réflexion et matériau pour le travail littéraire d’une langue à l’autre. À la suite de la réflexion de Derrida, Samoyault écrit que « la différence doit pouvoir s’inscrire dans le corps : voici le sens de la traduction » (2020 : 78). Pour Skalova cependant, cette difficulté à se sentir légitime dans l’une comme dans l’autre langue s’inscrit jusque dans le corps :
Être assise entre les fronts signifie : toujours simultanément dedans et dehors, comprendre les contextes mais ne pas pouvoir les porter dans mon corps, me situer ailleurs, dans un ailleurs qui est entrelacement de ces différents contextes, comme un enchevêtrement de bretelles d’autoroute.
Skalova 2016 : 26
Face à cette difficulté, voire impossibilité, à la fois de légitimation et d’incarnation des langues, comment les deux corps physiques – et ainsi les deux langues – se rencontrent-ils ? Si Skalova ne s’exprime ainsi pas directement sur ses trois « corps-langues », elle pose en effet la question du rapport entre les langues et les corps en termes de limite, de lieu et de territoire comme le révèlent plus d’un couple de poèmes en deux langues de Atemnot (Souffle court), et comme en témoignent aussi de nombreux passages du recueil de Silences d’exils :
Skalova et Abadie 2020 : 21Les limites de notre langue sont les limites de notre monde, disait Wittgenstein.
Lorsqu’on est entre deux langues, où est-on exactement ?
À l’extrémité d’une rive, peut-on voir le fleuve qui sépare de l’autre, les frontières qui la bordent ?
Arrivé à la limite de sa langue, discerne-t-on où commence la langue suivante ?
Quitte-t-on un monde sans tout à fait parvenir à atteindre l’autre ?
Et c’est bien la recherche d’un lieu, d’un territoire de la langue – les métaphores spatiales qu’elle utilise pour parler de l’écriture et de la traduction sont en effet très nombreuses –, qui semble dominer : « Pour ma part, j’ai souvent eu l’impression de ne pas vraiment avoir de langue, et plutôt de chercher à créer un territoire en écrivant » (Huynh 2017), ou encore « [J]e me pose la question de la langue dans laquelle j’écris, et je ne trouve des réponses que certains jours. Trouver une langue, est-ce déjà trouver un lieu ? […] En écrivant, j’essaie de m’inventer un territoire » (Skalova et Abadie 2020 : 27). Ce territoire, elle le cherche à travers ses langues, il se construit par le tissu sonore et musical que chacune des différentes langues compose : « [la langue est] un tissage de sons et de signes, qui imprègne la pratique. Ce que j’écris est étroitement lié à la langue dans laquelle j’écris, à ses sonorités, à sa musique. On ne coud pas de la même façon selon si l’on a un plaid ou un duvet synthétique entre les mains, par exemple. Je pense vraiment que la langue est le matériau que l’écriture triture, malaxe, modèle » (Huynh 2017). On notera qu’une lecture possible d’un poème de la section « Territorien » est celle d’un territoire de la désincarnation :
La porosité entre le paysage (feuilles, rameaux), l’automne et le corps (poignet, veines) est manifeste, et le territoire, sans l’empreinte du sang, est désincarné. Le corps se désincarne et se fond dans les éléments végétaux, il devient feuille, rameaux, automne, et le territoire de l’écriture est situé dans l’entre-deux, hors du corps. Dans une lecture où « aucun sang ne coule » signifierait plutôt l’absence de douleur, ce territoire serait un lieu de paix. La légitimité ne serait donc effective que dans cet espace (ou territoire) de l’entre-deux, entre les corps, qui nous ramène bien à la différence, mais éprouvée en quelque sorte « sur le seuil ».
Nous aimerions revenir à la question du « corps de la langue » sur le plan métaphorique décrit plus haut, bien perceptible dans les poèmes, plus précisément grâce à la mise en rapport entre eux. Parfois, le rapport entre les deux poèmes est plus nettement caractérisé par la différenciation : dans les poèmes de la page 17 cités plus haut par exemple), c’est comme si le corps de la langue du poème en allemand faisait violence à celui du poème en français. Ces poèmes de la section « Territorien » présentent également des différences assez marquées :
Le poème en français présente des blancs entre les vers, ce qui lui donne une structure aérée et légère, légèreté qui est renforcée par les sonorités (allitérations en « f », « s », et « l »). Le poème en allemand propose deux blocs de deux et trois vers, la structure est donc plus compacte, et les allitérations en « b » et en « r » plus rugueuses. Par ailleurs, le poème est plus ancré, par la présence d’un pronom sujet, ich, et de deux verbes conjugués, hüllen [enveloppent] et denke [pense], absents de la version française, qui préfère l’équivalence par les deux points. Les différences sont frappantes, les deux corps de la langue sont face à face, s’entrechoquent. Dans les poèmes de la page 16 (de la section « Figures du corps »), les deux « corps de la langue » s’inscrivent à nouveau dans la réciprocité du seuil. Les deux derniers vers des deux poèmes sont en miroir, puisqu’un mot en allemand du poème en allemand est présent dans le poème en français, deux mots en français du poème en français sont présents dans le poème en allemand, laissés respectivement en romain ou en italique :
La structure en miroir et le jeu entre l’italique et le romain, la présence de mots non traduits qui montrent l’expérience de la défloration par un corps « étranger » mettent au jour un parallèle : ici, les corps des deux langues sont dans un même rapport de pénétration et de violence que les corps dont il est question dans les poèmes.
7. La question de la migration : les poèmes en deux langues entre proximité et distance à l’autre
Le dernier point que nous souhaitons aborder, toujours en lien avec la notion de « seuil », a trait au parcours de Skalova qui, nous l’avons vu, s’inscrit dans un contexte de migration. C’est une thématique omniprésente dans son oeuvre : elle est au centre de Amarres, Exploration du flux et Silences d’exils, les trois livres publiés après Atemnot (Souffle court). Si c’est dans Atemnot (Souffle court) qu’elle est la moins évidente, cette dimension plus collective, humaine et politique transparaît en filigrane dans le recueil. C’est la section « Territorien » qui évoque la migration de la façon la plus nette. Dans un article publié dans L’Osservatore, l’auteure évoque cette section du livre :
Il s’agit de poèmes brefs qui se déploient en un cycle unique, comme s’il y avait une sorte de narration souterraine. Les questions qui en émergent sont liées aux limites entre intérieur et extérieur, à la violence et à la façon dont celle-ci pénètre nos corps, les transforme et les réfléchit vers l’extérieur. Ils ont pour lieu un bois et évoquent les expériences de migration et les situations de conflit ; ils convoquent des images qui travaillent l’intériorité de notre corps, la façon dont la violence du réel s’inscrit dans nos corps. Ces dernières années, j’ai beaucoup travaillé sur les questions de l’exil, des expériences migratoires, de la perte de sa propre langue et l’inscription de ces expériences du corps. Certaines images sont très concrètes : un homme n’ayant plus qu’une chaussure, une veste, qui, sans les corps, errent dans les bois. Quelque chose manque toujours.
Fioretti 2018 : 65, propos adaptés par M. Skalova, notre traduction[15]
La violence inhérente à la migration qui transparaît dans « Territorien », mais aussi dans d’autres parties du recueil, se retrouve dans le rapport entre les poèmes. Comme pour la question du rapport à son propre corps et au corps de l’autre, des territoires du corps, et celle du rapport à la langue, qui parcourent tout le livre, la question de l’exil déploie des tensions entre la différence, la limite, et la porosité, le lien, qui se jouent entre les poèmes. Ces poèmes de la section « Nuit(s) / Nacht(s) » en témoignent[16] :
Ce double poème évoque une nuit de départ dans un pays, potentiellement d’accueil, inconnu. En très peu de mots, de nombreuses thématiques propres à la migration sont présentes : la peur (du moins dans le poème en français), ce que l’on emporte avec soi, le changement de langue et la difficulté à s’exprimer (parler dans l’autre langue et parler de l’expérience vécue), la difficulté, voire l’impossibilité, d’accéder à un pays d’accueil. Dans le poème en français, la présence d’un sujet, même impersonnel, est esquissée à travers le pronom on, alors qu’en allemand, la tournure passive efface complètement le sujet. Le poème en français dit une nuit, tandis que dans le poème en allemand, c’est la nuit (es ist nacht, en opposition au jour). Le participe présent du poème français (en attendant) fait face à un infinitif en allemand (darauf warten) [attendre]. La tonalité du poème en français est cette fois plus sombre que celle du poème en allemand, d’où l’effroi est absent. Les sonorités du début du poème en français sont inquiétantes (« ui » ; « oi » ; « ou »), tandis que celles de l’ensemble du poème en allemand sont plutôt douces (« i » ; « a » ; puis « w » ; « ü » ; « en »). À la relative douceur du poème en allemand se heurte l’effroi du poème en français. Cette distance entre les deux poèmes met en évidence la confrontation entre deux univers qui a lieu dans tout processus migratoire. Elle peut signifier à la fois la distance intérieure que la migration provoque, distance de soi au monde, distance dans la langue et face à l’autre langue, et la distance extérieure, entre celui qui vit l’exil et celui qui est face à lui (pays d’accueil, assistance, ateliers d’écriture, etc.). Dans le processus migratoire, la notion de seuil peut être transposée dans la relation qui s’instaure entre la personne qui vit l’exil et celle qui lui fait face dans le pays d’accueil, ou le pays d’accueil lui-même. Revenant à la distance extérieure, il paraît pertinent de souligner qu’elle est au coeur d’un livre d’une écrivaine que Skalova connaît bien ; il s’agit de l’auteure du roman Schlafgänger [loueurs de lit] paru en 2014, Dorothée Elmiger[17]. L’évocation d’un extrait de Schlafgänger permettra de prolonger la réflexion sur le rapport à l’autre dans le contexte d’entraide aux migrants (Skalova 2016 : 13-15) en relation avec la notion de seuil. Dans cet ouvrage, qui entremêle les voix de différents personnages questionnant diverses dimensions du monde contemporain, un journaliste décrit une pratique connue chez les migrants, celle de se poncer le bout des doigts pour faire disparaître les empreintes digitales et leur permettre d’être identifiés et enregistrés deux ou trois semaines plus tard. On notera qu’une allusion probable à cette scène du livre se trouve dans Atemnot (Souffle court) même, dans les poèmes de la page 39 : « les doigts s’épluchent/on y laisse donc sa peau » / « die finger häuten sich/das leben bleibt so/hier hängen » [les doigts s’éraflent/la vie reste ainsi suspendue ici] et dans Exploration du flux : « Certains s’arrachent la pulpe des doigts pour cacher que la forteresse s’y est imprégnée » (2016 : 47). Dans le passage de Schlafgänger [loueurs de lit] qui nous intéresse, le journaliste réfléchit à cette pratique des migrants d’une violence inouïe (après un voyage très souvent ponctué de maltraitances et/ou de tortures, les migrants sont non seulement déshumanisés, mais ils doivent en plus s’infliger des blessures physiques pour tenter d’échapper à une procédure de contrôle) et envisage de se râper un doigt contre le mur pour s’approcher de ce qu’ils ressentent[18] ; cependant, il ne le fait pas. Cette attitude décrit de façon intense cette distance infranchissable et la complexité du rapport d’entraide. L’aide aux migrants, comme toute forme de secours, exige une distance face à ceux à qui l’on prête main-forte, pour que celui qui aide garde sa force et sa capacité d’aide ; mais cette distance nécessaire comprend une certaine violence : dans le contexte des migrants, d’une part celle d’assister à tout ce qui se passe en étant du côté de ceux qui ne sont pas touchés, d’autre part celle, pour ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité, de pouvoir si difficilement être rejoints. Il y a une violence extraordinaire dans ce que nous aimerions appeler cette « condition d’altérité ». Du point de vue de celui ou celle qui accueille, vouloir se mettre à la place de l’autre met en réalité face à une incapacité à être l’autre et à le libérer de son état, et provoque la nécessité d’une prise de distance pour se protéger. Ce passage de Silences d’exils, où Skalova parle de la période qui a suivi les ateliers d’écriture qu’elle a menés avec les migrants, exprime très bien cela :
Au cours des six derniers mois, j’ai senti le besoin de me protéger, d’établir une distance. Souvent, je n’arrive plus à répondre aux messages d’Omar ou Ali sur Facebook. Un abîme se creuse entre leurs vies et ma capacité à les porter. Je ne sais plus que faire de ma responsabilité. Face à ces nouveaux visages, je m’interroge sur la bonne distance. Celle qui me permettrait de garder mon humanité face à eux. Sans me laisser dévaster.
Skalova et Abadie 2020 : 120
Cette tension entre proximité et distance, qui peut mettre en danger lorsque le déséquilibre est trop grand, c’est aussi celle du seuil, où deux existences sont l’une face à l’autre. Comme le rappelle Nouss dans l’article déjà cité : « Le risque est là et le seuil est justement le lieu du risque : entrer ou non, danger ou non, hostis comme ami ou comme ennemi » (2014). Waldenfels, à la suite de Levinas, nomme ce constat de ne pouvoir se tenir toujours que d’un seul côté du seuil « irréprociprocité » (2009 : 165). L’espace qui se crée entre soi et l’autre peut cependant parfois devenir un lieu d’échange et de compréhension réciproque s’élaborant à partir de cette irréciprocité, chacun restant sur son propre territoire, pour reprendre un terme cher à Skalova : « Demeurant sur un seuil, sans pénétrer dans l’espace, je décris ce que je perçois, à distance quoique le recevant dans mon intériorité » ; « Car dans une rencontre véritable, chacun reste sur le seuil de l’autre, en en respectant l’existence et le parcours » (Nouss 2014).
8. Conclusion
Les poèmes de Atemnot (Souffle court) demeurent ainsi le seuil l’un de l’autre, l’un appelant l’autre et se tenant à distance de lui à partir de ses différences. Les analyses ont révélé que la circulation d’un poème à l’autre peut inviter à lire une transformation (exemple 1) ; qu’elle peut suggérer un double mouvement qui bloque et ouvre à la circulation du souffle (exemple 2) ; mettre au jour l’amenuisement du souffle et de la langue (exemple 3), ou la limite et la porosité entre les langues pour l’auteure plurilingue (exemple 4) ; qu’elle peut décrire un territoire de la désincarnation (exemple 5), ou encore l’entrechoquement des corps de la langue (exemple 6) et des corps dans la langue (exemple 7). Les poèmes parlent de et à partir de cet espace du seuil comme limite et lien entre l’autre et soi, entre la vie d’autrui et la vie propre. Ils évoquent la porosité ou non de cette frontière, du franchissement possible ou non de cette distance et de la nécessité de cette distance pour ne pas être dévasté. Si la tonalité de l’oeuvre de Skalova est obscure (un univers où règne l’incompréhension, l’absence, la violence ou la dégradation), si les mots eux-mêmes appartiennent très souvent à un registre dysphorique (dans ce qui s’esquisse de la relation à l’autre, dans le rapport au corps, dans la relation au langage), quelque chose s’ouvre dans ce qui se passe entre les poèmes, dans ce lieu de passage réciproque de l’un à l’autre. La teneur sombre du recueil devient ainsi respirable par ce qui a lieu dans les interstices, sur ce seuil qui permet la circulation du souffle. La métaphore du « territoire du seuil » révèle en effet un mouvement dynamique et positif : ce qui a lieu entre les poèmes montre qu’il y a porosité entre soi-même et l’autre, entre les langues, entre la vie d’un migrant et notre propre vie, comme l’a montré l’analyse du dernier poème (exemple 8). Ce qui se ferme ou est fermé dans un poème s’ouvre dans l’autre, par la différence, par ce qu’il dit et fait autrement ; ce qu’une langue ne peut faire ou ne peut dire ouvre à autre chose que l’autre langue déploie.
Se placer dans ce lieu de l’expérience de la distance et de la limite est une exigence à laquelle se heurte également le lecteur. Comme expérience de lecture, cette disposition à l’égard des textes exige d’accepter de se tenir dans une position particulière : dans l’un ET dans l’autre des deux poèmes, sans choisir l’un OU l’autre des deux poèmes. Lire Atemnot (Souffle court), c’est ainsi accepter également de se placer sur le seuil réciproque des poèmes. Cet espace entre les poèmes qui s’offre au lecteur est-il celui de l’indicible ? Pour Marina Skalova, l’écriture serait plutôt le signe d’une nécessaire « percée du silence » ou de la « Sprachlosigkeit », de la perte ou de l’impossibilité de la parole, l’incapacité de dire (Huynh 2017). Dans Silences d’exils, elle écrit : « Il n’y a pas d’indicible. Si une chose existe, elle se formule. / Mais qu’en est-il des blocs de roche, morceaux de caillasse, qui restent bloqués entre deux langues ? / Ce qui se sédimente dans l’incapacité de dire ? » (Skalova et Abadie 2020 : 31). Ce qui « se sédimente dans l’incapacité de dire », voilà peut-être ce qui résonne dans ce « territoire du seuil ».
Appendices
Annexe
De Marina Skalova
Skalova, Marina (2016) : Atemnot (Souffle court). Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne.
Skalova, Marina (2017) : Amarres. Lausanne : L’Age d’Homme.
Skalova, Marina (2018) : Exploration du flux. Paris : Seuil.
Skalova, Marina (2019) : Der Sturz der Kometen und der Kosmonauten [la chute des comètes et des cosmonautes], traduit du français par Frank Weigand. Francfort : Fischer Verlag.
Skalova, Marina (2019) : La Chute des comètes et des cosmonautes. Paris : L’Arche.
Skalova, Marina (2020) : La langue, les chaînes de vélo. La Cinquième saison. Revue littéraire romande, vol. (10), Le festin de Babel, 23-28.
Skalova, Marina et Abadie, Nadège (2020) : Silences d’exils. Lausanne : Éditions d’en bas.
Remerciements
L’auteure de la présente étude remercie chaleureusement Lucie Spezzatti, Marina Skalova et Arno Renken pour leur relecture ou leurs conseils.
Notes
-
[1]
Les références des textes du corpus sont données en annexe de la bibliographie.
-
[2]
Marina Skalova traduira cette pièce en allemand avec Frank Weigand (parution en 2019 sous le titre : Der Sturz der Kometen und der Kosmonauten la chute des comètes et des cosmonautes. Berlin : Fischer Verlag).
-
[3]
L’auteure a généreusement mis à notre disposition une partie de ses archives privées.
-
[4]
Voir à ce sujet notamment les articles de Lagarde, Grutman et Dasilva dans Ferraro et Grutman 2016.
-
[5]
Entretien non publié, réalisé le 17 avril 2019 à Genève. Marina Skalova nous a autorisée à retranscrire ses propos et nous l’en remercions.
-
[6]
Voir à ce propos la critique de De Montety (2017).
-
[7]
En français, il s’agit d’un substantif, tandis qu’en allemand, il s’agit d’un adverbe.
-
[8]
« La traduction met en lumière les hésitations, les incertitudes, montre à quel point les assises de chaque langue sont vacillantes. Aucune langue ne suffit vraiment pour dire ce qu’il y aurait à dire. D’autant plus quand elles sont deux ; quelque chose se dérobe, fait défaut » (Skalova 2016 : 7-8).
-
[9]
Dans un commentaire de notre propre traduction d’un poème de Vega Tescari, nous reprenons de façon très sommaire la notion de « seuil » en traduction. Voir Vischer 2022.
-
[10]
L’étude des poèmes se fera dans le rapport qui s’instaure par leur configuration dans le recueil, telle qu’elle sera reproduite à chaque début d’analyse. Il ne sera pas tenu compte de la genèse des poèmes et des éventuels allers-retours entre les deux langues qu’il a pu y avoir. Pour chaque poème ne seront pris en compte que les éléments jugés pertinents pour la présente étude, et qui ne seront pas nécessairement les mêmes pour chaque analyse.
-
[11]
Dans Silences d’exils (2020 : 83), Skalova commente ces deux mots : « En allemand, [o]n distingue die Stille, le silence, et das Schweigen, l’état de ce qui se tait. »
-
[12]
Voir la critique du blog main tenant (2017). Marina Skalova à la Rencontre poétique chez Tiasci-Paalam en novembre 2017. Consulté le 20 mars 2020, <http://ecrireiciaussi.canalblog.com/archives/2017/11/20/35882179.html>.
-
[13]
Voir plus haut le poème no 16. Le poème de la page 15 présente également une confrontation à la fois des corps et des deux poèmes par leurs différences sonores.
-
[14]
Au sujet de Jurgenson, voir aussi Holter 2016.
-
[15]
« Sono singole poesie brevi che confluiscono in un unico ciclo come se fosse una sorta di narrazione sotterranea. Quelle che emergono sono delle domande sui nostri confini interiori e esteriori, sulla violenza, su come essa penetri i nostri corpi trasformandoli e riflettendoli verso l’esterno. Sono ambientati in un bosco ed evocano le esperienze di migrazione, situazioni di conflitto e lavorano molto con immagini delle parti interiori del nostro corpo, piccoli universi interiori che riflettono il mondo esterno. Negli ultimi anni mi sono confrontata molto con le questioni dell’esilio, delle esperienze migratorie, la perdita della propria lingua e lo studio del corpo. Alcune mie immagini sono molto concrete, ci sono uomini senza una scarpa, una giacca, senza un pezzo del loro corpo che vagano nelle atmosfere del bosco. Qualcosa manca sempre. »
-
[16]
Les poèmes de la page 59, qui ferment le recueil, seraient également intéressants à analyser (ils évoquent l’unique chaussure qui reste après, peut-on imaginer, la traversée qui mène au pays d’accueil).
-
[17]
Marina Skalova a cotraduit, avec Camille Luscher, l’ouvrage d’Elmiger Aus der Zuckerfabrik (paru en 2023 sous le titre Sucre, journal d’une recherche. Genève : Éditions Zoé).
-
[18]
« Il s’était arrêté un instant dans le couloir de son appartement pour observer le crépi rugueux, l’avait touché des doigts, ce faisant, il avait craint d’effectuer une tentative, ne serait-ce qu’avec un seul doigt » (Elmiger 2016 : 14).
Bibliographie
- Anokhina, Olga et Rastier, François, dir. (2015) : Écrire en langues : littératures et plurilinguisme. Paris : Éditions des archives contemporaines.
- Anokhina, Olga et Sciarrino, Emilio, dir. (2018) : Genesis. 46.
- Benjamin, Walter (1982/1989) : Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages. Traduit de l’allemand par Jean Lacoste. Paris : Éditions du Cerf.
- Bissig, Florian (2018) : Mehrsprachige Inhalation. Zu einem Gedicht von Marina Skalova [Inhalation multilingue. À propos d’un poème de Marina Skalova].
- Ceccherelli, Andrea, Imposti, Gabriella Elina et Perotto, Monica, dir. (2013) : Autotraduzione e riscrittura. Bologne : Bologna University Press.
- Collin, David (2017) : Marina Skalova : Atemnot. Entretien. Play RTS Versus-Lire. Consulté le 18 mars 2020, https://www.rts.ch/play/radio/versus-lire/audio/marina-skalova-atemnot?id=8283357.
- Cordingley, Anthony, dir. (2013) : Self-Translation : Brokering originality in hybrid culture. London : Bloomsbury.
- De Montety, Félix (2017) : Marina Skalova, Atemnot (Souffle court). Recours au poème. Consulté le 18 mars 2020, https://www.recoursaupoeme.fr/marina-skalova-atemnot-souffle-court/.
- De Toledo, Camille (2014) : L’entre-des-langues. remue.net. Consulté le 27 novembre 2020, http://remue.net/spip.php?article692.
- Derrida, Jacques (1986) : Shibboleth, pour Paul Celan. Paris : Éditions Galilée.
- Elmiger, Dorothée (2014) : Schlafgänger. Hanover : Dumont.
- Elmiger, Dorothée (2016) : La Société des abeilles. Traduit de l’allemand par de Lila Van Huyen. Lausanne : Éditions d’en bas
- Ferraro Alessandra et Grutman, Rainier, dir. (2016) : L’Autotraduction littéraire. Perspectives théoriques. Paris : Classiques Garnier.
- Fioretti, Natascha (2018) : La poesia ha un’altra scansione del tempo. L’Osservatore. 9(8):65.
- Gentes, Eva (2020) : Bibliography Autotraduzione / autotraduccion / self-translation. En ligne : https://app.box.com/s/57vgm538l7turmaa2vl9gn63190wv6mf, consulté le 6 juillet 2021.
- Grutman, Rainier (2000) : Écriture bilingue et loyauté linguistique. Francophonies d’Amérique. 10:137-147.
- Heidmann, Ute (2005) : Comparatisme et analyse de discours : la comparaison différentielle comme méthode. Études de Lettres. 1-2:99-118.
- Holter, Julia (2016) : Les deux corps du traducteur littéraire. Carnets : revue électronique d’études françaises. 7(II):165-172.
- Huynh, Sabine (2017) : Marina Skalova. Mini-entretien avec Sabine Huynh. Terre à ciel. Consulté le 18 mars 2020, https://www.terreaciel.net/Marina-Skalova.
- Jurgenson, Luba (2014) : Au lieu du péril. Paris : Verdier.
- Levy, Linn (2018) : Marina Skalova : « Les réseaux sociaux sont le spectacle de notre paralysie. » Entretien. In RTS Livres. Consulté le 18 mars 2020, : Marina Skalova à la Rencontre poétique chez Tiasci-Paalam en novembre 2017, https://www.rts.ch/info/culture/livres/9747757-marina-skalova-les-reseaux-sociaux-sont-le-spectacle-de-notre-paralysie-.html.
- Lyrikkritik. Consulté le 18 mars 2020, https://www.lyrikkritik.de/pechakucha/florian-bissig-i/.
- Merkle, Denise, dir. (2009) : Littérature comparée et traductologie littéraire : convergences et divergences. Numéro thématique de TTR : Traduction, terminologie, rédaction. 22(2).
- Nouss, Alexis (2014) : La traduction : Au seuil. In : Ève de Dampierre-Noiray, Anne-Laure Metzger-Rambach, Vérane Partensky et al., dir. Traduction et partages : que pensons-nous devoir transmettre ? Bibliothèque comparatiste : SFLGC, en ligne. Consulté le 16 juillet 2024 : https://sflgc.org/acte/alexis-nouss-la-traduction-au-seuil/
- Oustinoff, Michaël (2002) : Bilinguisme d’écriture et auto-traduction : Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov. Paris : L’Harmattan.
- Renken, Arno (2012) : Babel heureuse. Pour lire la traduction. Paris : Van Dieren.
- Samoyault, Tiphaine (2015) : La mémoire est dans les seuils. Europe. 1038: 80-87.
- Samoyault, Tiphaine (2020) : Traduction et violence. Paris : Seuil.
- Santschi, Madeleine (1985) : La traduction, corps physique : à partir d’une expérience de traduction de Pasolini. Colloquium Helveticum, Cahiers suisses de littérature générale et comparée. 3:55-67.
- Sperti, Valeria (2017) : L’autotraduction littéraire : enjeux et problématiques. Revue italienne d’études françaises. 7. Consulté le 20 avril 2020, https://journals.openedition.org/rief/1573.
- Tanqueiro, Helena (2009) : L’autotraduction en tant que traduction. Quaderns : Revista de traducció. 16:108-112.
- Vischer, Mathilde (2014) : La traduction comme déstabilisation ? Autotraduction et écriture bilingue dans l’oeuvre de Pierre Lepori. Parallèles. 26:115-128.
- Vischer, Mathilde (2017) : La traduction de la poésie aujourd’hui, quelles perspectives théoriques ? Quelques repères. Atelier de traduction. 28:94-114.
- Vischer, Mathilde (2022) : Mathilde Vischer traduit Vega Tescari, « Habiter ». Poésie romande, L’un par l’autre. Consulté le 5 juillet 2022, https://poesieromande.lyricalvalley.org/2022/06/06/mathilde-vischer-traduit-vega-tescariabitareabitare-habiter/.
- Waldenfels, Bernhard (1999) : Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie des Fremden 3. [Seuils du sens. Phénoménologie de l’étranger : études 3]. Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp.
- Waldenfels, Bernhard (2009) : Topographie de l’étranger. Études pour une phénoménologie de l’étranger 1. Traduit de l’allemand par Francesco Gregorio, Frédéric Moinat, Arno Renken et Michel Vanni. Paris : Van Dieren.