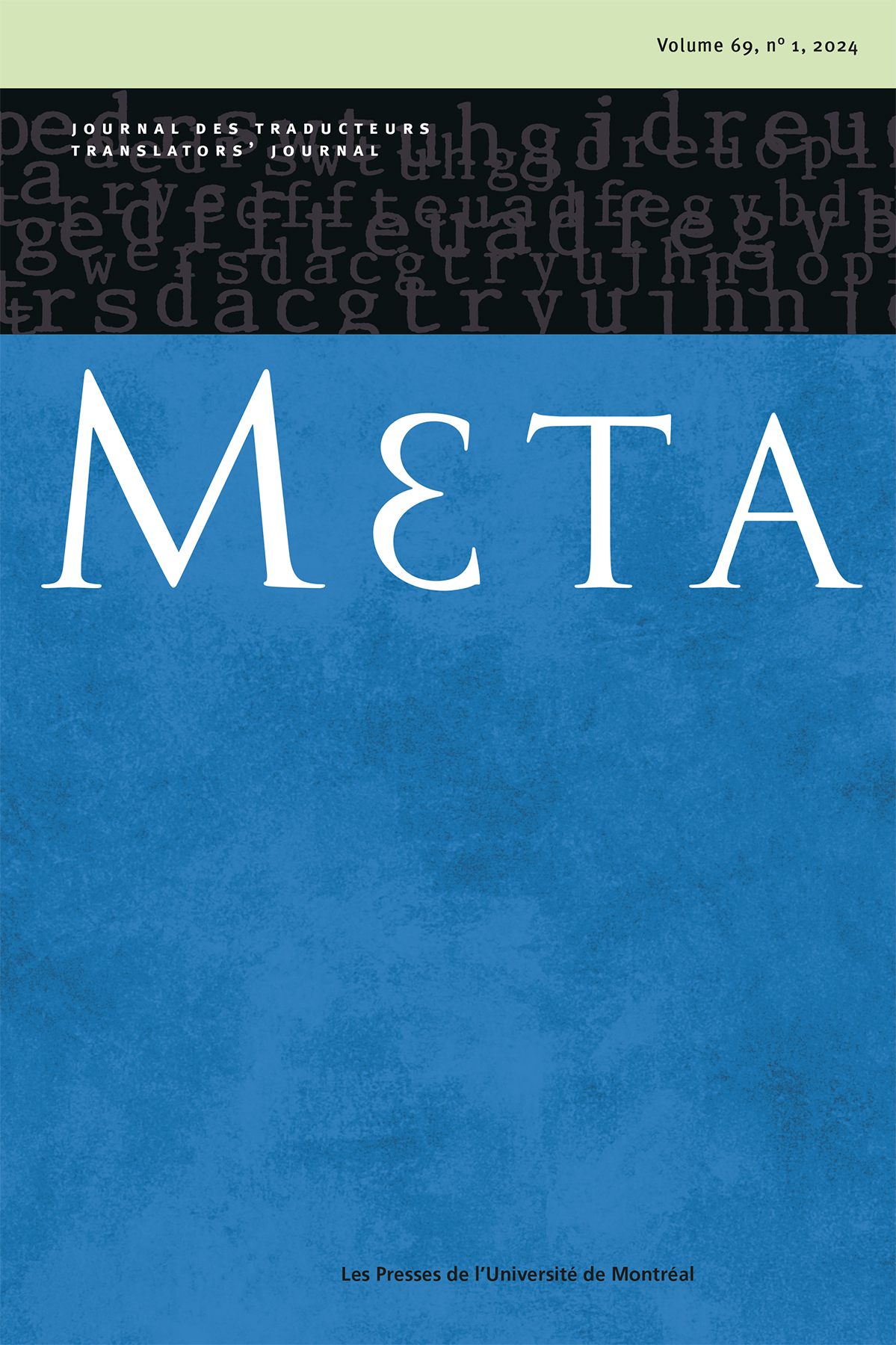Abstracts
Résumé
Le transfert des faits dialectaux dans une langue-culture étrangère s’avère difficile, notamment si les deux langues-cultures en question ne partagent pas le même socle culturel. L’objectif de cette étude est d’analyser les problèmes du transfert d’un texte arabe dialectal en langue française. À partir d’un roman écrit en arabe, oscillant entre l’arabe standard moderne et l’arabe égyptien, nous allons tenter d’étudier la traduction vers la langue française de quelques faits dialectaux composant le sociolecte des chauffeurs de taxi égyptiens. Pour ce faire, nous le classifierons en trois catégories : proverbes dialectaux, expressions figées dialectales et expressions dialectales inspirées de la religion. Nous voulons examiner les stratégies traductives dont se servent les traducteurs pour en transférer les composants en langue française. Les exemples d’analyse portent sur Taxi, roman arabe écrit par Khaled Al Khamissi, et sa traduction en français, ayant le même titre, faite par Hussein Emara et Moîna Fauchier Delavigne.
Mots-clés :
- dialecte,
- arabe égyptien,
- sociolecte,
- équivalent sociolinguistique,
- standardisation
Abstract
The dialect of any linguistic community is rooted in its own culture. Consequently, the transfer of this dialect to another language-culture is very difficult, especially if the two language-cultures in question do not share the same cultural base. The objective of this study is to unravel the problems of transferring a dialectal Arabic text into French. From a novel written in mixed Arabic between modern Standard Arabic and Egyptian Arabic, we will try to analyze the translation into French of some dialect features of the sociolect of Egyptian taxi drivers. To examine the translation of this sociolect, we classify it into three categories: dialect proverbs, fixed dialect expressions and dialect expressions of religious inspiration. Our aim is to take a close look at the translation strategies that translators use to transfer the components of this sociolect into the French language. The analysis examples relate to Taxi, a novel by Khaled Al Khamissi, and its French translation by Hussein Emara and Moîna Fauchier Delavigne.
Keywords:
- dialect,
- Egyptian Arabic,
- sociolect,
- sociolinguistic equivalent,
- standardization
Resumen
El dialecto de una comunidad lingüística determinada tiene sus raíces en su propia cultura. Por eso el proceso de su traducción a otra lengua-cultura es una tarea ardua, especialmente si las dos lenguas-culturas no pertenecen a la misma base cultural. El objetivo de este estudio es desentrañar los problemas de la traducción de un texto árabe de carácter dialectal a la lengua francesa. A partir de una novela escrita en árabe estándar moderno mezclado con el árabe egipcio, intentaremos analizar la traducción al francés de algunos rasgos dialectales del sociolecto de los taxistas egipcios. Para ello, clasificamos dicho sociolecto en tres categorías: proverbios dialectales, expresiones dialectales fijas y expresiones dialectales de inspiración religiosa. Nuestro objetivo es examinar las estrategias de traducción que utilizan los traductores para transferir los componentes de este sociolecto a la lengua francesa. Los ejemplos analizados están sacados de la novela egipcia Taxi de Khaled Al Khamissi y su traducción al francés realizada por Hussein Emara y Moîna Fauchier Delavigne.
Palabras clave:
- dialecto,
- árabe egipcio,
- sociolecto,
- equivalente sociolingüístico,
- estandarización
Article body
La traduction se situe justement dans cette région obscure et dangereuse où l’étrangeté démesurée de l’oeuvre étrangère et de sa langue risque de s’abattre de toute sa force sur le texte du traducteur et sa langue, ruinant ainsi son entreprise et ne laissant au lecteur qu’une Fremdheit inauthentique. Mais si ce danger n’est pas couru, on risque de tomber immédiatement dans un autre danger : celui de tuer la dimension de l’étranger.
Berman 1984 : 247-248
1. Introduction
En tant que langue diglossique, l’arabe dispose de deux variétés linguistiques : la première est l’arabe littéraire, qui renferme à la fois l’arabe classique et l’arabe standard moderne, considérée comme la variété haute, et la deuxième, l’arabe dialectal qui diffère d’un pays à l’autre, considérée comme la variété basse. Cette dernière est utilisée par les locuteurs arabophones dans la vie de tous les jours. Chaque dialecte reflète les conditions sociopolitiques et historiques qui lui sont propres. À titre d’exemple, l’arabe égyptien comprend un lexique divers découlant des différentes étapes de l’histoire de l’Égypte. Il en va de même pour tous les autres pays arabes. Par conséquent, l’arabe littéraire est le domaine de prédilection des écrivains arabes, des journalistes et de toute l’intelligentsia arabe, alors que l’arabe dialectal est exclusivement parlé dans la vie quotidienne[1]. Dans chaque communauté arabe, le dialecte est acquis dès l’enfance et constitue une langue maternelle pour ses locuteurs.
Dès l’apparition de la littérature arabe, l’arabe littéraire a toujours été le choix ultime dans l’écriture littéraire. Cependant, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, pour des raisons sociopolitiques, l’arabe dialectal commence à pénétrer dans la production littéraire arabe, y occupant une place considérable et reconnue. De plus, Doss (1996 : 5), après avoir tracé le début de l’écriture dialectale en Égypte, déclare que c’est au XIXe siècle qu’apparaît le premier texte connu donnant une place importante au dialecte.
Par ailleurs, la traduction de l’arabe dialectal va s’annoncer beaucoup plus difficile que celle de l’arabe littéraire, car elle exige, en plus des connaissances linguistiques et extralinguistiques des deux langues source et cible, une connaissance approfondie de la culture locale que contient le dialecte à traduire. De plus, ce qui rend la situation encore plus compliquée, c’est que la langue arabe se décline en plusieurs dialectes à cause de la diversité ethnique et culturelle des populations des 22 pays arabes. En outre, comme c’est le cas dans toutes les communautés linguistiques, le comportement linguistique des sujets parlant arabe n’est pas identique, mais plutôt variable en fonction de l’espace, du temps et de la couche sociale.
Dans cette étude, nous profitons, d’une part, des apports de la sociolinguistique variationniste et, d’autre part, des données théoriques de la théorie interprétative de la traduction. Nous utilisons également comme appui théorique les stratégies proposées pour traduire les faits dialectaux de Lievois, Noureddine et al. (2018). Le point de départ de notre étude est un roman écrit en arabe mixte, intitulé Taxi[2], et sa traduction en langue française[3]. Bien entendu, l’analyse de la traduction de tous les faits dialectaux cités dans notre corpus dépasse les limites de la présente étude. C’est la raison pour laquelle nous limiterons notre analyse à la traduction d’un fait dialectal clé du roman en question, à savoir le sociolecte des chauffeurs de taxi égyptiens. Ce qui est mis en jeu dans cette étude, selon la terminologie de la théorie interprétative, c’est le problème de la compréhension, de la déverbalisation, de la réexpression de ce sociolecte en français et de la façon dont la traduction reflète la situation sociolinguistique. D’après le roman en question, nous pouvons classifier les sociolectes des chauffeurs de taxi en trois catégories : des proverbes dialectaux, des expressions figées dialectales et des expressions dialectales inspirées de la religion. Nous analysons des exemples représentatifs de chaque catégorie. Nous cherchons à toucher de près les problèmes qu’affronte un traducteur lors du transfert de quelques éléments dialectaux composant le sociolecte des chauffeurs égyptiens dans un texte littéraire écrit en arabe mixte vers la langue-culture française. Quelles stratégies traductives entrent donc en jeu afin de transférer ce sociolecte en langue française ? Quelle est la stratégie la plus efficace pour le rendre en français ? Le transfert de l’arabe dialectal est-il vraiment plus difficile que celui de l’arabe standard ?
Dans ce qui suit, nous présentons d’abord la littérature arabe dialectale, puis les spécificités énonciatives du roman étudié. Ensuite, nous analysons les stratégies mises en oeuvre pour transférer chaque catégorie de sociolecte. Enfin, nous résumons les résultats et proposons des pistes pouvant éclaircir la problématique de la recherche et aider, par la suite, à traduire efficacement le sociolecte des chauffeurs de taxi égyptiens.
2. Littérature arabe dialectale
Force est de constater que l’histoire de la littérature arabe remonte à une époque très ancienne. La preuve en est la littérature dite préislamique, datant de la période précédant la révélation du Coran (475-622 apr. J.-C.), qui est essentiellement une tradition orale. Au cours de cette longue histoire, l’arabe littéraire, le classique puis le standard, fut le code incontesté dans la production littéraire arabe, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. L’arabe dialectal commence progressivement à s’imposer à la littérature arabe. Le recours au dialecte, ou les inserts diglossiques selon la terminologie de Schnyder (2013 : 175), dans la littérature arabe reconnue, se fait jour dans les années 1950 dans le cadre de la marche vers l’indépendance qui suit la Seconde Guerre mondiale. Cette littérature, dite « nationale », jouit des intrigues et des sujets reflétant les préoccupations locales et contemporaines des peuples arabes (Holes 2004 : 374). L’emploi du dialectal au sein de l’oeuvre littéraire sert à créer un certain univers sociolinguistique en exprimant des relations régionales et sociales plus familières et affectives ; le dialecte est employé pour démarquer géographiquement et socialement les personnages. Il est « le langage de l’affect, de l’implicite, il établit une connexion plus forte entre le locuteur et le récepteur, et une plus grande implication de ce dernier » (Bruneaud-Wheal 2011 : 51).
Par ailleurs, l’emploi du dialecte dans la littérature égyptienne s’est heurté de prime abord à une désapprobation importante de la part des critiques (Lagrange 2016 : 34), bien que le dialecte, notamment le cairote, ait été fort présent dans la littérature du début du xxie siècle. Actuellement, plusieurs écrivains arabes, notamment égyptiens, accordent délibérément une place majeure au dialecte dans leur production littéraire.
Les variétés dialectales arabes relèvent principalement de la communication orale et sont définies par des déviances lexicales, grammaticales et syntaxiques importantes par rapport à la norme. Néanmoins, ayant une structure différente de celle de la langue soutenue, le dialecte est plus apte à exprimer la réalité sociolinguistique d’une communauté donnée. Il est clair que l’arabe standard reste toujours la norme dans la production littéraire et que le dialecte arabe est identifié comme déviant de cette norme. Cependant, le recours d’un écrivain à la diglossie est lié, comme l’explique Lagrange, à deux phénomènes :
La question de la diglossie et de sa gestion chez un auteur arabe est liée à deux problématiques : celle de la représentation du réel, puisque la variété dialectale est langue de tous, sans lien à une appartenance sociale […], et celle de la représentation de l’oralité.
Lagrange 2016 : 31
De ce fait, certains écrivains optent pour une variété dialectale dans l’intention de vouloir écrire dans une langue plus représentative de la société d’aujourd’hui. En utilisant la langue dialectale, l’écrivain cherche à faire croire aux récepteurs que ses personnages s’expriment comme ils le feraient dans la réalité. Quant à l’oralité, elle peut exister dans le dialogue, qui en est une représentation réelle, et dans lequel on peut trouver des structures syntaxiques simplifiées et un lexique familier et argotique.
De plus, la présence des expressions et des termes dialectaux dans le roman étudié dans cette étude est justifiée par son caractère spécifique, où le dialogue se taille la part du lion.
3. Taxi, deux modes d’énonciation et deux niveaux de langue
Taxi est le chef d’oeuvre de Khaled Al Khamissi, écrivain et scénariste égyptien. Ce roman, traduit en plusieurs langues, est salué pour son originalité dans la littérature égyptienne contemporaine, par son thème et sa structure. Dans ce roman divisé en plusieurs épisodes, le héros est le passager qui rencontre un chauffeur de taxi différent dans chacun d’eux. Nous y rencontrons les deux types énonciatifs : le récit et le discours. D’abord, l’auteur utilise la variété haute, c’est-à-dire l’arabe standard, comme langue de son récit ; il s’en sert pour l’introduction de chaque épisode, la description des chauffeurs et les commentaires sur leur parler. Ensuite, en arabe dialectal, vient le discours qui comprend l’échange entre le narrateur, jouant le rôle du client, et le chauffeur, un nouveau dans chaque épisode. De plus, l’écrivain se permet, de temps en temps, au coeur de la narration, de faire appel à quelques éléments dialectaux, en les mettant entre parenthèses. Les deux variétés de la langue arabe se côtoient de la sorte dans ce texte littéraire.
Taxi nous présente une satire sociale et politique de la société égyptienne. L’auteur y donne la parole à une couche sociale particulière du peuple égyptien qui utilise une variété non standard de l’arabe, des expressions familières, une langue quelquefois teintée de vulgarité. De ce fait, la situation sociale des chauffeurs de taxi égyptiens détermine leur utilisation des termes et des expressions. À travers le langage de ces chauffeurs, l’écrivain critique la vie sociopolitique et économique à la veille de la révolution du 25 janvier 2011 et met en avant la souffrance des pauvres, la corruption et l’injustice sociale. Nous visons alors à étudier ce langage spécifique des chauffeurs égyptiens et les répercussions qu’il peut avoir sur le processus de traduction.
4. Traduire le dialectal dans la littérature arabe
Dans la littérature d’une nation, on peut trouver ses croyances populaires et religieuses, ses usages politiques, etc. Aussi la fonction expressive est-elle dominante dans les textes littéraires, car ils cherchent à susciter un certain effet esthétique sur les lecteurs. C’est la raison pour laquelle la traduction de la littérature s’avère difficile. S’agissant de la traduction d’un texte diglossique, la situation est d’autant plus compliquée que le texte source renferme plus d’une voix, et chacune emploie un niveau de langue bien différent de l’autre, à tel point que, dans le cas de l’arabe dialectal, on dirait que le traducteur est face à un texte écrit non pas dans une langue source, mais bien dans deux langues à la fois.
Si les traductologues voient qu’une langue « n’est pas faite uniquement de mots : chacune renferme une “vision” du monde propre » (Oustinoff 2003/2012 : 14), nous pouvons dire qu’une langue diglossique pourrait concevoir cette même « vision » du monde, mais sous deux angles différents : l’un pour la variété haute, l’autre pour la variété basse. Autrement dit, le découpage effectué sur le réel serait en quelque sorte différent d’une variété à l’autre. Soulignons également que chaque dialecte reflète les conditions sociopolitiques et historiques du pays arabe où il est parlé. En analysant, par exemple, l’arabe égyptien, nous nous apercevons qu’il renferme un lexique divers ayant son origine dans les différentes étapes de l’histoire de l’Égypte, des termes qui renvoient à l’époque abbasside, d’autres à l’époque fatimide. Nous y rencontrons aussi des termes et des expressions d’origine mamelouke, etc. Il en est de même dans tous les autres pays arabes. C’est pourquoi une connaissance approfondie de la culture locale que renferme le dialecte à traduire est indispensable pour transférer un texte dialectal en langue étrangère. D’où la difficulté majeure de transmettre un texte écrit en arabe dialectal vers la langue française.
En outre, la traduction devrait dépasser les barrières linguistiques et culturelles, sans néanmoins annuler complètement leurs retombées. D’ailleurs, si les traductologues trouvent qu’« en traduction littéraire les liens entre le traducteur et l’auteur de l’original sont particulièrement étroits. Il y a toujours affinité, amour, respect » (Woodsworth 1988 : 124), ces liens fort étroits ne doivent cependant pas entraîner une littéralité déformant le message original. Le traducteur devrait faire de son mieux pour transmettre le sens du texte de départ aux récepteurs de la traduction. Selon la théorie interprétative, le sens est le résultat de la compréhension du traducteur, il est « ce que l’interprète transmet, ce qu’il garde en mémoire et qui [est] rémanent après audition du discours » (Israël et Lederer 2005 : 45). Par conséquent, pour bien saisir le sens d’un fait dialectal, le traducteur doit se documenter sur la situation de communication ainsi que sur le contexte général sociohistorique de la réalité extralinguistique évoquée.
5. Traduire le sociolecte des chauffeurs de taxi égyptiens
Il est à remarquer que le sociolecte fait partie des faits de langue non standard. Comme synonyme de « dialecte social », il « désigne en sociolinguistique tout langage propre à un (sous -) groupe social déterminé » (Chapdelaine et Lane-Mercier 1994 : 7). Il s’agit donc d’une variété sociale plutôt que régionale. De leur côté, Jean et Claude Demanuelli définissent le sociolecte comme « un ensemble de traits linguistiques [se rattachant] à une communauté socioéconomico-culturelle » (1995 : 165). Les chauffeurs de taxi égyptiens font partie, comme le dit Al Khamissi, d’une « couche sociale économiquement épuisée » (2006/2018 : 10, notre traduction), obligés de travailler tous les jours pour pouvoir gagner leur vie. Cela se reflète clairement dans leur façon de s’exprimer. D’après le roman étudié dans cet article, le sociolecte des chauffeurs égyptiens renferme généralement des termes et des expressions qui renvoient à la classe sociale, à la situation économique et à la souffrance physique et morale liée à cette profession
[p]hysiquement épuisante, car le fait d’être constamment au volant dans des véhicules délabrés endommage la colonne vertébrale, le fait d’être exposé au hurlement permanent dans les rues du Caire brise le système nerveux et l’embouteillage fait tomber le moral.
Al Khamissi 2006/2018 : 10, notre traduction[4]
En examinant leur sociolecte, nous constatons qu’il résulte d’un mélange de plusieurs facteurs : la profession, la classe sociale, l’éducation, la dimension géographique et le sexe. Il est vrai que « les sociolectes sont définissables à partir de critères proprement sociaux, culturels, économiques et institutionnels » (Chapdelaine et Lane-Mercier 1994 : 7).
La traduction des sociolectes d’une langue-culture vers une autre constitue un vrai défi dans le processus de traduction. En conséquence, le problème de leur transfert reste « […] one of the biggest lacunae in translation studies » (Herrera 2014 : 290). Bien des auteurs ont abordé la question de la traduction française du vernaculaire noir américain ou du Black English (comme Vidal 1994 ; Brodsky 1996 ; Lavoie 1994 ; 2002 ; Lappin-Fortin 2016). D’autres auteurs ont analysé la traduction française du vernaculaire créole trinidadien (Buzelin 2000), etc. Néanmoins, les écrits sur la traduction française des sociolectes arabo-égyptiens sont rarissimes. Par conséquent, la présente étude propose d’aborder la traduction française du sociolecte des chauffeurs de taxi égyptiens en examinant la traduction récente d’un roman égyptien où cette variété linguistique occupe une place majeure.
La traduction du sociolecte des chauffeurs égyptiens en langue française constitue en quelque sorte le transfert d’une idéologie et d’une vision du monde particulières. La traduction représente vraiment un échange culturel, car :
[l]’identité culturelle passe, entre autres, par les échanges linguistiques puisque la langue est l’élément fondamental de la culture. Orientée vers un public qui veut lire et apprendre quelque chose sur la culture et la vision du monde étrangères, la traduction devient l’un des lieux privilégiés des échanges interculturels.
Kristeva 2016 : 21
Par ailleurs, il semble que la difficulté majeure de la traduction du sociolecte réside essentiellement dans les différences de socle socioculturel entre les communautés linguistiques différentes. Pour sa part, Gil-Bardají (2010 : 282) trouve que l’usage d’un déterminé sociolecte ou dialecte représente une des situations problématiques dans l’activité traductive, comme la rime, la métrique, les jeux de mots et les histoires drôles.
Par ailleurs, partant du principe que la traduction est le fait de restituer une identité de sens dans une équivalence de forme, le modèle interprétatif de la théorie du sens confirme que tout est traduisible malgré les structures linguistiques différentes dans chaque langue. Examinons pratiquement la traduction du sociolecte suivant à la lumière de ce modèle interprétatif :
Selon la théorie interprétative de la traduction, le processus de celle-ci consiste à comprendre le discours original, à déverbaliser sa forme linguistique et à réexprimer (reverbaliser) dans une langue cible les significations comprises. Linguistiquement parlant, les trois mots – constituant le sociolecte en question – sont facilement connus du traducteur. Or, sa connaissance linguistique n’est pas suffisante pour le comprendre ; le traducteur devrait exploiter à la fois ses connaissances linguistiques et extralinguistiques, autrement dit associer les signes linguistiques aux « compléments cognitifs », notion avancée par la théorie interprétative pour souligner la nécessité des informations supplémentaires aux désignations linguistiques chez le traducteur dans le processus de traduction (Lederer 1994 : 178-179). Concernant la traduction du sociolecte de cet exemple, ces compléments peuvent être divisés en deux parties. Premièrement, c’est la situation de communication de ce sociolecte dans le texte original, c’est-à-dire le contexte textuel : c’est un reproche fait par le narrateur au chauffeur qui prétend achever plusieurs affaires au même moment. Deuxièmement, c’est le contexte sociohistorique général de la réalité extralinguistique exprimée dans le sociolecte, c’est-à-dire le contexte extratextuel : au sein de la communauté linguistique égyptienne, ce proverbe indique l’impossibilité d’entreprendre deux choses simultanément d’une manière efficace.
Une fois le sens saisi, vient la phase de déverbalisation où le traducteur se débarrasse des contraintes linguistiques de l’original pour ne garder en mémoire que le vouloir-dire de l’auteur, c’est-à-dire l’explicite et l’implicite dans le texte à traduire (Lederer 1994 : 25-27). Dans le même ordre d’idées, Jean Delisle (1980 : 77) écrit que « le sens est saisi sous une forme déverbalisée, c’est-à-dire libérée de tout signifiant ». C’est en déverbalisant le message que le traducteur pourra trouver les équivalences appropriées entre deux langues qui n’ont pas la même logique ni le même découpage de la réalité (Medhat-Lecocq 2021 : 119). Concernant les sociolectes, il s’agit de dégager la valeur notionnelle et émotionnelle ainsi que la valeur connotative dont ce type de texte est porteur. Le traducteur devra exploiter toutes les ressources sociolinguistiques de la langue-culture source afin de saisir tous les composants verbaux et non verbaux qui contribuent à la construction du sens. Partant du même principe, Seleskovitch constate que :
il se produit entre le moment de la compréhension d’un discours et celui de sa réexpression, une phase intermédiaire au cours de laquelle les mots disparaissent à quelques exceptions près ; en revanche les sens qui subsistent sont dépourvus de forme verbale. Une fois le phénomène dégagé à partir de cette situation mainte fois répétée, on comprend mieux que l’on puisse traduire en désignant les choses plutôt qu’en substituant des signifiés à ceux d’une autre langue […].
Seleskovitch 2002 : 365
Une fois le message déverbalisé, vient le rôle de la réexpression de son sens qui est la troisième phase du modèle interprétatif. Le traducteur trouve ici les termes et les tournures linguistiques lui permettant de restituer le vouloir-dire de l’auteur original selon les règles permises par le génie de la langue d’arrivée. Lederer formule de la sorte cette troisième phase :
[l]a troisième étape du processus de la traduction sera donc la recherche d’une expression qui rende justice au sens de l’original et qui, dans sa formulation, réussisse le divorce d’avec la langue de départ et respecte totalement les usages, les habitudes de parole de l’autre langue.
Lederer 1997 : 17
Voilà la réexpression du sens proposée par les traducteurs :
Il nous semble que les traducteurs ont compris le sens du texte source. Ils ont également pu déverbaliser sa forme linguistique dans leur mémoire. Or, dans l’étape finale, le fruit du processus de traduction, ils ont opté pour la littéralité, ou la traduction linguistique selon la terminologie de la théorie interprétative, en négligeant la reproduction du même effet que l’auteur original a voulu produire sur ses lecteurs. Le sens est en quelque sorte rendu dans la version française, mais l’absence d’un équivalent sociolinguistique fait perdre aux destinataires de la traduction l’émotion ressentie par les lecteurs de l’expression originale. En outre, contrairement à l’expression proposée par les traducteurs, la forme figée dont dispose le texte original renforce l’idée qu’elle porte. Cependant, en cherchant une équivalence pouvant restituer une identité de sens en langue-culture française, nous trouvons ce proverbe, On ne peut pas courir deux lièvres à la fois, qui indique presque la même réalité extralinguistique désignée dans le texte source. Ce proverbe équivalent pourrait exercer sur les destinataires de la traduction le même effet que le proverbe original en langue arabe. Dans la traduction littéraire, le sens n’est pas seulement notionnel mais aussi émotionnel. Le traducteur est donc libre de varier le style à condition qu’il atteigne une concordance entre le sens notionnel et un effet esthétique comparables à ceux évoqués par le texte de départ. Dans la phase de réexpression, le traducteur est guidé par le souci de transmettre le sens non verbal et de rendre « un effet analogue à celui engendré par l’original » (Israël 2001 : 15). La traduction n’est donc pas une affaire de langues mises en contact, mais d’équivalence de sens et d’effet. C’est pour cette raison que la théorie interprétative de la traduction prône une traduction qui crée des équivalences dans la langue cible, car avec celles-ci, le traducteur pourrait rendre dans le texte d’arrivée l’effet produit par la forme de l’original dans sa langue source, à l’aide des moyens linguistiques propres à la langue cible. La véritable traduction est celle qui « consiste à transférer des sens identiques d’une langue à l’autre dans l’équivalence des formes » (Lederer 1994 : 216).
De ce qui précède, et aussi d’après notre pratique de la traduction, il nous semble que la stratégie la plus efficace pour transférer le sociolecte entre deux langues-cultures différentes est l’équivalence, étant donné que, selon la théorie interprétative de la traduction, le processus de traduction n’est plus considéré comme un acte de comparaison linguistique. L’objet de celui-ci n’est pas la langue, mais le discours. Si l’équivalence est un concept transversal en traductologie, nous sommes d’accord avec les inventeurs de cette théorie qui précisent les équivalences comme « des discours et des textes présentant une identité de sens, quelles que soient les divergences de structures grammaticales ou de choix lexicaux » (Lederer 1994 : 214). Cette stratégie traductive pourrait respecter le génie de la langue d’arrivée en restant en même temps fidèle au vouloir-dire de l’auteur du texte source.
Pour traduire les sociolectes, ou généralement les dialectes, certains traductologues proposent trois stratégies traductives (Lievois, Noureddine et al. 2018 : 76-77). Nous allons tenter ici de voir à quel point celles-ci sont applicables dans la traduction de quelques sociolectes cités dans notre corpus.
La première stratégie, c’est l’équivalent sociolinguistique, c’est-à-dire « le recours à un sociolecte ou à un régiolecte équivalent dans la langue cible » (Lievois, Noureddine et al. 2018 : 76). En fait, bien que cette stratégie soit efficace, la recherche des sociolectes pouvant refléter la même portée sociolinguistique dans la langue-culture cible n’est pas aisément applicable, car, si l’on analyse la traduction des sociolectes mentionnés dans notre corpus, nous observons que trouver des équivalents français capables de répondre aux exigences sociolinguistiques et historiques du (con)texte source est loin d’être chose facile. De même, pour transférer en français le proverbe figé ci-dessous, les traducteurs ont recours à l’omission par manque d’équivalent sociolinguistique en français.
Il est ardu de traduire les termes et les expressions qui sont fortement liés à une communauté sociolinguistique donnée. Cette expression fait partie des proverbes populaires qui renvoient à la formation sociohistorique de la culture arabe égyptienne qui se distingue certainement de celle de la culture française. Ce proverbe veut dire littéralement que la personne décédée ne mérite pas tous ces pleurs et gémissements, que ce soit pendant les funérailles ou après. Les Égyptiens ont recours à cette expression pour affirmer que ce dont nous parlons n’en vaut pas la peine. L’auteur original puise dans sa langue-culture de manière spontanée et sans y réfléchir, car il sait bien que les lecteurs partagent la même formation socio-culturelle. Il en va autrement pour les destinataires de la traduction qui ne connaissent pas forcément la culture d’origine. Ils n’ont pas la même conception des choses. Étant donné l’écart entre les cultures égyptienne et française, le traducteur n’est pas toujours capable d’accéder à l’équivalent sociolinguistique, bien souvent inaccessible. Ce proverbe dialectal s’inscrit donc, selon la classification de Gambier (2008 : 179), dans les réalités concernant exclusivement une culture donnée et n’ayant pas de correspondance exacte dans une autre culture.
Par contre, les traducteurs ont pu trouver un équivalent en langue-culture française pour cette expression :
Le chauffeur no 13 tourne en dérision la manie des États-Unis de s’ingérer dans les affaires d’autres pays en proposant une idée surprenante au narrateur, celle d’appliquer la même politique aux Américains, c’est-à-dire, par exemple, de leur imposer des sanctions économiques sous prétexte de défendre les droits de la minorité noire dans leur pays. Il renforce ses propos en ayant recours à ce proverbe dialectal, qui se dit d’une personne particulièrement mal placée pour faire des reproches à d’autres. Comprenant le contexte textuel et extratextuel, les traducteurs ont recours à l’équivalent sociolinguistique en utilisant la locution figurée balayer devant sa porte qui est la plus apte à garder les traits stylistiques de l’original. C’est pour cette raison que la théorie interprétative de la traduction prône généralement la traduction par équivalence. Selon Lederer,
[l]a traduction pour être réussie doit viser à établir une équivalence globale entre le texte original et le texte traduit, les correspondances répondant à des besoins ponctuels alors que leur application systématique ne permettrait pas d’obtenir cette équivalence.
Lederer 1994 : 51
Quant à l’exemple suivant, il donne un cas intéressant de l’équivalence :
4)
أنا ولادي ح يجيبوا لي نقطة
[Moi, mes enfants me causeront une thrombose.]
Al Khamissi 2006/2018 : 79a)
Moi, mes enfants vont me tuer.
Al Khamissi 2006/2009 : 95, traduit par Emara et DelavigneL’expression يجيب لي نقطة se dit généralement pour ridiculiser quelqu’un qui commet tellement de sottises contre quelqu’un que ce dernier en tombe malade. Par ailleurs, une mère peut souvent utiliser ce proverbe même lorsque son enfant fait des bêtises qui pourraient lui faire du mal à lui-même et non pas à elle. De même, le chauffeur no 29 utilise cette expression pour exprimer le mal que lui font ses enfants. Selon le contexte situationnel du discours, l’énoncé original n’est qu’une structure que les interlocuteurs ont l’habitude d’utiliser dans une situation de communication déterminée pour désigner la souffrance causée par les enfants à l’égard du père. La compréhension du sens d’un texte est par voie de conséquence liée à celle de la situation d’énonciation et du contexte. C’est pour cette raison que les traducteurs ont proposé une expression assez courante dans une situation d’énonciation pareille dans le langage courant. Les deux expressions arabe et française expriment différemment cette souffrance. La thrombose utilisée dans l’expression originale pourrait être considérée comme cause de l’acte de tuer souligné dans la traduction française. Il s’ensuit que les langues du monde peuvent exprimer la même réalité linguistique mais d’une manière différente.
D’où le rôle de la capacité du traducteur à détecter le non-dit implicite dans le but de restituer le même sens voulu dans le texte original. Par ce faire, il pourrait offrir une traduction conforme aux règles textuelles de la langue d’arrivée et par la suite accessible aux destinataires de la traduction. L’acte traductif relève ainsi plus du discours que de la langue. Il faut que le traducteur comprenne le message original afin de pouvoir fournir un message équivalent ayant le même effet dans le texte cible. C’est pourquoi, pour les tenants de la théorie interprétative, « la traduction n’est pas un travail sur la langue, sur les mots, c’est un travail sur le message, sur le sens. Le traducteur doit, dans un premier temps, comprendre, et, dans un deuxième temps, dire » (Herbulot 2004 : 309).
La deuxième stratégie proposée est la standardisation qui consiste à rendre les sociolectes par des éléments lexicaux appartenant à la langue standard. En appliquant cette stratégie, les traducteurs nous donnent des constructions sémantiquement correctes, mais dépourvues des traits stylistiques caractérisant le roman source. Consultons la traduction française de cet exemple :
5)
اللى ايده فى المية مش زى اللى ايده فى النار
[Celui dont la main est dans l’eau n’est pas comme celui dont la main est dans le feu.]
Al Khamissi 2006/2018 : 74a)
Je ne suis pas à votre place.
Al Khamissi 2006/2009 : 59, traduit par Emara et DelavigneCe proverbe dialectal se dit le plus souvent quand une personne n’est pas dans la même situation difficile qu’une autre afin de souligner la différence entre elles. Le chauffeur no 16 demande l’avis du narrateur sur un problème financier, mais ce dernier confirme que c’est à lui seul de prendre la décision. Il confirme sa thèse par l’utilisation de ce proverbe. Les traducteurs laissent de côté la transmission du proverbe en question et se contentent d’une phrase interprétant partiellement le sens. Les traducteurs utilisent simplement cette expression cible qui rend presque le sens voulu dans le texte source, mais de façon neutre. De cette façon, la stratégie de la standardisation aboutit à un appauvrissement stylistique. Elle entraîne ipso facto une perte des effets créés dans le texte original. Grâce à l’accessibilité de cette stratégie, qui fait plus ou moins abstraction du contexte socioculturel du texte source, elle est devenue le domaine de prédilection des traducteurs. Dans une traduction littéraire, le traducteur devrait prendre en considération la dimension poétique afin de transmettre l’effet que l’auteur original a voulu produire sur ses lecteurs dans sa langue. Pour ce faire, il faut que sa démarche finale « consiste à repérer dans l’idiome et la culture d’accueil toutes les ressources propres à l’instauration d’un rapport sens-forme susceptible d’engendrer le même effet » (Israël 1990 : 41). Quant à l’omission de la traduction de ce proverbe, elle porte atteinte à la fonction expressive du texte original qui cherche entre autres à mettre en exergue l’utilisation des proverbes dialectaux qui se considère comme une caractéristique linguistique dans l’arabe égyptien.
La troisième stratégie est le recours sur le plan de la langue parlée, que nous voyons la plus proche du dialecte dans les langues non diglossiques. Le va-et-vient entre les registres familier et standard dans sa version aide le traducteur à indiquer que le texte source renferme plus d’un niveau de langue. Cependant, dans ce cas de figure, le registre du français parlé ne peut recouvrir toutes les situations de diglossie de l’arabe, car, comme nous l’avons déjà dit, la divergence entre les niveaux de l’arabe est beaucoup plus ressentie que celle qui existe en français. En conséquence, le texte cible sera dépourvu de beaucoup de caractéristiques des sociolectes originaux. C’est la raison pour laquelle les traducteurs de Taxi ont rarement recours à la langue parlée. Sur le plan lexical, ils n’utilisent que deux termes appartenant au niveau familier : un type et pubs. Sur le plan grammatical, il s’agit seulement de la suppression de l’adverbe de négation ne dans une seule phrase : « Hé ! Te défoule pas sur moi » (Al Khamissi 2006/2009 : 11).
Passons maintenant à quelques cas de figure de chaque catégorie de sociolecte pour analyser les choix opérés par les traducteurs.
5.1 Proverbes dialectaux
Le proverbe est un énoncé qui se veut principalement plutôt bref. Les linguistes trouvent que les proverbes sont « des signes-phrases qui possèdent les vertus des dénominations sans perdre pour autant leur caractère de phrase » (Kleiber 2000 : 41). Ayant une valeur argumentative, les proverbes se basent sur l’expérience humaine et sont présents dans toutes les cultures du monde. Étant donné que les proverbes sont l’expression de la sagesse populaire, ils occupent une place considérable dans la langue de tous les jours et, en conséquence, dans la littérature dialectale. Il est courant d’utiliser des proverbes dans les conversations familières pour donner plus de crédibilité à ce qui est dit. Les linguistes confirment que « l’énoncé proverbial, en tant que principe général, autorise le passage, au sein d’un processus argumentatif, d’un argument à sa conclusion » (Fournet 2005 : 37). Soulignons également que les thèmes des proverbes touchent tous les aspects du quotidien : la vie, la mort, l’amour, l’amitié, le bonheur, etc. Notre corpus renferme des conversations familières en langue dialectale entre le narrateur et les différents chauffeurs de taxi. Ceux-ci ont régulièrement recours à ces formes sentencieuses pour soutenir leur point de vue.
De façon générale, il convient de noter que la transmission des formes sentencieuses, y compris grosso modo les proverbes, entre les langues indo-européennes semble assez aisée du fait que celles-ci partagent linguistiquement le même modèle latin et, idéologiquement, la culture classique gréco-latine (Anscombre 2008 : 257-258). Beaucoup de proverbes issus de ces langues partagent la même idée de base ou même la forme. Toutefois, il est un vrai défi de transférer les proverbes dialectaux égyptiens vers la langue-culture française, car ils reflètent les valeurs culturelles populaires des Égyptiens, leurs traditions sociales, historiques et aussi religieuses. Ils sont donc profondément enracinés dans la culture populaire égyptienne qui est bien différente de celle des Français. Nous pouvons trouver des notions qui appartiennent aux traditions ou aux coutumes religieuses du peuple de la langue-culture source et qui ne se trouvent pas dans la langue-culture cible. D’où les difficultés importantes de les transmettre en langue-culture française. Voyons comment les traducteurs ont rendu ces proverbes égyptiens à forme figée en langue française.
6)
عمر الشقى بقى
[La vie du malheureux sera longue.]
Al Khamissi 2006/2018 : 24a)
Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas mourir.
Al Khamissi 2006/2009 : 20, traduit par Emara et DelavigneCe proverbe dialectal s’emploie pour indiquer que l’homme malheureux vit pendant longtemps, mais dans la souffrance. Selon le contexte, il est énoncé par le chauffeur no 4, qui s’était assoupi au volant, et ce pour rassurer le narrateur inquiet à ce sujet. Après avoir compris et déverbalisé le proverbe original, les traducteurs ont réexprimé le sens compris en ayant recours à la standardisation dans un registre formel. Sémantiquement, le sens est presque rendu, mais il y a une perte au niveau sociolinguistique. Les significations de ces signes linguistiques ne peuvent faire éprouver aux récepteurs de la traduction les mêmes émotions que celles éprouvées par les lecteurs du proverbe de départ. Il est vrai que s’agissant de la diglossie littéraire, la traduction « ne parvient pas à rendre linguistiquement l’aura du terme ou de l’expression employée » (Schnyder 2013 : 176).
En effet, la traduction proposée en langue française n’a pas la même valeur argumentative que le proverbe original dans la langue d’origine. Certes, il n’est pas facile de transférer ici cette couleur locale égyptienne en langue-culture française étant donné que « le traducteur littéraire ne peut jamais dire dans sa langue tout ce que l’auteur a exprimé dans la sienne, mais il peut le plus souvent dire ce que l’auteur aurait dit s’il s’était servi du langage du traducteur » (Sumner-Paulin 1995 : 549). Par conséquent, il est possible que les traducteurs aient cherché dans la langue cible une structure figée qui pourrait, même partiellement, occuper la même fonction dans le texte d’arrivée.
7)
طباخ السم بيدوقه
[Le cuisinier du plat empoisonné finira par le goûter.]
Al Khamissi 2006/2018 : 57Le chauffeur no 11 raconte au narrateur une histoire drôle qui vient de lui arriver. Une femme toute voilée est montée dans le taxi, puis à sa surprise, elle s’est mise à moitié nue, toute honte bue. Il lui a demandé pourquoi elle réagissait de la sorte, car il s’était senti concerné par cet acte incompréhensible. Il a donc justifié sa question par ce proverbe qui indique que toute personne impliquée dans un acte doit en subir les conséquences. Il est donc vrai qu’« un proverbe est usuellement employé dans l’objectif de servir le projet argumentatif de celui qui l’emploie, de le rendre valide, car en conformité avec une instance supérieure extérieure : la sagesse populaire » (Fournet 2005 : 37). En effet, ce proverbe jouit d’une double valeur argumentative et esthétique : d’un côté, elle maintient le texte original dans une ambiance égyptienne ; de l’autre, elle cherche à provoquer les émotions des lecteurs. Cependant, nous remarquons que les traducteurs négligent totalement la transmission de ce proverbe en langue française. Cette traduction ne peut ainsi susciter le même écho que chez les locuteurs de l’original. Les récepteurs visés par la traduction devraient recevoir le même effet qu’eux. Margot confirme ce point de vue en ces termes :
[l]a valeur d’une traduction […] dépend de la façon dont le lecteur monolingue saisit le message traduit, c’est-à-dire que sa qualité est certaine si ce lecteur réagit (autant que possible) de la même manière que le récepteur du texte original.
Margot 1979 : 102
8)
اللي أوله شرط آخره نور
[Toute chose dont le début est clair, sa fin sera lumière.]
Al Khamissi 2006/2018 : 108a)
Il est encore temps d’en discuter.
Al Khamissi 2006/2009 : 133, traduit par Emara et DelavigneCe proverbe exhorte l’accord préalable sur toute question ou processus d’affaires. Il est adressé par le narrateur, client, au chauffeur de taxi no 41 qui refuse de se mettre d’accord avec lui sur le montant de la course pour aller au quartier Maadi. Pour lui, ce proverbe dialectal démontre la nécessité de savoir combien cette course va lui coûter avant de monter dans le taxi.
Les traducteurs se limitent à une phrase simple contenant des éléments qui n’ont aucune connotation. Ils ne réussissent pas à déverbaliser le sociolecte original qui met l’accent sur la nécessité de l’accord préalable ; ils donnent de cette manière une version qui ne dit presque rien aux destinataires de la traduction. Par ce faire, ils renoncent à transmettre un aspect sociolinguistique caractérisant l’acte langagier des Égyptiens. Ce procédé de traduction ne permet donc pas de refléter le contexte socioculturel de la communauté linguistique originale. En conséquence, il y a des traductologues qui privilégient la traduction linguistique des proverbes afin de faire connaître aux destinataires la couleur locale de la culture-source :
[e]n soulignant les différences culturelles entre la communauté originale et la communauté à l’intention de laquelle les proverbes sont traduits, elle respecte l’identité culturelle des deux communautés. Le traducteur est un médiateur de communication et il convient qu’il permette au lecteur de s’approcher au maximum du contexte culturel original des proverbes.
Sumner-Paulin 1995 : 554
Toutes les langues expriment les mêmes réalités, mais celles-ci se reflètent différemment dans chacune d’entre elles. En passant d’une langue à l’autre, le traducteur ne devrait pas se contenter d’introduire dans le texte d’arrivée des correspondances lexicales ou syntaxiques, en revanche, il « se construit une image mentale de la situation et, ayant trouvé le sens du texte, il l’exprime par équivalences, de façon idiomatique en langue d’arrivée » (Lederer 2002 : 18). Par conséquent, le traducteur doit chercher dans la langue d’arrivée un proverbe, ou une autre forme sentencieuse, qui soit équivalent ou plus proche du proverbe original afin de pouvoir produire des effets équivalents ou similaires sur ses destinataires.
D’après l’analyse de la traduction de certains proverbes cités dans notre corpus, nous pouvons déclarer que le transfert de ceux-ci en langue française n’est pas seulement une opération linguistique. Le traducteur est tenu de faire une documentation suffisante dans la langue source pour être en mesure de comprendre le message implicite du proverbe original, puis de mener une recherche linguistico-culturelle dans la langue cible dans le but de le réexprimer dans une formule équivalente adéquate. Dans le même ordre d’idées, la majorité des traductologues proposent « la recherche de l’équivalent préétabli comme solution traductive » (Yao 2018 : 87) pour faire passer un proverbe d’une langue vers une autre. Cependant, si le proverbe à traduire n’a pas d’équivalent exact dans la langue d’arrivée, le traducteur devrait, dans cette situation, avoir recours à une traduction interprétative pouvant conserver le sens, de préférence sous forme sentencieuse. Dans cette optique, les destinataires de la traduction auront la possibilité de comprendre le vouloir-dire de l’auteur original et d’obtenir en quelque sorte une réaction assez similaire à celle des premiers lecteurs.
5.2 Expressions figées dialectales
En général, le figement constitue une difficulté importante dans le processus de traduction étant donné que les expressions figées se caractérisent par la fixité idiomatique (Mejri 2010 : 32), c’est-à-dire qu’il y a une solidarité entre la forme et le contenu. À l’instar des expressions figées de la langue classique, les expressions figées dialectales se caractérisent par l’opacité sémantique, les restrictions morphosyntaxiques et la limitation paradigmatique (Ali 2016 : 108-110). À cela s’ajoute également la situation diglossique qui rend bien difficile leur transfert en langue-culture française. Pour transférer en langue française ces expressions, il faut comprendre leur charge sémantique et socioculturelle ainsi que leur structure morphosyntaxique. Voyons la traduction de quelques expressions figées dialectales puisées dans notre corpus.
9)
قادلي صوابعه العشرة شمع
[Il a allumé ses dix doigts comme des bougies pour moi]
Al Khamissi 2006/2018 : 96a)
Il s’est plié en quatre pour moi
Al Khamissi 2006/2009 : 79, traduit par Emara et DelavigneCette expression figée indique qu’une personne veut faire de son mieux pour plaire à quelqu’un d’autre. Elle est énoncée par le chauffeur no 22 pour valoriser l’aide qu’un ami iraquien lui avait apportée. Pour réexprimer le sens voulu dans le texte original, les traducteurs utilisent cette expression fréquente dans la vie quotidienne des Français. Elle se dit pour désigner qu’une personne fait tout son possible pour en aider une autre. Elle peut donc rendre le vouloir-dire de l’expression originale. Tandis que la langue-culture arabe se sert de الصوابع – doigts – et الشمع – bougies – pour exprimer cette représentation sociale, la langue-culture française utilise le fait de se plier en quatre pour traduire la même représentation. Il en résulte que les deux langues arabe et française expriment la même réalité, mais chacune d’elles se sert des sémantismes différents en fonction des exigences sociales et linguistiques de la culture qu’elle porte. C’est pour cette raison que les traducteurs se sont éloignés de la forme de l’original pour chercher un équivalent dans la langue française ; ils ont déverbalisé la forme linguistique pour reproduire le sens du texte source au moyen des structures linguistiques compatibles avec le génie de la langue d’arrivée. Ce qui souligne que les significations des structures linguistiques du texte de départ ne suffisent pas à elles seules pour saisir le vouloir-dire de l’auteur. Le traducteur devrait également chercher les idées non dites en exploitant le contexte spatiotemporel et le contexte cognitif où ces structures linguistiques se trouvent. Aussi fait-il intervenir son bagage cognitif qui est l’ensemble de ses connaissances et expériences acquises sur le long terme. Le vouloir-dire sera de la sorte reverbalisé dans des structures linguistiques qui respectent à la fois le génie de la langue d’arrivée et la pensée des récepteurs de la traduction. Les traducteurs ont pu réexprimer le sens dans le texte d’arrivée indépendamment de la forme verbale qu’il revêt dans la langue de départ tout en respectant le génie de la langue d’arrivée. Lederer (1994 : 49) écrit, à ce propos, qu’« un texte écrit dans une langue conforme à son “génie” appelle dans l’autre langue un texte écrit lui-aussi dans son “génie” ».
10)
مراتي دبت معايا خناقة للسما
[Ma femme a engagé contre moi une telle dispute, qu’elle s’en est élevée jusqu’au ciel.]
Al Khamissi 2006/2018 : 52a)
Ma femme m’a fait une crise effroyable.
Al Khamissi 2006/2009 : 60, traduit par Emara et DelavigneSoulignons d’abord que le terme سما – ciel – n’a pas de portée religieuse dans cette expression familière, mais les Égyptiens le disent pour désigner la grandeur, physique ou morale, de quelque chose. De même, le chauffeur no 16 utilise cette expression pour désigner la grande dispute que sa femme a eue avec lui sur un sujet quelconque. Les traducteurs ont recours à la standardisation pour expliquer le vouloir-dire de l’expression source. Cependant, il nous semble que l’utilisation du substantif crise ne rend pas l’ampleur exprimée par l’expression source parce que l’écart sémantique entre سما et ce substantif est évident. D’ailleurs, le substantif proposé ne clarifie pas l’origine de cette bagarre qui n’est qu’un échange verbal. À notre avis, ils auraient dû utiliser le terme dispute pour faire comprendre aux destinataires de la traduction qu’il ne s’agissait que d’une vive discussion entre époux qui avait dégénéré en dispute. Le sens se dégage en toute logique de la rencontre des composants linguistiques et non linguistiques du discours. Delisle (1980 : 59) déclare que
le sens du message découle de la combinaison et de l’interdépendance des significations pertinentes des mots et syntagmes qui le composent enrichies des paramètres non linguistiques représentant le vouloir-dire de l’auteur.
11)
الكلام اللي ولا بيودي ولا بيجيب
[La parole qui ne mène à rien, n’apporte rien.]
Al Khamissi 2006/2018 : 32a)
Des mots qui ne mènent à rien et n’apportent rien.
Al Khamissi 2006/2009 : 23, traduit par Emara et DelavigneDans leur langage quotidien, les Égyptiens utilisent cette expression à connotation péjorative pour désigner le fait de parler pour ne rien dire. En critiquant la situation politique en Égypte, le chauffeur no 6 utilise cette expression figée pour déclarer qu’il est las des slogans futiles du patriotisme. Il est clair que les traducteurs ont trouvé une solution dans la traduction linguistique qui cherche à établir une concordance entre la paire de langues départ/arrivée. Si les tenants de la théorie interprétative prônent généralement la traduction par équivalence, la traduction linguistique, par correspondance, y a aussi sa place. Selon cette théorie, la traduction par correspondance est parfois valable parce qu’« [i]l arrive en revanche souvent que les mots gardent dans un texte leur identité et que leur signification, conservant ses droits, exige une correspondance » (Lederer 1994 : 67).
Bien que la traduction par correspondance ne choisisse pas ici une expression toute faite, elle peut refléter littéralement le vouloir-dire du texte de départ. Si les récepteurs visés par la traduction ne captent pas le même effet que les lecteurs originaux, ils peuvent pour autant comprendre facilement la visée argumentative du chauffeur en question. Enfin, nous trouvons qu’une compréhension parfaite du sémantisme et de la portée culturelle des expressions figées dialectales est indispensable pour les comprendre et, par la suite, les réexprimer en langue-culture française. Le sens devrait être pris dans son contexte dans la langue de départ et transposé dans un contexte équivalent, ou du moins similaire, dans la langue d’arrivée.
D’après l’analyse de la traduction de certaines expressions figées dialectales, il s’avère que celles-ci désignent la même idée dans différentes langues en s’énonçant par des mots divergents. La formation de ces expressions est conditionnée par la logique de composition propre à chaque langue. C’est pour cette raison que la traduction par correspondance de ces expressions produit parfois des formulations linguistiques aboutissant à un non-sens ou un faux-sens. « Par leur différence de composition, les expressions toutes faites nous le montrent : jamais ou presque jamais, deux langues ne consacrent la même formulation à l’expression d’une même idée » (Seleskovitch et Lederer 1986/2014 : 60). D’où la nécessité de la traduction par équivalence des expressions figées. Pour restituer leur sens, le traducteur devrait chercher dans la langue d’arrivée des énoncés qui portent l’idée exprimée dans le texte original et qui respectent, en même temps, les moyens d’expression propres au génie de cette langue.
5.3 Expressions dialectales inspirées de la religion
La valeur sociale de la religion diffère d’une communauté linguistique à une autre. Contrairement aux Français, la religion joue un rôle important dans la vie quotidienne des Égyptiens (Ali 2020 : 98-99). Par conséquent, leur discours quotidien contient beaucoup d’expressions inspirées de la religion musulmane. Dans la même perspective, le sociolecte des chauffeurs de taxi égyptiens est imprégné d’un grand nombre d’allusions religieuses. En effet, la traduction des expressions remontant à la culture religieuse musulmane en langue-culture française constitue un problème majeur à cause de la difficulté de trouver des équivalences entre deux mondes culturels différents (Mounin 1963 : 61). Analysons la traduction de quelques exemples.
12)
— تصدق بالله ؟
— لا إله الا الله
Al Khamissi 2006/2018 : 43[— Vous croyez en Allah ?]
[— Il n’y a de dieu qu’Allah.]
a)
Vous n’allez pas y croire.
Al Khamissi 2006/2009 : 32, traduit par Emara et DelavigneDans la langue de la vie quotidienne des Égyptiens, la première réplique est une formule interrogative que l’on pourrait utiliser pour préparer l’interlocuteur à croire quelque chose qui a l’air illogique. En réaction immédiate, l’interlocuteur débite la deuxième réplique. Pareillement, le chauffeur no 8 recourt à la première réplique pour confirmer avoir participé à une troupe de théâtre. Les traducteurs ont transmis les deux répliques en une seule phrase négative, ce qui ne rend ni la réalité morphosyntaxique, ni la couleur locale du texte de départ.
Le transfert des référents culturels, notamment ceux qui appartiennent à la culture religieuse, soulève un vrai problème dans le processus de traduction, surtout entre deux langues ne partageant pas les mêmes convictions. « C’est le cas limite, pessimiste, de la quasi-intraduisibilité, là où la réalité à laquelle se réfère le message-source n’existe pas pour la culture-cible » (Ladmiral 1994 : 20).
13)
الجواز برضه نص الدين
[Le mariage est également la moitié de la religion.]
Al Khamissi 2006/2018 : 69a)
Le mariage, c’est la moitié de la religion.
Al Khamissi 2006/2009 : 83, traduit par Emara et DelavigneÉtant donné que les Égyptiens relient beaucoup d’affaires de leur vie quotidienne à la religion, l’expression originale se dit le plus souvent pour valoriser le mariage dans la société égyptienne. Le chauffeur no 24 la prononce, de la même manière, pour justifier la raison pour laquelle il s’est marié prématurément. Les traducteurs optent pour la traduction par correspondance. Cependant, un lecteur ignorant le contexte socioculturel arabo-égyptien est-il en mesure de comprendre la charge sémantique et la dimension culturelle de cette expression inspirée de la religion ? En effet, du point de vue religieux, le mariage ne représente pas vraiment la moitié de la religion ; ce n’est qu’une expression toute faite qui a pour but d’encourager les jeunes gens à se mettre en ménage. Une telle littéralité, sans même une note explicative, pourrait dérouter les récepteurs de la traduction et aboutir à un malentendu culturel. Si l’auteur original n’est pas obligé de tout dire, étant donné qu’il partage certaines connaissances culturelles avec ses lecteurs, il en va autrement dans la traduction. Concernant les faits culturels inconnus des lecteurs seconds, le traducteur devrait fournir des explications afin que sa traduction soit plus intelligible. Selon Lederer, « l’explicitation est en traduction un procédé d’adaptation au lecteur étranger » (1998 : 161). De plus, la fidélité à la langue de départ n’arrive pas à reproduire l’effet que l’auteur a voulu produire sur ses lecteurs. Par conséquent, cette traduction par correspondance ne transmet que le sens notionnel. C’est pourquoi il incombe au traducteur de restituer par des équivalences les idées comprises et les sentiments ressentis du texte de départ. Pour bien comprendre un énoncé, le traducteur devrait mobiliser non seulement ses connaissances linguistiques mais aussi ses connaissances extralinguistiques, c’est-à-dire tout le savoir dont il dispose sur la situation discursive et le contexte spatiotemporel.
[L]e sens est compris par le traducteur (ou l’interprète) lorsqu’il ente des compléments cognitifs et affectifs sur un énoncé. La somme du linguistique et de l’extralinguistique confère donc à l’énoncé un sens.
Balliu 2007 : 4
D’ailleurs, si le quotidien égyptien est en général plus imprégné de religieux que celui des Français, ces derniers ont eux aussi gardé dans leur langue parlée une foule de références à Dieu. Consultons la traduction de cette expression :
14)
من بقك لباب السما
[De ta bouche à la porte du ciel.]
Al Khamissi 2006/2018 : 52a)
Que Dieu vous entende.
Al Khamissi 2006/2009 : 39, traduit par Emara et DelavigneCette expression familière d’inspiration religieuse se dit généralement pour exaucer la prière de quelqu’un d’autre. Lorsqu’il est question de l’occupation américaine de l’Irak, le chauffeur no 10 déclare prier pour que les Irakiens réussissent à éliminer tous les soldats américains. Le narrateur donne son approbation à cette prière.
Difficile de trouver en langue française une correspondance lexicale de l’expression originale. C’est la raison pour laquelle les traducteurs utilisent le subjonctif qui exprime le souhait en français afin d’indiquer l’approbation par le narrateur de la prière du chauffeur. Cette expression peut être dite par tous les Français, même si chez les non-croyants son usage sera teinté d’une légère ironie. En cette façon, les traducteurs cherchent en quelque sorte à faire une traduction ethnique – ethnocentrique – en transformant le roman original en quelque chose de familier aux récepteurs de la traduction. Bien que les formes des deux expressions en question ne se correspondent pas, le contenu du message original trouve son équivalent dans le texte d’arrivée. De ce qui précède, on pourrait affirmer que le transfert des sociolectes qui remontent au religieux constitue un obstacle majeur dans le processus de traduction en raison de la différence de la valeur socioculturelle de la religion dans les sociétés égyptienne et française.
À la lumière des exemples étudiés, nous pouvons remarquer que, d’une part, le simple transfert du contenu linguistique de ces expressions dialectales toutes faites ne saurait pas satisfaire les destinataires de la traduction, cette démarche linguistique aboutira à un texte illisible, remarque déjà faite concernant la traduction du dialecte dans la littérature (Lavault-Olléon 2006 : 509). D’autre part, en l’absence d’équivalent en langue d’arrivée, ce qui est souvent le cas, la traduction interprétative ne pourrait produire le même effet que l’original. La traduction des éléments dialectaux dans une oeuvre littéraire ne se limite donc pas aux difficultés de compréhension, qui sont certainement présentes, mais surtout aux obstacles de reverbalisation, c’est-à-dire le « besoin d’adopter un traitement cohérent du dialecte qui doit trouver sa justification » (Lavault-Olléon 2006 : 504).
De façon générale, le traducteur des sociolectes se trouve pris entre deux attitudes différentes : celle de restituer l’étrangeté de l’autre ou celle de produire un texte lisible et acceptable dans la langue d’arrivée (Bruneaud-Wheal 2011 : 49). C’est donc au traducteur de gérer cette double contrainte entre la lettre du texte source et la langue du texte cible en adoptant les stratégies traductives appropriées pour son projet dont il sera responsable. En opérant ses choix, il conviendra de prendre en considération que les sociolectes sont employés par l’auteur original dans une situation donnée pour accomplir la fonction de « la mise à l’écart des conflits et la réconciliation au sein d’un groupe social » (Martin 1996 : 117). Par conséquent, il appartient au traducteur de comprendre la situation de communication dans laquelle le sociolecte est utilisé et de préciser le contexte socioculturel de son utilisation tout en tenant compte de l’écart culturel entre la langue-culture source et la langue-culture cible. Les traductologues confirment que le traducteur des sociolectes, et plus généralement des dialectes, « se doit d’envisager sa tâche d’un point de vue socio-culturel et historique avant même de considérer les contraintes linguistiques » (Blom 2022) afin qu’il puisse comprendre les connotations qu’évoquent les sociolectes chez les premiers lecteurs.
La traduction des sociolectes des chauffeurs de taxi égyptiens en langue française révèle l’écart culturel entre deux communautés linguistiques bien différentes. Nous pouvons dire que le sociolecte raconte une histoire ancienne et populaire en cherchant à incarner son idée dans une forme linguistique concise. De ce fait, le traducteur n’est pas toujours en mesure de trouver en langue cible un équivalent exact qui puisse répondre aux exigences linguistiques et culturelles du texte source. Ce qui ne nous semble pas étrange, car la traduction ne consiste pas à dire la même chose de manière identique mais plutôt à « dire presque la même chose » (Eco 2006). On n’attend donc pas du traducteur des sociolectes qu’il nous dise la même chose, mais plutôt qu’il exprime sa créativité pour proposer une version qui aurait pu être rédigée par l’auteur lui-même dans la langue cible.
Il convient de souligner que la recherche d’équivalents ne signifie pas ici l’adaptation des sociolectes dans une variété française non standard, car cette démarche générerait une certaine ambiguïté auprès des destinataires de la traduction qui se trouveraient face à des éléments linguistiques typiquement français prononcés par des chauffeurs égyptiens ; la dimension politique et sociohistorique qui caractérise bien tout le roman, à travers la narration et les échanges des personnages, ayant disparu. Ce qui nuit au projet idéologique du romancier engagé qui a délibérément mis une variété vernaculaire dans la bouche des personnages dans le but de nous présenter leur situation socioculturelle dans un contexte politique spécifique. La traduction ne se limite pas à la simple transmission de mots et de langues, mais elle s’inscrit dans une activité de communication complexe qui « donne le même “contenu situationnel”, soit la signification des mots dans leur environnement qui inclut aussi, à des degrés divers, des aspects non linguistiques, ou encore pragmatiques ou culturels » (Clas 2011 : 18). Trouver des équivalents à ces faits dialectaux qui servent de marqueurs sociaux et à leurs situations socio-culturelles entre deux langues-cultures différentes constitue ainsi un défi majeur dans le processus de traduction. D’où le rôle de la créativité du traducteur-lecteur-écrivain-ethnologue bien formé qui devrait, selon Lederer (1994 : 49), « formuler dans sa propre langue et selon son propre talent les idées qu’il doit faire comprendre et les sentiments qu’il doit faire ressentir ».
Nous admettons donc que le traducteur laisse sa marque, sa « visibilité », dans son projet de traduction qui est le fruit de ses compétences et de ses connaissances linguistiques, culturelles et aussi traductologiques. Au lieu de chercher à établir des correspondances, il est invité à effectuer « un travail de réécriture, soucieux de donner une lisibilité au texte tout en préservant ses caractéristiques » (Lavault-Olléon 2006 : 509). En somme, le transfert des sociolectes implique la rencontre de la recherche documentaire et linguistique du traducteur, qui propose une traduction pouvant dire presque le même sens, et du travail herméneutique du lecteur afin de reconstruire ce sens en fonction du contexte textuel et extratextuel.
6. Conclusion
Au terme de cet article, nous pouvons dire que si l’arabe dialectal permet de refléter la réalité sociolinguistique de la communauté linguistique égyptienne, il n’est néanmoins pas transmis sans difficulté dans la langue française. En effet, la traduction d’un texte écrit en arabe mixte, passant de l’arabe standard moderne à l’arabe égyptien, en langue française, est une opération compliquée, car elle consiste, pour ainsi dire, à passer de deux langues sources à une seule langue cible. En outre, la grande majorité des traducteurs ne maîtrisent pas l’arabe dialectal. Dans la présente étude, nous avons trouvé que le sociolecte des chauffeurs égyptiens prenait plusieurs formes dans Taxi : proverbes dialectaux, expressions figées dialectales et expressions dialectales inspirées de la religion.
Pour rendre le sociolecte des chauffeurs égyptiens en français, les traducteurs ont eu recours à plusieurs stratégies traductives : l’équivalent sociolinguistique, la standardisation, le niveau de la langue parlée, la traduction par correspondance et l’omission. Faute de place, nous ne pouvons pas exposer tous les cas puisés dans notre corpus. Cependant, nous découvrons, d’une part, qu’il n’y a pas de choix ultime respecté ; les traducteurs procèdent au cas par cas. D’autre part, la stratégie de la standardisation est d’autant plus fréquente qu’elle efface les traits stylistiques caractérisant le texte original, entraînant un appauvrissement stylistique du texte d’arrivée. Nous constatons également que l’équivalent sociolinguistique est la méthode la plus efficace pour transmettre le vouloir-dire du discours original qui est un point essentiel de la théorie interprétative de la traduction. Cependant, elle est la moins utilisée en raison de l’énorme écart entre les deux langues-cultures arabe et française. Quant à l’omission, nous croyons qu’elle nuit à la fidélité au discours, étant donné que les sociolectes, en tant que stratégie de production du sens mise en oeuvre par l’auteur, doivent être respectés dans le texte traduit pour y reproduire le même effet.
Cela dit, nous concluons que le transfert du dialecte arabo-égyptien en langue-culture française soulève deux problématiques.
Primo, ce dialecte est profondément enraciné dans la culture locale égyptienne et, le plus souvent, n’a pas d’équivalent dans la culture française. Il y a toujours un fossé, même entre les cultures qui se ressemblent. De même, l’auteur et le traducteur, s’ils ne partagent pas le même socle culturel, possèdent une vision différente du monde. En l’occurrence, une analyse sociolinguistique du texte à traduire est indispensable. Ainsi Lederer (2004 : 78-79) insère-t-elle les dialectes dans les éléments culturels extralinguistiques qui appartiennent à l’univers du discours. Par conséquent, la recherche de correspondances linguistiques dans la traduction en français des sociolectes des chauffeurs égyptiens se fait rejeter.
Secundo, tandis que l’arabe est une langue diglossique, ayant deux variétés linguistiques distinctes, dont chacune a son propre système lexical et morphosyntaxique, le français possède, comme la plupart des langues du monde, deux niveaux différents : l’oral et l’écrit. Alors, les deux langues, l’arabe et le français, ont plus d’un niveau linguistique. Elles ont, toutes les deux, un niveau formel, littéraire et châtié, et un autre niveau populaire et vulgaire. Cependant, la différence entre les deux niveaux de l’arabe est d’ordre lexical, morphosyntaxique et phonologique, alors qu’en français, cette différence n’existe que dans la simplification sur le plan grammatical et l’utilisation de quelques alternatifs lexicaux à l’oral. L’arabe est une langue diglossique par excellence, par contre le français ne l’est pas. Ce dernier est « habituellement considéré comme le meilleur exemple d’une langue à norme unique » (Pöll 2005 : 15). Le français jouit de cette manière d’un caractère mononormatif. Par conséquent, le traducteur se trouve devant un défi réel pour transférer un texte dialectal de l’arabe vers la langue française.
Malgré ces difficultés, le transfert du dialecte arabo-égyptien en langue-culture française reste possible, à condition que, comme le prône la théorie interprétative de la traduction, le traducteur prenne largement en compte que son travail repose sur le message et le sens et non sur les mots et la langue. Dans le processus de traduction, les langues ne jouent que le rôle de vecteurs du sens. De même, la théorie interprétative souhaite conserver au maximum la culture de départ, ce qui ne signifie nullement conserver sa langue.
Il est évident que le transfert de la langue dialectale à une langue étrangère exige plus d’efforts et de connaissances linguistiques et extralinguistiques de la part des traducteurs pour reproduire un texte cible à la fois fidèle au vouloir-dire du texte source et lisible par les récepteurs de la traduction. La transmission de l’arabe dialectal dans les oeuvres littéraires arabes en langue-culture française en y faisant passer toutes les subtilités reste un chemin long et semé d’embûches.
Appendices
Remerciements
Je tiens à remercier Mme Marianne Lederer, professeure à l’Université Sorbonne-Nouvelle, et Mme Hedaya Machour, professeure à l’Université du Caire, pour leur lecture attentive et leurs remarques pertinentes. Je remercie également M. Sayed Ragab pour l’échange que nous avons eu sur le sociolecte.
Notes
-
[1]
Il est à souligner que l’arabe égyptien est compris dans presque tout le monde arabe grâce à la diffusion des différentes formes artistiques (chansons, films, feuilletons, etc.).
-
[2]
Al Khamissi, Khaled (2006/2018) : تاكسي (Taksī) [Taxi]. Le Caire : Dâr al-chorouq.
-
[3]
Al Khamissi, Khaled (2006/2009) : Taxi. (Traduit de l’arabe égyptien par Hussein Emara et Moïne Delavigne) Paris : Actes Sud.
-
[4]
Texte original :

Bibliographie
- Ali, Mohamed Saad (2016) : La traduction des expressions figées : langue et culture. Traduire. 235(2):103-123.
- Ali, Mohamed Saad (2020) : Le transfert culturel dans la traduction littéraire. Hermès. 31(9):81-120.
- Anscombre, Jean-Claude (2008) : Les formes sentencieuses : peut-on traduire la sagesse populaire ?. Meta. 53(2):253-268.
- Balliu, Christian (2007) : Cognition et déverbalisation. Meta. 52(1):3-12.
- Berman, Antoine (1984) : L’épreuve de l’étranger : culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Paris : Gallimard.
- Berman, Antoine (1999) : La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain. Paris : Éditions du Seuil.
- Blom, Marie (2022) : La traduction du non-standard : une crise identitaire. La main de Thôt. 10. http://interfas.univ-tlse2.fr/lamaindethot/1048.
- Brodsky, Françoise (1996) : La traduction du vernaculaire noir : l’exemple de Zora Neale Hurston. TTR. 9(2):165-177.
- Bruneaud-Wheal, Karen (2011) : La double contrainte du traducteur de sociolectes littéraires : entre adéquation et acceptabilité. In : Michaël Mariaule et Corinne Wecksteen, dir. Le Double en traduction ou l’(Impossible ?) entre-deux. Arras : Artois Presses Université, 49-73.
- Buzelin, Hélène (2000) : The Lonely Londoners en français : l’épreuve du métissage. TTR. 13(2):203-243.
- Chapdelaine, Annick et Lane-Mercier, Gillian (1994) : Présentation : Traduire les sociolectes : définitions, problématique, enjeux. TTR. 7(2):7-10.
- Clas, André (2011) : Théorie et enseignement de la traduction. Équivalences. 38(1-2):15-51.
- Delisle, Jean (1980) : L’analyse du discours comme méthode de traduction. Ottawa : Éditions de l’Université d’Ottawa.
- Demanuelli, Jean et Demanuelli, Claude (1995) : La traduction : mode d’emploi. Paris : Masson.
- Doss, Madiha (1996) : Réflexions sur les débuts de l’écriture dialectale en Égypte. Égypte-Monde arabe. 27-28:119-146.
- Eco, Umberto (2006) : Dire presque la même chose – Expériences de traduction. (Traduit de l’italien par Myriem Bouzaher) Paris : Éditions Grasset.
- Fournet, Sonia (2005) : Le processus argumentatif révélé par le proverbe. Travaux de linguistique. 51(2):37-54.
- Gambier, Yves (2008) : Traduire l’autre. Ela - Études de linguistique appliquée. 150(2):177-194.
- Gil-Bardaji, Anna (2010) : La résolution de problèmes en traduction : quelques pistes. Meta. 55(2):275-286.
- Herbulot, Florence (2004) : La Théorie interprétative ou Théorie du sens : point de vue d’une praticienne. Meta. 49(2):307-315.
- Herrera, José Manuel Rodrίguez (2014) : The Reverse Side of Mark Twain’s Brocade : The Adventures of Huckleberry Finn and the Translation of Dialect. European Journal of English Studies. 18(3):278-294.
- Holes, Clive (2004) : Modern Arabic Structures, Functions and Varieties. Washington : Georgetown University Press.
- Israël, Fortunato (1990) : Traduction littéraire et théorie du sens. In : Marianne Lederer, dir. Études traductologiques. Paris : Lettres modernes Minard, 29-43.
- Israël, Fortunato (2001) : Pour une nouvelle conception de la traduction littéraire : le modèle interprétatif. Traduire. 190-191:9-18.
- Israël, Fortunato et Lederer, Marianne (2005) : La théorie interprétative de la traduction. Paris : Lettres modernes Minard.
- Kleiber, George (2000) : Sur le sens des proverbes. Langages. 139:39-58.
- Kristeva, Irena (2016) : Idéologie, traduction et réécriture en bulgare. In : Astrid Guillaume, dir. Idéologie et traductologie. Paris : L’Harmattan, 21-37.
- Ladmiral, Jean-René (1994) : Traduire : Théorèmes pour la traduction. Paris : Gallimard.
- Lagrange, Frédéric (2016) : Le désir de la langue chez Yūsuf Idrīs. In : Sobhi Boustani et Marie-Aimée Germanos, dir. La littérature arabe dialectale. Paris : Éditions Karthala, 29-72.
- Lappin-Fortin, Kerry (2016) : Traduire le Black English (« C’est comme ça des fois. »). Meta. 61(2):459-478.
- Lavault-Olléon, Élisabeth (2006) : Le skopos comme stratégie de déblocage : dialecte et scotticité dans Sunset Song de Lewis Grassic Gibbon. Meta. 51(3):504-523.
- Lavoie, Judith (1994) : Problèmes de traduction du vernaculaire noir américain : le cas de The Adventures of Huckleberry Finn. TTR. 7(2):115-145.
- Lavoie, Judith (2002) : Mark Twain et la parole noire. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.
- Lederer, Marianne (1994) : La traduction aujourd’hui : le modèle interprétatif. Paris : Hachette.
- Lederer, Marianne (1997) : La théorie interprétative de la traduction : un résumé. Revue des Lettres et de Traduction. 3:11-20.
- Lederer, Marianne (1998) : Traduire le culturel : la problématique de l’explicitation. Palimpsestes : Traduire la culture. 11:161-171.
- Lederer, Marianne (2002) : Correspondances et équivalences : faits de langue et faits de discours en traduction. In : Fortunato Israël, dir. Altérité, identité, équivalence. Paris : Lettres modernes Minard, 17-34.
- Lederer, Marianne (2004) : Quelques considérations théoriques sur les limites de la traduction du culturel. Forum : Revue internationale d’interprétation et de traduction. 2(2):73-94.
- Lievois, Katrien, Noureddine, Nahed Nadia et Kloots, Hanne (2018) : Le lexique des jeunes des cités dans Kiff Kiff demain : choix traductifs en arabe, espagnol et néerlandais. TTR. 31(1):69-96.
- Margot, Jean-Claude (1979) : Traduire sans trahir. Lausanne : Éditions l’Âge d’Homme.
- Martin, Jacky (1996) : La spécification en traduction : le cas (particulier) des situatiolectes. Palimpsestes : Niveaux de langue et registres de la traduction. 10:115-123.
- Medhat-Lecocq, Héba (2021) : Terminologie comparée et traduction. Paris : Éditions des Archives contemporaines.
- Mejri, Salah (2010) : Traduction et fixité idiomatique. Meta. 55(1):31-41.
- Mounin, Georges (1963) : Les problèmes linguistiques de la traduction. Paris : Gallimard.
- Oustinoff, Michael (2003/2012) : La traduction. Paris : Presses universitaires de France.
- Pöll, Bernhard (2005) : Le français, langue pluricentrique ? Études sur la variation diatopique d’une langue standard. Francfort-sur-le-Main : Peter Lang.
- Schnyder, Peter (2013) : Comment traduire les éléments hétérogènes dans les textes littéraires ? Le problème des dialectes suisses. Synergies Pologne. 10:175-185.
- Seleskovitch, Danica (2002) : Discours de clôture. In : Fortunato Israël, dir. Altérité, identité, équivalence. Paris : Lettres modernes Minard, 359-368.
- Seleskovitch, Danica et Lederer, Marianne (1986/2014) : Interpréter pour traduire. Paris : Les Belles Lettres.
- Sumner-Paulin, Catherine (1995) : Traduction et culture : quelques proverbes africains traduits. Meta. 4(40):548-555.
- Vidal, Bernard (1994) : Le vernaculaire noir américain : Ses enjeux pour la traduction envisagés à travers deux oeuvres d’écrivaines noires, Zora Neale Hurston et Alice Walker. TTR. 7(2):165-207.
- Woodsworth, Judith (1988) : Traducteurs et écrivains : vers une redéfinition de la traduction littéraire. TTR. 1(1):115-125.
- Yao, Jean-Marc (2018) : La recherche de l’équivalent préexistant en traduction proverbiale : une démarche obsolète. Traduire. 238 :87-96.