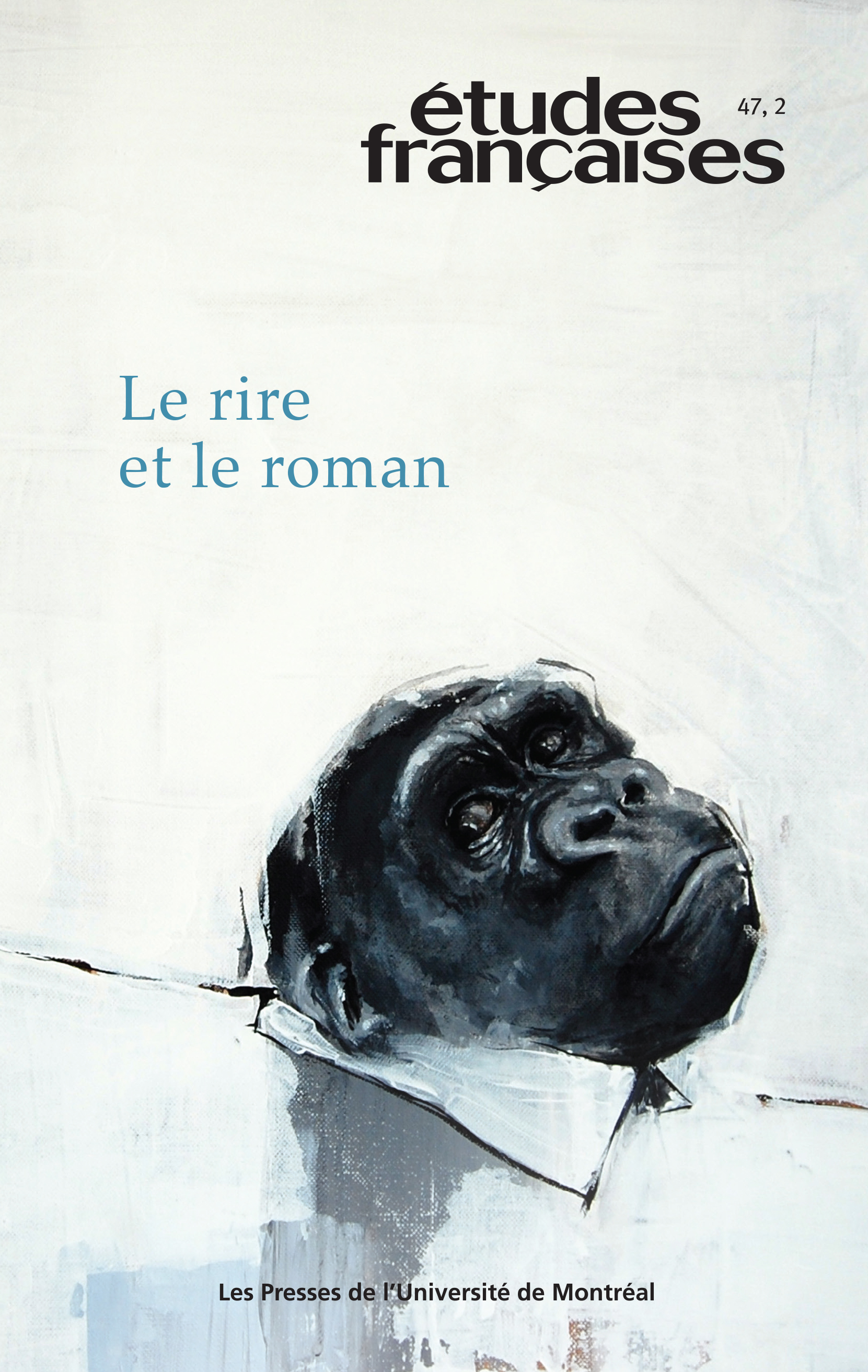Aux yeux de plusieurs historiens et critiques, le développement du roman est intimement lié à l’expression, voire à la découverte d’une forme originale de comique ou d’humour, à laquelle les oeuvres de Rabelais et de Cervantès auraient contribué de manière décisive. Pantagruel et Gargantua font entendre un rire assourdissant, hors de toute mesure, qui ouvre pour l’imagination un champ de possibilités nouvelles, l’équivalent romanesque, suggère Erich Auerbach, des grandes découvertes. Le rire rabelaisien libère le corps, continent oublié, du discrédit qui l’affligeait ; il témoigne de l’enthousiasme d’une humanité devenue la compagne des géants. Ce rire libérateur précède de quelques décennies le rire à la fois plus spirituel et plus grave du Don Quichotte de Cervantès. À l’heure du désenchantement renaissant, ce roman met en évidence, plutôt que les triomphes comiques des héros de Rabelais, le poids des limites humaines. Le chevalier errant est la proie de son imagination, maîtresse d’erreur ; son enthousiasme débordant, au contraire de celui qui anime Panurge et ses compagnons, ne manque pas de susciter l’hilarité moqueuse de son entourage. En effet, rien ne paraît plus ridicule, aux yeux des voyageurs qui peuplent les routes de Castille, qu’un homme qui, après s’être lui-même sacré chevalier, se lance à la poursuite de chimères. Entre le rire enchanté de Rabelais et le rire désenchanté de Cervantès se dessine une tension essentielle, fondamentale, qui pour plusieurs romanciers confère aux oeuvres de ces deux auteurs une valeur exemplaire. On peut penser à Flaubert, attaché comme Sterne avant lui à l’héritage cervantin, à Hugo, qui voue une grande admiration au grotesque rabelaisien, aux oeuvres d’Anatole France, d’Aymé, de Céline, de Cohen, de Queneau, qui marquent leur dette à l’égard de l’humour et de la fantaisie de Rabelais. Milan Kundera, qui accorde à l’oeuvre de Cervantès l’insigne mérite d’avoir le premier déchiré le « voile de la préinterprétation », affirme que l’histoire du roman commence avec le rire de Rabelais, « moment exceptionnel de la naissance d’un art nouveau » : avec cette oeuvre, « le papillon du roman s’envole en emportant sur son corps les lambeaux de la chrysalide ». D’ailleurs, Bakhtine estime de même que l’oeuvre de Rabelais a « grandement présidé aux destinées non seulement de la littérature et de la langue littéraire françaises, mais aussi de la littérature mondiale (probablement au même degré que Cervantès) ». Albert Thibaudet va plus loin, en ce qu’il fait du rire que font entendre les oeuvres de ces deux auteurs un attribut critique constitutif du roman : On reconnaît dans les propos de Thibaudet les termes d’une opposition entre, d’une part, le « vieux roman », c’est-à-dire ce que l’on a coutume d’appeler le roman idéaliste, et, d’autre part, le roman anti-romanesque (auquel le critique accorde de toute évidence sa préférence), opposition qui connaîtra dans les débats littéraires du xxe siècle une fortune considérable. Des études récentes contribuent à faire avancer le débat en ce qu’elles suggèrent que les « romans anti-romanesques » et les « parodies du vieux roman » évoqués par Thibaudet se retrouvent aussi parmi… les vieux romans. Même les romans de chevalerie, que la critique associe généralement au courant idéaliste, contiennent sinon des traits parodiques, du moins un certain humour. Que dire, par exemple, des fabliaux que Robert de Boron intègre à son Merlin, cet étrange devin hilare ? De la dérision dont Chrétien de Troyes témoigne à l’égard de ses personnages (le chevalier Gauvain, notamment) et de la fonction narrative elle-même, dérision en vertu de laquelle il peut, avec la complicité du lecteur, interrompre et reprendre librement le récit ? Dans un récent numéro …