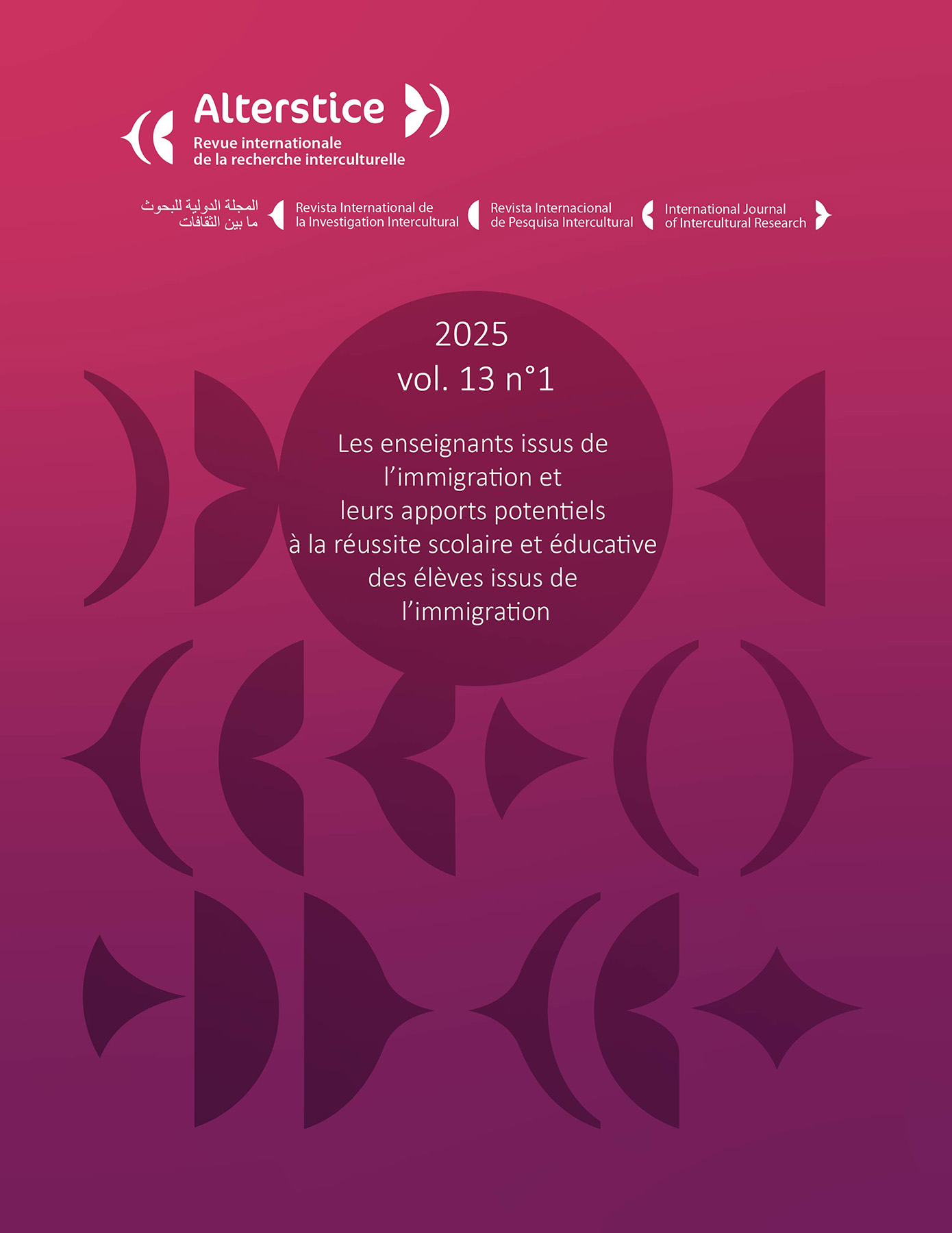Abstracts
Résumé
Dans Vers une pédagogie de la reliance en éducation avec Möbius et Morin, publié en 2024, Henri Vieille-Grosjean et Patrick Prignot proposent une réflexion philosophique sur l’application des concepts du ruban de Möbius et de la notion de reliance d’Edgar Morin à la pédagogie. Les auteurs soulignent que la figure de Möbius illustre l’interconnexion circulaire et continue des divers éléments d’un phénomène social, où les frontières entre début et fin deviennent floues. Les concepts du ruban de Möbius et de la reliance de Morin sont utilisés comme des métaphores permettant d’explorer la complexité des dynamiques éducatives, qui peuvent se révéler à la fois complémentaires et paradoxales.
Mots-clés :
- pédagogie,
- reliance,
- Möbius,
- complexité,
- apprentissage,
- philosophie
Article body
Présentation
Henri Vieille-Grosjean est anthropologue de l'éducation, enseignant-chercheur en sciences humaines à l'Université de Strasbourg. Aussi bien en Afrique qu'en France, ses domaines de recherche et ses investissements en formation sont tournés vers la pédagogie de l'intervention sociale. Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation, Patrick Prignot est professeur agrégé de mathématiques en classes préparatoires à Strasbourg. Ses travaux portent notamment sur l’apprentissage en classe inversée ainsi que sur l’évaluation en milieu scolaire.
Dans Vers une pédagogie de la reliance en éducation avec Möbius et Morin, publié en 2024, Henri Vieille-Grosjean et Patrick Prignot proposent une réflexion philosophique sur l’application des concepts du ruban de Möbius et de la notion de reliance d’Edgar Morin à la pédagogie. Les auteurs soulignent que la figure de Möbius illustre l’interconnexion circulaire et continue des divers éléments d’un phénomène social, où les frontières entre début et fin deviennent floues. Dans cette perspective, les relations entre les individus, les institutions et les normes sociales sont envisagées comme des processus réciproques et dynamiques, en constante interaction. Aux origines de cet ouvrage, les auteurs précisent que leur objectif est double. D’une part, ils cherchent à démontrer comment la bande de Möbius, bien qu’originaire du domaine des mathématiques, peut transcender ce cadre pour être envisagée comme une pratique pédagogique. D’autre part, cette figure permet de redécouvrir les attributs et les attentes de la pensée complexe, en offrant une vision globale et interconnectée des phénomènes. Les concepts du ruban de Möbius et de la reliance de Morin sont ainsi utilisés comme des métaphores permettant d’explorer la complexité des dynamiques éducatives, qui peuvent se révéler à la fois complémentaires et paradoxales.
Première partie : « Découverte et apprivoisement »
Le livre est divisé en deux parties. La première partie, intitulée « Découverte et apprivoisement », est elle-même divisée en quatre sections.
L’histoire de la figure de Möbius (1.1)
La première section s’intitule « L’histoire de la figure de Möbius » (1.1), qui doit son nom à August Ferdinand Möbius, un mathématicien et astronome allemand ayant formulé ses propriétés en 1858. Pour créer cette figure, il s’agit de prendre une bande de papier rectangulaire, lui appliquer une torsion d’un demi-tour, puis relier ses deux extrémités, générant ainsi une surface unique avec une seule face et un seul bord. Cette structure non orientable est utilisée par les auteurs pour symboliser des relations de pouvoir circulaires et interconnectées. Dans une hiérarchie sociale ou politique, le pouvoir et l’opposition peuvent alors être perçus comme des forces qui coexistent et s’entrelacent dans une relation réciproque et circulaire.
Les auteurs expliquent que la structure unique et topologique de la bande de Möbius permet de représenter la complexité. Sa surface non orientable, ayant une seule face et un seul bord, symbolise l’idée que des phénomènes apparemment opposés ou distincts peuvent être interconnectés de manière fluide et continue. Cette structure illustre comment des éléments, bien que différents, se fondent en un tout indivisible, unissant des forces opposées dans une dynamique commune. De plus, la forme du ruban, qui s’enroule sur lui-même, représente la non-linéarité des systèmes complexes. Les causes et effets dans ces systèmes ne suivent pas un parcours direct ou prévisible, mais les éléments interagissent de manière circulaire, se nourrissant mutuellement, sans qu’il soit possible de définir un point de départ ou de fin. Ce phénomène rejoint les principes de la pensée systémique, qui met l’accent sur les dynamiques globales plutôt que sur des composants isolés. La bande de Möbius illustre également les boucles de rétroaction caractéristiques des systèmes complexes de Morin. Dans ces systèmes, chaque action ou événement influence continuellement d’autres parties du système, mettant en évidence l’interdépendance des éléments.
Cette première section se conclut en soulignant la structure de la bande de Möbius, qui réunit des propriétés opposées en une seule entité, et sert de métaphore pour les ambiguïtés et paradoxes inhérents aux phénomènes complexes. Cela incarne la résistance des systèmes complexes à une compréhension simple ou binaire, où des opposés tels que l’individuel et le collectif, le bien et le mal coexistent et s’entrelacent de manière dynamique. Ainsi, la bande de Möbius offre une illustration des systèmes complexes, dans lesquels les éléments sont en constante interaction et interdépendance. Cette représentation suggère que la compréhension de ces systèmes doit intégrer des perspectives multiples et souvent paradoxales.
« Au commencement était la complexité » (1.2)
Les auteurs utilisent le ruban de Möbius pour développer la réflexion sur le principe de reliance proposé par Edgar Morin. Ce principe vise à comprendre les systèmes et phénomènes de manière holistique et interconnectée, en insistant sur l’importance des relations entre les différentes parties d’un tout. Morin plaide pour une remise en question des approches linéaires et fragmentées de l’analyse des phénomènes, en mettant en avant la nécessité de considérer les relations dynamiques et parfois paradoxales entre les éléments d’un système.
Dans le domaine éducatif, le principe de reliance dépasse la simple transmission de savoirs. Il promeut une approche de l’éducation qui prend en compte les interactions entre les individus, les savoirs et l’environnement. Les relations humaines et sociales jouent ainsi un rôle central dans le processus d’apprentissage. Morin insiste sur le fait que l’apprentissage n’est pas seulement un processus cognitif, mais qu’il se construit aussi à travers des liens affectifs, sociaux et relationnels. Le principe de reliance conduit à une vision systémique dans laquelle il est impossible de comprendre un phénomène sans tenir compte de l’ensemble de ses relations et interactions.
« Approche descriptive » (1.3)
Dans cette section, les auteurs présentent divers découpages possibles du ruban de Möbius, illustrés à la fin de l’ouvrage. Ces schémas permettent de mieux visualiser les mouvements qu’ils proposent, transformant le binaire ou le hiérarchique en circulaire et itératif.
« Approche analogique » (1.4)
Cette approche d’autoréflexion servirait de posture pédagogique, en facilitant les interactions entre personnes ou groupes aux cultures et vécus divers. La reconnaissance de l’autre devient essentielle à la connaissance de soi, un processus en constante transformation, autorisant les échanges entre différentes injonctions, parfois perçues comme paradoxales. Les auteurs concluent cette première partie du livre en soulignant que leur proposition peut aussi servir pour réfléchir à des phénomènes sociétaux plus larges, au-delà du cadre scolaire. Ils abordent également l’interdisciplinarité que favorise le principe de reliance de Morin, facilitée par les analogies permises par la bande de Möbius, comme ouvrant la voie à une forme de médiation entre les savoirs.
Seconde partie : « Approfondissement et complexité »
La seconde partie du livre, « Approfondissement et complexité », est également divisée en quatre sections.
« Approche analytique » (2.1)
Cette section fait référence au fait qu'un mathématicien construit ses objets en tant que formules autonomes, soit un concept abstrait qui ne fonctionne que dans sa dynamique propre, tel l’objet mathématique que forme le ruban de Möbius. Selon les auteurs, ce qui est remarquable, c'est que, lorsqu’ils sont transposés dans différents contextes, les résultats théoriques peuvent être utilisés comme analogies à des réalités concrètes. Toujours selon les auteurs, l’aspect systémique permet également de décrire la complexité et d’en comprendre certains aspects, pouvant éclairer sous d’autres angles certaines possibilités d'agir, comme dans un continuum.
« Approche épistémologique » en compagnie d’Edgar Morin » (2.2)
Cette section résume les idées d’Edgar Morin, notamment sa conception de la complexité, définie comme un tissu composé de divers éléments hétérogènes, inséparablement liés, créant ainsi le paradoxe entre le tout et ses parties. Selon lui, la complexité ne peut se réduire à des explications simples et linéaires. Elle nécessite une approche qui dépasse les cadres traditionnels comme le dualisme, le cartésianisme, le positivisme et le déterminisme, qui, bien que sources d'avancées scientifiques, montrent leurs limites lorsqu'il s'agit de saisir le vivant dans ses itérations, son caractère dynamique. Morin introduit alors le concept d’émergence, désignant le phénomène par lequel le tout est différent de la somme de ses parties, soulignant que le découpage en disciplines séparées empêche de rendre compte de certains phénomènes. Pour Morin, la science doit dépasser le cloisonnement des savoirs et elle doit établir des ponts entre les différentes disciplines, en favorisant l'interdisciplinarité et la « reliance ». Cela implique de relier les contradictions et les incertitudes, d'accepter la non-linéarité des phénomènes et de recourir parfois à des métaphores, comme pourrait l’être le ruban de Möbius, selon les auteurs. Ce type d’approche évoque les niveaux d’abstraction de l’apprentissage chez Gregory Bateson — « la différence qui crée une différence », comme le souligne Sylvie Genest dans Le changement d’état d’esprit » : une étude à partir de la pensée systémique de Gregory Bateson (Genest, 2022), ainsi que la pensée de Morin dans La méthode (Morin, 1977).
Alors peut-être aurons-nous pu apprendre à apprendre à apprendre en apprenant. Alors le cercle aura pu se transformer en une spirale où le retour au commencement est précisément ce qui éloigne du commencement »
Morin, 1977, t.1, p. 22
« Approche éducative, trois fondamentaux de l'acte d'apprendre » (2.3)
En réfléchissant à la manière dont l’apprenant et l’éducateur peuvent interagir dans un processus d’apprentissage dynamique et interconnecté, les auteurs posent trois concepts qu’ils considèrent comme fondamentaux pour une pédagogie de la reliance. Ils mettent d'abord en avant l'importance de 1) la relation entre l'apprenant et l'éducateur, soulignant que cette interaction est au coeur du processus d'apprentissage. L'apprentissage est également perçu comme 2) un processus collaboratif où l'apprenant et l'éducateur co-construisent ensemble les connaissances. Enfin, les auteurs insistent sur la nécessité de 3) la réflexivité, c'est-à-dire que les acteurs de l'éducation doivent réfléchir sur leurs pratiques et leurs interactions, favorisant ainsi un apprentissage profond et significatif.
« Entre dispositifs » (2.4)
Pour clore cette seconde partie, ils proposent une réflexion sur le dispositif de la médiation et l'utilisation de la métaphore du ruban de Möbius, soulignant qu’en éducation, rien n’est acquis de manière définitive; les dispositifs doivent évoluer pour s’enrichir, en favorisant une nouvelle économie du savoir entre subjectivité et pragmatisme.
La notion de médiation, est également analysée à travers une perspective philosophique et théologique, faisant une analogie avec la figure de Satan dans le récit biblique. Plutôt que d'être un simple agent du mal, Satan pourrait être vu comme celui qui introduit l’intelligence. Par la transgression, il permettrait à l’humanité de prendre conscience d’elle-même, transformant ainsi l’acte de médiation en un processus fondateur de l’humanité. Un long pèlerinage intellectuel qui semble réitérer que l'éducation, comme la médiation, doit intégrer et dépasser les oppositions tout en permettant une évolution constante des savoirs et des pratiques... Tel qu’exposé tout au long du livre.
Conclusion de l’ouvrage : une méta-métaphore
Dans leur conclusion, les auteurs développent les concepts de ruban de Möbius et de "reliance" comme une méta-métaphore pour mieux comprendre les dynamiques de l’action humaine et de l’apprentissage. Ce ruban, qu’ils décrivent comme le résultat d’une torsion et d’une perturbation, symbolise ainsi le passage d’une dualité figée et limitante à une ternarité dynamique, qui favorise une vision plus complexe et fluide du monde. En ce sens, ils proposent de remplacer les oppositions rigides par une dynamique plus souple, où les éléments, loin d’être isolés, se relient et se transforment de manière continue et interconnectée.
Présentée comme un outil théorique pour appréhender ces dynamiques, l’autopoïèse, qui désigne la capacité des systèmes vivants à se reconstruire, serait un processus permettant aux individus et aux sociétés de résister aux forces de stagnation et de redéfinir leur espace de vie. Cette dynamique permettrait donc de transcender l’apparente dichotomie entre vie et mort, par exemple, et de concevoir les processus humains et éducatifs comme un mouvement continu de transformation et de réinvention.
Les auteurs critiquent les conceptions simplistes de la motivation et de la résilience, qui seraient trop souvent des formes de réponses passives aux difficultés. Pour eux, la motivation ne réside pas simplement dans une réponse à des événements déclencheurs, mais dans une volonté active de s’engager malgré les obstacles. De même, la résilience n’est pas une simple résistance face à l’échec, mais un processus de transformation personnelle, souvent nécessitant des sacrifices. Ils soulignent que ce processus se rapproche de la métanoïa, qui implique une transformation profonde de l’individu, passant par la mort symbolique de certaines représentations et la naissance d’une nouvelle identité.
Le ruban de Möbius, en transformant le binaire en circulaire et itératif, permet donc aux auteurs d’illustrer la complexité des mouvements entre motivation, renoncement, résilience et mobilisation, ce qui permettrait une perspective unifiée de l’existence, intégrant à la fois les concepts d’anamnèse, illustrés comme le processus de se souvenir ou de se rappeler des événements passés, notamment dans le cadre de la psychologie ou de la philosophie, ainsi que les concepts de métanoïa et d’autopoïèse. Selon les auteurs, ce modèle offre une lecture dynamique et complexe des processus éducatifs, où les identités et les savoirs se réinventent à travers l’action collective et l’engagement personnel.
Compléments
En guise de « Bouquet final » est proposée une post-face de Jacques Demorgon, « philosophe et sociologue ayant conduit des recherches sur les terrains interculturels de l'Europe et des entreprises dans la mondialisation » (Demorgon, s.d.), post-face suivie d’un post-scriptum, ces deux éléments permettant ensemble l’approfondissement des paradigmes à partir desquels certains termes ou concepts sont articulés. Cela permet une meilleure compréhension de certaines terminologies et analogies présentées au cours de l’ouvrage, parfois très nichées. Les illustrations des différentes manipulations du ruban de Möbius sont également pertinentes afin de bien suivre comment cette proposition se voit construite.
Apports et limites de l’ouvrage
Si la métaphore du ruban, couplée au principe de reliance de Morin, s’avère éclairante, elle l’est davantage en tant que posture philosophique face à la diversité qu’en tant qu'outil pédagogique applicable en milieu scolaire. Les auteurs utilisent souvent un langage qui pourrait être simplifié, ce qui complexifie la compréhension de concepts plutôt simples, bien que déjà modélisés. Comme lorsqu’un mathématicien crée une formule, ce que Kant appelait une « intuition pure » — signifiant un concept qui ne fonctionne que dans sa propre forme logique —, cet ouvrage propose un paradigme faisant de la différence un principe de reliance, un dénominateur commun à toutes les différences. Cet ouvrage représente un effort pour relier, pour sortir d’une tendance à penser les choses en opposition; en revanche, il ne permet pas suffisamment de rendre compte des inégalités économiques et sociales qui continuent de nous différencier. Les auteurs proposent donc une réflexion théorique et conceptuelle qui devient difficilement transposable de manière appliquée en milieu scolaire, mais demeure intéressante si elle est abordée comme un effort d’autoréflexivité.
Appendices
Bibliographie
- Demorgon, J. (s.d.). Présentation [page du site officiel de Jacques Demorgon]. https://www.jacques-demorgon.com/
- Genest, S. (2022). Le « changement d’état d’esprit »: une étude à partir de la pensée systémique de Gregory Bateson [thèse de doctorat, Univeristé de Montréal]. Papyrus. http://hdl.handle.net/1866/27428
- Morin, E. (1977). La méthode (6 tomes). Éditions du Seuil.