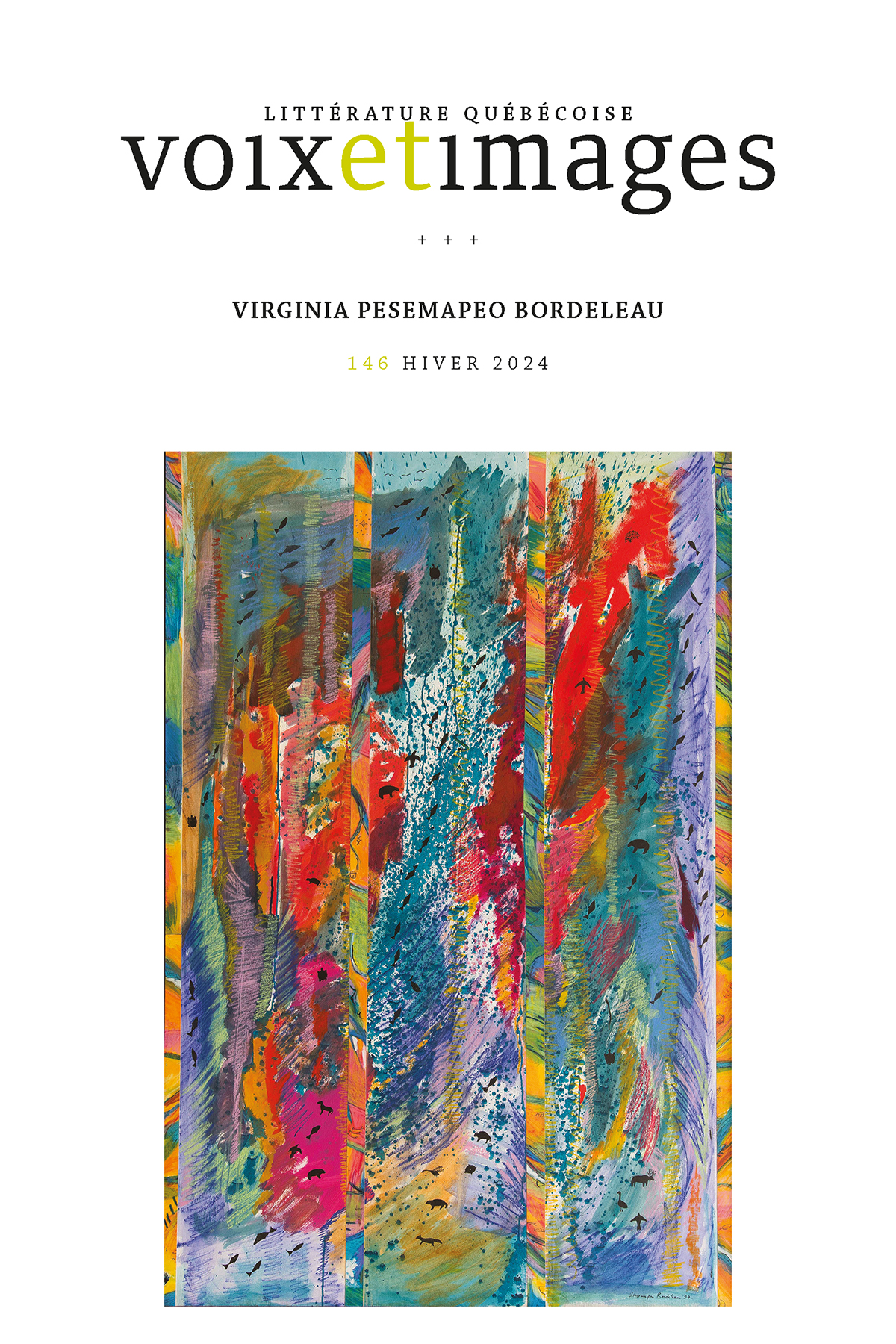En 1991, dans un texte paru à l’occasion du premier dossier que Liberté consacrait aux voix autochtones, et ce, au terme d’une trentaine d’années d’existence de la revue, l’autrice eeyou et anishinaabe Virginia Pesemapeo Bordeleau refusait le statut d’écrivaine : elle se disait avant tout artiste peintre. La dernière phrase du passage cité en exergue est à cet effet parlante : l’autrice souligne ne pas écrire pour « la littérature ». A posteriori, et alors que l’écrivaine s’est vue décerner, au printemps 2024, un doctorat honorifique de l’Université de Moncton pour sa carrière d’écrivaine et d’artiste, qu’est-ce qu’un geste d’écriture qui ne serait pas littéraire ? Ce que la citation révèle peut-être, c’est que l’écriture est d’abord (à tout le moins, elle l’était, il y a plus de trente ans) un acte de (sur)vie et d’expression de soi. Elle ne se fonde pas sur la volonté de s’inscrire dans une histoire de la littérature ni de consacrer cette dernière, à un moment (le début des années 1990) où l’existence même d’une littérature autochtone est mise en doute. Comment donc écrire pour la littérature alors que d’aucuns diront que cette littérature, celle des Premiers Peuples, n’existe pas ? Si cette littérature peut aujourd’hui être replacée dans une histoire littéraire plus large, l’écriture représente plutôt, pour l’autrice, dans l’expression qu’elle en fait, une occasion de se dire, de guérir et de penser le monde depuis un espace à et pour soi. Si cette conception de l’écriture est déjà esquissée dans « Des opinions et de l’expérience » (1991), elle est plus explicitement mise en scène dans le prologue qui ouvre De rouge et de blanc, le premier recueil de poésie de Pesemapeo Bordeleau publié en 2012 : Dans ces lignes se trace une amorce à l’écrit, mais surtout un véritable récit de création, à entendre dans son sens double : un récit sur la création littéraire et un récit étiologique qui explique la mise au monde par et dans l’écriture, et ce, à travers un jeu sur les codes judéo-chrétiens du récit créationniste. L’affect, dans sa dimension la plus personnelle, est compris comme premier et l’écriture seconde, au contraire du trope du récit biblique dans lequel c’est le langage qui crée le monde. Ici, c’est l’écriture qui devient le lieu d’inscription et de traduction d’une pensée affective préalable et au plus près de l’intime de ce « tremblement intérieur » évoqué par la poète. Mais la pensée de l’écriture qui se développe dans le passage cité est aussi relationnelle, tournée vers l’autre, vers la communauté. Si elle part d’un frémissement originel comme lieu singulier de l’affect, elle se prolonge également dans un double désir : celui d’écrire la mémoire collective des peuples autochtones et, plus encore, des membres de la famille, mais aussi celui de faire une place aux femmes, à leur histoire autrement oubliée, tue, voire effacée. Cet engagement au féminin, on le retrouve notamment dans la « Déclaration de paix des femmes », un texte poétique coécrit avec l’écrivaine québécoise et féministe Hélène Pedneault et qui occupe près de la moitié du recueil. Dans ce texte qui critique la vision patriarcale de l’histoire, spécifiquement sur le plan politique, les deux poètes évoquent le travail invisible et invisibilisé des femmes, en particulier des femmes autochtones : Si l’on retient de l’histoire telle qu’elle a été consignée que la Grande Paix de Montréal a été entérinée en 1701 par les Français et les Cinq Nations haudenosaunee, les autrices rappellent que le traité a été mis en place avec comme seuls témoins des hommes, en l’absence des femmes qui, elles, étaient …
SITUER LES ÉCRITS DE VIRGINIA PESEMAPEO BORDELEAU DANS L’HISTOIRE DES LITTÉRATURES AUTOCHTONES AU QUÉBEC[Record]
…more information
Marie-Ève Bradette
Université Laval
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ)
Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA)