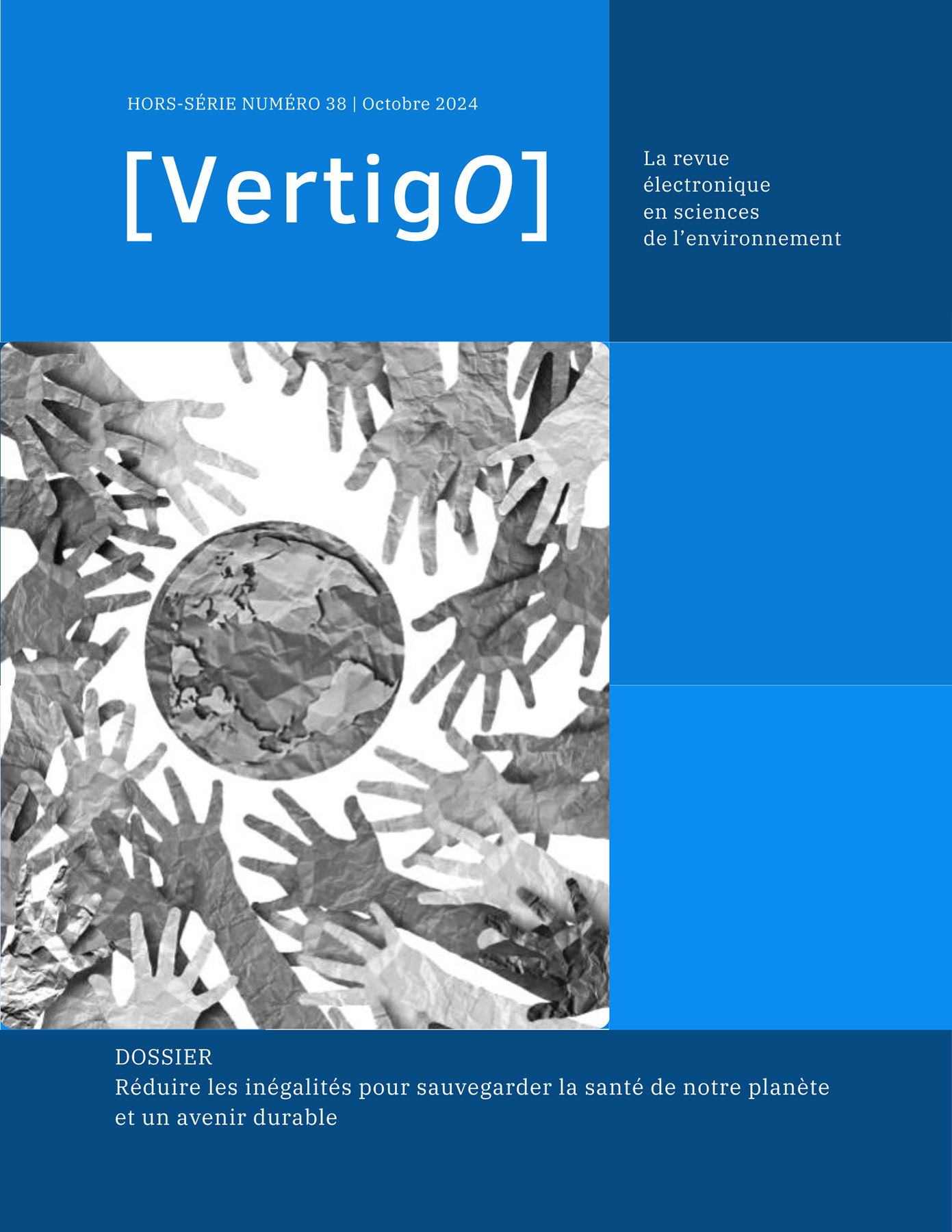Abstracts
Résumé
À l’échelle mondiale, certaines pratiques agricoles ont simplifié les écosystèmes en réduisant la biodiversité de façon irréversible. Or, la perte de biodiversité constitue une menace pour tous les êtres humains, et plus particulièrement pour les populations qui dépendent étroitement de ressources naturelles variées. Par conséquent, le besoin de concilier production agricole et maintien de la biodiversité est criant, comme en témoigne le débat scientifique opposant le land sparing au land sharing. Chacune de ces approches propose une perspective ; la première propose d’intensifier l’agriculture et de créer des aires de conservation séparées, la deuxième cherche à mieux imbriquer les fonctions de la biodiversité dans les systèmes agricoles. Bien que ces approches soient importantes dans le développement de connaissances scientifiques, l’incidence de ce débat pour la formulation de politiques publiques peut être lourde de conséquences. À titre d’illustration, l’approche du land sparing peut encourager des mesures favorables aux acteurs de l’intensification agricole et défavorables aux petits exploitants en systèmes extensifs disposant de ressources limitées. Ainsi, la dualité sur laquelle le débat du land sparing contre le land sharing repose tend à limiter l’attention accordée aux divers contextes socioéconomiques et écologiques étudiés. Nous proposons, par considération éthique à l’égard des populations plus vulnérables et moins représentées dans ce type de recherche, de dépasser le débat en lui-même afin d’éviter d’imposer une approche plutôt que l’autre. Il semble préférable de considérer au premier chef les caractéristiques propres à chaque contexte agricole, ainsi que les relations qui se tissent entre agriculteurs et biodiversité.
Mots-clés :
- land sparing,
- land sharing,
- biodiversité,
- recherche scientifique,
- vulnérabilité,
- complexité,
- agriculture,
- contexte socioéconomique,
- conservation,
- utilisation du territoire
Abstract
Biodiversity loss is a threat to human survival and more explicitly to populations that are closely dependent of various natural resources. Particular agricultural practices have irreversibly simplified ecosystems, affecting global biodiversity. Likewise, the compelling necessity to conciliate biodiversity and agriculture has led to the production of valuable scientific knowledge, such as the land sparing versus land sharing debate. The land sparing approach promotes the intensification of agriculture and the creation of biodiversity conservation areas, while the land sharing approach tends to value functional biodiversity into agricultural systems. The impact of this debate in the elaboration of policies needs to be considered with caution. For example, land sparing can lead to measures that either enable actors that practice substantial intensive agriculture or disadvantage smaller farmers with limited resources. The duality on which the land sparing vs. land sharing debate is articulated tends to limit the attention given to more nuanced arguments. Out of ethical consideration for the less affluent and represented populations in this specific research display, we suggest to overcome the state of debate in order to avoid imposing one approach over the other. For future research prospects, it seems to be preferable to study socio-economical contexts in which agriculture is practiced, as well as the specific relationships between farmers and biodiversity.
Keywords:
- land sparing,
- land sharing,
- biodiversity,
- scientific research,
- vulnerability,
- complexity,
- agriculture,
- socio-economical context,
- conservation,
- land use
Article body
Introduction : besoin de concilier biodiversité et agriculture pour faire face à la crise écologique
La biodiversité, soit la diversité du vivant sur Terre, subit présentement sa dégradation la plus marquée depuis le début de l’humanité (Rampino et Shen, 2021). Les causes principales de cette destruction se rapportent, entre autres, à l’agriculture, du fait que plusieurs modèles agricoles simplifient les écosystèmes et réduisent les fonctions de la biodiversité de façon irréversible (Le Roux et al., 2012). Globalement, l’agriculture affecterait la biodiversité principalement par cumul de conversion permanente de milieux naturels en terres cultivées, ainsi que de certaines pratiques culturales et d’aménagement, dont les monocultures ou encore le drainage des terres (FAO, 2020 ; IPBES, 2019 ; Le Roux et al., 2012). Or, pour répondre à l’évolution des habitudes de consommation mondiales, la production agricole poursuit sa croissance en termes de superficie, ainsi que son développement technique (Glamann et al., 2017). Dans de telles conditions, le déclin de la biodiversité risque de continuer, voire de s’accentuer (Dudley et Alexander, 2017).
En contexte de crise écologique mondiale, les sciences, en tant que système de production de connaissances vérifiables, sont directement interpelées dans cette quête de solutions pour aborder la protection de la biodiversité mondiale (UNESCO, 2021 ; Schmeller et al., 2017). D’ailleurs, la littérature scientifique offre de nombreuses approches pour concilier la protection de la biodiversité et le développement de l’agriculture (comme évoqué dans Bàrberi et Moonen, 2020). Nous proposons un regard critique sur un des débats prégnants au sein de la communauté scientifique opposant le land sparing au land sharing. Si ce débat a pris place principalement en anglais, on pourrait le présenter en français comme l’opposition entre les approches favorables à une utilisation parcimonieuse et intensive des terres à des fins agricoles pour mieux protéger les milieux naturels non affectés par l’agriculture (land sparing) ; et les approches qui préconisent plutôt une intégration entre fonctions de production agricole et maintien de la biodiversité au sein d’un même territoire (land sharing) (Tscharntke et al., 2012 ; Phalan et al., 2011).
En observant ce débat à travers le prisme de la gouvernance de la biodiversité, nous avons élaboré cette réflexion par une analyse de contenu d’articles de revues scientifiques de tous domaines confondus mentionnant explicitement le land sparing ou le land sharing ; ceux-ci ayant été identifiés par une revue narrative exhaustive, mais non systématique de la littérature scientifique produite entre 1980 et 2023. Les articles retenus dans cette étude l’ont été sur la base de leur pertinence afin de comprendre les avis des divers auteurs dans le débat. Des critères d’inclusion et d’exclusion ont donc été utilisés de façon implicite par la première auteure de cet article qui a effectué le choix des articles (Mateo 2020). Il s’agit dans ce sens d’une revue narrative de la littérature réalisée d’un point de vue critique, dans ce cas-ci pour interroger et puis démontrer les limites de la dualité opposant les deux versants du débat (Jahan et al, 2016). Comme étudié par Loconto et al. (2020), les concepts de land sparing et de land sharing ont évolué depuis leur apparition respective dans la littérature à la fin des années 1980 et en 2011. Leur sens et l’utilisation qu’en font les auteurs ont évolué, tout comme les divers acteurs impliqués dans la discussion (Loconto et al., 2020). La méthode employée vise à rendre compte de la complexité des concepts et de l’usage dont ils font l’objet dans la littérature scientifique cernée.
Les connaissances produites par divers domaines scientifiques (agronomiques, économiques, écologiques…) sur le land sparing ou le land sharing sont fréquemment élaborées dans une approche prescriptive (par exemple Macchi et al., 2020 ; Grass et al., 2019 ; Salles et al., 2017 ; Hulme et al., 2013). Elles visent des applications concrètes, ou à alimenter la recherche d’avenues prometteuses afin de concilier les ambitions mondiales de protection de la biodiversité et de production agricole, et ce, entre autres pour subvenir à une sécurité alimentaire mondiale. Comme démontré par Turnhout et al. (2016) au niveau des processus décisionnels internationaux en faveur de la biodiversité, les savoirs scientifiques ont une portée normative (elles définissent ce qui est souhaitable et ce qui ne l’est pas).
Dans notre perspective analytique sur le débat du land sparing contre le land sharing, nous insistons sur le fait que les connaissances scientifiques revêtent un intérêt politique particulier (Loconto et al., 2020 ; Perfecto et Vandermeer, 2012). En effet, elles concernent ultimement l’utilisation concrète des terres et les modèles agricoles soutenus par les autorités. De plus, nous avançons qu’il existe un potentiel que les connaissances scientifiques générées dans le cadre du débat soient instrumentalisées pour des intérêts particuliers afin de légitimer un modèle agricole plutôt qu’un autre, et ce, aux dépens des intérêts de populations souvent plus vulnérables qui sont moins nanties. D’un point de vue socioéconomique et écologique, les populations moins nanties provenant souvent des pays du Sud, sont moins bien représentées dans les connaissances scientifiques nourrissant le débat (Loconto et al., 2020). Ainsi, le risque que la diversité des pratiques agricoles et des modes de subsistance soit peu visible dans les connaissances scientifiques, qui sous-tend l’élaboration de politiques agricoles, parait bien réel. À titre d’illustration, certaines mesures d’intensification agricole dans les pays à faible niveau de revenu, sous prétexte de favoriser le land sparing, pourraient avoir des conséquences néfastes sur les ménages n’étant pas en mesure d’adopter de nouvelles pratiques agricoles, pour des raisons d’ordre socioéconomique. Les conséquences de cette intensification agricole sur la biodiversité pourraient être importantes et inégalement réparties, bien que difficiles à prédire, considérant le caractère dynamique des écosystèmes agricoles (García et al., 2020).
Dans l’optique où des connaissances scientifiques influencent les orientations politiques, nous proposons de prendre une certaine distance envers les positions tranchées dans le débat du land sparing contre le land sharing. Ces positions peuvent être accompagnées d’interprétations erronées et d’une utilisation tendancieuse des résultats scientifiques. Dans leur ouvrage, Loconto et al. (2020) insistent sur le fait que les résultats scientifiques à eux seuls ne peuvent expliquer la prééminence du land sparing par rapport au land sharing dans les politiques. Par cet argumentaire, nous souhaitons porter une attention particulière au rapport entre la science et les politiques qui influencent les modèles agricoles et les rapports à la biodiversité. Nous proposons de dépasser le dualisme entre le land sparing et le land sharing par considérations éthiques à l’égard des populations vulnérables subissant les conséquences de rapports inégalitaires dans l’accès aux ressources. Nous considérons qu’un ensemble de facteurs, comme les conditions socioéconomiques, la tenure, les rapports historiques des collectivités avec les agroécosystèmes, devraient être considérés au premier chef, avant toutes propositions relatives au land sharing ou au land sparing. L’article est structuré ainsi : dans un premier temps nous présentons le contexte dans lequel s’inscrit le débat ; dans un second, nous insistons sur la polarisation des deux camps ; dans un troisième, nous explorons les conséquences de ce débat pour la formulation des politiques relatives à la gouvernance de la biodiversité ; finalement dans la discussion, nous élaborons sur l’importance de tenter de dépasser cette dualité, sans pour autant remettre en question la valeur du travail de recherche effectué dans le cadre de ce débat.
Concilier biodiversité avec agriculture : un défi contextuel et pressant
Concilier la biodiversité et l’agriculture est une affaire complexe qui relève de divers domaines, comme la biologie, l’aménagement du territoire, l’agronomie, la sociologie, l’ingénierie et l’économie (García-Vega et al., 2024). Le défi de cette conciliation est non seulement d’arrimer des domaines d’intervention aux connaissances scientifiques plus fondamentales, mais aussi de les mettre en relation avec les réalités sociales (par exemple institutions, et modes de fonctionnement collectif), économiques (par exemple prévalence de la pauvreté et appuis financiers des autorités) et culturelles (par exemple les systèmes de connaissances traditionnelles, langues et valeurs) des populations visées par les mesures à mettre en place (García-Vega et al., 2024 ; Desquilbet et al., 2017 ; Tscharntke et al., 2012). C’est ce que nous qualifions de contexte socioéconomique.
D’une part, les biens et services fournis par la biodiversité sont essentiels à la survie des humains (IPBES, 2019). Ils permettent, entre autres, de réguler le climat, de pourvoir des médicaments, de fournir de la matière première et de créer des habitats (IPBES, 2019). Ainsi, la biodiversité contribue significativement au bien-être des populations humaines ainsi qu’à la sécurité alimentaire mondiale (Marselle et al., 2021 ; Pilling et al., 2020 ; Tilman et Clark, 2015). Par le fait même, une perte de biodiversité nuit à tous les êtres humains et constitue une menace particulièrement aigüe pour les populations qui dépendent directement de ressources naturelles variées, comme les exploitants agricoles familiaux ou les collectivités forestières (IPBES, 2019 ; Tilman et Clark, 2015). Selon l’IPBES (2019) le besoin de préserver la biodiversité relève d’une motivation existentielle.
D’ailleurs, à l’échelle internationale, les individus et collectivités les plus exposés aux conséquences d’une perte de biodiversité proviennent majoritairement de milieux défavorisés sur le plan matériel (Roy et al., 2018 ; Reid et Swiderska, 2008). Pour illustrer ceci, Noack et al. (2019) ont démontré que les milieux ruraux de nombreux pays du Sud sont plus susceptibles à la sècheresse lorsque la biodiversité naturelle y est réduite en raison de la dégradation des écosystèmes ; ce qui vient directement diminuer les revenus et la qualité de vie des collectivités. Essentiellement, ces chercheurs ont observé un lien statistique entre faibles revenus, activités agricoles et perte de biodiversité dans les pays du Sud. Sans définir de rapport de causalité, cette étude permet d’avancer que la perte de biodiversité peut ainsi avoir un lien avec la pauvreté en contexte agricole (Noack et al., 2019 ; Roy et al., 2018). Dans le même sens, protéger la biodiversité implique d’éviter l’accroissement des inégalités socioéconomiques qui pourraient survenir par des interventions de conservation qui auraient pour conséquence l’exclusion de populations des terres qu’elles cultivent (tels les exemples abordés dans Blanc, 2020 ; Scott, 2020 ; Li, 2007). Envisager une protection pérenne de la biodiversité ne peut se faire sans considération des réalités humaines qui y sont imbriquées.
D’autre part, plusieurs caractéristiques influencent la biodiversité au sein des systèmes agricoles, dont la taille des exploitations, la diversité des cultures, les objectifs agricoles des exploitants, les réalités foncières, et les systèmes de production intensifs ou extensifs (Cozim-Melges et al., 2024 ; Chaléard, 2010). D’ailleurs, celles-ci sont abondamment traitées dans la littérature scientifique. Cependant, il est délicat pour la communauté scientifique de définir distinctement des solutions pratiques et de portées générales du fait que les systèmes agricoles varient en fonction des contextes socioéconomiques et écologiques (García-Vega et al., 2024 ; Perfecto et al., 2019b). En effet, l’utilisation du territoire, les objectifs et les retombées de productions agricoles varient entre les régions du globe et selon les productions (Meiyappan et al., 2014). Il existe à cet égard des différences agricoles notoires entre les pays à haut niveau de revenu, souvent localisés dans l’hémisphère nord où dominent des systèmes d’exploitation intensifs à grande échelle, et les pays à faible niveau de revenu, généralement au Sud, dominés en nombre par des petits exploitants avec des systèmes de production mixtes, vivriers et commerciaux (Peemans, 2018). Ainsi, il s’avère difficile d’émettre des propositions générales pour l’application d’une agriculture compatible avec la protection de la biodiversité. La portée des résultats des analyses scientifiques traitant du maintien de la biodiversité en agriculture est nécessairement limitée au-delà de ce contexte spécifique (Law et Wilson, 2015).
En ce sens, il nous semble raisonnable de limiter les risques que des mesures visant à favoriser le maintien de la biodiversité en contexte agricole n’entraînent des écueils pour les populations les plus vulnérables. Par exemple, le coût de l’adoption de mesures favorables à la biodiversité en milieu agricole ne pourrait être supporté en totalité par des petits exploitants plus modestes (exemples de situations abordées avec Salazar-Ordóñez et al., 2021 ; Kremen, 2020). Au même titre, des mesures visant à conserver la biodiversité par l’exclusion des activités de subsistance sur un territoire risquent d’être contestées et d’entraîner à terme la destruction de ces milieux par des pratiques non encadrées ou de résistance (Vijay et Armsworth, 2021 ; Blanc, 2020). Omettre de considérer ces réalités dans l’analyse et la communication des résultats de recherche sur la conciliation de la biodiversité et de l’agriculture pourrait favoriser des mesures qui renforceraient ces inégalités défavorables à des populations en situations précaires, en plus de mettre en danger la pérennité des mesures pour la biodiversité.
Le land sparing contre le land sharing : un débat polarisé
Dès la fin de la première décennie du XXIe siècle, le débat opposant les tenants du land sparing et ceux du land sharing s’est polarisé (Loconto et al., 2020). Les scientifiques en faveur du land sparing promeuvent l’intensification agricole sur des surfaces restreintes dans le but de produire des quantités importantes de nourriture, et ce, en préservant davantage de territoire à des fins de conservation (Phalan, 2018, Law et Wilson, 2015). Selon cette approche, l’agriculture peut revêtir diverses formes, pourvu qu’elle soit la plus productive possible sur la plus faible unité de surface. Il revient ainsi aux autorités concernées de mettre en place des mesures de protection de la biodiversité in situ dans les espaces non nécessaires à l’agriculture en excluant le plus possible les activités humaines (par exemple, voir Pazos-Almada et Bray, 2018). Une telle utilisation du territoire peut permettre d’anticiper la mise en place de normes et d’indicateurs de suivis pour la gestion planétaire des ressources naturelles et agricoles (García et al., 2020 ; Loconto et al., 2020 ; Heck et al., 2018 ; Phalan, 2018). Le land sparing se traduit dans les politiques en visant une productivité agricole maximale couplée à des mesures strictes de conservation de la biodiversité sur des territoires adjacents ou plus lointains, comme des aires protégées.
En contrepartie, les scientifiques favorables au land sharing défendent l’idée que l’agriculture doit intégrer les fonctions écosystémiques à même ses mécanismes de production (Reboud et Hainzelin, 2017). Autrement dit, le land sharing valorise les fonctionnalités de la biodiversité, comme le cycle des nutriments du sol, afin de subvenir aux demandes de production sans compromettre l’intégrité des écosystèmes et en maximisant les retombées pour les collectivités (Loconto et al., 2020 ; Bommarco et al., 2013). Dans ce modèle, une certaine biodiversité est bénéfique à l’agriculture et favorise la coexistence entre des fonctions multiples sur un même territoire (Dudley et Alexander, 2017). Les systèmes de gestion de cette biodiversité varient en fonction des modèles agricoles et des contextes socioéconomiques dans lesquels ils s’insèrent. À titre d’exemple, des pratiques agroforestières, soit l’intégration des arbres aux cultures annuelles permettant de limiter l’érosion des sols par le vent, visent à optimiser les fonctionnalités écologiques par la diversité des espèces végétales et animales en agriculture (Follett et al., 2024 ; Santos et al., 2022 ; Weninger et al., 2021).
Autant le land sparing que le land sharing présentent des écueils. On reproche entre autres au land sparing d’entraîner un effet de rebond, c’est-à-dire que peu de terres seront réellement protégées en raison des gains en productivité susceptibles de générer des bénéfices qui seront réinvestis dans l’augmentation des superficies cultivées (García et al., 2020 ; Desquilbet et al., 2017 ; Cresson et al., 2013). Pour des raisons propres aux divers contextes socioéconomiques, plusieurs régions du monde où l’on pratique le land sparing, peinent à augmenter les superficies attribuées à la protection de la biodiversité au sein de milieux considérés naturels ou largement exempts de l’empreinte humaine (García et al., 2020 ; Loconto et al., 2020). Selon certaines études, le land sharing serait associé à de plus faibles rendements agricoles par unité de superficie que le land sparing (Grass et al., 2019 ; Mertz et Mertens, 2017). Cependant, il faut être prudent en la matière, considérant les différences qui existent dans les méthodes de calcul du rendement agricole, lesquels peuvent différer selon les systèmes de production. Il s’avère périlleux de comparer la réelle productivité d’un système de monoculture basé sur la production d’une seule denrée (souvent le cas du land sparing), à un système potentiellement diversifié basé sur une production variée (souvent le cas du land sharing), céréalière, fruitière et de bois (Hayami, 2010). Le débat reste entier à savoir quelles approches permettront de répondre aux besoins agricoles d’une population mondiale avec habitudes de consommation croissantes et préoccupation astreignante de sécurité alimentaire.
Bien que ces conceptions soient polarisées, aucune en elle-même ne semble protéger adéquatement la biodiversité (García-Vega et al., 2024 ; Kremen, 2015). Les faits scientifiques internes et externes au débat démontrent plutôt qu’une hétérogénéité de mesures permettrait d’atteindre plus efficacement les finalités de protection de la biodiversité en milieux agricoles (García-Vega et al., 2024 ; DeClerck et al., 2023). D’abord, des recherches ont démontré qu’autant la conservation des milieux naturels, que la pratique d’une agriculture soucieuse des fonctionnalités écosystémiques peuvent, selon leur utilisation, toutes deux être bénéfiques pour la biodiversité, tout dépendamment des indicateurs de préférence (comme évoqué dans Phalan, 2018 ; Goulart et al., 2016 ; Hulme et al., 2013 ; Perfecto et Vandermeer, 2012). Puis, il est démontré qu’il est avantageux d’un point de vue agronomique de protéger la biodiversité étant donné que la présence de milieux naturels à proximité maintien de nombreuses fonctionnalités écologiques bénéfiques (Noack et al., 2019 ; Power, 2010). Cette situation nous amène à suggérer que le développement des connaissances scientifiques diverses sur la conservation et la protection de la biodiversité vient nuancer l’interprétation et la compréhension du débat en lui-même.
Voyant le potentiel de convergence entre ces deux modèles, des efforts ont été investis afin de dépasser ou de recadrer cette polarisation au sein de la communauté scientifique (comme avec Fischer et al., 2014, 2017 ; Mertz et Mertens, 2017 ; Kremen, 2015). Cependant, le débat scientifique semble persister (Loconto et al., 2020). Les recherches et les prises de positions tranchées se poursuivent. À titre d’illustration, un article de Bateman et Balmford (2023), publié dans Nature, s’appuie sur une recension des écrits scientifiques et défend l’efficacité du land sparing en comparaison au land sharing. L’étude avance qu’un plus grand nombre d’espèces sont recensées dans les systèmes de land sparing à travers le monde où de plus vastes superficies de terres d’un seul tenant sont exemptes d’agriculture. Ces auteurs expriment ainsi une conception particulière des enjeux mondiaux de sécurité alimentaire et de protection de la biodiversité.
Comme Law et Wilson (2015) ainsi que Mertz et Mertens (2017), nous sommes d’avis que les contextes des recherches et des milieux d’application des modèles doivent être davantage étudiés. Dans son état, ce débat semble mettre de côté les réalités socioéconomiques et écologiques, dont une étude plus approfondie viendrait nuancer les visions.
Quelles conséquences pour la formulation des politiques ?
La polarisation du débat entre les deux modèles de land sparing et de land sharing semble liée à des finalités différentes et des visions divergentes des défis à surmonter pour la biodiversité planétaire et la sécurité alimentaire. D’ailleurs, la manière de faire le suivi de l’état de la biodiversité et de la production agricole varie fortement en fonction des modèles. En effet, le choix d’indicateurs précis pour la biodiversité (par exemple : la superficie de milieux dits naturels, ou la valeur économique des paiements pour services écologiques de la biodiversité) et l’efficacité de la production agricole (par exemple : les indicateurs de souveraineté alimentaire, ou le nombre de calories produites par superficie cultivée) peut influencer les opinions en faveur d’un modèle ou de l’autre. Le land sparing parait plus facilement mesurable que le land sharing. Le premier met l’accent sur les résultats d’actions d’intensification agricole ou de mise en réserve de milieux dits naturels, tandis que le second valorise un processus de coexistence entre la biodiversité et l’agriculture (García et al., 2020 ; Loconto et al., 2020 ; Heck et al., 2018). Autrement dit, le land sparing a pour objectif d’atteindre des cibles de conservation et de production agricole bien précises, alors que le land sharing tente de valoriser une multiplicité de fonctions écosystémiques à même les milieux agricoles au-delà de la seule production alimentaire (par exemple la pollinisation, la séquestration de carbone). Par conséquent, il est plus aisé d’implanter des indicateurs du land sparing dans les mécanismes de suivi mondiaux, tandis que les indicateurs suivant la fonctionnalité de la biodiversité sont difficilement standardisables et freinent la considération du land sharing globalement (Phalan, 2018 ; Salzman et al., 2018).
L’argumentation qui découle de ces deux modèles se rapporte aux conceptions fondamentales du rapport de l’humain avec la nature ou la biodiversité (Loconto et al., 2020). À titre d’illustration, le modèle de land sparing considère principalement la nature « non domestiquée » dans la représentation de la biodiversité, tandis que les tenants du land sharing intègrent plus largement les activités humaines dans le suivi de la qualité des écosystèmes (Loconto et al., 2020 ; Jiren et al., 2018). Par conséquent, en alimentant une dualité entre le land sparing et le land sharing, cela revient à mettre en opposition des conceptions culturelles. Ceci fait en sorte que le débat est inéluctablement voué à s’articuler autour de réalités socioculturelles.
En plus de justifier des visions différentes à l’égard de la biodiversité, les deux positions ne luttent pas à force égale dans la communauté scientifique. Dans la littérature scientifique, l’option du land sparing est plus largement admise que celle du land sharing (Loconto et al., 2020 ; Mertz et Mertens, 2017). Le débat du land sparing vs land sharing a émergé au début du XXIe siècle, et depuis les recherches sur le land sparing ont été plus nombreuses et davantage financées (Loconto et al., 2020). D’ailleurs, les intérêts de certains organismes subventionnaires de recherche, provenant majoritairement de pays du Nord, ont progressivement réorienté le débat vers les enjeux de sécurité alimentaire, notamment sur l’importance d’intensifier l’agriculture et de créer des aires protégées, au lieu de maintenir le cap sur la protection de la biodiversité au sein des milieux agricoles (Loconto et al., 2020). De plus, il existe davantage de collectifs scientifiques pour le land sparing que pour le land sharing (Loconto et al., 2020 ; Mertz et Mertens, 2017). La vision du land sparing profite, au sein du débat scientifique, de plusieurs avantages en termes de financement et de visibilité.
Le modèle du land sparing occupe une place de choix dans les discussions internationales (Loconto et al., 2020 ; Perfecto et al., 2019a ; Mertz et Mertens, 2017 ; Kremen, 2015). Dans de nombreux discours à l’égard de la biodiversité, la proposition du land sparing s’avère dominante, bien que l’origine de cet arrangement demeure encore énigmatique (Loconto et al., 2020 ; Mertz et Mertens, 2017). En revanche, plusieurs intervenants agricoles dans les pays du Sud préfèrent défendre la perspective du land sharing (Jiren et al., 2018). La domination du land sparing découlerait des relations socioéconomiques privilégiant les pays du Nord et les grands agro-exportateurs aux dépens des petits exploitants, majoritaires au Sud, moins nantis (Perfecto et al., 2019b). En effet, c’est dans les pays du Nord que le modèle de production agricole intensif est le plus répandu parallèlement au mouvement conservationniste qui tente de préserver la nature sauvage (wilderness) (Perfecto et al., 2019b). C’est par le biais de puissantes organisations privées, relevant notamment des filières agroindustrielles mondialisées, et du mouvement conservationniste, que certaines entreprises et organisations tentent d’exercer une influence sur les systèmes de production agricole des pays du Sud, tout en faisant pression pour la mise en place d’aires protégées (Perfecto et al., 2019b). Ces relations inégales s’expriment au travers de politiques internationales et dans la mise en place de mesures d’intensification agricole dans les pays du Sud (Pierpauli et Turzi, 2020). Essentiellement, le fait que certains savoirs scientifiques soient priorisés dans les politiques signifie que des liens étroits existent entre les sciences et la politique (par exemple Vadrot, 2020), et plus particulièrement pour le land sparing (Loconto et al., 2020 ; Jiren et al., 2018).
Dépasser la dualité par considérations éthiques
Pour pallier les lacunes des modèles du land sparing ou du land sharing, la communauté scientifique déploie déjà de nombreux efforts afin d’intégrer davantage de variables socioéconomiques et écologiques dans les recherches (par exemple Phalan, 2018 ; Bommarco et al., 2013). Concrètement, ces efforts contribuent à rétrécir l’écart entre les mesures recommandées sur une base théorique et l’identification des opportunités concrètes de protection de la biodiversité dans un contexte donné.
Or, un débat portant sur une activité aussi fondamentale que l’agriculture ainsi que le rapport entre les collectivités et les écosystèmes dépasse nécessairement le seul cadre des sciences plus fondamentales. Aussitôt qu’il est nécessaire de traduire des études scientifiques en mesure d’intervention visant un objet aussi complexe, les sciences sont imbriquées dans la politique (Funtowicz et Ravetz, 2018 ; Turnhout et al., 2016). C’est pourquoi une attention particulière devrait être consentie afin d’ajuster les objectifs de protection de la biodiversité aux réalités locales, et ainsi éviter les risques de conflits. Nous pouvons par exemple souligner les efforts de concertation pour concilier les pratiques agricoles paysannes avec les besoins d’espèces menacées, comme pour le cas du jaguar au sud du Mexique (Lecuyer et al., 2019).
Cependant, le débat est en lui-même, chargé des valeurs que défendent les personnes et les organisations qui y participent, favorisant ainsi des visions particulières de la biodiversité et de l’agriculture. En l’occurrence, vu la force du land sparing face au land sharing, les perspectives et les contextes socioéconomiques des pays du Nord sont mieux représentés par rapport à ceux des pays du Sud (Perfecto et al., 2019b). Dans une telle situation, le risque est que le positionnement des acteurs au sein du débat, structuré comme tel, vienne renforcer la dualité des visions entre divers systèmes de production, exprimant des conceptions et des intérêts divergents quant aux systèmes agricoles. Encore une fois, les réalités agricoles des nombreuses collectivités paysannes, populations souvent moins nanties et vulnérables, se verraient moins bien représentées dans les discours politiques.
Cette polarisation dans les discours scientifiques pourrait se poursuivre au sein de politiques, au risque d’entraîner des décisions qui consolident le décalage entre les populations nanties et celles qui le sont moins au niveau économique et écologique. Par notre argumentaire, nous soutenons que les acteurs responsables de la production des connaissances scientifiques devraient contribuer aux efforts de réduction des inégalités défavorables aux populations vulnérables, non seulement par le type de connaissances qu’ils produisent, mais aussi par rapport à la portée de ces connaissances sur les politiques publiques. Ultimement, aucune connaissance n’est extérieure aux enjeux éthiques et politiques. Or, en contexte de crise de la biodiversité, l’impact de la production et de la communication de connaissances, surtout dans le cadre du débat qui nous intéresse, peut être majeur pour la sphère politique. Faire preuve de précaution dans la présentation et la communication des résultats, notamment par une contextualisation rigoureuse, parait essentiel. Ainsi, les recherches prenant position en faveur du land sparing ou du land sharing mériteraient d’être rigoureusement contextualisées, de façon à prévenir une utilisation outrancière, voire tendancieuse, des résultats (Jiren et al., 2018).
Par considération éthique à l’égard des populations paysannes, majoritairement situées dans les pays du Sud, nous pensons qu’il faudrait dépasser le débat du land sparing contre le land sharing, sans pour autant rejeter le travail de recherches scientifiques l’ayant alimenté. D’ailleurs, le nouveau paradigme en matière de conservation de la biodiversité favorise la reconnaissance d’une pluralité d’approches et de mesures afin de favoriser la convergence entre les objectifs de sécurité alimentaire et de conservation (Jonas et al., 2021 ; Vijay et Armsworth, 2021). Par ce fait, les connaissances scientifiques ne peuvent être dissociées de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur les collectivités qui dépendent directement des ressources agricoles et forestières pour leur subsistance. Toute forme de jugement normatif ou d’énoncé prescriptif en matière d’aménagement du territoire ou de gestion des ressources agricoles doit être soumise à un processus délibératif local et culturellement approprié (par exemple Guibrunet et al., 2021). C’est là où les sciences et la politique ne peuvent faire l’économie l’une de l’autre.
Conclusion
Du point de vue de la recherche, nous pensons que les sciences derrière la quête de solutions pour concilier la biodiversité et l’agriculture doivent faire davantage de place aux contextes socioéconomiques ; cela, d’abord et avant tout pour ne pas proposer de mesures qui porteraient préjudice aux populations dans des situations socioéconomiques vulnérables, renforçant des inégalités existantes ou en générant de nouvelles. C’est pourquoi nous sommes d’avis que davantage de connaissances scientifiques devraient être produites afin d’en arriver à une compréhension plus minutieuse des contextes agricoles, comme les systèmes de gouvernance, les réalités socioéconomiques et culturelles. De plus, les efforts menés pour réduire les inégalités sont intrinsèquement liés à la manière dont les objets d’intervention (production, accès à la terre, mesure de la biodiversité) sont construits dans les discours scientifiques et politiques.
Plus particulièrement pour le land sparing contre le land sharing, dépasser la dualité rigide sur laquelle le débat est articulé permettrait, selon nous, de considérer plus rigoureusement la question des inégalités socioéconomiques au sein des mesures visant à assurer la protection de la biodiversité, notamment telles qu’elles sont véhiculées dans certaines politiques agricoles des États, comme celles qui visent l’expansion et l’intensification agricole (Cramb, 2011). Cela signifie pour la communauté scientifique de faire preuve d’une prudence de tous les instants en matière de communication, considérant que certaines évaluations de pratiques agricoles pour la biodiversité peuvent avoir une portée normative et mener à l’élaboration de politiques pouvant avoir des dimensions préjudiciables à des populations. Assurer la protection de la biodiversité, tout en répondant aux besoins alimentaires mondiaux, nécessitera assurément une pluralité d’approches et de perspectives (Pascual et al., 2021). La réserve est donc de mise quand vient le temps de proposer de grands modèles d’aménagement du territoire, que celui-ci soit à prédominance agricole ou qu’il s’agisse d’écosystèmes peu anthropisés.
Appendices
Remerciements
Nous tenons à remercier les organisatrices et organisateurs du Colloque de l’ACFAS de 2022 intitulé Réduire les inégalités pour sauver la planète : par quel bout commencer ? de leur invitation à communiquer nos réflexions par le biais de cet article suite à une conférence donnée par Marie Saydeh. Nous remercions également les évaluateurs anonymes de la revue pour leurs précieux commentaires qui nous ont permis d’améliorer cette contribution.
Bibliographie
- Abbas, M., 2017, Libre-échange et développement. Les Suds dans le système commercial multilatéral, Revue internationale et strategique, 108, 4, pp. 69‑76.
- Bàrberi, P., Moonen, A.-C. (éd.), 2020, Reconciling agricultural production with biodiversity conservation , Burleigh Dodds Science Publishing, Londres, 282 p.
- Bateman, I., Balmford, A., 2023, Current conservation policies risk accelerating biodiversity loss. Nature, 618, [En ligne] URL : https://www.nature.com/articles/d41586-023-01979-x
- Blanc, G., 2020, L’invention du colonialisme vert : Pour en finir avec le mythe de l’éden africain, Flammarion, Paris, 352 p.
- Bommarco, R., Kleijn, D., et Potts, S. G., 2013, Ecological intensification : Harnessing ecosystem services for food security, Trends in Ecology & Evolution , 28, 4, pp. 230‑238.
- Chaléard, J.-L, 2010, Géographie de la production agricole au début du XXIe siècle, Chapitre 1, dans Doré, T., Réchauchère, O., La question agricole mondiale : Enjeux économiques, sociaux et environnementaux, Documentation Française, Paris, pp. 15-38.
- Cramb, R. A., 2011, Re-inventing dualism: policy narratives and modes of oil palm expansion in Sarawak, Malaysia, The Journal of Development Studies , 47, 2, pp. 274-293.
- Cozim-Melges, F., Ripoll-Bosch, R., Veen, G. F. (Ciska), Oggiano, P., Bianchi, F. J. J. A., van der Putten, W. H., et van Zanten, H. H. E., 2024, Farming practices to enhance biodiversity across biomes : A systematic review, Npj Biodiversity , 3, 1, pp. 1‑11.
- Cresson, C., Desquilbet, M., Dorin, B., et Couvet, D., 2013, AB et Biodiversité : Intensive ou extensive : quelle agriculture pour favoriser la biodiversité ?, Alter Agri, 122, pp. 15‑16.
- DeClerck, F. A. J., Koziell, I., Benton, T., Garibaldi, L. A., Kremen, C., Maron, M., Del Rio, C. R., Sidhu, A., Wirths, J., Clark, M., Dickens, C., Carmona, N. E., Fremier, A. K., Jones, S. K., Khoury, C. K., Lal, R., Obersteiner, M., Remans, R., Rusch, A., Schulte, L. A., Simmonds, J., Stringer, L. C., Weber, C., et Winowiecki, L., 2023, A Whole Earth Approach to Nature-Positive Food : Biodiversity and Agriculture dans J. von Braun, K. Afsana, L. O. Fresco, et M. H. A. Hassan (éd.), Science and Innovations for Food Systems Transformation , Springer International Publishing, New York, pp. 469‑496.
- Desquilbet, M., Dorin, B., et Couvet, D., 2017, Land Sharing vs Land Sparing to Conserve Biodiversity : How Agricultural Markets Make the Difference, Environmental Modeling & Assessment , 22, 3, pp. 185‑200.
- Dudley, N., Alexander, S., 2017, Agriculture and biodiversity : A review, Biodiversity , 18, 2‑3, pp. 45‑49.
- Fischer, J., Abson, D., Butsic, V., Chappell, M. J., Ekroos, J., Hanspach, J., Kuemmerle, T., Smith, H., et von Wehrden, H., 2014, Land Sparing Versus Land Sharing : Moving Forward, Conservation Letters , 7, 3, pp. 149-157.
- Fischer, J., Abson, D. J., Bergsten, A., French Collier, N., Dorresteijn, I., Hanspach, J., Hylander, K., Schultner, J., et Senbeta, F., 2017, Reframing the Food–Biodiversity Challenge, Trends in Ecology & Evolution , 32, 5, pp. 335‑345.
- Follett, E., Davis, L., Wilson, C., et Cable, J., 2024, Working for the environment : Farmer attitudes towards sustainable farming actions in rural Wales, UK. Environment, Development and Sustainability , [En ligne] URL : https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-024-04459-y
- Funtowicz, S., Ravetz, J., 2018, Post-normal science, Chapitre 4,15 dans Castree, N., Hulme M. et Proctor J. D., Companion to Environmental Studies , Routledge, Londres, pp. 443-447.
- García, V. R., Gaspart, F., Kastner, T., et Meyfroidt, P., 2020, Agricultural intensification and land use change : Assessing country-level induced intensification, land sparing and rebound effect, Environmental Research Letters , 15 , 8, 085007, [En ligne] URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab8b14
- García-Vega, D., Dumas, P., Prudhomme, R., Kremen, C., et Aubert, P.-M., 2024, A safe agricultural space for biodiversity, Frontiers in Sustainable Food Systems , 8, [En ligne] URL : https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2024.1328800/full
- Glamann, J., Hanspach, J., Abson, D. J., Collier, N., et Fischer, J., 2017, The intersection of food security and biodiversity conservation : A review, Regional Environmental Change , 17, 5, pp. 1303‑1313.
- Goulart, F. F., Carvalho-Ribeiro, S., et Soares-Filho, B., 2016, Farming-Biodiversity Segregation or Integration? Revisiting Land Sparing versus Land Sharing Debate, Journal of Environmental Protection , 7 , 7, pp. 1016-1032.
- Grass, I., Loos, J., Baensch, S., Batáry, P., Librán-Embid, F., Ficiciyan, A., Klaus, F., Riechers, M., Rosa, J., Tiede, J., Udy, K., Westphal, C., Wurz, A., et Tscharntke, T., 2019, Land-sharing/-sparing connectivity landscapes for ecosystem services and biodiversity conservation, People and Nature , 1 , 2, pp. 262‑272.
- Guibrunet, L., Gerritsen, P. R. W., Sierra-Huelsz, J. A., Flores-Díaz, A. C., García-Frapolli, E., García-Serrano, E., Pascual, U., et Balvanera, P., 2021, Beyond participation : How to achieve the recognition of local communities’ value-systems in conservation? Some insights from Mexico. People and Nature , 3, 3, pp. 528‑541.
- Hayami, Y., 2010, Plantations Agriculture, Handbook of Agricultural Economics , 4, pp. 3305‑3322.
- Heck, V., Hoff, H., Wirsenius, S., Meyer, C., et Kreft, H., 2018, Land use options for staying within the Planetary Boundaries – Synergies and trade-offs between global and local sustainability goals, Global Environmental Change , 49 , pp. 73‑84.
- Hulme, M. F., Vickery, J. A., Green, R. E., Phalan, B., Chamberlain, D. E., Pomeroy, D. E., Nalwanga, D., Mushabe, D., Katebaka, R., Bolwig, S., et Atkinson, P. W., 2013, Conserving the Birds of Uganda’s Banana-Coffee Arc: Land Sparing and Land Sharing Compared, PLOS ONE, 8, 2, e54597. [En ligne] URL : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054597
- IPBES, 2019, IPBES Global Assessment Summary for Policymakers , [En ligne] URL : https://files.ipbes.net/ipbes-web-prod-public-files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf
- Jiren, T. S., Dorresteijn, I., Schultner, J., et Fischer, J., 2018, The governance of land use strategies: Institutional and social dimensions of land sparing and land sharing, Conservation Letters , 11 , 3, e12429, [En ligne] URL : https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12429
- Jahan, N., Naveed, S., Zeshan, M., et Tahir, M. A., 2016, How to conduct a systematic review: a narrative literature review, Cureus , 8, 11.
- Jonas, H. D., Ahmadia, G. N., Bingham, H. C., Briggs, J., Butchart, S. H. M., Cariño, J., Chassot, O., Chaudhary, S., Darlling, E., de Gemmis, A., et Dudley, N., 2021, Equitable and effective area-based conservation : Towards the conserved areas paradigm. PARKS , 27.1 , pp. 71‑84.
- Kremen, C., 2015, Reframing the land-sparing/land-sharing debate for biodiversity conservation. Annals of the New York Academy of Sciences , 1355 , 1, pp. 52‑76.
- Kremen, C., 2020, Ecological intensification and diversification approaches to maintain biodiversity, ecosystem services and food production in a changing world, Emerging Topics in Life Sciences , 4, 2, pp. 229‑240.
- Larson, G., Piperno, D. R., Allaby, R. G., Purugganan, M. D., Andersson, L., Arroyo-Kalin, M., Barton, L., Climer Vigueira, C., Denham, T., Dobney, K., Doust, A. N., Gepts, P., Gilbert, M. T. P., Gremillion, K. J., Lucas, L., Lukens, L., Marshall, F. B., Olsen, K. M., Pires, J. C., Richerson, P. J., de Casas, R. R., Sanjur, O. I., Thomas, M. G., et Fuller, D. Q., 2014, Current perspectives and the future of domestication studies, Proceedings of the National Academy of Sciences , 111, 17, pp. 6139-6146.
- Law, E. A., Wilson, K. A., 2015, Providing Context for the Land-Sharing and Land-Sparing Debate, Conservation Letters , 8 , 6, pp. 404‑413.
- Le Roux, X., Barbault, R., Baudry, J., Burel, F., Doussan, I., Garnier, E., Herzog, F., Lavorel, S., Lifran, R., Roger-Estrade, J., Sarthou, J.-P., et Trommetter, M., 2012, Agriculture et biodiversité, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable, et de l’Aménagement du Territoire, Éditions Quae, Montréal, 178 p.
- Li, T. M., 2007, The Will to Improve : Governmentality, Development, and the Practice of Politics , Duke University Press, Durham, 390 p.
- Loconto, A., Desquilbet, M., Moreau, T., Couvet, D., et Dorin, B., 2020, The land sparing – land sharing controversy: Tracing the politics of knowledge, Land Use Policy , 96, 103610.
- Macchi, L., Decarre, J., Goijman, A. P., Mastrangelo, M., Blendinger, P. G., Gavier-Pizarro, G. I., Murray, F., Piquer-Rodriguez, M., Semper-Pascual, A., et Kuemmerle, T., 2020, Trade-offs between biodiversity and agriculture are moving targets in dynamic landscapes, Journal of Applied Ecology , 57, 10, pp. 2054‑2063.
- Marselle, M. R., Hartig, T., Cox, D. T. C., de Bell, S., Knapp, S., Lindley, S., Triguero-Mas, M., Böhning-Gaese, K., Braubach, M., Cook, P. A., de Vries, S., Heintz-Buschart, A., Hofmann, M., Irvine, K. N., Kabisch, N., Kolek, F., Kraemer, R., Markevych, I., Martens, D., Müller, R., Nieuwenhuijsen, M., Potts, J. M., Stadler, J., Walton, S., Warber, S. L., Bonn, A., 2021, Pathways linking biodiversity to human health : A conceptual framework, Environment International , 150 , pp. 106420.
- Mateo, S., 2020, Procédure pour conduire avec succès une revue de littérature selon la méthode PRISMA, Kinésithérapie, la Revue, 20, 226, pp. 29-37.
- Meiyappan, P., Dalton, M., O’Neill, B. C., et Jain, A. K., 2014, Spatial modeling of agricultural land use change at global scale. Ecological Modelling , 291, pp. 152‑174.
- Mertz, O., Mertens, C. F., 2017, Land Sparing and Land Sharing Policies in Developing Countries – Drivers and Linkages to Scientific Debates, World Development , 98 , pp. 523‑535.
- Noack, F., Riekhof, M.-C., et Di Falco, S., 2019, Droughts, Biodiversity, and Rural Incomes in the Tropics, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists , 6 , 4, pp. 823‑852.
- Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2020, L’utilisation des terres agricoles en chiffres, Food and Agriculture Organization of the United Nations. [En ligne] URL : http://www.fao.org/sustainability/success-stories/detail/fr/c/1298262/
- Pazos-Almada, B., Bray, D. B., 2018, Community-based land sparing : Territorial land-use zoning and forest management in the Sierra Norte of Oaxaca, Mexico, Land Use Policy , 78 , pp. 219‑226.
- Peemans, J.-P., 2018, Agricultures, ruralités, paysanneries : Réflexions et questions pour une économie politique critique des discours dominants sur le développement, Mondes en developpement, 182, 2, pp. 21‑48.
- Perfecto, I., Vandermeer, J., 2012, Separación o integración para la conservación de biodiversidad : La ideología detrás del debate « land-sharing » frente a « land-sparing », Ecosistemas , 21 , 1‑2, pp. 180-191.
- Perfecto, I., Vandermeer, J., et Wright, A., 2019a, Ecological theory and political realities, dans Perfecto, I., Vandermeer, J., et Wright, A. (éd.), Nature’s Matrix (2 e édition), Routledge, Londres, pp. 42-59.
- Perfecto, I., Vandermeer, J., et Wright, A., 2019b, Nature’s Matrix : Linking Agriculture, Biodiversity Conservation and Food Sovereignty (2 e édition), Routledge, Londres, 316 p.
- Phalan, B., Onial, M., Balmford, A., et Green, R. E., 2011, Reconciling Food Production and Biodiversity Conservation : Land Sharing and Land Sparing Compared. Science , 333, 6047, pp. 1289‑1291.
- Phalan, B. T., 2018, What Have We Learned from the Land Sparing-sharing Model?, Sustainability , 10, 6, pp. 1760.
- Pierpauli, G., Turzi, M., 2020, Agricultural heterotopia : The Soybean Republic(s) of South America, dans Ferdinand, S., Souch, I., et Wesselman D. (éd.), Heterotopia and Globalisation in the Twenty-First Century , Routledge, Londres, pp. 66-79.
- Pilling, D., Bélanger, J., et Hoffmann, I., 2020, Declining biodiversity for food and agriculture needs urgent global action, Nature Food , 1, 3, pp. 144-147.
- Rampino, M. R., Shen, S.-Z., 2021, The end-Guadalupian (259.8 Ma) biodiversity crisis : The sixth major mass extinction? Historical Biology, 33, 5, pp. 716‑722.
- Reboud, X., Hainzelin, É., 2017, L’agroécologie, une discipline aux confins de la science et du politique. Natures Sciences Sociétés, 25, S64‑S71.
- Reid, H., Swiderska, K., 2008, Biodiversity, climate change and poverty : Exploring the links , [En ligne] URL : file:///C:/Users/sophi/Downloads/1498.pdf
- Roy, J., Tscharket, P., Waisman, H., Abdul Halim, S., Antwi-Agyei, P., Dasgupta, P., Hayward, B., Kanninen, M., Liverman, D., Okereke, C., Pinho, P. F., Riahi, K., et Suarez Rodriguez, A. G., 2018, Sustainable development, poverty eradication and reducing inequalities , dans Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H. O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., Connors, S., Matthews, R. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis. M. I., Lonnoy. E., Maycock. T., Tignor, M., et Waterfield, Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report , Cambridge University Press, pp. 445-538.
- Salazar-Ordóñez, M., Rodríguez-Entrena, M., et Villanueva, A. J., 2021, Exploring the commodification of biodiversity using olive oil producers’ willingness to accept. Land Use Policy , 107, 104348.
- Salles, J.-M., Teillard D’eyry, F., Tichit, M., et Zanella, M. V., 2017, Land sparing versus land sharing : An economist’s perspective. Regional Environmental Change , 17, 5, pp. 1455‑1465.
- Santos, M., Cajaiba, R. L., Bastos, R., Gonzalez, D., Petrescu Bakış, A.-L., Ferreira, D., Leote, P., Barreto da Silva, W., Cabral, J. A., Gonçalves, B., et Mosquera-Losada, M. R., 2022, Why Do Agroforestry Systems Enhance Biodiversity? Evidence From Habitat Amount Hypothesis Predictions, Frontiers in Ecology and Evolution , 9, [En ligne] URL : https://www.frontiersin.org/journals/ecology-and-evolution/articles/10.3389/fevo.2021.630151/full
- Schmeller, D., Niemelä, J., et Bridgewater, P., 2017, The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) : Getting involved, Biodiversity and Conservation , [En ligne] URL : https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-017-1361-5
- Scott, J. C., 2020, Seeing like a state : How certain schemes to improve the human condition have failed , Yale University Press, New Haven, 464 p.
- Tilman, D., Clark, M., 2015, Food, Agriculture & the Environment : Can We Feed the World & Save the Earth?, Daedalus , 144, 4, pp. 8‑23.
- Tilman, D., Clark, M., Williams, D. R., Kimmel, K., Polasky, S., et Packer, C., 2017, Future threats to biodiversity and pathways to their prevention, Nature , 54 6 , 7656, pp. 73‑81.
- Tscharntke, T., Clough, Y., Wanger, T. C., Jackson, L., Motzke, I., Perfecto, I., Vandermeer, J., et Whitbread, A., 2012, Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification, Biological Conservation , 151 , 1, pp. 53‑59.
- Turnhout, E., Dewulf, A., et Hulme, M., 2016, What does policy-relevant global environmental knowledge do? The cases of climate and biodiversity, Current Opinion in Environmental Sustainability , 18, pp. 65‑72.
- UNESCO, 2021, UNESCO Science Report : The race against time for smarter development , UNESCO Publishing, 736 p.
- Vadrot, A. B. M., 2020, Multilateralism as a ‘site’ of struggle over environmental knowledge : The North-South divide, Critical Policy Studies , 14 , 2, pp. 233‑245.
- Vijay, V., Armsworth, P. R., 2021, Pervasive cropland in protected areas highlight trade-offs between conservation and food security, Proceedings of the National Academy of Sciences , 118, 4, [En ligne] URL : https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2010121118