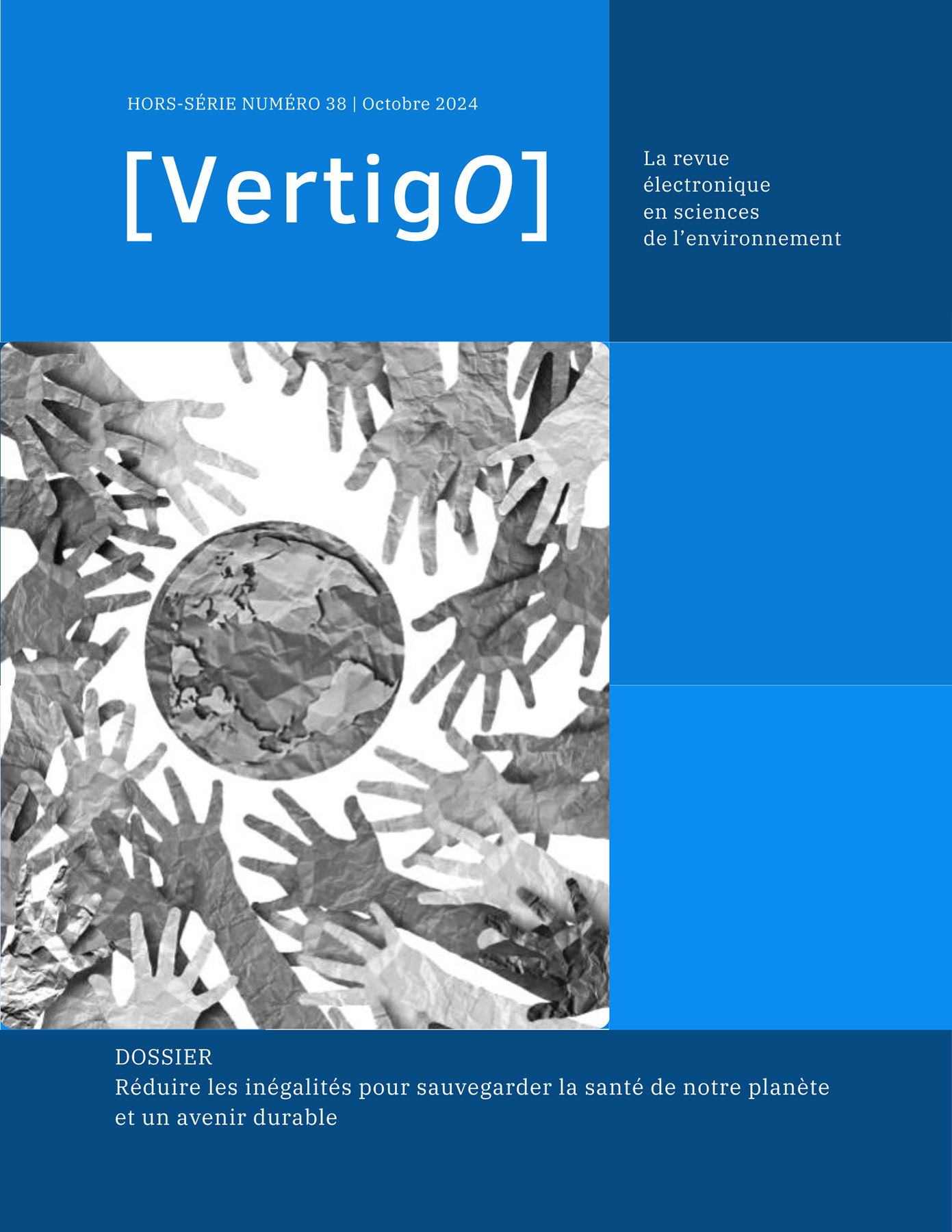Abstracts
Résumé
Pour que la transition écologique devienne une réalité et ne demeure pas de l’ordre du discours incantatoire, une nouvelle trajectoire juridique doit être tracée pour une transformation effective de la société. La sobriété est au nombre des outils conceptuels qui peuvent y contribuer. Expression antique d’une tempérance face à l’intempérance ou de mesure contre la démesure et l’excès, la sobriété est une vertu de la limitation qui renvoie aux fondements du droit, entendu comme l’ensemble des règles de régulation des comportements en société. Aujourd’hui, le champ lexical de la sobriété se développe en droit français et il importe de prêter attention à l’essor des dispositions législatives destinées à lutter contre l’immodération et les excès à l’origine de la crise écologique. En regroupant différents textes ayant trait à l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et en s’appuyant sur l’injonction faite au législateur d’un changement de trajectoire, il serait possible de dégager un objectif de sobriété. C’est-à-dire l’action de modération parcimonieuse, temporelle et spatiale de l’utilisation des ressources naturelles dans le respect du principe de solidarité écologique.
Mots-clés :
- transition écologique,
- sobriété,
- suffisance,
- ressources naturelles,
- droit français,
- droit somptuaire,
- solidarité écologique
Abstract
To ensure that the ecological transition becomes a reality and does not remain at the stage of incantatory discourse, a framework for action must be devised for an effective transformation of society. Sobriety, or sufficiency in English, are some of the conceptual tools that can contribute to this. Defined as an expression of temperance, in opposition to intemperance, or of measure against excess, sufficiency is a virtue of limitation which refers to the foundations of law understood as the set of rules for regulating the behaviors in society. Today, the lexical field of sufficiency is growing in French law and it is important to pay attention to the rise of legislative provisions to curb the immoderation and excesses that are at the root of the ecological crisis. By gathering various texts relating to the objective of prudent and rational use of natural resources and by relying on the injunction for the legislator to change the current trajectory, it would be possible to identify an objective of sufficiency. That is to say, the use of natural resources through the action of parsimonious, temporal and spatial moderation while respecting the principle of ecological solidarity.
Keywords:
- ecological transition,
- sufficiency,
- enoughness,
- natural resources,
- French law,
- sumptuous law,
- ecological solidarity
Article body
Introduction
« Le bien se trouve entre deux limites ; il finit toujours où l'excès commence » (Fenet, 1836, p. 123)
Éloigné du faste du jardin du château de Versailles, le bonzaï est l’art ancestral japonais qui consiste à maintenir la croissance d’un arbuste à l’échelle miniature. Énième expression de domination des humains sur la nature ? Ou bien expression mésologique d’humilité de l’Homme dans son appartenance à la Terre (Berque, 2019) ? La culture du « petit », la mesure, l’échelle, la limite, la proportion sont profondément inscrites dans les racines du droit, outil de régulation des activités humaines.
Entre mesure et démesure, la frontière définie par le droit est parfois mince. Des activités anodines telles que manger, se vêtir, se déplacer, bâtir ou encore entreprendre, bien que saisies par diverses branches du droit, n’empêchent pas dans leur accumulation et leur répétition, un résultat de démesure et d’excès. Constat inscrit dans le préambule de la Charte de l’environnement de 2005 : « la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles » (JORF n° 0051 du 2 mars 2005, p. 3697). C’est par exemple pour une entreprise, financer l’exploitation de ressources fossiles, ou pour un individu, effectuer régulièrement des voyages touristiques alors que l’effet néfaste de ces activités sur le dérèglement climatique ou la biodiversité est scientifiquement démontré. Il en résulte une profonde dissonance juridique entre la légalité de ces activités et les effets qui en émanent sur la société, les êtres vivants et l’environnement. Cette relativité rappelle la théorie de l’abus des droits qui pour Josserand constitue « l’atmosphère », le « climat » de nos systèmes juridiques (Josserand, 1939, p. 1). Or, pour assurer le bon développement d’un bonzaï, aucune branche ne doit pousser de façon à entraîner le déséquilibre, puis la chute, du pot qui contient l’ensemble. De la même façon, tout système juridique doit assoir son équilibre sur des branches qui expriment fondamentalement, chacune, un droit de la mesure. Autrement dit, les droits et libertés qui permettent l’exercice d’activités diverses doivent fonctionner et se réaliser dans la stabilité, « non pas dans une direction quelconque mais en vue de fins déterminées et dans un climat donné » (Josserand, 1939, p. 3). Or, ce « climat » dont parlait Josserand s’avère aujourd’hui être une crise de la démesure qui se manifeste, non seulement par une crise écologique, mais aussi par la difficulté du droit à exprimer sa pleine effectivité, le droit de l’environnement constituant une persistante illustration (Bétaille, 2012 ; Fonbaustier, 2019 ; Prieur et al., 2021).
En réalité, le caractère pernicieux de la crise écologique ne réside pas nécessairement dans les hypothèses d’abus de droit restées sans réponse juridique, mais peut-être davantage et surtout dans l’exercice démesuré de droits et libertés. Si selon Josserand (1939, p. 8) l’abus de droit naît de l’acte malicieux ou contre l’esprit d’un droit déterminé[1], nous pourrions dire que l’exercice démesuré de droits et libertés naît quant à lui de l’acte immodéré, intempérant, exubérant, ou tout simplement, des mauvaises habitudes ancrées dans les comportements des personnes dont il peut résulter un effet néfaste. Aucune sanction n’est pourtant prévue par le droit dans ce cas. Le plus souvent parce que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est trop distant ou bien qu’une multitude d’acteurs et de facteurs en sont à l’origine. La difficulté surgit lorsque l’exercice immodéré de droits et libertés entraîne des conséquences dommageables sur l’équilibre social, économique ou environnemental ; toléré et accepté, l’exercice démesuré de droits participe d’une pernicieuse banalisation du superflu. C’est ainsi que « des gestes quotidiens mille fois répétés comme ceux qui consistent à utiliser un véhicule privé ou à faire usage d’un aérosol apparaissent aujourd’hui comme une contribution, infinitésimale sans doute, mais une contribution néanmoins, à des effets globaux virtuellement catastrophiques » (Ost, 2003, p. 266). Le cumul, la répétition voire l’incitation aux démesures par la création de besoins artificiels ou tyraniques crées par la société de consommation (Illich, 1973), tant des personnes physiques que morales, devient alors une démesure générale et de ce fait, une responsabilité collective (Fauconnet, 1928 ; Rousseau, 2011). Or, c’est précisément dans cette brèche de l’immodération individuelle et collective que s’inscrit la crise écologique. L’absence de profonds changements du système économique capitaliste participe de l’amplification et de l’inertie de cette dernière. Il semble que la « croissance verte » constitue difficilement une solution – quand elle ne retarde pas le changement – alors qu’il s’agit de repenser à la racine, les notions de besoin et de valeur dans le courant de la socio-économie écologique (Douai et Plumecocq, 2017 ; Bruno et Cary, 2022). C’est encore, en droit des sociétés par exemple, repenser la notion de bénéfice au-delà du seul enrichissement pécuniaire (Baudouin, 2019, p. 595). Or, l’exercice démesuré de droits et leur mauvaise distribution sociale conduisent à la destruction de valeurs humaines et non-humaines, surtout lorsqu’il devient impossible de maintenir indéfiniment la valeur créée sans l’aide des services écosystémiques (Neumayer 2013 ; Gabriel et Bond, 2019) ; c’est pourquoi une réduction des besoins et une consommation réduite des ressources naturelles s’avèrent incontournables (Corvellec et Paulsson, 2023).
Devant l’aggravation de la crise, sans conteste au regard des rapports scientifiques les plus récents (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, 2019 ; Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2022), il relève de la fonction du droit de traduire ce phénomène de crise par une redéfinition des valeurs et besoins compatibles avec les limites planétaires. C’est sous l’angle d’un discours articulé autour du champ sémantique de la sobriété que le législateur français tend à intervenir dans cette direction. Communément présentée à travers son étymologie latine – sobrietas – la sobriété s’oppose à l’hubris, la démesure, l’intempérance. Elle est identifiable dans l’histoire comme une vertu, un outil de mesure et de modération dans des domaines aussi variés que la philosophie (Platon, -370 ; Plutarque, 72 ; Thoreau, 1854 ; Gregg, 1936 ; Valery, 1936), la religion (Saint-Paul, 57 ; Léon, 1891 ; François 2015, 2019, 2021), la santé (Syrus, 1er siècle avant J.-C. ; Cornaro, 1558 ; Renan, 1882), la politique (Montesquieu, 1748) ; le courant de la frugalité heureuse (Ellul, 1965 ; Illich, 1973 ; Rhabi, 2013) et l’économie (Malthus, 1798 ; Marx, 1867 ; Mill, 1894 ; Hicks, 1966 ; Meadows et al., 1972 ; Georgescu-Roegen, 1979 ; Latouche, 2011, Parrique, 2019 ; Jungell-Michelsson et Heikkurinen, 2022). Les orientations et horizons de la sobriété dans ces différents domaines présentant une hétérogénéité tout autant variable (sagesse, santé, idéal d’émancipation, démocratie, justice distributive, critique de la technique, décroissance, et cetera).
Aujourd’hui, le droit n’y échappe pas et sa position stratégique dans la société en tant que grille d'infrastructure centrale (Kjaer, 2020) l’empêche nécessairement d’ignorer l’émergence d’un nouveau paradigme de la mesure, alternatif au modèle de gestion ordinaire des excès. Poussé par les forces agissantes de l’urgence écologique et d’un droit global – notamment sous la pression d’un activisme judiciaire croissant qui vise à pointer les carences ou l’inertie des États en matière de respect des engagements climatiques – le législateur français est pressé de poursuivre un objectif de sobriété. Plus exactement, injonction lui est faite de conduire un « changement de trajectoire » dans l’affaire Commune de Grande-Synthe (Conseil d’État, 19 novembre 2020, n° 427301, Lebon ; Conseil d’État, 1er juillet 2021, n° 427301, Lebon) au terme d’un « contrôle de trajectoire » opéré par le juge administratif (Delzangles, 2021). Il s’agit donc pour le législateur, en étroite association avec les autres forces agissantes du droit et acteurs de la co-production normative (Jasanoff, 2004), de penser plus avant la modération des activités humaines[2]. En réalité, ce travail est déjà commencé. Parfois, les termes « sobre » ou « sobriété » sont expressément employés dans les textes. L’année 2015 marque un tournant avec la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes où quinze occurrences du terme « sobriété » peuvent être relevées ; tandis que le terme sobriété revient encore à onze reprises dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Fonbaustier, 2015). Le plus souvent, la sobriété apparaît néanmoins indirectement à travers un champ lexical articulé autour de la mesure, voire d’un « changement de trajectoire » comme affiché dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience[3].
De manière sous-jacente, se joue l’avènement d’un objectif de sobriété dans le droit ou du moins, d’une notion souche ou d’une métanorme nouvellement révélée (Jestaz, 2015, p. 38)[4] au soutien d’un nécessaire changement de trajectoire pour juguler la crise écologique. Dans cette perspective, nous proposons de montrer en quoi la sobriété est de plus en plus identifiable en droit français. Pour ce faire, nous nous appuierons sur un travail de recensement des textes imprégnés du champ lexical de la sobriété et présents dans diverses branches du droit : énergie, déchets, consommation, numérique et télécommunication, agriculture, urbanisme ou encore transport. L’ensemble normatif hétéroclite qui s’en dégage nous permet alors de dessiner les contours d’une définition juridique de la sobriété écologique qui reste cependant fragile pour saisir toute l’étendue de son champ d’intervention. Aussi, pour mieux cerner les enjeux de l’inscription de la sobriété dans le droit et afin d’en offrir une meilleure lecture, nous proposons d’en effectuer la caractérisation à partir de traits récurrents relevés dans les textes relatifs à la sobriété. Sous cet angle, la sobriété revêt d’abord un caractère parcimonieux par la présence de règles visant le moins ou le mieux, elle contient ensuite un caractère spatial ou de proximité, enfin elle comporte un caractère temporel lié à la notion de durabilité. La sobriété ainsi caractérisée pourrait alors trouver un cadre d’expression plus nette dans le principe de solidarité écologique en raison de sa propension à établir une trajectoire juridique conforme à l’interdépendance entre humanité et environnement.
La réception de la sobriété dans le droit
Transition[5], résilience, neutralité, bas-carbone, durabilité, réduction, mesure, efficacité, proportionnalité, division ou diminution ; le jardin du législateur offre à voir une diversité croissante de fleurs terminologiques liées à la sobriété dont leur parfum juridique mérite d’être identifié. L’emploi d’une terminologie de la sobriété, pour laquelle aucune définition préétablie n’existe ni dans le langage courant (Cezard et Mourad, 2019, p. 5) ni en droit, interroge ; s’agit-il d’une simple reprise d’un discours politique ambiant, dénuée de signification juridique, ou bien est-ce le signe plus profond d’une inscription de la sobriété dans le droit ? En réalité, les termes liés à la sobriété apparaissent essentiellement dans des textes relevant du droit de l’environnement et expriment une mise en œuvre de l’objectif de développement durable inscrit à l’article L110-1 du Code de l’environnement et, plus largement, de l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et des matières premières inscrit à l’article 191, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il faudrait alors plus exactement parler de sobriété écologique[6] qui traduit la préoccupation d’une urgente conversion écologique et en droit, d’un rapide changement de trajectoire juridique. En réalité, l’émergence d’un vocable de la sobriété dans les textes de droit positif n’apparaît pas réellement comme une nouveauté, mais traduit plutôt une réminiscence des anciennes lois somptuaires. Contrairement à ces dernières, qui dans le passé avaient pour objectif moral de lutter contre l’inutile, le luxe et la dépravation (Pastoret 1804 ; Gimalac, 2001 ; Cuzacq, 2002 ; Dubois-Pelerin, 2008 ; Castaldo et Lévy, 2010)[7], de nouveaux textes qualifiables de néo-somptuaires cherchent à assurer un modèle de développement sobre ou « suffisant » en ressources naturelles et en matières premières. Plusieurs branches du droit contiennent déjà un corpus terminologique de la sobriété et il s’agira d’en présenter les illustrations pour ébaucher, à partir de cet ensemble, une définition juridique de la sobriété.
La sobriété écologique : métanorme de changement de trajectoire juridique
Objectif de maîtrise de la démesure, la sobriété consiste en la poursuite d’une « norme du suffisant » (Gorz, 1992 ; Princen, 2005) ou aussi enoughness (Jungell-Michelsson et Heikkurinen, 2022). C’est-à-dire si l’on adopte la définition de la sobriété selon le terme sufficiency retenu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : « l’action qui consiste à prévenir l’utilisation de ressources naturelles, d’énergie, de sol ou encore d’eau tout en assurant un niveau de vie décent pour tous dans le respect des limites planétaires » (GIEC, 2022, p. 1510)[8].
À défaut, l’économie de pénurie (Kornai, 1984) ou de régression (Weil, 1955, p. 35) risquent très vraisemblablement de s’imposer, faisant craindre l’adoption de normes réduites dans leurs choix et beaucoup plus contraignantes, fondées par exemple sur la multiplication de mécanismes de quotas[9] ou de maîtrise des consommations d’énergie[10], comme ce fut déjà le cas par le passé lors des chocs pétroliers (Faberon, 1991, p. 355), et désormais de ressources vitales telle que l’eau[11] (Denier-Pasquier, 2023). Aux droits et libertés causes d’excès, répond un devoir de sobriété dont les prémisses ont depuis longtemps été esquissées en 1972 dans le rapport du Club de Rome Halte à la croissance ? (Meadows et al., 1972)[12] . Dès lors, pour combattre l’inertie d’un homo confort qui peine à modérer ou combattre ce qui garantit son propre confort (Boni, 2022), un droit de la sobriété – ou droit néo-somptuaire – paraît de plus en plus inéluctable pour modérer les excès.
Évidemment, modérer les besoins humains touche aux libertés et l’acceptation de mesures de sobriété peut s’avérer difficile tant les habitudes et les réflexions sont solidement ancrées. À Rome déjà, les tentatives de modération des comportements rencontraient de fortes réticences et peuvent, encore aujourd’hui, être résumées selon cette formule : « à quoi sert la liberté, si, voulant périr par le luxe, nous n’en avons pas le pouvoir ? » (Pastoret, 1804, p. 1260)[13]. Au contraire, il faut comprendre et sans doute chercher à mieux expliquer que la sobriété est un instrument de préservation des droits et libertés qui garantit leur pérennité dans le temps. Il est assurément préférable d’opter pour une modération préventive des droits et libertés, plutôt que d’avoir à affronter les effets de l’inertie, par de plus fortes restrictions ou à travers l’éventualité d’une suppression pure et simple de certains droits ou de certaines libertés, devenue inévitable faute d’action. En réalité, la sobriété ne doit pas être réduite à une limitation comportementale volontaire, une responsabilité morale individuelle ou une responsabilité sociétale et environnementale pour les entreprises, elle exprime de fait la responsabilité collective d’un ensemble de personnes, indivisiblement confronté à des enjeux partagés. Aussi, pour que le superflu cesse d’être considéré comme une « chose très nécessaire » (Voltaire, 1736), des compromis doivent être trouvés pour que des propositions comme celles de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (2022) ou du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2022) puissent largement imprégner le droit[14]. Pour ce faire, il semble utile de préciser juridiquement ce qui constitue un « comportement superflu » susceptible de constituer une action nuisible aux intérêts protégés par la société, en se fondant par exemple sur la notion de « nocivité » (Viard, 2009), et ce, afin d’en permettre une meilleure justiciabilité. Selon cet auteur : « c’est la notion de “nocivité”, qui légitime les interdictions et leur assure une validité juridique au regard des normes constitutionnelles, communautaires ou internationales et législatives. ». À l’inverse du comportement nocif ou superflu, le comportement sobre pourrait bénéficier d’une meilleure reconnaissance juridique au-delà de la fiscalité comportementale incitative (Billet et Dufal, 2021), de l’économie réalisée en raison de la prudence des associés d’une société ou de la seule approbation morale.
Sans aucun doute, dire ce qui est excessif ou superflu prête immédiatement à débat et oblige à penser les rapports de forces et intérêts politiques divergents. Toutefois, il faut convenir que malgré l’absence d’objectif de sobriété et de définition juridique de celle-ci, une forme embryonnaire de droit néo-somptuaire se développe à travers la sobriété. Non limitée aux domaines historiques de l’alimentation et des tenues vestimentaires des anciennes lois somptuaires, la sobriété tend à courber de nombreux champs du droit vers une nouvelle trajectoire globale de la modération. En droit français, la sobriété puise essentiellement ses sources dans le droit de l’Union européenne et le droit de l’environnement.
L’article 191, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la politique de l’UE dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite de « l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ». En réalité, cet objectif est déjà présent dans le droit communautaire depuis le Traité de Paris du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), son article 3 d prévoyait que « les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l’intérêt commun : […] promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant leur épuisement inconsidéré »[15]. Aujourd’hui, l’Union européenne promeut plus précisément une « transition vers une économie durable et sobre en carbone », notamment à travers l’efficacité énergétique, les économies d’énergies ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Règlement de l’Union européenne (UE) 2018/1999, 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat). Le Pacte vert de la Commission européenne présentant les axes d’action de l’UE en matière de changement climatique et de dégradation de l’environnement suit la même logique de « promotion d’une transition vers des activités sobres en carbone et résilientes au changement climatique » (COM(2019) 640, 11 décembre 2019, point 2.2.1).
En droit français, la sobriété peut être rattachée au devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement inscrit à l’article 2 de la Charte de l’environnement ainsi qu’à l’objectif de développement durable inscrit au considérant 7 et à l’article 6 de la Charte de l’environnement ainsi qu’à l’article L110-1 du Code de l’environnement. Ce dernier fixe, dans le même esprit que l’article 191, paragraphe 1 du TFUE, un objectif de « consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires »[16]. S’agissant spécifiquement des questions de climat et d’énergie, l’article 2 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation énergétique. À ces intentions législatives au souffle un peu court (Fonbaustier, 2020), la loi dite Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit de nouvelles « trajectoires » ; notamment de rénovation énergétique des logements (art.151), d’absence d’artificialisation nette des sols (art. 194) ou encore de réduction des émissions de protoxde d’azote et d’ammoniac dans le secteur agricole (art. 268). Prise comme métanorme de transition ou d’adaptation au changement, la sobriété est matériellement identifiable à travers des règles de réduction ou plus généralement, de redirection des comportements dans le cadre de nouvelles « trajectoires » fixées par le législateur tendant à utiliser prudemment et rationnellement les ressources ou éviter leur épuisement. Plus simplement, la sobriété est ce qui emporte l’effet de modération en matière d’intendance des ressources naturelles. L’idée-force réside alors dans la poursuite du moins et du mieux, qu’il s’agisse de transition écologique ou désormais, d’indépendance et de sécurité énergétique (Commission européenne, 2022 ; Méda, 2022). Pour l’heure, l’examen des textes montre que la sobriété ou son champ lexical est déjà présente dans de nombreuses branches du droit positif français.
La prise en compte de la sobriété par les branches du droit
Sans parler d’« intégration » au sens d’une exigence transversale qui se diffuserait dans l’ensemble du droit et des politiques publiques à l’image du développement durable, la notion de sobriété est pour l’heure seulement « prise en compte » (Fonbaustier, 2012) par le droit. Nouvelle, elle vient heurter frontalement des intérêts et des exigences économiques ou sociales préexistants et prédominants. Il reste que la sobriété commence à être identifiée dans diverses branches du droit français : énergie, déchets, lutte contre le gaspillage, consommation, numérique et télécommunications, urbanisme et habitat ou encore transports. L’ensemble qui s’en dégage permet alors de tisser les éléments de définition de la sobriété écologique.
1. La sobriété énergétique est historiquement la plus ancienne et certainement la plus connue alors qu’elle signe son retour dans l’actualité avec la hausse du prix de l’énergie. En témoigne la création de l’Agence pour les économies d’énergie (AEE) par décret n° 74-1003 du 29 novembre 1974 dont l’objet était le développement d’actions tendant à réaliser des économies d’énergie[17]. Si cet objectif de réduction de la consommation d’énergie répondait alors à l’impératif de répondre à une crise pétrolière, il entre aujourd’hui dans les objectifs et priorités d’actions de la politique énergétique française pour répondre à l’urgence écologique et climatique. L’article L100-1, 1° du Code de l’énergie prévoit en ce sens que la politique énergétique s’appuie sur « la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie ». Plus précisément, l’État doit veiller à favoriser la sobriété énergétique[18], par exemple par l’adoption de programmations pluriannuelles de l’énergie (voir par exemple l’article 4 du décret n°2022-575 du 22 avril 2022 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de La Réunion qui contient des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale dont l’énergie primaire fossile), par le respect de l’étiquetage énergétique européen qui vise à faire baisser la consommation énergétique des produits vendus par l’indication de leur classe énergétique (voir l’article L122-11 du Code de la consommation ou le Règlement européen (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique), ou encore par la communication obligatoire d’un diagnostic de performance énergétique sur les biens immobiliers mis en vente ou en location (voir les articles L126-23, L126-26 et les articles R126-15 à R126-20 du Code de construction et de l’habitat).
S’agissant spécifiquement du secteur du bâtiment, la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 a enrichi l’article L 100-1 A du Code de l’énergie relatif aux objectifs de politique énergétique en y inscrivant l’objectif « de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiment sobre en énergie et faiblement émetteur en gaz à effet de serre ». L’Union européenne souhaite toutefois aller plus loin dans la sobriété énergétique et la décarbonation de l’énergie consommée par les bâtiments. La Commission européenne propose désormais dans son Pacte vert la « neutralité climatique » du parc immobilier de l’UE d’ici 2050, c’est-à-dire à émissions nulles (Commission européenne, 2019 ; 2021). Les nouvelles normes de construction et de rénovation des bâtiments qui contribuent à leur sobriété énergétique devront en conséquence être révisées à la hausse (voir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale ; et l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R172-6 du Code de la construction et de l'habitation), notamment les objectifs de la réglementation environnementale (RE2020) applicable aux bâtiments neufs entrée en vigueur au 1er janvier 2022 (Conseil de l’UE, Annexe de la décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan de relance et de résilience pour la France, COM(2021) 351, 5 juillet 2021).
Alors que la réglementation RE2020 fixe depuis le 1er janvier 2022 à 4 kg CO2/m²/an les gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie d’une maison individuelle, une proposition de révision de la directive européenne sur la performance énergétique du bâtiment (directive 2010/31/UE, 19 mai 2010 ; directive modificative (UE) 2018/844, 30 mai 2018) envisage, non plus une forte réduction mais une « neutralité climatique » d’ici 2050 (Commission européenne, Proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), COM(2021) 802 final, 15 décembre 2021, p. 3). L’ambition de neutralité climatique d’ici 2050 du Pacte vert européen offre à voir une expression concrète de sobriété énergétique par la fixation des règles qui tendent à une forte réduction de la consommation d’énergie et donc de ressources naturelles. Sur ce point, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a publié un rapport prospectif en mars 2022 dans lequel il est proposé quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dessinant des choix de société différents, les quatre scénarios envisagent tous de répondre à la croissance de la demande énergétique par un équilibre entre sobriété et efficacité énergétique. La sobriété y est définie par l’ADEME comme une démarche, un effort de « questionnement des modes de vie et de consommation afin de maîtriser la demande de biens et de services et l’efficacité énergétique qui permet de réduire la quantité d’énergie nécessaire à leur production » (ADEME, 2022, p. 13). En ce sens, prévenir la production de déchets conduit à autant d’énergie consommée et le législateur envisage également la sobriété dans ce domaine.
2. Un mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie au titre de l’article L110-1 du Code de l’environnement exige le respect d’objectifs toujours plus nombreux en matière de prévention de la production des déchets[19]. Pour ce faire, le législateur cherche notamment à développer l’économie de la fonctionnalité, c’est-à-dire les pratiques qui privilégient l’usage plutôt que la possession dans une « logique de consommation sobre et responsable » des ressources (article L541-1, Code de l’environnement ; Commission d’enrichissement de la langue française, Vocabulaire de l’environnement, « Economie de l’usage », Journal officiel de la République française, 18 mai 2018, texte 140). C’est pour l’exemple le plus employé, la vente d’un kilométrage parcouru par un pneu par la société Michelin à des sociétés de transport au lieu de la vente du pneu lui-même.
Au-delà d’objectifs qui peuvent être considérés comme relevant du droit souple (promouvoir, favoriser, soutenir, tendre vers), la sobriété apparaît dans ce domaine à travers de réelles obligations de parcimonie[20]. Est par exemple interdite la pratique qui vise à rendre délibérément impropres à la consommation des aliments encore consommables[21] ; ou encore, depuis le 1er janvier 2022, la pratique qui vise à incinérer les invendus non alimentaires neufs en méconnaissance de l’obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage des invendus[22]. L’adoption d’une consommation sobre et responsable des ressources s’entend aussi par la lutte contre le gaspillage. Les produits phytopharmaceutiques dans le milieu agricole[23] font par exemple l’objet d’une « exigence de sobriété dans l’usage »[24]. Si cette disposition est de portée toute limitée, l’inscription d’une telle exigence pour les produits phytosanitaires marque en toute hypothèse l’apparition bienvenue d’un discours juridique de la sobriété dans le droit agricole alors que les objectifs du plan « Ecophyto 2 + » de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques ont été repoussés à 2025 (Dufour et al., 2021)[25]. Plus visible sans doute dans ses effets, la sobriété intègre le droit de la consommation, des usages numériques et des télécommunications.
3. La sobriété en matière de consommation est particulièrement identifiable par l’interdiction de l’obsolescence programmée ainsi que par le principe corollaire d’utilisation durable. L’interdiction de l’obsolescence programmée est la pratique par laquelle un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement[26]. L’infraction restera toutefois difficile à caractériser en raison de la délicate démonstration de l’aspect délibéré exigé par les textes (Moyse, 2020, p. 94). À noter qu’une telle intention n’est pas exigée en matière d’obsolescence logicielle, c’est-à-dire la diminution des usages d’un bien en raison de l’indisponibilité ou du dysfonctionnement d’un logiciel (Fonbaustier, 2022, p. 290). Cette interdiction est sans doute la disposition la plus emblématique de la recherche de sobriété en matière de consommation de biens et services. La dissuasion légale au renouvellement prématuré d’un bien – par la lutte contre la pratique délibérée visant à réduire sa durée de vie ou d’usage – contribue à l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Plus largement, la sobriété en matière de consommation apparaît dans le principe de l’utilisation durable ; inscrit à l’article L110-1 du Code de l’environnement[27], il vise à optimiser la durée d’utilisation des produits. Par définition, la durabilité d’un bien réside dans sa capacité à « maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal »[28]. La durabilité désigne par conséquent la qualité d’un bien pour lequel une certaine durée d’usage ou de vie peut légitimement être attendue[29]. Dans cette perspective, le bien peut être tout simplement interdit s’il ne répond pas au principe d’utilisation durable comme c’est désormais le cas pour les produits en plastique à usage unique[30]. Le bien peut également faire l’objet d’une information renforcée à destination du consommateur[31]. Dans ce cas, le vendeur est débiteur d’une obligation d’information précontractuelle sur la durée pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un produit seront disponibles sur le marché[32]. En matière de logiciel, le vendeur a par ailleurs une obligation spécifique depuis le 1er janvier 2022 de veiller à ce que le consommateur soit informé de la période pendant laquelle il peut légitimement s’attendre à recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de son bien[33], ce qui permet de lutter contre le renouvellement prématuré de terminaux (hardware) du seul fait de logiciels (software) devenus obsolètes (Fonbaustier, 2022, p. 290). Il faut cependant souligner l’insuffisance de ces nouvelles obligations d’information[34] qui sont davantage des obligations de « rendre compte » (reporting) que des obligations de « rendre des comptes » (responsabilité) à propos de la durabilité du bien lui-même. Le Pacte vert européen laisse néanmoins entrevoir un enrichissement des possibilités d’engagement de la responsabilité des entreprises en raison de leurs pratiques environnementales : les textes relatifs au devoir de vigilance, aux obligations d’informations en matière de durabilité, à l’écoconception et aux allégations environnementales[35] devraient amener les entreprises à mieux devoir répondre de la durabilité de leurs produits. Le principe d’utilisation durable s’articule encore par un « indice de réparabilité » ; obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour certains produits limitativement énumérés et pour lesquels la réparabilité est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment les téléphones intelligents, les ordinateurs portables ou encore les téléviseurs[36]. Le législateur interdit en outre, sur le fondement de la tromperie, « toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors des circuits agréés » (article L441-3, Code de la consommation).
Il faut cependant reconnaître l’inexistence de condamnation en matière d’obsolescence programmée depuis l’interdiction de la pratique par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Soit les plaintes n’aboutissent pas en raison des difficultés à caractériser le comportement qui peut être présenté comme un standard légitime de l’industrie (innovation, obsolescence esthétique, et cetera), soit les entreprises visées préfèrent résoudre le litige par la voie transactionnelle[37]. Signe que la durabilité est peut-être davantage à rechercher dans l’allongement de la durée de garantie légale (Moyse, 2020, p. 104). Enfin, l’indice de réparabilité sera complété ou remplacé par un « indice de durabilité » à compter du 1er janvier 2024. Celui-ci inclura des critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit[38]. Dans ces dispositions, la prévention du renouvellement prématuré des biens et services, la recherche d’un allongement du temps d’usage ou de vie, évitent le recours à l’utilisation de nouvelles ressources naturelles conformément à l’idée de sobriété. Plus avant, l’extension exponentielle des pratiques liées au numérique et aux télécommunications, accompagnée d’une hausse du nombre de terminaux, a conduit à intégrer dans le droit une préoccupation a priori technique de « sobriété numérique » (Flipo, 2021 ; Fonbaustier 2022).
4. L’avènement de nouvelles technologies numériques et de télécommunications a naturellement poussé le législateur à encadrer les effets d’une telle évolution, essentiellement pour leurs aspects sanitaires et environnementaux. C’est dans ce cadre que, pour la première fois, le législateur français emploie expressément le terme de sobriété dans la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques. Dite loi « Abeille », cette loi illustre la préoccupation de santé publique en matière de communications électroniques poursuivie par un véritable objectif de sobriété de l’exposition des populations aux ondes[39]. Cet objectif est traduit par une information du public exposé aux ondes Wi-fi dans les établissements recevant du public[40] ou encore, par l’indication du débit d’absorption spécifique (DAS) de tout équipement terminal radioélectrique proposé à la vente ainsi qu’une recommandation d’usage permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications (selon l’article R*9 du Code des postes et communications électroniques : « On entend par débit d'absorption spécifique de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties ».
Plus récemment, un rapport sénatorial sur « l’empreinte environnementale numérique »[41] a conduit à l’adoption de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique (REEN) en France[42]. L’objectif recherché par la loi REEN est expressément de faire changer le comportement des consommateurs par la promotion d’une sobriété des usages numériques ; par exemple par la limitation du renouvellement des terminaux, ou le développement des usages écologiquement vertueux. Ainsi, la transition vers la sobriété numérique consiste essentiellement pour un auteur à acheter les équipements les moins puissants possibles, à les changer le moins souvent possible et à réduire les dépenses d’énergies inutiles (Ferreboeuf, 2019, p. 5). En toute hypothèse, la législation relative à la sobriété numérique semble promise à des évolutions en considération du rapport gouvernemental attendu par le Parlement sur le développement des cryptomonnaies[43] – monnaies numériques virtuelles connues pour être énergivores.
5. Embrassant des domaines très variés, la sobriété peut encore être foncière. Le législateur entend ainsi poursuivre un objectif de « sobriété foncière » dans les documents de planification relatifs à l’habitat et à la mobilité[44]. L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme doit notamment être poursuivie en respectant les objectifs de « développement urbain et rural maîtrisé » et d’ « utilisation économe des espaces naturels » ou encore par la fixation d’une trajectoire permettant d’aboutir à « l’absence de toute artificialisation nette des sols »[45]. Pour illustration, le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) – document de planification de l’urbanisme pour une aire urbaine, un bassin de vie ou d’emploi – comprend un Document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui met en œuvre un « principe de gestion économe du sol »[46]. Ce DOO définit les « objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain par secteur géographique »[47]. Le SCOT comprend également un Document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) qui détermine les conditions d’implantations commerciales, lesquelles doivent privilégier la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville par la compacité des formes bâties[48]. Enfin, le SCOT comprend un Projet d’aménagement stratégique (PAS) qui fixe un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation et définit à l’horizon de 20 ans, les objectifs de développement et d’aménagement en favorisant notamment « une gestion économe de l’espace limitant l’artificialisation des sols » (article L141-3, Code de l’urbanisme). La sobriété foncière permet à cet égard de poursuivre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité au titre du principe général d’action préventive et de correction, par priorité à la source et inscrit à l’article L110-1 du Code de l’environnement[49].
Sous une autre approche, la sobriété foncière se traduit également par la lutte contre l’accaparement excessif du foncier agricole. À cet effet, le législateur français a adopté une loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant des mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Par mimétisme contemporain à la loi somptuaire Licinia-Sextia de modo agrorum de 367 av. J.-C (Hermon, 1994)[50], la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 fixe des limitations de superficie et de seuil à compter desquels une autorisation est requise, notamment lors de l’agrandissement d’une exploitation agricole ou en raison de la réunion d’exploitations agricoles, envisagés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales[51]. Véritable disposition néo-somptuaire, les terres agricoles doivent rester petites ou du moins « à taille humaine » (Montesquieu, 1772 ; Leopold, 1949 ; Schumacher 1978), d’une superficie modérée et ne pas pouvoir être réunies dans les mains d’un trop faible nombre de personnes, notamment pour des raisons de lutte contre la spéculation foncière, de souveraineté alimentaire, de transmission d’exploitations agricoles ou d’installation de jeunes agriculteurs[52].
La sobriété foncière s’exprime encore dans le cadre de « l’habitat participatif » consacré par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) de 2014[53]. « Habitat alternatif » à la croisée entre habitat individuel et habitat collectif (Lerousseau, 2014), l’habitat participatif est conçu selon l’exposé des motifs de la loi comme une « troisième voie » d’accès au logement, caractérisé par le « regroupement de ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement au sein d’un bâtiment collectif » (Assemblée nationale, Projet de loi ALUR, 26 juin 2013, exposé des motifs, chapitre VI, p. 33). Il est en outre construit autour de « valeurs essentielles comme la non-spéculation, la solidarité, la mixité sociale, l’habitat sain et écologique, la mutualisation d’espaces et de ressources » (Assemblée nationale, ibidem). En ce sens, le projet permet des économies de superficie grâce à la création d’espaces communs au-delà des seules parties communes ordinaires, par exemple par le partage d’une buanderie, d’un verger, d’une salle de jeu ou encore d’une terrasse, ce qui conduit à autant de ressources naturelles et matières premières non utilisées conformément à l’idée de sobriété.
6. La sobriété peut encore être relevée dans le domaine du transport. La loi Climat et résilience y consacre notamment un chapitre en vue de « limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, articles 142 à 147). L’article 145 de la loi, disposition phare codifiée à l’article L6412-3 du Code des transports et issue d’une proposition de la Convention citoyenne, prévoit que sont interdits : les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente. La recherche de sobriété est ici liée à l’empreinte environnementale du train inférieure à l’avion en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Par cette disposition, le législateur s’emploie à mettre un terme à un comportement jugé excessif lorsque des solutions plus sobres existent et peuvent être identifiées. Le comportement sobre apparaît alors en creux du comportement excessif prohibé. L’article 144 de la loi Climat et résilience l’indique clairement, il s’agit de « favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien »[54]. La sobriété vise dans ce cas indirectement les comportements qui peuvent être à l’origine d’une utilisation excessive de ressources naturelles lorsqu’elle peut être moindre. Véritable mise en œuvre d’un principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source des excès[55], le législateur fixe une redirection contraignante des comportements excessifs vers des comportements plus sobres. L’interdiction prévue d’ici 2035 au niveau européen de la vente de voitures thermiques neuves illustre par ailleurs ce qui semble annoncer un phénomène plus vaste de redirection contraignante des comportements et prodrome d’un véritable droit néo-somptuaire.
Pour l’heure, la sobriété est aujourd’hui identifiable dans différentes branches du droit, parfois directement par l’emploi exprès du terme sobre, mais le plus souvent indirectement, par un champ lexical s’y rapprochant sans qu’aucune définition juridique ne soit énoncée par le législateur. Néanmoins, en s’appuyant sur les textes et nos précédents travaux, une définition de la sobriété peut être proposée en droit français selon laquelle : la sobriété est l’action de maîtrise quantitative et qualitative des ressources naturelles qui concourent aux activités économiques et qui tend à prévenir les nuisances sur la Société et l’environnement (Baudouin, 2019). Autrement dit, la sobriété est une action de modération des activités et des comportements en vue d’assurer l’objectif de développement durable, inscrit au considérant 7 et à l’article 6 de la Charte de l’environnement et à l’article L110-1 du Code de l’environnement, ainsi que l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et matières premières énoncé à l’article 191, paragraphe 1 du TFUE. Encore faut-il pouvoir préciser la consistance de l’action de modération. En effet, la proposition de définition énoncée, proche de celle récemment adoptée par le GIEC (2022)[56], n’exprime pas suffisamment le contenu de l’action de sobriété ou le comportement sobre de façon générique, c’est-à-dire, les caractéristiques d’une conduite ou d’une activité qui emporte un effet de modération. Selon nous la sobriété peut essentiellement trouver deux sources : elle peut résulter d’une part dans l’action de sobriété (l’acte de sobriété) entendue comme la manifestation de volonté destiné à produire un effet de modération, une obligation légale ou contractuelle par exemple, et d’autre part, dans le comportement sobre qui emporte un tel résultat mais qui n’est pas nécessairement recherché (le fait de sobriété). Par simplification, seule la terminologie d’action de sobriété sera employée. Aussi, en vue de disposer d’une approche plus systématique et systémique de la sobriété en droit et dans la perspective plus large d’un objectif de sobriété, il semble opportun de caractériser la sobriété.
La recherche d’une caractérisation de la sobriété
En quoi consiste précisément l’action de sobriété ? La question emporte nécessairement des choix politiques et fondamentaux de départage d’intérêts. En réalité, les textes liés à la sobriété en sont déjà le résultat, mais l’ensemble reste hétéroclite et dispersé. Ce constat invite à la recherche d’une meilleure compréhension de l’action de sobriété telle qu’elle peut être conçue en droit français. À cette fin, il est opportun d’identifier les traits distinctifs qui se dégagent des textes en vue de préciser l’action de sobriété. L’intérêt d’une telle grille de lecture n’est pas seulement de constater que la sobriété peut être caractérisée dans le droit positif, elle pourrait surtout aider le législateur à adopter de nouveaux textes sur la sobriété et inscrire un objectif général de sobriété dans la loi[57]. La présence d’un trait distinctif de la sobriété dans une disposition pourrait alors indiquer au juge que l’action de sobriété s’inscrit bien dans les trajectoires et objectifs adoptés par le législateur.
À l’inverse, l’absence de comportement conforme à la trajectoire poursuivie, un comportement superflu, excessif ou manifestant l’abstention fautive de modération lorsqu’elle est techniquement et économiquement possible, pourrait être appréciée par le juge pour déterminer une éventuelle responsabilité. Un contrôle de sobriété pourrait alors être opéré au regard du contenu du texte lui-même, ou à défaut de précision, par une appréciation prétorienne du degré de sobriété attendu en considération de la trajectoire fixée par le législateur et à laquelle il peut être rattaché. En ce sens, l’examen des textes envisagés jusqu’à présent montre que la sobriété est d’abord et essentiellement caractérisée par la présence de ce que nous appelons des « règles de parcimonie » (réduire, diminuer, limiter, et cetera). Celles-ci permettent alors de s’assurer du respect de la trajectoire énoncée par le législateur lorsqu’elle est suffisamment déterminée (pourcentage, délai, seuil, et cetera). Au-delà, la sobriété peut également être caractérisée par référence à l’espace et à un principe de proximité, ou encore, lorsqu’il est question de modération du temps et de durabilité. Enfin, la sobriété peut être rattachée au principe de solidarité écologique – principe pivot de reconnaissance de l’interdépendance entre ressources naturelles et humanité – et potentiel guide d’action pour penser les comportements sobres.
Parcimonie, proximité et durabilité
La sobriété peut être caractérisée dans les textes par l’existence de marqueurs relatifs à des exigences de parcimonie, de proximité et de durabilité.
Le caractère parcimonieux : le moins et le mieux
Conformément aux objectifs d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et des matières premières primaires (article 191 paragraphe 1 TFUE ; article L110-1-1, Code de l’environnement), la sobriété est d’abord une action complémentaire entre la réduction des usages et la réflexion sur leur utilité. Elle est à la fois quantitative (le moins, la réduction, l’utilisation prudente) et qualitative (le mieux, l’efficience ou l’utilisation rationnelle des ressources naturelles). Souvent, le moins et le mieux se confondent[58] dans des textes qui poursuivent un objectif identique de limiter l’utilisation des ressources naturelles. En ce sens, la sobriété est qualifiable de parcimonieuse en ce qu’elle traduit la recherche d’une intendance des ressources. Cette recherche de parcimonie est principalement identifiable dans les textes relatifs à la transition énergétique ou à l’économie circulaire qui visent une moindre consommation nette de ressources et de matières premières primaires[59]. Un texte prévoit par exemple la réduction de 15 % de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2030 par rapport à 2010[60].
Dans cette disposition, la sobriété est objective, il n’y a guère d’interprétation possible sur la trajectoire à atteindre, le moins et le mieux sont précisément chiffrés et l’évaluation de l’effectivité du texte est réalisable. La difficulté surgit lorsqu’un texte prévoit une réduction non chiffrée, une amélioration insuffisamment déterminée, manque de préciser le délai ou le seuil attendus. L’interprétation de la trajectoria legis est alors nécessaire[61]. Celle-ci peut être effectuée en faisant appel au principe de proportionnalité. Présent à l’article 5, paragraphe 4 du Traité sur l’Union européenne, il indique que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Critère directif de pondération (Cornu, 2011), la proportionnalité permet de mettre en balance des intérêts ou des règles ayant également vocation à gouverner la solution d’un litige. Dans le domaine spécifique de l’environnement, Gerd Winter propose l’application de la « proportionnalité écologique » qui permettrait d’apprécier les objectifs, actions et comportements des personnes au regard d’une « exigence de justification des usages de la nature » (Winter, 2014).
Dans cette perspective, il s’agirait d’évaluer, de calculer, de mesurer la matérialité des comportements et d’en apprécier la nécessité au regard notamment de l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, du devoir de prendre part à la préservation de l’environnement inscrit à l’article 2 de la Charte de l’environnement ou encore pour les entreprises, de l’article 1833 du Code civil qui indique qu’une société commerciale doit non seulement être gérée dans son intérêt social mais aussi – marque attendue de sobriété ou du moins d’une « obligation de réflexion » (Berlioz, 2018) sur les usages de la nature – en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité[62]. Cette exigence de justification des usages de la nature est déjà présente en matière d’artificialisation des sols. Ainsi, l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ne peut être prévue par le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme « que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés » (article L151-5, 2° al.3, Code de l’urbanisme). Selon cet article, le PADD doit tenir compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et espaces déjà urbanisés. L’absence de proportionnalité écologique résiderait dans l’incapacité à justifier la mise en œuvre suffisante de moyens en vue de réduire et de mieux utiliser des ressources naturelles et des matières premières[63]. Outre l’idée que la sobriété s’apprécie à la lumière d’une parcimonieuse utilisation des ressources, la sobriété peut également être caractérisée par la présence d’un critère de proximité spatiale.
Le caractère de proximité spatiale
Parcimonieuse par le moins et le mieux, la sobriété présente également un caractère spatial ou de proximité territoriale des activités. C’est-à-dire pour Léopold, une « éthique du territoire » qui tend à y assurer la durabilité des ressources (Léopold, 1949, p. 204)[64], aujourd’hui traduite par des concepts tels que « reterritorialisation » (Deleuze et Guatarri, 1991, p. 82), « biorégionalisme » (Berg et Dasmann, 1977 ; Celnik, 2015)[65], « ville sobre » (Lorrain et al., 2018), « territoires résilients » (Chardonnet Darmaillacq et al., 2020), ou encore « localisme ». Dans cette perspective d’adaptation d’un territoire face aux pressions anthropiques, il est question de mettre en place des modèles de sociétés qui tiennent compte des limites et ressources d’un territoire, en premier lieu des sols qui sont essentiellement une ressource non renouvelable[66]. Aussi, les dispositions précédemment envisagées relatives à la « sobriété foncière » prévoient par exemple un usage économe des sols, mais aussi leur usage dans une aire géographique restreinte de façon à respecter un aménagement conforme à des objectifs de développement durable fixés dans les documents d’urbanisme[67].
L’écologie industrielle et territoriale[68] s’inscrit pleinement dans cette vision d’une éthique du territoire par sa contribution à la transition vers une économie circulaire[69] ; elle prévoit que les déchets pris en tant que ressources doivent être gérés selon un principe de proximité, c’est-à-dire de manière aussi proche que possible de leur lieu de production[70]. Cette proximité trouve une nette expression juridique avec le principe de subsidiarité énoncé, tant à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne, qu’à l’article 72 de la Constitution française, lequel tend à privilégier l’échelon local de décision lorsque, mieux que l’échelon supérieur de décision, il permet de mieux atteindre les objectifs envisagés (selon l’article 5 paragraphe 3 al. 1er du Traité sur l’Union Européenne : « en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » ; selon l’article 72 al. 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958 : « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. »). C’est pourquoi la collecte et le traitement des déchets ménagers sont assurés par les collectivités territoriales (article L2224-13, Code général des collectivités territoriales), celles-ci étant considérées comme pouvant plus facilement « peser sur les évolutions des pratiques de consommation, soutenir des projets et favoriser les filières de tri et recyclage en mettant en relation les gestionnaires de déchets et les industriels utilisateurs de matière première issues du recyclage » (ADEME, 2022, p. 554).
Le domaine agroalimentaire aussi comporte cette sobriété de proximité à travers l’objectif de reterritorialisation du modèle agricole qui articule autant des questions de marchés publics, de droit international, de géopolitique, d’économie que de philosophie politique à travers des débats – parfois nauséabonds – sur les « terroirs » et les « traditions ». La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 relative à l’alimentation, dite « EGalim I » contient un objectif d’ancrage territorial de l’alimentation, notamment réalisé par l’élaboration de projets alimentaires territoriaux[71] et le développement de la consommation de produits agricoles en circuits courts[72]. Outre le fait de favoriser l’agriculture et l’économie locales, l’intérêt est de sortir d’une agriculture déterritorialisée responsable de nuisances et pollutions dues au transport des produits sur de nombreux kilomètres et cultivés dans des conditions qui ne préservent pas toujours les ressources naturelles du territoire de production. Pour promouvoir une alimentation de proximité, le législateur prévoit que depuis le 1er janvier 2022, les repas de restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge incluent des produits relevant à 50% de « l’alimentation durable », c’est-à-dire notamment issus d’approvisionnements directs de produits de l’agriculture[73]. En outre, la loi prévoit de privilégier les produits de saison[74], ce qui permet dans la poursuite d’une caractérisation de la sobriété d’observer dans certains textes une concomitante prise en compte de l’espace et du temps (ADEME, 2022, p. 90). La sobriété apparaît alors également comme l’action de modération du temps, une limitation de la temporalité devenue excessivement rapide.
Le caractère de durée : de la temporalité modérée à la durabilité
La sobriété possède intrinsèquement une temporalité de la modération, elle s’inscrit dans un « sens de la durée », s’oppose à la vitesse, à la « manie de la hâte » et à la « trépidation perpétuelle » (Valéry, 1936, p. 28-32) source d’une « intoxication insidieuse » (Valéry, 1936, p. 26)[75] ; elle est aussi antagoniste à la « dromocratie », régime caractérisé par une course permanente sans destination dans l’espace et le temps (Virilio, 1977, p. 48). De ce point de vue, l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles participe d’un réapprentissage de la durée alors que « nous ne supportons plus la durée. Nous ne savons plus féconder l’ennui » (Valéry, 1936, p. 8). Il s’agit d’éviter les excès accrus par l’accélération du temps (Rosa, 2010) dont la négociation algorithmique à haute fréquence d’instruments financiers (high-frequency trading), sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée, constitue le paroxysme[76]. Afin de permettre une sobriété dans le temps, il est alors préférable que le temps juridique – construit intellectuel non hermétique au passage du temps (Cour de cassation, 2014, p. 104) –, le temps social et de l’environnement s’accordent.
Plusieurs textes illustrent cette recherche d’harmonie temporelle avec la nature. En matière de transport, il a été proposé que désormais l’avion ne puisse plus se substituer au train lorsqu’une liaison ferroviaire effectue une liaison similaire pour une durée inférieure à deux heures trente[77]. En matière d’urbanisme, l’aménagement et la gestion dans le temps ont toute leur importance dans la poursuite d’une sobriété foncière. En matière de consommation, le temps est une donnée fondamentale dans les textes liés à la durabilité des biens et des services[78]. Par l’aménagement spécifique de la temporalité juridique dans la relation vendeur-consommateur, la durabilité évite le renouvellement excessif des biens et services et contribue à l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, c’est-à-dire à une sobriété dans le temps. Ces dispositions sont en réalité la marque d’une législation « adaptative » ou de la « mutabilité » (Markus, 2001 ; ADEME, 2022, p. 90) ; l’essentiel des textes liés à la sobriété prête une attention particulière au temps, et plus spécifiquement à l’urgence pour le droit de s’adapter au changement climatique. Nous appelons ainsi à penser une « dromologie juridique » qui permette de penser l’élaboration de règles contraignantes contre ce qui produit un temps fractionné – donne des représentations d’instantanéité où tout apparaît virtuellement possible – en contradiction évidente avec les limites planétaires et l’inséparable couple espace/temps (Paquot, 2021).
Le changement climatique est d’ailleurs expressément pris en considération dans le bâtiment. La nouvelle réglementation thermique RE2020 prévoit désormais un « indice d’inconfort estival obligatoire » calculé en degrés-heures pour les nouvelles constructions. Cet indice exprime la durée et l’intensité des périodes d’inconfort d’un bâtiment sur une année, soit lorsque de fortes chaleurs conduisent à une température intérieure présumée engendrer de l’inconfort (article R172-4, 5° et article annexe, Code de la construction ; décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale). La sobriété énergétique des bâtiments est donc également pensée par le législateur à travers la prise en considération de l’évolution temporelle du bâtiment face à la hausse globale des températures et des périodes de fortes chaleurs estivales amenées à se répéter. À l’exemple de « l’indicateur de durabilité » de biens de consommation (article L541-9-2, Code de l’environnement), ces nouveaux bâtiments pourraient entrer dans une catégorie à créer de « biens à forte durabilité » ; c’est-à-dire des biens dont le législateur cherche à organiser l’intégrité de la substance sur le temps long, tels des communs appropriés, mais demeurant « biens éternels de la Cité » en référence au droit canon et à la distinction entre biens temporels et biens éternels. Le bien à forte durabilité dans le temps permettant alors de prévenir l’emploi de nouvelles ressources ou matières premières. Sur ce point, il faut souligner que la sobriété – caractérisée par une temporalité modérée et l’inscription de la durabilité dans le droit – protège deux intérêts indissociables que sont l’humanité et l’environnement.
Le deuxième considérant du préambule de la Charte de l’environnement de 2005 indique ainsi : « Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel », tandis que l’article L110-1, I du Code de l’environnement dispose que : « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. (…) ». Aussi, pour assurer la pérennité du couple d’intérêts humanité/environnement dans le temps, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles est une condition sine qua none de leur évolution parallèle. En réalité, cette relation d’interdépendance trouve aujourd’hui son expression dans le principe de solidarité écologique qui pourrait constituer un cadre pertinent pour le développement de la sobriété.
Le principe de solidarité écologique comme cadre de la sobriété
Si la sobriété peut permettre à l’échelle individuelle de repenser « l’agir éthique » (Ost, 2003, p. 266), c’est certainement à l’échelle universelle qu’elle développe sa plus grande force. Non seulement en raison de sa capacité à garantir la démocratie par l’indissociable lien entre égalité et frugalité générale (Montesquieu, 1772), mais surtout parce que l’action de sobriété traduit intrinsèquement « une responsabilité élargie », une « action éthique » (Ost, 2003, p. 268) à travers la fixation de limites (parcimonie, proximité, durabilité) qui permettent la prise en compte de l’interdépendance entre humanité et environnement (Barrière, 2022).
A fortiori, l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et des matières premières primaires[79] rattache la sobriété – outre à l’objectif de développement durable – au principe de solidarité écologique. Entendu largement, ce principe désigne la recherche d’une harmonie avec la nature (Organisation des Nations unies, 2013) et la prise en considération du lien d’interdépendance entre les êtres vivants et les éléments qui composent l’environnement, et ce dans le respect des droits des générations futures[80]. Selon l’article L110-1, II, 6° du Code de l’environnement, le principe de solidarité écologique « appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Une autre définition de la solidarité écologique est par ailleurs proposée par Agnès Michelot: « le principe de solidarité écologique est un principe selon lequel les interdépendances des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels et artificialisés (quel que soit leur degré d’artificialisation) sont reconnues et guident toute action, pratique et décision » (2020, p. 749). La proposition est assurément séduisante bien que le terme « guider » pourrait être amendé par un terme plus contraignant au regard de l’urgence (gouverne, conduise, et cetera). Cette recherche de solidarité apparaît clairement dans l’exposé des motifs de la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 puisqu’elle poursuit l’objectif d’une « transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » (Projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Assemblée nationale, 10 février 2021, p. 4). La question de la solidarité écologique ne doit pas être réduite à la seule question du climat, elle doit viser l’ensemble des interdépendances entre humains et non-humains et permettre la structuration d’une gouvernance des socio-écosystèmes, concept qui se heurte pour l’heure à de sérieuses inerties (Mazé et Ragueneau, 2022). À défaut d’actions, pratiques et décisions « guidées » par la solidarité écologique, la voie de l’activisme judiciaire peut permettre la transformation des pratiques par l’ouverture d’actions tendant à la protection de ces interdépendances ; notamment en introduisant ces actions sur des fondements novateurs à l’image de la proposition de « défendre pour lui-même et directement un intérêt naturel commun devant le juge » (Camproux-Duffrène, 2022, p. 14).
De fait, les textes relevés sur la sobriété (énergie, numérique, télécommunication, déchets, gaspillage, agriculture, durabilité, urbanisme, construction, transport) se rejoignent autour d’une préoccupation commune : l’usage prudent et rationnel des ressources naturelles et des matières premières, tant par les générations présentes que pour les générations futures. Ces dispositions présentent en ce sens une évolution vers une meilleure responsabilité transgénérationnelle (Gaillard, 2008 ; Markus, 2012). Certes, la sobriété peut protéger des intérêts individuels actuels comme l’interdiction de l’obsolescence programmée protège l’intérêt du consommateur. Toutefois, la sobriété exprime surtout un devoir objectif et solidaire de modération des comportements dans le temps long, car l’ensemble de la communauté humaine, doté de ressources naturelles communes, partage une « solidarité de destin » (Ost, 2003, p. 272), une « solidarité transtemporelle » (Delmas-Marty, 2012, p. 1).
En ce sens, la solidarité écologique est sans doute ce qui offre à la sobriété son cadre d’expression le plus abouti lorsque les caractères de parcimonie, de durabilité et de proximité sont réunis. Ainsi, lorsqu’un texte prévoit la parcimonie de l’utilisation des ressources naturelles, inscrite dans la durabilité et tenant compte du territoire, il contient un pouvoir d’intendance solidaire des ressources naturelles. Le principe de solidarité écologique pourrait alors donner à la sobriété un cadre de développement adapté selon sa potentialité à devenir un « principe structurant » en ce qu’il permet « d’aller plus loin que l’approche déployée autour de l’harmonie avec la nature » (Michelot, 2020, p. 746). Pour A. Michelot, le principe de solidarité écologique repose sur une double démarche ; la reconnaissance préalable des interdépendances des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels et artificialisés, puis la conduite de transformation à adopter pour guider les comportements, les actions et les décisions (Michelot, 2020, p. 749). Selon cette approche, le principe de solidarité écologique permettrait d’offrir un cadre pratique pour penser le développement d’un objectif de sobriété en droit ; d’une part, à travers la reconnaissance de l’interdépendance entre une ressource naturelle et la personne qui en fait l’utilisation, et d’autre part, selon la conduite à tenir, l’action de sobriété à observer en considération de la trajectoire fixée par le législateur. L’objectif de sobriété devant in fine assurer la bonne intendance des ressources naturelles et des matières premières de façon à n’engendrer ni inégalités ni épuisement dans leur utilisation.
Conclusion
Partant de l’hypothèse que la sobriété tend à imprégner le droit, les dispositions recensées y manifestent son indéniable diffusion. Si dispersés qu’ils soient, les textes de droit positif liés à la sobriété montrent qu’au-delà de l’idée générale de modération des comportements, la sobriété traduit l’émergence d’un droit néo-somptuaire, une métanorme de redirection des comportements excessifs vers des comportements plus vertueux. L’emploi d’interdictions et de dispositions contraignantes pour emporter des effets de modération ne trompe pas quant à l’identification de la sobriété en droit. Pressé par la crise écologique, le législateur débute peut-être ce qui se dessine comme un profond changement de trajectoire juridique, l’amenant à réécrire un droit ouvert à l’excès pour en faire un droit de la sobriété. Aussi, dans la perspective d’une multiplication des dispositions relatives à la sobriété et en l’absence de définition donnée par le législateur, il est utile de pouvoir l’identifier afin de pousser plus avant la réflexion de son intégration dans le droit.
Des textes recensés, tous ne contiennent pas nécessairement une norme de parcimonie, un critère de durabilité et un principe de proximité, mais ils poursuivent assurément dans l’ensemble une préoccupation d’intendance des ressources naturelles, exprimant in fine une solidarité écologique. En ce sens, la sobriété ou plus exactement la sobriété écologique peut alors recevoir la définition suivante : la sobriété est l’action de modération parcimonieuse, temporelle et spatiale de l’utilisation des ressources naturelles dans le respect du principe de solidarité écologique. À l’avenir, ces réflexions peuvent contribuer à dessiner les contours d’un objectif général de sobriété, mais c’est à la condition de bousculer les forces de l’immodération, les résistances économiques, politiques et sociales qui empêchent l’avènement d’un nécessaire changement de trajectoire. Il est pourtant impérieux que l’hétérogénéité des intérêts cesse d’être un prétexte empêchant la recherche de toute norme utile aux « intérêts communs de l’humanité » (Kiss, 1982), la sobriété écologique peut être l’une de ces normes à la hauteur des enjeux, un essentiel droit de la modération.
Appendices
Remerciements
L’auteur remercie vivement les relecteurs pour leurs précieuses remarques ainsi que la rédaction de la revue Vertigo pour sa confiance.
Notes
-
[1]
Pour Josserand, l’acte abusif est un acte antifonctionnel qui implique le détournement d’un droit, c’est-à-dire son utilisation dans une direction autre que la direction légale, en violation de l’esprit de l’institution.
-
[2]
Sur le point de l’activisme judiciaire, une base de données propose le recensement des affaires, [En ligne], URL : http://climatecasechart.com, consulté le 21 avril 2023.
-
[3]
Le terme « trajectoire » y apparaît à quinze reprises et fait écho à l’injonction de changement de trajectoire du juge administratif à l’égard de l’État français dans la décision du Conseil d’État du 1er juillet 2021, n° 427301, Commune de Grande-Synthe, Lebon, préc.
-
[4]
L’auteur appelle « révélation » : l’affirmation solennelle d’une loi morale et/ou juridique, présentée comme l’expression d’une vérité supérieure et sans aucune démonstration ou peu s’en faut, le plus souvent sur un fond sous-jacent de droit naturel. Elle peut devenir solennelle avec le temps par la vox populi.
-
[5]
Du latin trans-ire, aller au-delà, la transition indique le mouvement pour palier un déséquilibre, une démesure.
-
[6]
Cette terminologie peut sembler tautologique mais permet de désigner une sobriété fonctionnelle dirigée vers la protection de l’environnement. Toute sobriété ne pouvant être assimilée à cet objet (austérité, avarisme, économies), par souci de simplicité nous retiendrons cependant le terme unique de sobriété pour signifier sobriété écologique dans la suite de nos développements.
-
[7]
É. Dubois-Pelerin (2008, p. 23 et s.) présente l’origine rurale de la notion de luxe qui apparaît d’abord dans luxus, « le fait de pousser de travers » et pour une végétation de « pousser avec excès », luxus sera ensuite globalement compris au Ier siècle après J.-C. comme synonyme d’excès dans un sens moral et péjoratif, « ce qui rompt la mesure », « l’excès dans la façon de vivre ».
-
[8]
Notre traduction : « Sufficiency is defined as avoiding the demand for materials, energy, land, water and other natural resources while delivering a decent living standard for all within the planetary boundaries ». D’autres termes expriment l’application de cette sobriété dans les préconisations du rapport : « reduce », « moderate action », « net negative emissions », « low demand », « limit », « downsizing ».
-
[9]
V° par ex. le Règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche. Certains proposent par ailleurs l’instauration d’un « quota carbone individuel » : v° la Proposition de loi n° 3164 visant à instaurer un quota carbone individuel pour limiter l’usage de l’avion, Assemblée nationale, 30 juin 2020.
-
[10]
L’actuelle Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est issue de l’ancienne Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME), elle-même issue de l’Agence pour les économies d’énergie (AEE) créée en 1974 suite au choc pétrolier de 1973 par un décret n° 74-1003 du 29 nov. 1974, JORF 1er déc. 1974.
-
[11]
En 2019, les Assises de l’eau s’accordaient sur un impératif de sobriété et d’efficience des usages de l’eau : Ministère de la Transition écologique, Assises de l’eau, Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique, Feuille de route deuxième séquence des Assises de l’eau, 1er juillet 2019, 28 p. ; Le 14 novembre 2022, un « plan eau » était présenté par le gouvernement avec un groupe de travail spécifiquement intitulé « sobriété, économies et partage de l’eau ».
-
[12]
V. aussi l’approche sociale : Social Limits to Growth (Hirsch F., 1976).
-
[13]
« On vous commande la frugalité ! Ne souffrez pas, Romains, qu’on vous impose ainsi une véritable servitude. Abrogeons cette loi [loi Licinia de 131 av. J.-C. qui fait suite à la loi Fannia] toute couverte de la rouille du vieux temps. A quoi sert la liberté, si, voulant périr par le luxe, nous n’en avons pas le pouvoir ? ».
-
[14]
Des quatre scénarios de transition proposés par l’ADEME (2022) pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (génération frugale, coopération territoriales, technologies vertes, pari réparateur), tous sont considérés comme difficiles et imposant des efforts considérables de l’ensemble des acteurs ; voir aussi sur la nécessité de compromis GIEC, 2022, p. 53.
-
[15]
La lecture de l’article 3 d du traité CECA est toutefois à nuancer car par ordre de priorité, il est d’abord question d’inciter les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production : « Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'intérêt commun : (…) d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant leur épuisement inconsidéré. ».
-
[16]
Remarquons l’emploi du terme « consommation » dans le Code de l’environnement alors que l’article 191 paragraphe 1 du TFUE, tout comme l’article L101-2, Code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, emploient quant à eux le terme « utilisation », ce qui présente l’intérêt d’écarter l’idée d’aliénation systématique de la chose par sa disparition. Au surplus, la définition – non juridique – de la sobriété donnée par le GIEC (2022, p. 1510) rejoint l’idée de non utilisation : « avoiding the demand ».
-
[17]
Décret n° 74-1003 du 29 novembre 1974 créant une Agence pour les économies d’énergie, JORF du 1er décembre 1974, p. 12014, article 2. L’AEE est aujourd’hui l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
-
[18]
L’article L100-2, Code de l’énergie, prévoit que l’État veille, en particulier, notamment à « maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ».
-
[19]
Ces objectifs énumérés à l’article L541-1 du Code de l’environnement ont été enrichis à plusieurs reprises par : la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforçant la résilience face à ses effets.
-
[20]
Expression qui permet de désigner la portée expressément contraignante de dispositions relatives à la réduction ou l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. Le législateur réservant par exemple à l’article L541-9 du Code de l’environnement la possibilité d’interdire, en cas de nécessité, la fabrication ou la vente de produits générateurs de déchets.
-
[21]
Article L541-15-5 et L515-15-6, III, Code de l’environnement ; v. aussi la création du label public « anti-gaspillage alimentaire », décret n° 2021-1906 du 30 décembre 2021, article D541-215 et s., Code de l’environnement. Sur la définition du gaspillage alimentaire v. article L541-15-4, Code de l’environnement.
-
[22]
Article L541-15-8 et article D541-320 et s., Code de l’environnement. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie estimait qu’en 2019 la valeur marchande des invendus non alimentaires était de 4,3 milliards d’euros dont 7 % était détruit (ADEME, 2021, p. 16).
-
[23]
La loi Climat et résilience du 22 août 2021, préc., fixe dans son article 268 une trajectoire de réduction annuelle des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac liés aux usages d’engrais azotés minéraux du secteur agricole, permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015.
-
[24]
Article L254-3, IV, Code rural et de la pêche maritime : « À compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. ». À nuancer toutefois au regard du cadre limité de cette exigence.
-
[25]
Pris sur le fondement de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable, le plan « Ecophyto » mis à jour en 2018 sous le nom d’Ecophyto 2 + n’a pas atteint l’objectif quantitatif de réduction des produits phytosanitaires (initialement fixé à 50 % en 2008, l’objectif a été repoussé à 2025). Ces objectifs seront vraisemblablement une nouvelle fois repoussés avec le projet de plan « Eco-phyto 2030 ».
-
[26]
Articles L441-2 et L454-6, Code de la consommation ; L541-1, Code de l’environnement.
-
[27]
Article L110-1, II, 7°, Code de l’environnement : « principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ».
-
[28]
Article liminaire, 12°, Code de la consommation.
-
[29]
Rapp. articles L217-4, L217-5 et article L224-25-14, Code de la consommation, relatifs à la conformité d’un bien.
-
[30]
Article L541-15-10, article D541-330 et s., Code de l’environnement.
-
[31]
Article L541-1, I, 2°, Code de l’environnement ; rapp. des nouvelles obligations d’informations en matière de durabilité par les entreprises issues de la Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, JOUE, 16 décembre 2022, L322, p. 15.
-
[32]
Article L111-4, Code de la consommation.
-
[33]
Articles L217-3, 2°, L217-19, Code de la consommation tels que modifiés par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.
-
[34]
Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, « Une information sur les performances énergétiques et sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques encore largement à améliorer », Communiqué de presse, Paris, 27 septembre 2022, 3 p.
-
[35]
Proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, COM(2022) 71 final, 23 février 2022 ; Directive (UE) 2022/2464 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, 14 décembre 2022 ; Proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, COM(2022) 142 final, 30 mars 2022 ; Directive (UE) 5417/24 du 20 février 2024 (proposition COM(2022) 143 du 30 mars 2022) pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, JOUE, à paraître ; Proposition de directive sur la justification et la communication des allégations environnementales (Green Claims Directive Proposal), COM (2023) 166 final, 22 mars 2023.
-
[36]
L’indice consiste en une note de 0 à 10 qui permet d’informer le consommateur sur la capacité du produit à être générateur de déchet : Article L541-9-2, article R541-210 et s. c. env. ; décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 ; arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d’affichages. V. aussi articles L441-2 et L441-3 c. conso., selon ce dernier, la réparabilité est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
-
[37]
Le groupe Apple a accepté de payer une amende de 25 millions d’euros dans le cadre d’une transaction pénale pour pratique commerciale trompeuse faute d’avoir informé le consommateur des problèmes qu’engendraient la mise à jour du téléphone sur les performances de la batterie : Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, « Transaction avec le groupe APPLE pour pratique commerciale trompeuse », 7 février 2020.
-
[38]
Article L541-9-2, Code de l’environnement.
-
[39]
V. l’article L32-1, II, 9° et article L34-9-1, Code des postes et communications électroniques.
-
[40]
Article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2015-136 du 9 février 2015, article 4.
-
[41]
Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, mission d’information sur l’empreinte environnementale numérique, Pour une transition numérique écologique, Rapport d’information n° 555 du 24 juin 2020, 223 p. Le rapport contient 40 occurrences du terme sobriété et vise par exemple la sobriété des « data centers ».
-
[42]
Pour une présentation de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN) : Delpech X., 2021 ; Fonbaustier, 2022.
-
[43]
Loi REEN, ibid, article 27.
-
[44]
Loi « Climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021, préc., exposé des motifs.
-
[45]
Article L101-2, Code de l’urbanisme. Notons la suppression du terme « consommation » substitué par « utilisation » entre ancienne et nouvelle rédaction ; Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, articles 194 et 207 ; articles L4251-1, L4424-9, L4433-7, Code général des collectivités territoriales.
-
[46]
Article L141-5, Code de l’urbanisme.
-
[47]
Article L141-10, Code de l’urbanisme, v. aussi l’article L151-5 relatif au contenu du projet d’aménagement et de développement durable compris dans le plan local d’urbanisme : « le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ».
-
[48]
Article L141-6, Code de l’urbanisme.
-
[49]
V. également l’article L163-1 du Code de l’environnement sur les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
-
[50]
La loi de modo agrorum de Licinius et Sextius, adoptée en 367, défendait de posséder plus de cinq cents arpents de terre sur l'ager publicus. Le co-auteur de cette loi, Licinius Stolo, fut néanmoins condamné pour ne pas avoir respecté sa propre loi et mis des terres au nom de son fils.
-
[51]
V. article L333-1 et s., Code rural et de la pêche maritime.
-
[52]
V° l’exposé des motifs de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.
-
[53]
Article 47, loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové codifié à l’article L200-1 Code de la construction et de l’habitation. Deux formes spécifiques de sociétés d’habitat participatif sont nées de cet objectif : les coopératives d’habitants et les sociétés d’attribution et d’autopromotion. Leur régime est respectivement fixé aux articles L201-1 à L201-13 et aux articles L202-1 à L202-11 du Code de la construction et de l’habitation. Pour un aperçu du régime : Zalewski-Sicard V., 2017.
-
[54]
Le projet de décret d’application de l’article L6412-3 du Code des transports devant préciser les liaisons ferroviaires concernées et les liaisons aériennes interdites était présenté en février 2023. La consultation publique sur le projet de décret menée par le Ministère chargé des transports permet d’avoir un aperçu concret des intérêts et préoccupations qui s’opposent sur un sujet lié à la sobriété, URL : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-projet-de-decret-a2784.html, consulté le 21 mars 2023.
-
[55]
V. article L110-1, II, 2°, Code de l’environnement.
-
[56]
« Sufficiency is defined as avoiding the demand for materials, energy, land, water and other natural resources while delivering a decent living standard for all within the planetary boundaries » ; Rapp. de la définition de la sobriété figurant dans le rapport de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Transition(s), 2022, p. 13 : « démarche de questionnement des modes de vie et de consommation afin de maîtriser la demande de biens et de services et l’efficacité énergétique qui permet de réduire la quantité d’énergie nécessaire à leur production ».
-
[57]
L’effectivité d’un objectif général de sobriété dépendrait indéniablement de l’altitude, d’un effet hiérarchique utile et de la réunion de conditions sociétales, économiques et institutionnelles qui sont pour l’heure inexistantes.
-
[58]
Cette confusion dans les textes n’est pas étrangère à la confusion d’un moins et d’un mieux en économie au sein de l’entreprise, les discours - « meilleur pour l’environnement » - ne peuvent qu’être absurdes en l’absence d’une définition et d’une délimitation collective des besoins dans un monde fini.
-
[59]
Article L100-1, Code de l’énergie ; Article L110-1-1, Code de l’environnement : « La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ».
-
[60]
Article L541-1, I, 1°, Code de l’environnement.
-
[61]
En référence au « contrôle de trajectoire » désormais opéré par le juge administratif (v. Delzangles, 2021).
-
[62]
Le choix de la formule « prendre en considération » participe toutefois d’une normativité dégradée qui tend à reproduire le droit souple sans pour autant le hisser au rang de droit dur et avec des conséquences presque nulles. Sur ce point : Fonbaustier L. 2012.
-
[63]
À l’image des projets soumis à une évaluation environnementale, l’autorité compétente motive sa décision au regard des incidences négatives notables du projet sur l’environnement et dans le cas d’une autorisation précise les prescriptions pour éviter, réduire ou compenser celles-ci.
-
[64]
« The land ethic simply enlarges the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals, or collectively : the land. (…) A land ethic of course cannot prevent the alteration, management, and use of these ‘ressources,’ but it does affirm their right to continued existence ».
-
[65]
Soit pour Celnik J. – s’appuyant sur les travaux de Berg P. et Dasmann R., (1977) – un modèle de société décentralisé, écologique, démocratique et s’adaptant aux frontières naturelles.
-
[66]
V° Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la protection des sols, 2021/2548(RSP) ; Proposition de directive définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE (COM(2006) 0232), 22 septembre 2006.
-
[67]
Les directives territoriales d’aménagement et de développement durable (DTADD) définies à l’article L102-4 du Code de l’urbanisme permettent en ce sens à l’Etat de déterminer les objectifs et orientations de l’aménagement d’un territoire, notamment en matière d’urbanisme, de logement, de transport, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sites et paysages, ou encore de cohérence des continuité écologiques.
-
[68]
Précisée à l’article L541-1 c. env., l’écologie industrielle et territoriale – promue par les politiques publiques – consiste à quantifier et optimiser les flux de ressources produites ou utilisées par un territoire (eau, énergie, déchets) afin de limiter les impacts environnementaux en améliorant la compétitivité et l’attractivité des territoires.
-
[69]
Article L110-1-1, Code de l’environnement.
-
[70]
Article L541-1, II, 4°, Code de l’environnement.
-
[71]
Article L 1, III ; L111-2-2, Code rural et de la pêche maritime.
-
[72]
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ; article L1, I, 9° c. rural de la pêche maritime. La loi dite EGalim II n° 2021-1357 du 18 oct. 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est venue renforcer la bonne information du consommateur sur l’origine des produits (v. Delpech X., 2021).
-
[73]
Article L230-5-1, Code rural et de la pêche maritime, la rédaction originelle issue de la loi n° 2018-938 du 30 oct. 2018 indiquait plus expressément « issus d’approvisionnement en circuit-court », cette rédaction a été modifiée par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021.
-
[74]
Article L230-5 Code rural et de la pêche maritime.
-
[75]
« Notre système organique, soumis de plus en plus à des expériences mécaniques, physiques et chimiques toujours nouvelles, se comporte, à l’égard de ces puissances et de ces rythmes qu’on lui inflige, à peu près comme il le fait à l’égard d’une intoxication insidieuse. Il s’accommode à son poison, il l’exige bientôt. Il en trouve chaque jour la dose insuffisante ».
-
[76]
Selon l’article L533-10-3 du Code monétaire et financier, la technique de négociation algorithmique à haute fréquence désigne la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres des ordres (conditions de prix ou de quantité, opportunité du moment) sans intervention humaine ou avec intervention humaine limitée. La vitesse de cette technique d’agiotage est souvent perçue comme constitutive d’un risque pour la sécurité du marché et comme une atteinte à l’égalité entre les investisseurs.
-
[77]
Supra, article L6412-3, Code des transports.
-
[78]
Article liminaire, 12°, Code de la consommation : « Capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ».
-
[79]
Article 191 paragraphe 1 du TFUE et article L110-1-1 du Code de l’environnement prévoyant la poursuite d’une « empreinte écologique neutre dans le respect des limites planétaires » et un objectif de « consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ».
-
[80]
V° le préambule de la Charte de l’environnement, préc., dans lequel il est indiqué que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité et que les générations futures doivent pouvoir continuer à satisfaire leurs propres besoins.
Bibliographie
- ADEME, 2021, Études des gisements et des causes des invendus non alimentaires et de leurs voies d’écoulement, collection Expertises, Rapport final, 158 p.
- ADEME, 2022, Transition(s) 2050 : Choisir maintenant – Agir pour le climat, 687 p.
- Assemblée nationale (française), 2013, 26 juin, Projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, n° 1179, Exposé des motifs, 876 p.
- Barrière, O., 2022, La solidarité écologique, lien de droit d’une interdépendance au vivant, VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement, Hors-série 37, [En ligne], URL : http://journals.openedition.org/vertigo/38429
- Baudouin, V., 2019, Vers l’entreprise sobre, étude sur un concept juridique émergent, Thèse, Université de Strasbourg, 716 p.
- Berg, P., R. Dasmann, 1977, Reinhabiting California, The Ecologist, 7.10, pp. 399-401
- Berlioz, P., 2018, Droit souple ou droit dur, un (non) choix lourd de conséquences, Revue des sociétés, 11, p. 644.
- Berque, A., 2019, La terre et la Terre : une question d’échelle, une question de devoir, Revue juridique de l’environnement, Hors-série 18, pp. 19-31.
- Bétaille, J., 2012, Les conditions de l’effectivité de la norme en droit public interne, Thèse, Limoges, 767 p.
- Billet, P., R. Dufal, 2021, Chronique de fiscalité française de l’environnement. Tour d’horizon des principales évolutions législatives des cinq dernières années, Revue juridique de l’environnement, 46, pp. 161-181.
- Boni S., 2022, Homo confort, Le prix à payer d’une vie sans efforts ni contraintes, trad. Serge Milan, L’échappée, 256 p.
- Buno, I., P. Cary, 2022, Nature et propriété : pour une socio-économie écologique, Revue Française de Socio-Économie, 29, pp. 19-42.
- Camproux Duffrène, M.-P., 2022, Les communs naturels, de l’intérêt à l’action en défense,, VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement, Hors-série 37, [En ligne], URL : http://journals.openedition.org/vertigo/38348
- Castaldo, A., J.-P. Lévy, 2010, Histoire du droit civil, Dalloz, collection Précis, 1620 p.
- Celnik, J., 2015, La Cascadia, laboratoire du modèle biorégional étatsunien, Revue française d’études américaines, n° spécial 145, pp. 117-129.
- Cezard, F., M. Mourad, 2019, Panorama sur la notion de sobriété – définitions, mises en œuvre, enjeux, ADEME, collection Expertises, , 52 p.
- Chardonnet Darmaillacq, S., É. Lesueur, D. Louda, C. Maisonneuve et C. Voisin-Bormuth (dir.), 2020, Villes et territoires résilients, Hermann, 462 p.
- Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la), JORF n° 0051 du 2 mars 2005, p. 3697.
- Cour de cassation, 2014, Rapport annuel 2014, Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation, La documentation française, 678 p.
- Cornaro, L., 1558, De la sobriété, Conseils pour vivre plus longtemps, éd. Million Jérôme, 2014, 176 p.
- Cornu G, Association Henri Capitant., 2018, Vocabulaire juridique, Collection Quadrige, PUF, 12ème édition, voir sous entrée proportionnalité.
- Corvellec, H., A. Paulsson, 2023, Resource shifting: Resourcification and de-resourcification for degrowth, Ecological Economics, 205, 107703.
- Commission européenne, 2019, 11 décembre, Le pacte vert pour l’Europe, Communication, COM(2019) 640 final.
- Commission européenne, 2020, 19 septembre, Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030, Communication, COM(2020) 562 final.
- Commission européenne, 2021, 15 décembre, Pacte vert pour l’Europe : la Commission propose de stimuler la rénovation et la décarbonation des bâtiments, Communiqué de presse.
- Commission européenne, 2022, 25 mars, Déclaration commune de la Commission européenne et des Etats-Unis sur la sécurité énergétique.
- Cuzacq, N., 2002, Le luxe et le droit, RTD Com., pp. 605-626.
- Deleuze G., F. Guattari, 1991, Qu’est-ce que la philosophie ?, Éditions de Minuit, 206 p.
- Delmas-Marty, M., 2012, Préface, dans Markus, J.-P. (dir.), Quelle responsabilité envers les générations futures ?, Dalloz, collection Thèmes et commentaires, pp. 1-8.
- Delpech, X., 2021, 2 décembre, Une loi pour réduire l’empreinte environnementale du numérique, Dalloz actualité.
- Delzangles, H., 2021, Le « contrôle de la trajectoire » et la carence de l’Etat français à lutter contre les changements climatiques, AJDA, p. 2115.
- Denier-Pasquier, F., 2023, 17 mars, Le flou sur les volumes de prélèvements d’eau et les stratégies d’irrigation est inadmissible, Le Monde, Idées, p. 25.
- Douai, A., G. Plumecocq, 2017, L’économie écologique, La découverte, collection Repères, 128 p.
- Dubois-Pelerin, É., 2008, Le luxe privé à Rome et en Italie au Ier siècle après J.-C., Publications du Centre Jean Bérard, 390 p.
- Dufour A., C. Ronceray, M. Gravier-Bardet, L. Hubert et P. Deprost, 2021, Mars, Évaluations des actions financières du programme Ecophyto, Rapport CGEDD n° 013476-01, CGAAER n°20070, IGF n°2020-M-040-03, 208 p.
- Ellul, J.,1965, L’illusion politique, Robert Laffont, 362 p.
- Faberon, J.-Y., 1991, Droit de la maîtrise d’énergie, Janvier 1990 à mars 1991, Revue juridique de l’environnement, 3, chronique, pp. 355-367.
- Fauconnet, P., 1928, La responsabilité, Etude de sociologie, Librairie Félix Alcan, 2ème éd°, 400 p.
- Ferreboeuf, H. (dir), 2019, Lean ICT – towards digital sobriety, The Shift Project, Report, 90 p.
- Fenet, P.-A., 1836, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Videcoq, t. XIV, 1836, 618 p.
- Flipo, F., 2021, L’impératif de la sobriété numérique, Les concepts à l’épreuve du terrain, Dossier thématique, Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 13, pp. 29-47.
- Fonbaustier, L., 2012, Principe d’intégration et échelle de normativité : libres propos sur la délicate notion de « prise en compte » en droit de l’environnement, dans Institut de droit public des affaires, Florilèges du droit public. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Boivin, La mémoire du droit, pp. 531-558.
- Fonbaustier, L., 2015, 5 octobre, Une volonté politique énergique et croissante aux effets incertains. À propos de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JCP G, act. 1053, pp. 1778-1783.
- Fonbaustier, L., 2019, L’(in)efficience de la norme environnementale, Délibérée, 3, n°8, pp. 19-25, [En ligne], URL : https://www.cairn.info/revue-deliberee-2019-3-page-19.html
- Fonbaustier, L., 2020, 27 janvier, Des intentions ambitieuses au souffle un peu court - À propos de la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, JCP G, act. 86., pp. 150-154.
- Fonbaustier, L., 2022, 7 février, Le législateur environnemental s’empare (enfin) de la sobriété numérique. À propos des lois des 15 novembre et 23 décembre 2021, JCP G, doctr. 186, pp. 286-293.
- François (Pape), 2015, Lettre encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison commune, Rome, 192 p., spéc. points 222-224.
- François (Pape), 2019, 2 décembre, Discours du Pape François à un groupe de jeunes entrepreneurs français, Rome, 3 p.
- François (Pape), 2021, 24 décembre, Homélie du Pape François, Basilique Saint-Pierre, Messe de la nuit, 4 p.
- Gabriel, C.-A., C. Bond, 2019, February, Need, Entitlement and Desert: A Distributive Justice Framework for Consumption Degrowth, Ecological Economics, vol. 156, pp. 327-336.
- Gaillard, E., 2008, Générations futures et droit privé, Thèse, Orléans, LGDJ, collection Bibliothèque de droit privé, 2011, 692 p.
- Gimalac, L., 2001, 30 octobre, La définition de la quintessence du luxe : un défi utile pour le juriste ?, Gazette du Palais, n° 303, pp. 10-16.
- Georgescu-Roegen, N., 1979, La décroissance, Entropie – Ecologie - Economie, présentation et traduction de Grinevald J. et Rens I., Editions Sang de la terre, 1995, 254 p.
- Gorz, A., 1992, L’écologie politique entre expertocratie et autolimitation, Actuel Marx, 12, pp. 15-29.
- Gorz, A., 2019, Éloge du suffisant, présenté par Gilliand C., PUF, collection Classiques de l’écologie, 96 p.
- Gregg, R., 1936, The Value of Voluntary Simplicity, traduction française, éditions Vierzon, 2012, 93 p.
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2022, Climate Change 2022, Mitigation of Climate Change, Working Group III, Contribution to the Sixth Assessment Report of the IPCC, 2913 p.
- Hermon, E., 1994, Les lois Licinia-Sextia : un nouvel examen, Ktèma, 19, pp. 119-142.
- Hicks, J. R., 1966, 1 st November, Growth and anti-growth, Oxford Economic Papers, volume 18, pp. 257- 269.
- Hirsch, F., 1976, Social Limits to Growth, Harvard University press, 2013, 208 p.
- Illich, I., 1973, La convivialité, Paris, Éditions du Seuil, 157 p.
- Jasanoff, S., 2004, States of knowledge. The co-production of science and social order, London, Routledge, 336 p.
- Jestaz, P., 2022, Les sources du droit, Dalloz, 3ème édition, 212 p.
- Josserand, L., 1939, De l’esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de l’abus des droits, Dalloz, 2ème éd., 486 p.
- Jungell-Michelsson, J, P. Heikkurinen, 2022, May, Sufficiency : A systematic literature review, Ecological Economics, vol. 195, 107380, [En ligne], URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800922000428?via%3Dihub
- Kornai, J., 1984, Socialisme et économie de la pénurie, Economica, 587 p.
- Kiss, A. C., 1982, La notion de patrimoine commun de l’humanité, RCADI, vol. 175, p. 203.
- Kjaer, P. F., 2020, 31 August, What Comes After Neoliberalism?: Four Propositions for a New Law of Political Economy beyond Structural Liberalism and Structural Marxism, VerfassungsBlog, [En Ligne], URL : https://verfassungsblog.de/what-comes-after-neoliberalism-2/
- Latouche, S., 2011, Vers une société d’abondance frugale. Contresens et controverses sur la décroissance, Fayard, collection Mille et une nuits, 208 p.
- Lavorel, S., 2021, Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États, Revue juridique de l’environnement, vol. 46, pp. 37-62.
- Léon XIII (Pape), 1891, 15 mai, Lettre encyclique Rerum novarum, Rome, 23 p.
- Léopold, A., Sand County Almanach. And sketches here and there, Oxford University Press, New-York, 1949 (trad. française, Almanach d’un comté des sables, Paris, Aubier, 1995), p. 204.
- Lerousseau, N., 2014, septembre, La promotion de l’habitat alternatif : habitat participatif, habitat léger ou mobile, Lamy RLCT, 104, p. 56.
- Lomerteau, B., 2021, octobre, Environnement et développement durable - La loi Climat et Résilience : une approche systémique timide des enjeux climatiques, JCP Energie, environnement, infrastructures, 10, dossier 25.
- Lorrain, D., C. Halpern et C. Chevauche, 2018, Villes sobres, nouveaux modèles de gestion des ressources, Science Po Les Presses, 360 p.
- Malthus, T. R., 1798, Essai sur le principe de population, traduction de Theil P. et mis en ligne par Tremblay J.-M. : http://classiques.uqac.ca/classiques/maltus_thomas_robert/essais_population/principe_de_population.pdf, 153 p., spéc. p. 10.
- Markus, J.-P., 2001, Le principe d’adaptabilité : de la mutabilité au devoir d’adaptation… , RFDA, pp. 589-604.
- Markus, J.-P. (dir.), 2012, Quelle responsabilité juridique envers les générations futures ? Dalloz, Thèmes et commentaires, 2012, 320 p.
- Marx, K., 1867, Le Capital, PUF, 1993, Tome 1er, 990 p.
- Mazé, C., O. Ragueneau, La solidarité écologique de la science à l’(in)action publique, VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement, Hors-série 37, [En ligne], URL : http://journals.openedition.org/vertigo/38499
- Meadows, D., D. Meadows, J. Randers et W. Behrens, 1972, Halte à la croissance ? Rapport sur les limites de la croissance, Massachusetts Institute of Technology, trad. de l’anglais par Delaunay, J., Fayard, collection Ecologie, 314 p.
- Méda, D., 2022, 28 mars, L’heure de la sobriété est venue, Le Monde, [En ligne] URL : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/26/dominique-meda-l-heure-de-la-sobriete-est-venue_6119214_3232.html
- Michelot, A., 2020, Pour un principe de solidarité écologique ? De la critique à la proposition, du droit interne au droit international, Revue juridique de l’environnement, vol. 45, pp. 733-750.
- Mill, J.-S., 1894, Principes d’économie politique, Ed. Guillaumin, Paris, 1894, p. 138.
- Montesquieu, C. de S., 1748, De l’Esprit des lois, éd. Nourse, 1772, t.1, livre V, chap. VI, p. 56.
- Moyse, P.-E., 2020, The Uneasy Case of Case of Programmed Obsolescence, HeinOnline, 71 U.N.B.L.J. 61, 52 p. [En ligne], URL : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3804451
- Neumayer, E., 1999, Weak Versus Strong Sustainability: Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms, Edward Elgar Publishing, 4th ed., 2013, 296 p.
- Organisation des Nations-unies, 2013, Harmonie avec la nature. Rapport du Secrétaire général, Assemblée générale, 15 août 2013, 68ème session, A/68/325, 19 p.
- Ost, F., 2003, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, La découverte, pp. 266-272.
- Pastoret, E. de, 1804, Recherches et observations sur les lois somptuaires des Romains, pendant la République, Séance publique de l’Institut national, Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 277, 26 juin 1804, p. 1260 ; Histoire et mémoire de l’Institut de France, 1821, t.5, pp. 76-142.
- Parrique, T., 2019, The political economy of degrowth, Thèse en sciences économiques, Université Clermont Auvergne, Stockholm University, 872 p.
- Paquot, T. (dir.), 2021, Dromologie : cahiers Paul Virilio n°1. La vitesse c’est l’état d’urgence, Éd. Eterotopia France, 189 p.
- Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, 2019, The global assessment report on Biodiversity and Ecosystem services, IPBES secretariat, Bonn, 1148 p.
- Platon, 1833 [370 avant J.-C.], La République, trad. V. Cousin, Paris, éd° Rey et Gravier, 1833, t. 9, Livre IV, 430e.
- Plutarque, 1844 [72-126], Œuvres morales, trad. Ricard, éd. Didier, Paris, 1844, t. 2, 600 p., v. p. 359, De la vertu morale.
- Prieur, M., C. Bastin et A. Mekouar, 2021, Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement, Peter Lang, 270 p.
- Princen, T., 2005, The logic of Sufficency, Cambridge, MIT Press, 424 p.
- Rahbi, P., 2013, Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 163 p.
- Renan, E., 1882, Marc-Aurèle et la fin du monde antique, Calman Lévy, 446 p., v. pp. 9-10
- Règlement de l’Union européenne (UE) 2018, 2018/1999, 11 décembre, sur la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat, Journal officiel de l’Union européenne, 21 décembre 2018, L 328/1.
- Rosa, H., 2010, Accélération. Une critique sociale du temps, La Découverte, 486 p.
- Rousseau, F., 2011, De quelques réflexions sur la responsabilité collective, Recueil Dalloz, p. 1983.
- Saint-Paul, 1585 [57], Epitre aux romains, chap. XII, § 3, trad. Montaigne, Essais, Livre I, chap. 29, « De la modération ».
- Schumacher, E. F., 1978, Small is beautiful – Une société à la mesure de l’homme, Contretemps/Le Seuil, 316 p.
- Syrus, P. (selon l’adage attribué à), Ier s. avant J.-C., Medicorum nutrix est intemperantia, l’intempérance est nourrice de la médecine.
- Thoreau, H. D., 1971 [1854], Walden, Lyndon Shanley J. Princeton University Press, 371 p.
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 2012, Journal officiel de l’Union européenne, n° C 326 du 26 octobre 2012, p. 0001.
- Valéry, P., 2019 [1936], Le bilan de l’intelligence, Éditions Allia, 64 p.
- Van Lang, A., 2022, Le droit de la transition écologique en devenir, AJDA, pp. 133-141.
- Viard, C., 2009, Protéger la santé grâce à l’interdiction, Droit et cultures, 57, pp. 143-169.
- Virilio, P., 1977, Vitesse et politique, Essai de dromologie, Éditions Galilée, 151 p.
- Voltaire, 1736, Le Mondain, Paris, 8 p.
- Weil, S., 1955, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, Gallimard, Folio, essais, 151 p.
- Winter, G., 2014, décembre, La proportionnalité écologique : un principe émergent, Environnement, n°12, étude 19.
- Zalewski-Sicard, V., 2017, L’habitat participatif : un choix cornélien entre liberté et sécurité, Gazette du Palais, p. 77.