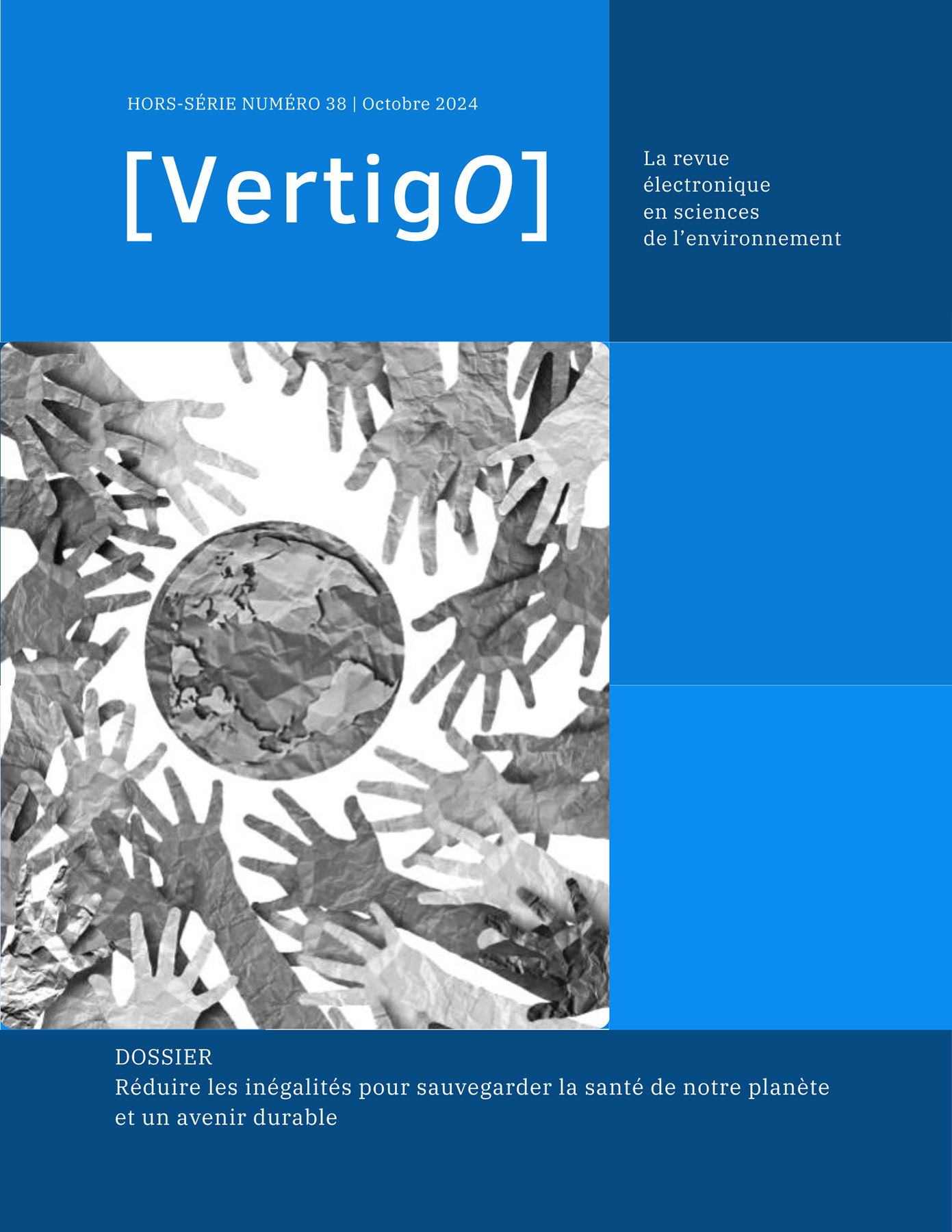Abstracts
Résumé
Notre prémisse commence avec les inégalités : la santé de la planète et de l’humanité est dépendante de notre capacité à les réduire. Les inégalités plongent toutes les sociétés dans des crises interreliées : environnementale, climatique, énergétique, agricole, économique, sociale, santé publique. Alors que certains individus et groupes sont touchés disproportionnellement plus que d'autres, tout le monde, à tous les niveaux de la société, souffre des effets négatifs des inégalités. Les défis de compréhension touchent deux domaines principaux : d’une part, la population et la manière dont elle consomme la planète ; d’autre part, l’adaptation aux changements, en particulier à ceux induits par les problèmes socioenvironnementaux causés par notre système socioéconomique global. Notre contribution collective – ce qu’on peut extraire des articles composant ce numéro spécial et leur mise en contexte – est double. Premièrement, elle s’attache à mieux comprendre la complexité des sources d’inégalités, regroupées autour de quatre thèmes : l’information ; les enjeux de pouvoir ; les bonnes intentions de développement et leurs effets négatifs ; les questions systémiques, en particulier celles reliées au foncier. De plus, existe un besoin pressant de comprendre les défis socioenvironnementaux soulevés par les inégalités : par exemple, ceux reliés aux connaissances scientifiques, à la nature dynamique des situations diverses, à la mise en œuvre des projets de réduction de ces mêmes inégalités, aux obstacles mis en place, ainsi qu’à d’autres défis en lien avec les questions de vulnérabilité et de justice. Sur cette base, deuxièmement, cette introduction explore aussi quelques pistes de solutions, examinées aux échelles locale, nationale et mondiale. Des solutions systémiques multiscalaires font partie intégrante de la lutte contre les inégalités, afin de parvenir à un monde plus équitable et plus juste.
Mots-clés :
- inégalités,
- équité,
- vulnérabilité,
- défis de compréhension,
- défis socioenvironnementaux,
- relation à la nature,
- relations de pouvoir,
- solutions,
- changement climatique,
- adaptation
Abstract
We begin with inequalities: the health of the planet and humanity depends on our ability to reduce them. Inequalities lead societies into interrelated crises: environmental, climatic, energetic, agricultural, economic, social, and public health. While certain individuals and groups are disproportionately more affected than others, everyone at all levels of society suffer from negative impacts of inequalities. To improve our understanding of these inequalities, we focus on two main areas: the population and the way in which it consumes the planet; and adaptation to stresses, in particular those induced by socio-environmental problems caused by our global socio-economic system. Our contribution is twofold. First, the articles together highlight the need to better understand the complex sources of inequalities, which we group into four main categories: information; issues of power; good intentions for development and their adverse effects; and systemic questions, particularly those related to land. In addition, there is a need to understand the socio-environmental challenges that arise from inequalities, which are: those related to scientific knowledge; linked to dynamic nature of diverse situations; concern implementation of projects that aim to reduce inequalities; surrounding obstacles; and other challenges that involve issues of vulnerability and justice. Based on these understandings, our second contribution is the exploration of some solutions, examined from local, national, to global scales. Systemic solutions at different scales are integral to tackle inequalities, in order to achieve a more equitable and just world.
Keywords:
- inequalities,
- equity,
- vulnerability,
- understanding challenges,
- socioenvironmental challenges,
- relationship with nature,
- power relations,
- solutions,
- climate change,
- adaptation
Article body
Introduction : atteindre l’équité dans un monde juste ?
Il était une fois…
Il était une fois un monde où tous les habitants semblaient vivre dans la misère et où les limites planétaires n’étaient pas respectées. Les 5% les plus riches contrôlaient plus de 80% des ressources alors que le reste de monde vivait très pauvrement. Puis, les gens se sont réunis, même les riches, pour affronter ce problème et tout a commencé à changer. Les humains se sont reconnectés aux écosystèmes. Pour tous, les productions agricoles sont devenues suffisantes d’une manière qui respecte non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la souveraineté alimentaire. Comme l’alimentation était de qualité, la population mangeait bien, ce qui, avec l'universalisation de l'accès aux services de santé, permettait à tous de vivre sainement. De la même manière, grâce à un accès universel à une éducation de qualité, autant dans les formations techniques que celles plus poussées, les gens pouvaient choisir les emplois qu’ils préféraient ; il en résultait une participation citoyenne considérable. Les guerres entre les pays et les conflits civils avaient disparu et la paix était répandue partout. C’était bien sûr « il était une fois »…
Cette amorce fait écho avec l’introduction du livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui commence avec « Une fable pour demain ». Ce livre a contribué à lancer le mouvement écologiste dans les années 1960 (Carson, 1962). Le présent numéro spécial de la revue VertigO n’a bien sûr aucune prétention pour déclencher un mouvement aussi signifiant que celui amorcé par Carson. Nous souhaitons tout même insister sur le fait qu’un monde où les inégalités sont réduites, un monde plus équitable et juste est un monde qui privilégie les libertés et les capacités (dans le sens de Sen, 2000, repris par Nussbaum, 2011) de toutes les personnes, où l’économie est basée sur les besoins humains et où l’environnement qui en forme la base est protégé, restauré, conservé. C’est un monde où chaque personne, chaque collectivité, connait et comprend les différentes ressources et opportunités auxquelles elles ont accès. Tous les facteurs et processus qui contribuent à la vulnérabilité (dans le sens donné par Wisner et al., 2012) sont compris et autant les citoyens que les professionnels et les élus prennent des décisions intentionnelles et se mettent en action pour réduire la vulnérabilité pour tous et toutes. Une société dont l’économie est équitable, inclusive et durable, et où l’on trouve une fluidité des échanges culturels et sociaux, des connaissances, c’est-à-dire une facette positive de la mondialisation actuelle, c’est un monde auquel nous aspirons, et notre contribution à un tel monde se poursuit ici.
… des inégalités, à réduire pour atteindre l’équité…
Notre prémisse commence avec les inégalités : la santé de la planète et de l’humanité est dépendante de notre capacité à les réduire. Ici, nous nous concentrons sur les impacts des inégalités, qui sont généralisés. Les inégalités plongent toutes les sociétés dans des crises interreliées : environnementale, climatique, énergétique, agricole, économique, sociale, santé publique (Pickett et al., 2024 ; Bonneuil, 2017 ; Klein, 2015 ; Moore, 2015 ; Kempf 2007 et 2009 ; Bairoch, 1994). Plus que cela, elles ont des impacts négatifs sur la société, peu importe la classe sociale : pauvres et riches dans les pays inégalitaires vivent en moyenne moins longtemps, sont moins éduqués et présentent une prévalence plus élevée d’obésité, de toxicomanie et de maladie mentale (Pickett et al., 2024 ; Wilkinson et Pickett, 2009 ; aussi cité par Laurent, 2021, p.112). Pire, nous constatons que les inégalités entre les pays – ainsi qu’à l’intérieur des pays – ont de graves répercussions (Chancel et al., 2021) : « la crise des inégalités, qui nourrit le ressentiment identitaire, accroît la distance entre les citoyen-nes et mine l’idéal d’égalité partout sur la planète » (Laurent, 2021, p.58). À une autre époque, elles ont contribué à déclencher deux guerres mondiales en moins d’une génération, ainsi que l’a bien analysé Karl Polanyi (Polanyi, 1944).
Rappelons aussi qu’Homo Sapiens, malgré qu’il soit devenu une force géologique, celle de l’Anthropocène (Bonneuil et Fressoz, 2016 ; Crutzen et Stoermer, 2000), reste intégré à cette nature dont il est issu (Bai et al., 2018 ; Constanza et al., 2014 ; Capra, 2004 ; Passet, 1996), « la nature prenant conscience d’elle-même », comme l’affirmait le géographe-anarchiste Élisée Reclus au tout début du 20e siècle (Reclus, 1998), y compris à travers ses institutions comme l’économie de marché ou le capitalisme (Moore, 2015). De cet ensemble systémique multiscalaire, nous mettons en évidence, dans ce numéro spécial, les inégalités affectant les humains, en particulier celles qui ont des impacts touchant aux différentes composantes de son environnement physique comme la biodiversité et les écosystèmes à partir de laquelle ils sont construits, le climat, le cycle hydrologique, et cetera. Les problèmes « environnementaux » sont en fait d’abord des problèmes sociaux, causés ou exacerbés par les inégalités socioéconomiques (Bookchin, 1993), créées par le système capitaliste (Moore, 2015 ); pas seulement parce que l’on vit dans cet environnement et que nous sommes touchés par leurs effets, mais d’abord parce que ce sont nos relations sociales qui dictent en quelque sorte notre relation à la nature (Bookchin, 1993). Et bien sûr, à partir de là, les transformations drastiques que nous imposons à cette nature dans absolument tous ses aspects, ce qui veut dire à nous-mêmes aussi, alors que les problèmes causent des impacts différenciés (Gemenne et Rankovic, 2019), augmentent les vulnérabilités différenciées aussi à plusieurs échelles, d’autant plus que les échanges inégaux (Emmanuel, 1969) sont aussi écologiques (Bonneuil, 2017). Bref, les inégalités à réduire et que nous analysons sont d’abord sociales, et elles affectent l’ensemble de la biosphère ; le volet économique y joue un rôle important, du fait de sa prééminence dans les décisions politiques, mais n’équivaut en aucun cas ni à l’un (la société), ni à l’autre (la biosphère) (figure 1). De ce point de vue, dans les grandes approches, qu’elles soient scientifiques ou politiques, il est nécessaire de revoir la hiérarchie ou plutôt l’emboitement entre économie, société et biosphère, selon le modèle proposé par Passet.
Figure 1
Remettre l’économie à sa place : un phénomène social… partie de la nature
NOTE : Presque 25 ans après le Sommet de la Terre de Rio, on a aussi vu réapparaitre cette idée dans les travaux du Stockholm Resilience Centre pour décrire la relation entre les ODD (https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html). Et d’autres chercheurs ont développé des variantes plus ou moins complexes selon les thèmes abordés (par exemple Bleau, 2020). À noter que le livre dans lequel Passet a publié son schéma est initialement paru en 1979.
Les grands enjeux planétaires actuels, notamment la crise climatique, plongent leurs racines dans ces inégalités et les liens entre inégalités et problèmes environnementaux sont aussi bien établis. Il existe des preuves empiriques suffisamment solides qui démontrent que l'écart croissant entre riches et pauvres entraine des conséquences négatives pour l’environnement et, inversement, les problèmes environnementaux, dont les problèmes climatiques, exacerbent les inégalités ou les iniquités (IPCC, 2023 ; Byskov et al., 2021 ; Hamann et al., 2018). Il faut souligner que, lorsque nous évoquons le fait de « réduire les inégalités », nous considérons que l’égalité est une importante composante normative de la justice. L’inégalité est plus qu’une dimension de la pauvreté ; ce qui signifie que le travail pour la réduire pour atteindre équité est plus ambitieux que de viser seulement à réduire de la pauvreté. Réduire l’inégalité extrême entre riches et pauvres, ça veut dire s’attaquer non seulement à l’écart de richesse (dans le sens de la justice distributive) mais aussi aux écarts dans l’accès au pouvoir et à la prise de décision concernant les ressources et les opportunités (dans le sens de la justice procédurale). Assurer ces accès pour ceux qui n’en ont pas en considérant leurs capabilités et leurs vulnérabilités contribue ainsi à atteindre l’équité. Et atteindre de l’équité permet d’avancer vers la justice (Sen, 2000). Ainsi, les mouvements de justice environnementale et climatique ont porté à notre attention les impacts plus significatifs de dégradation de l’environnement et de changements climatiques vécus par les communautés ou les pays plus pauvres : « les riches (…) disposent de moyens appréciables de se protéger de la fureur du climat » (Klein, 2015, p.82). Admettons que nous sommes d’accord qu’il faut réduire des inégalités pour atteindre l’équité vers un monde juste, il faut d’abord reposer la question, comme Amartya Sen la posait déjà il y a plus de 30 ans : de quelles égalités et de quelles inégalités parle-t-on, et aussi, quelle différence y a-t-il entre l’égalité et l’équité (Sen, 1992 et 2000) ?
… pour sauver la planète
« Sauver la planète » constitue la deuxième partie du titre du colloque qui a servi de base à ce numéro spécial, repris comme titre de cette introduction. Remettons tout de suite les choses en perspective : la planète Terre n’a pas besoin d’être sauvée ; la matière qui la constitue se retransformera dans l’espace intersidéral lorsque notre soleil s’éteindra, dans quelques milliards d’années. Quant à la vie sur la planète, même avec la réalisation du pire scénario, c’est-à-dire l’explosion des arsenaux nucléaires et la destruction totale de nos civilisations, complétant la 6e extinction massive de l’histoire de la vie sur la planète – qui, elle, bien en cours (Ceballos et al., 2020 ; Leakey et Lewin, 2011) -, grosso modo, dans un million d’années, il n’y paraitra plus et la vie aura repris ses « droits » (National Geographic, 2009). C’est bien sûr notre monde humain, créé par Homo Sapiens, qu’il importe de sauver, mais la planète telle qu’elle est constituée reste la base de la vie et nous en sommes dépendants.
Nous sommes certes conscients que la compréhension des liens entre inégalités et l’état de l’environnement physique ou de la nature, s’avère une entreprise complexe qui est discutée d’une manière croissante dans le cadre de la justice environnementale depuis la fin des années 1970 particulièrement aux États-Unis (Deldrève et al., 2019 ; VertigO, 2019) et plus récemment aussi dans le cadre de la justice climatique. Ces discussions permettent de placer dans des modèles ou des matrices la grande diversité des interactions entre les humains, les paysages et les écosystèmes naturels. Par exemple, bien que les chocs, comme les extrêmes ou les stress météorologiques, les pandémies et les guerres attirent particulièrement l’attention, les changements graduels comme le rehaussement du niveau de la mer, la disparition de langues et de cultures et les évolutions technologiques posent aussi plusieurs problèmes majeurs, qui requièrent l’attention d’acteurs, à différentes échelles décisionnelles, et qui interviennent sur divers plans géographiques et temporels (The Shift Project, 2022). Les milieux de vie sont étroitement imbriqués et interagissent les uns avec les autres. Ils se sont développés dans une matrice de paysages et d’écosystèmes naturels qui fournissent d’importants services écologiques. Composés de systèmes dynamiques et complexes, ces milieux de vie où sont intégrés les humains, à la fois, génèrent et souffrent d’importants problèmes (santé, économie, sécurité publique, environnement, et cetera), qui risquent de s’aggraver en raison, entre autres, des changements climatiques (figure 2).
Figure 2
Complexité de la matrice des paysages et des écosystèmes naturels
NOTE : Matrice de paysages et d’écosystèmes naturels qui fournissent, pour le bienêtre humain, d’importants services écologiques aux systèmes physiques et socioéconomiques qui composent les milieux urbains et ruraux. Cette structure et ces liens sont dynamiques et évolutifs, avec des voies non linéaires.
Selon des scientifiques, l’adoption d’une approche plus holistique et systémique permettrait de mieux tenir compte des liens étroits et complexes entre les sous-systèmes physiques, socioéconomiques et écologiques des milieux de vie (Capra, 2004 ; Passet, 1996), et d’aborder, dans leur ensemble, les grands enjeux de société comme la gouvernance (cohérente et juste socialement) (Waridel, 2019), l’utilisation durable des ressources (partagées équitablement), et l’environnement (Baï et al., 2018 ; Passet, 1996).
C’est là un très grand défi, autant pour la recherche, pour la vie citoyenne, que pour la gouvernance. Comme Klein l’a constaté dans son excellent dossier sur le changement climatique : « il faut faire face simultanément à des crises multiples, qui se chevauchent et se croisent, notamment le changement climatique, la pauvreté, la faim, le racisme ; pour réaliser tous cela, il faut apprendre le travail « multitâches », c’est-à-dire, mettre l’équité et la justice au centre de notre réponse au défi du changement climatique et à d’autres problèmes « environnementaux » » (Klein, 2019). Adopter une perspective plus holistique et inclusive dans nos décisions et nos actions permettrait : 1) de mieux comprendre l’ensemble des problèmes, entre autres en identifiant mieux leurs sources dans un cadre multiscalaire pour éventuellement prendre la bonne décision au bon niveau (Déry, 2006 ; Passet, 1996) ; 2) d’augmenter le potentiel des synergies et actions complémentaires ; 3) d’éviter les solutions partielles, les actions qui entrent en conflit ou la maladaptation (Bleau et Després, ce numéro) ; et 4) de prévenir un transfert inéquitable des risques et des couts entre les différents acteurs de la société et entre les pays dans le monde. Mieux établir et comprendre cela constitue une première phase pour permettre éventuellement d’atteindre les consensus sociaux nécessaires au déploiement d’actions politiques pertinentes et fortes.
Le contexte de la recherche
Les défis d’une transition
Réfléchir à l’histoire des inégalités, c’est en quelque sorte entrer dans l’histoire de la pensée économique. Ce n’est pas notre objectif ici, d’autant plus que René Passet a déjà réalisé l’exercice avec brio (Passet, 2010). Gardons tout de même en tête que les premières formations étatiques ont en quelque sorte constitué les premières machines à maximiser les inégalités sociales (Scott, 2017) et que les Grecs antiques voyaient les hiérarchies sociales comme « naturelles » (Passet, 2010, p.51), même si Platon avait compris que l’accroissement de la richesse engendrait des inégalités qui, par oligarchie et démocratie interposées, finissaient par résulter en tyrannie (Passet, 2010, pp.53-54). Pour notre propos, concentrons-nous d’abord sur deux jalons récents qui ont transformé les réflexions sur la transition à accomplir en ce deuxième quart du 21e siècle qui débute très bientôt.
Premier jalon : la constatation de la finitude de la planète qui s’est amorcée après que la première photo de la Terre vue de l’espace a été publiée. Prouesse technique pour l’époque, elle a tout de même nourri toutes les réflexions qui ont entrainé le premier Sommet de la Terre à Stockholm en 1972, la création du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le rapport Meadows au Club de Rome (Halte à la croissance ?, Meadows et al., 1972), dans le sillon desquels des ministères nationaux de l’Environnement ont germé, la Commission Bruntland a remis son rapport intitulé Notre avenir à tous en 1987 (CMED, 1988), et le programme de l’Agenda 21 a été défini et lancé en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio.
Deuxième jalon : la constatation que notre histoire humaine pourrait avoir une fin sur un horizon plus prévisible, mesurable ; ce jalon peut être placé au tournant du nouveau millénaire lorsque Paul Crutzen a lancé l’idée que nous vivons maintenant dans une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène (Crutzen et Stoermer, 2000)[1]. Au même moment, les rapports du GIEC confirmaient avec plus de précision la part anthropique dans les changements climatiques en cours et développaient divers scénarios pour les horizons 2050 et 2100, certains, les pires, annonçant très certainement la fin de l’histoire humaine telle que nous la connaissons.
De ces nouvelles connaissances ont émergé toute une panoplie d’études cherchant à en comprendre les divers mécanismes, tout comme des réflexions sur les solutions aux problèmes de notre monde ou sur les transitions à effectuer. Entre le déni complet d’un côté, comme dans l’ouvrage Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête (Brunel et Pitte, 2010), et, de l’autre, le scénario extrême du sixième rapport du GIEC – une augmentation de la température moyenne du globe de 5,7°C à l’horizon 2100 (IPCC, 2022) –, une panoplie d’auteurs ou d’organisations y lancent leurs idées et leurs projets qui demeurent au départ surtout économiques : par exemple, le Green growth du World Resource Institute (WRI, 2024), ou, avec un très large consensus politique international, les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU à l’horizon 2030, pour ne nommer que ceux-là.
Parmi les défis de compréhension que tout cela induit, le premier est celui des effets de la croissance de la population mondiale et des impacts sur la consommation des matières premières transformées en ressources, en particulier les impacts liés aux inégalités (Hamann et al., 2018). Meadows et ses collègues avaient analysé la question dès 1972 (Meadows et al., 1972), alors que les mesures se raffinent (Mérenne-Schoumaker, 2020). Au total, il reste que, ce n’est pas tant le total de la population qui compte le plus que la manière dont elle consomme les ressources de la planète, comme le démontre entre autres l’indicateur de l’empreinte écologique (Wackernagel et Rees, 1999)[2], dans toutes les déclinaisons de la Footprint family (Galli et al., 2012). Par exemple, grâce d’abord aux travaux de Arjen Y. Hoekstra, on peut maintenant mesurer la consommation d’eau virtuelle (virtual water en anglais) ou l’empreinte hydrique (water footprint en anglais), c’est-à-dire la consommation totale d’eau d’un pays, d’une région ou même d’un individu, en tenant compte de l’eau utilisée pour fabriquer les produits et services, ce qui inclut celle qui est « importée » de l’étranger (Krol et al., 2022 ; Hoekstra et al., 2017 ; Fonds mondial pour la nature, 2010 ; Hoekstra, 2003)[3]. Il en résulte très souvent un échange écologique inégal (Bonneuil, 2017). Dans cette même veine, l’on sait aussi que l’empreinte ichtyologique (pêches) mondiale dépasse la capacité des mers à produire de nouveaux poissons depuis déjà les années 1970 (Talberth et al., 2006) et que, comme pour la biodiversité terrestre, la capacité biologique des mers a continué à diminuer depuis le début du 21e siècle (Fonds mondial pour la nature, 2020 et 2022).
Un deuxième défi de compréhension, lié au premier, est celui des capacités d’adaptation aux changements, qu'ils soient environnementaux, climatiques ou socioéconomiques. Par exemple, si l’on prend les régions rurales, de manière décalée depuis les années 1960 et 1970, elles se sont transformées, dans certains cas à une vitesse inégalée dans l’histoire (Guibert et Jean, 2011). Si, au total, la dynamique des enclosures, prélude à la révolution industrielle, s’est déroulée sur plus d’une centaine d’années en Angleterre (Polanyi, 1944), certaines régions d’Asie, en particulier en Asie du Sud-Est, ont connu « récemment » des transformations drastiques, parfois même en quelques jours (De Koninck, 2019 ; De Koninck et Rousseau, 2012, 2013 ; Rigg et Vandergeest, 2012). Sur le plan spécifiquement agricole, cette capacité d’adaptation rurale a été systématiquement brisée et même parfois éliminée, jusqu’au tournant des années 2010, y compris par le biais des organisations internationales. Plus particulièrement, le Fonds monétaire international (FMI) et ses politiques d’ajustements structurels, la Banque mondiale (BM), ou même l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont généralement favorisé le développement et l’expansion des grandes compagnies multinationales de l’agriculture et de l’agroalimentaire sans vraiment tenir compte de la capacité d’adaptation des agriculteurs locaux. Pour de nombreux observateurs, les courbes démographiques et de demande alimentaire justifiaient l’expansion continue de l’agriculture mondialisée (Fouilleux et al., 2017 ; De Koninck, 2015 ; Charvet, 2012 ; Rousseau et al., 2009 ; Hall, 2009 ; Bricas et Daviron, 2008), y compris pour la production de carburants, à tout le moins jusqu’à 2007. L’absurdité de la chose, et peut-être aussi l’urgence climatique, les a amenés à retirer leur soutien à cette entreprise (De Koninck, 2015). D’ailleurs, en 2011, l’ONU a proclamé 2014 « L’Année internationale de l’agriculture familiale » (AIAF), à laquelle a succédé pour 2019-2028, la « Décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale ». La FAO, selon ses rapports, a depuis lors réorienté ses interventions et sa vision en faveur de l’agriculture familiale (FAO, 2015), et éventuellement « d’une transformation rurale inclusive » (FAO, 2017), et même d’une réduction du gaspillage (FAO, 2019).
Le système agroalimentaire est toujours créateur d’immenses profits pour une minorité et de gaspillages inutiles - le tiers des aliments produits est gaspillé (De Koninck, 2015 ; Waridel, 2019, pp. 144-148) -, a déjà contribué à la déstructuration du tissu social aux 19e et 20e siècles (Bairoch, 1994 ; Polanyi, 1944) et cet état de fait se poursuit encore maintenant (Rastoin 2018). Il est toutefois de bon aloi de constater que les instances internationales reconnaissent maintenant que les petites agricultures familiales peuvent être plus productives et plus durables (De Koninck 1992, 2015 ; Cochet, 2015), même si elles reçoivent moins d’aides publiques et doivent souvent contourner les règles des États pour survivre (Cole et Rigg, 2019)[4]. Tout de même, lors de la COP28, le directeur de la FAO, monsieur Qu Dongyu, a poursuivi dans la même veine que ses prédécesseurs en affirmant qu’il fallait « produire plus » de nourriture (FAO, 2023).
Un troisième défi a émergé au grand jour avec la pandémie de covid-19, en lien avec la mondialisation des échanges, en particulier dans le cadre du système agroalimentaire mondialisé : celui de la grande fragilité des réseaux du système agroalimentaire. Fragilité inhérente justement au système d’agriculture mondialisée, alors que les intermédiaires sont nombreux. Fragilité consécutive à la dépendance d’une majorité de producteurs à l’endroit de l’industrie pétrochimique ou des entreprises de transformation des produits halieutiques, et pour lesquels les productions font maintenant l’objet de spéculations agressives (Dufumier, 2020 ; Friis, 2017 ; Altieri et al., 2015). Tout aussi importante est la fragilité accrue liée au fait que le système, depuis les années 1950, a miné les connaissances locales et leur utilisation (Déry et al., 2019b ; Agrawal, 1995 ; Wisner et Luce, 1993, p.129), ce qui a contribué à la progression de la vulnérabilité des pauvres, des autochtones et minorités ethniques, des femmes, des handicapés, rendant difficile pour ces groupes l’adaptation aux chocs et aux changements drastiques, autant de leur environnement naturel que de l’environnement économique dans lequel ils évoluent, y compris les transformations induites spécifiquement par les États (Oliver-Smith, 2009 ; Wisner et Luce, 1993). Wisner et Luce ont même développé l’idée que l’État constitue un danger, un aléa au même type qu’un tremblement de terre : State as hazard (Wisner et Luce, 1993, p.134 ; voir aussi le questionnement sur le sujet dans Déry, ce numéro).
Quoi qu’il en soit, aux deux pôles de l’organisation multiscalaire de l’humanité actuelle, deux processus sont liés : l’intégration au marché international et les réactions qu’elle suscite localement sous forme d’adaptation. Tout espace qui ne fait pas partie du système de production mondialisée représente une frontière à conquérir. L’adaptation, concept-clé en écologie culturelle (Head, 2010), en anthropologie et en ethnologie (Robinne et Sadan, 2007 ; Leach, 1954) est revenue aussi en géographie (Head, 2010 ; O’Keefe et al., 2010). La frilosité dans son usage, en raison du déterminisme des réflexions du début du XXe siècle (Lévy et Lussault, 2003, p.45), a été vaincue par… le réchauffement climatique (GIEC, 2007 ; Adger et al., 2001). L’adaptation est devenue une stratégie d’action face aux changements actuels et futurs du climat (Cochet et al., 2019). Pourtant, alors que le GIEC a été créé en 1988, il a fallu attendre 2010 (Banque mondiale, 2010) pour que le concept d’adaptation soit vraiment utilisé dans les instances internationales (O’Keefe et al., 2010). Les méthodes de recherche ont commencé à mieux intégrer les savoirs locaux, souvent garants d’une meilleure adaptation aux risques et aux changements (Hiwasaki et al., 2014, 2015), mais beaucoup reste à faire pour que cette intégration soit plus généralisée, entre autres parce que plusieurs groupes sont marginalisés dans ces processus (pour le cas du Vietnam : Hiwasaki et al., 2016 ; Déry et Tremblay, 2009). On pourrait en dire autant pour les savoirs professionnels, expérientiels et traditionnels (Durand et al., 2022 ; Pruneau et al., 2009). C’est d’autant plus nécessaire que les capacités d’adaptation locales sont différenciées, par exemple au Vietnam (Ducourtieux et al., 2019 ; Déry et al., 2019a ; Friederichsen et Neef, 2010).
En 2024, la question des inégalités n’est pas un sujet de recherche très original : on la voit sur toutes les tribunes, dans tous les médias, dans les rapports gouvernementaux, ceux des ONGs et des organisations internationales, dans les articles scientifiques, dans les livres. Les Nations Unies ont noté cela pendant leurs discussions menant jusqu'aux Objectifs de Développement Durable (ODD), lancés en 2015, ce qui a permis de définir un objectif spécifique sur la réduction des inégalités (Kamau et al., 2018). Malgré toutes les analyses scientifiques, certains angles morts existent pourtant, comme par exemple : inégalités, itinérances, handicaps et changements climatiques (Préfontaine, 2024). Aussi, malgré toutes les dénonciations des activistes, les actions concrètes pour réduire les inégalités significativement demeurent superficielles ou pire, elles sont complètement inefficaces. C’est probablement le sens à donner aux chiffres évoqués par Déry dans ce numéro spécial : 27,6 téra dollars (soit plus de 27 600 milliards) dépensés en aide au développement entre 2000 et 2021[5]. Sans tomber dans le journalisme racoleur, tout de même, il est révélateur que cela représente 188$ ÉU par année par habitant de la planète pendant 21 ans[6]. C’est dans ce contexte que notre contribution souhaite combler certaines de ces lacunes : en ajoutant à la littérature sur les relations entre inégalités et défis « environnementaux », en particulier les idées issues de nos travaux et des contributions à ce numéro spécial sur des données probantes pour réduire ces inégalités.
Nos analyses et travaux depuis 30 ans nous incitent à croire que le principal problème est que, chez les personnes en autorité, il n’y a aucune remise en question du système d’économie de marché qui repose sur l’argent-dette et la croissance économique qui doit le nourrir. C’est pourtant la source d’une majorité des problèmes auxquels on tente de trouver des solutions, pointée du doigt par des scientifiques de différents horizons disciplinaires (Polanyi, 1944 ; Passet, 1996, 2010 ; Latouche, 1986, 2006, 2010) ou même par des journalistes qui ont une longue expérience de couverture justement des problèmes causés (Kempf, 2007, 2009, 2017 ; Klein, 2015, 2019) ou des personnes intéressées (Grignon, 2010). Du côté de l’ONU, certes, arriver à placer l’environnement ou les questions sociales à l’avant-scène de l’agenda international dans les années 1970 et 1980 a peut-être été vu comme une réussite – compte tenu de la diversité des points de vue autour de la table et des luttes de pouvoir internes -, comme pour le rapport Bruntland en 1987 (CMED, 1988). Mais même avec la progression entre les Objectifs du Millénaire pour le développement (huit, non-connectés entre eux) et les ODD (17, plus intégrés), on est en droit de douter que ces derniers puissent être atteints, pour la simple et bonne raison que la croissance économique, objectif central de l’objectif 8, reste le moteur de toute cette mécanique - neuf ODD réfèrent spécifiquement à la croissance économique pour qu’ils puissent être atteints (ONU, 2015 et 2024) -, ce qui reste logique dans un monde organisé autour de l’argent-dette (Grignon, 2010). Pour certains, nombreux, comme Jeffrey Sachs, l’extrême richesse n’est pas du tout remise en question, alors que l’objectif à atteindre serait plutôt simplement de « mettre fin à la pauvreté extrême, pas de mettre fin à toute la pauvreté, et encore moins d’égaliser les revenus mondiaux ou de réduire la différence entre les riches et les pauvres. Cela pourra arriver éventuellement, mais pour cela, les pauvres devront s’enrichir par eux-mêmes » (traduction libre, nous soulignons ce dernier passage) (Sachs, 2005, p.289). D’ailleurs, dans une analyse de l’objectif #10 des ODD (réduire les inégalités),
« of the 10 targets and 11 indicators, there is not one that would oblige countries to reduce the unequal distribution of income and wealth within and between countries. The targets and indicators focus on the exclusion of marginalized groups from socioeconomic and political opportunities to escape poverty, but neglect issues of ‘extreme inequality’ and the concentration of income and wealth at the top. Thus targets and indicators are not aligned with the norm set in the goal » (Fukuda-Parr, 2019).
Pour nous, c’est cette incohérence qui cause problème. Sachs suggère de réduire les inégalités en rehaussant le niveau de richesse des pauvres sans toucher au niveau de richesse des riches. Mais un système social qui encourage l’imitation des plus riches et de leur consommation ostentatoire (Veblen, 1899), qui tire la consommation toujours plus à la hausse, est insoutenable étant données les limites planétaires (Kempf, 2007[7]), d’autant plus qu’il contribue à une individualisation qui mine la société et force les individus à affronter les risques seuls plutôt que collectivement (Mythen, 2021, p. 537, qui discute des travaux d’Ulrich Beck, 2001). Il faut viser un changement transformationnel ; et ce type de changement doit commencer par des modifications au niveau des normes et valeurs sociales, appuyées par des incitatifs économiques, institutionnels et politiques pour transformer le système (Chapin et al., 2022).
Pour ce numéro spécial de la revue VertigO, nous visons à replacer les inégalités à leur place, à savoir un phénomène socioéconomique dans son contexte écologique (figure 1). Nous ciblons nos efforts autour des impacts que les inégalités imposent aux défis « environnementaux » et vice versa. Les inégalités entre humains contribuent à construire de mauvaises relations avec le reste de la nature (Bookchin, 1993), dont nous faisons pourtant partie ; inversement, les destructions humaines causées à son propre écoumène – à sa maison, oïkos – se répercutent sur sa capacité de survie. Des analyses séparant différentes variables, dont les comportements humains et certains impacts sur la nature, ont déjà démontré de nombreux problèmes. Par exemple, les pays et les régions montrant les plus grandes inégalités de revenus sont associés à de plus grandes pertes en biodiversité ; dans les pays riches où il y a plus d’inégalités, la consommation per capita des ressources comme l’eau, les poissons ou la viande est plus élevée et génère plus de gaspillage et de déchets. Aussi, des inégalités plus fortes se traduisent par des émissions de carbone plus élevées par personne et par unité de produit intérieur brut (Pickett et al., 2024 ; Chancel et al., 2021 ; Boyce, 2018 ; Islam, 2015). Mais, au final, tout cela est bien interrelié (Passet, 1996) : les inégalités produites par l’économie de marché capitaliste trouvent leur source dans la « nature à rabais » (Cheap Nature en anglais) (Moore, 2015, p.17) et de là se mondialisent (Bourguignon, 2012). Hamann et ses collègues (Hamann et al., 2018) ont démontré les dynamiques complexes et les boucles de rétroaction entre inégalités et biosphère : en considérant les impacts négatifs des inégalités sur l’environnement, générant des problèmes environnementaux, et aussi les impacts négatifs des changements environnementaux sur les inégalités (par exemple, les impacts inégaux des catastrophes ou des évènements météorologiques extrêmes), ils soutiennent que l'inégalité est une variable clé qui interagit avec de multiples autres composantes à travers les échelles qui régissent la relation entre la nature et la société. La principale lacune identifiée dans la littérature entourant ces sujets, c’est le besoin d’une compréhension plus systémique, multiscalaire (ou inter-échelle) et multidimensionnelle des interactions entre les inégalités et les défis environnementaux (Hamann et al., 2018). Nous allons plus loin pour souligner l’importance d’atteindre l’équité en s’attaquant aux inégalités comme moyen de parvenir à un monde juste pour sauver la planète.
Parmi les avenues de recherche et les solutions prometteuses figurent des moyens de subsistance diversifiés rassemblés autour d’une idée, l’ancrage territorial local, source de meilleures relations sociales, d’un meilleur bienêtre, dans un milieu de vie écologique sain et durable grâce à une triple proximité : 1) dans l’écosphère, entre agriculture, pêches et industries alimentaires, et dans l’approvisionnement (Rastoin, 2018) ; 2) autour d’une agroécologie (Altieri et al., 2012) qui reconstruit les liens à la nourriture, au territoire et à la nature (Olivier, 2021), une économie écologique socialement équitable (Waridel, 2019 ; Hours et Lapierre, 2012) ; 3) et dans le développement d’un chemin vers une durabilité équitable (Folke et al., 2021). Les besoins politiques, citoyens et de recherche pour comprendre ces systèmes, au profit d’une gouvernance locale participative (Gravel, 2018) font de cette question l’une des plus importantes aujourd’hui (Olivier, 2021 ; Dufumier, 2019 ; Peemans, 2015).
Inégalités, iniquités et vulnérabilités : les termes du sujet
Cette publication se construit en suivant différents axes, socio-géohistorique, sociopolitique, socio-pratique, qui dessinent une perspective qui fait place à diverses nuances d’application ou d’implication du champ des inégalités : « pour une analyse exhaustive, il faudrait impérativement comparer le terme avec d’autres concepts similaires, et examiner les binômes et le spectre entre leurs extrêmes : égalité – inégalité ; iniquité – équité ; exclusion – inclusion ; pauvreté – richesse, et cetera, sans compter les multiples mélanges avec d’autres termes comme « discrimination » ou l’utilisation impropre de plusieurs de ces termes, pris l’un pour l’autre, comme marginalité, pauvreté, exclusion ou inégalités » (Déry et Saint-Fleur, 2021). Tous ces termes présentent des variations importantes à ne pas confondre. Trop souvent, on ramène tout cela à une mesure simple, ou même simpliste, comme celle de la pauvreté mesurée par le revenu, même si, depuis Sen à tout le moins, on comprend mieux sa complexité et le fait que ce ne soit pas simplement un manque de revenu par rapport à une ligne qui délimite subjectivement qui sont les pauvres qui ne le sont pas (Sen, 1992 et 2000).
D’une façon générale, les inégalités sont inhérentes à la vie sur Terre – la biosphère est naturellement inégale -, à la base même du foisonnement de la biodiversité (Hamann et al., 2018) : par définition et au plus profond de nous-mêmes, dans nos gènes, nous sommes tous différents, donc inégaux, comme Sen (1992 et 2000) le rappelle aussi ; on pourrait ajouter aussi en compétition pour des matières premières limitées. Lorsqu’on parle d’inégalités à réduire, Bleau et Després dans ce numéro nous informent qu’on fait alors référence à des différences jugées injustifiées entre personnes, entre groupes et dans l’accès à des éléments qui ont une valeur, faisant naitre un sentiment, légitime ou non, d'injustice au sein de ses membres. Cette définition sous-entend qu’une inégalité relève de l’interprétation qui en est faite selon les époques, les lieux et les sociétés (adapté de Galland et Lemel, 2018 ; voir aussi Déry et Saint-Fleur, 2021 ; Moulin, 2016 ; Bihr et Pfefferkorn, 2008). Elle est un construit social et politique, émergeant d’un contexte socioéconomique particulier, d’un système, ce qui signifie qu'il existe des moyens de l'éliminer et de l'éviter même si cela demande des efforts, de la concertation et du temps. Encore une fois, il faut ici éviter de confondre inégalités et pauvreté (Sen, 1992 et 2000). D’où quelques précisions conceptuelles supplémentaires pour orienter la compréhension de nos réflexions.
L’égalité repose sur une distribution égale des ressources (financières, humaines, environnementales) disponibles sans considérer les besoins individuels. Elle peut cependant engendrer des situations qui sont inéquitables. L'équité est une valeur qui varie dans l’espace et dans le temps, selon les cultures, les groupes, et selon les individus, même parfois à l’intérieur d’une même famille. Elle défend l’idée que chaque individu, chaque groupe, « a le droit d’accéder à ce dont il a besoin pour son bienêtre, et ce, tant au niveau matériel et financier qu’au niveau de la participation au sein de la société. L’équité peut impliquer « plus pour ceux qui en ont besoin », c’est-à-dire une distribution adaptée aux différentes réalités afin d’atteindre une égalité entre chacun et chacune (adapté de Leach et al., 2018) » (Després, 2021, p. 6). Si l'intention est d'être juste, il est question d'équité, et cela force une mise en perspective de la réflexion sur l’égalité, l’amène à un autre niveau, ou plutôt sur d’autres termes temporels, dans la moyenne et la longue durée, travail qu’ont accompli Piketty et ses collègues en faisant ressortir les dynamiques d’accumulation dans la construction des inégalités (Chancel et al., 2021 ; Piketty, 2013 ; Piketty et Saez, 2003). Distribuer également une ressource n'est pas très utile à ceux et celles qui la possèdent déjà. Il ne sert à rien de rechercher l’égalité en distribuant des richesses égales à tous les citoyens d’une nation. Les riches l’ont déjà. Leurs avoirs vont encore augmenter. Seule l’équité permet une rétribution juste aux moins nantis, en considérant aussi leurs capabilités, les trajectoires qui ont construit ces capabilités, une combinaison de toutes les forces, attributs et ressources qui leur sont disponibles, ainsi que les opportunités extérieures. Ce sont les capabilités qui donnent aux personnes, ou l’absence de capabilités qui les frustrent de, la liberté d’accomplir les choses qu'ils veulent réaliser et, ultimement, d'être la personne qu'ils veulent être. La capacité est donc au cœur de la justice (Nussbaum, 2011 ; Sen, 1992 et 2000).
Comme plusieurs termes au cœur de cette publication, celui de « justice » est polysémique. Il renvoie à des notions tel l'idéal moral (Byskov et al., 2021 ; Tavoillot, 2013) et aux institutions rattachées aux systèmes juridiques (Rawls, 2008). Le concept de justice dépend du contexte, du milieu où il est appliqué, contexte qui varie aussi dans le temps. Par exemple, les notions de vulnérabilité et de résilience ont été intégrées au droit de l’environnement français à partir des années 1970, dans le cadre d’améliorations au cadre juridique liées à la gestion des risques naturels (Fabregoule, 2023, p.101). Le terme « justice » se décline aussi sous plusieurs appellations sans typologie consensuelle ; on parle de justice sociale, juridique ou légale, distributive, réparatrice, procédurale ou climatique, et cetera. De cette pluralité de sens découle une pluralité d'usages du mot juste, parfois évoquant l'équité, parfois ce qui respecte les normes/commandements, ou encore ce qui est convenable. Sans aller plus loin dans cette analyse, pour notre numéro spécial, nous considérons la justice comme un terme qui nous amène encore plus loin que l’équité, c’est-à-dire qu’un monde juste transforme les systèmes pour valoriser ceux qui facilitent l’équité sur le long terme (voir par exemple GW-UMT, 2020).
Le terme « vulnérabilité » est aussi amplement utilisé autant dans plusieurs disciplines scientifiques que dans l’espace public, et pour atteindre différents objectifs (Bentirou Mathlouthi et Pomade, 2023). Témoignant de la difficulté à circonscrire la portée de ce terme, Weichselgartner (2001) a identifié une vingtaine de définitions provenant de la littérature entre 1980 et 2000. Et d'autres se sont ajoutées depuis. Être vulnérable, c’est être exposé à un danger, c’est présenter une certaine fragilité face à celui-ci en plus de ne pas avoir, ou d’avoir des difficultés à identifier, les possibilités pour lui faire face (Maret et Cadoul, 2008). Ainsi, un système qui serait jugé comme étant relativement sensible aux dangers ne serait pas forcément vulnérable s'il a une grande capacité de réaction (Bush et Lemmen, 2019 ; Lemmen et Warren, 2004). Pour analyser la vulnérabilité d'une personne, d'une communauté, d'un milieu, il faut donc aussi connaitre ses moyens d'action, son pouvoir de décision. La définition de ce terme par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR) et les scientifiques spécialistes des catastrophes souligne l’importance de considérer la diversité des facteurs et processus qui contribuent à une progression de vulnérabilité d’une personne ou d’une communauté à l’impact des stress et des chocs (voir par exemple Gibb, 2018). Ces spécialistes sont conscients du fait que la vulnérabilité est créée et maintenue par les décisions et les actions des gens qui exercent du pouvoir et qui ont accès aux ressources (Kelman, 2020 ; Wisner et Lavell, 2017), une vision des choses qui est différente de la définition du GIEC, de celles des climatologues, ou des scientifiques et praticiens de développement durable (Hiwasaki et al., ce numéro spécial). Ainsi, pour mieux comprendre la vulnérabilité d'une personne ou d'une communauté – et aussi, travailler à la réduire – , il faut certes analyser les idéologies, les structures de gouvernance, les préjugés, la répartition inégale des ressources, les relations de pouvoir et la capacité à prendre des décisions, mais aussi les facteurs se construisant sur le long terme (Kelman, 2020 ; Kelman et Gaillard, 2010).
D’ailleurs, le pouvoir de décision nous amène à aborder un autre thème pluriel de cette publication, celui de la marginalité. Elle peut caractériser l’individu qui agit en marge des conventions de la collectivité dans laquelle il vit (Park, 1928), mais également celui qui subit la pression des normes sociales. Elle ne peut se définir sans un rapport à l'autre, à un groupe ; une personne, un groupe est toujours marginal dans un système donné (Déry et al., 2012), par rapport à un autre majoritaire, voire dominant. Et de tels systèmes se déploient sur différents termes temporels et à différents niveaux géographiques (Déry et al., 2012 ; Leimgruber, 2004). Bref, la marginalité peut être identifiée à un moment dans un processus spatiotemporel de différenciation sociale d’un système donné dans lequel des inégalités fortes se manifestent dans les relations de pouvoir (Hiwasaki et Minh, 2022). Elle dépend, comme les précédents thèmes abordés, du contexte socio-politico-géographique et de l'époque (Stankovich, 2020).
Notre contribution collective
Du point de vue des réflexions précédentes, les contributions de ce numéro spécial permettent de progresser encore un peu plus. En apparence disparates, autant par les thématiques abordées que par les régions qui servent d’études de cas ou les méthodes employées, elles se rejoignent pourtant sur plusieurs grands thèmes. Collectivement, elles permettent de mieux décrire et d’éclairer la complexité des sources d'inégalités, tout comme de celles qui motivent les actions, les collaborations et la recherche de solutions. Les contributions montrent des sociétés fragmentées et complexes, que l’on doit chercher à mieux comprendre. Enfin, elles s’attachent à améliorer notre compréhension du rôle de l’État et son ambivalence, pour mieux saisir les inégalités et aussi comment il peut contribuer à les réduire. Les auteurs des articles, qui proviennent d’horizons disciplinaires différents, montrent aussi l’importance des approches inter- (ou trans-) disciplinaires pour atteindre l’équité en comprenant et en réduisant les inégalités, ainsi que pour éventuellement résoudre les problèmes liés aux enjeux globaux (développement, changements climatiques, et cetera).
Dans l’analyse qui suit, nous résumons la contribution collective des articles de ce numéro autour de deux grandes idées : 1) le besoin de mieux comprendre les inégalités, en particulier la complexité des sources, les défis socio-environnementaux qu’elles engendrent, et les ramifications systémiques qui permettent leur construction et les acteurs qui y participent ; 2) la recherche de solutions, en particulier en tenant compte des ramifications multiscalaires, dont celles qui s’attardent aux niveaux local, national, ainsi que transnational ou global.
Mieux comprendre les inégalités
La complexité des sources
Quatre grandes catégories émergent de nos travaux dans la recherche d’une meilleure compréhension des sources d’inégalités : 1) tout ce qui touche à l’information ; 2) ce qui concerne les enjeux de pouvoir et l’espace du politique ; 3) la question des bonnes intentions (de développement ou d’adaptation) et leurs effets pervers ; 4) et enfin les questions plus systémiques, en particulier dans leurs relations au foncier.
S’agissant de l’information, les enjeux analysés concernent premièrement les questions linguistiques. Il s’agit par exemple des difficultés entrainées par les différences linguistiques entre les pays donateurs d’aide au développement et les populations locales. Les intermédiaires doivent naviguer entre les exigences de l’un et les besoins des autres, un véritable défi qui contribue parfois à construire des inégalités là où l’on s’attendrait à ce qu’elles soient réduites (Labossière). Ainsi, à l’échelle mondiale, toutes les langues n’ont pas le même pouvoir pour produire de l’information, en particulier les nouvelles connaissances scientifiques. Huynh et ses collègues en témoignent justement pour la situation en Asie du Sud-Est où les langues locales apparaissent très peu utilisées pour la production scientifique en comparaison avec l’anglais, d’autant plus que le processus de recherche se bute lui-même sur la difficulté de consulter la documentation ou les travaux diffusés dans les langues locales : cela nécessite des connaissances et du temps, que les chercheurs pressés n’ont pas toujours (Huynh et al.). De plus, lorsqu’il s’agit de construire des liens entre le monde scientifique et les autorités et populations locales, la langue de diffusion peut devenir un écueil à une véritable connexion (Buclet et Lagrée), ou dans certaines circonstances, un véritable verrou qui empêche la réduction des inégalités (Déry).
Enfin, la diffusion de l’information, qu’elle soit scientifique ou autre, passe par la capacité des récepteurs à la comprendre (Raffestin, 1980 et 2019). Cela signifie au départ une éducation et une littéracie suffisantes qui permettent l’accès à cette information et à sa compréhension (Bleau et Després ; Déry ; Mizaba, 2023). Ici, la difficulté de compréhension peut être d’autant plus renforcée par la technicisation de la mise en œuvre d’un projet par des acteurs (ONG, État) en position de pouvoir sur les populations locales (Mizaba, 2023). Mais aussi, il faut pouvoir s’entendre sur la signification des concepts, des termes utilisés, en particulier en recherche et dans les législations et programmes gouvernementaux (Baudouin), surtout si ces derniers émergent des accords internationaux ; sinon, il peut en résulter des problèmes ou même une croissance des inégalités (Hiwasaki et al. ; Huynh et al.). Ici, c’est la question des différences de langages entre les disciplines qui augmente les difficultés. Ou bien simplement l’application concrète des préceptes enchâssés dans l’appareil législatif, même quand le langage est précis (Baudouin).
Le deuxième point autour de la complexité des sources, ce sont les enjeux de pouvoir, ou de ne pas pouvoir. Il en est plus ou moins question explicitement dans tous les articles. Plus spécifiquement, c’est l’importance de débats politiques sereins et inclusifs qui ressort, sans lesquels les efforts de réduction des inégalités apparaissent vains (Buclet et Lagrée ; Déry ; Huynh et al.) ; comment par exemple définit-on ce qui est superflu ou non en termes légaux, pour s’assurer de préserver les droits et libertés dans la longue durée (Baudouin) ? Les questions de pouvoir (mal gérées) apparaissent aussi quand il est question d’aide au développement et des relations entre les donateurs et les populations locales, presque toujours par l’intermédiaire d’ONG (Labossière ; Mizaba, 2023 ; Saydeh et Bissonnette), ou simplement dans la manière dont, au Bénin, hommes et femmes ont un accès différencié, plus difficile pour les femmes, aux facteurs de production (Egah et al., 2024).
L’information et les relations de pouvoir se rejoignent sur un troisième thème, que nous appelons ici, pour les besoins heuristiques : « les bonnes intentions et leurs effets pervers ». S’additionnent ici par exemple les programmes de développement, officiellement pour que les pays plus riches aident les pays plus pauvres dans leurs efforts de développement. Bien que ces programmes atteignent certaines de leurs cibles, des conséquences néfastes sont aussi constatées, telles que justement l'augmentation des inégalités ou même la création d’inégalités là où il n’y en avait pas (Huynh et al. ; Labossière), d’autant plus lorsque les efforts d’aide demeurent limités et (mal) ciblés (Hiwasaki et Leahy). Dans tous les cas, les difficultés surviennent lorsque les caractères multiscalaire et systémique des enjeux ne sont pas pris en compte dans la planification de l’aide et dans leur mise en œuvre. Soutenir un groupe, dans un système à un niveau donné, sans tenir compte des répercussions ailleurs, plus localement, ou chez les voisins, constitue ainsi parfois une source d’inégalités (Bleau et Després ; Hiwasaki et al.), et peut contribuer à créer des relations de dépendance (Mizaba, 2023).
Enfin, le quatrième point dans la complexité des sources d’inégalités touche aux questions systémiques et à leurs impacts, en particulier sur le plan foncier. Les travaux soulignent : la nature historique de cette construction systémique dans le temps, qui permet des « accumulations de biens et de privilèges » (Déry qui cite les travaux de Sen et ceux de Piketty), « crise de la démesure » et « banalisation du superflu » (Baudouin), ce qui comprend la mise en place de verrous pour empêcher de « déverrouiller » ces constructions, comme les paradis fiscaux (Déry) ; le peu de progrès accompli pour renforcer le capital social et le capital culturel, deux éléments cruciaux pour réduire la vulnérabilité (Hiwasaki et Leahy) ; les impacts fonciers négatifs autant sur les forêts et la biodiversité en général (qui se dégradent) – soulevant des enjeux sanitaires – (Buclet et Lagrée) que sur l’agriculture et les activités agricoles, en particulier avec les processus d’accaparement des terres et lorsque des questions ethniques sont à l’enjeu (Hyunh et al. ; Saydeh et Bissonnette) ; les conséquences sur la capacité différenciée des populations pour faire face aux aléas naturels divers, qui se transforment parfois en catastrophes pour les populations locales (Huynh et al.) ou qui créent de nouvelles inégalités (Bleau et Després).
Certains défis socioenvironnementaux
Les défis socioenvironnementaux soulevés par les contributions à ce numéro spécial peuvent être regroupés euristiquement en quatre grandes catégories : les défis liés aux connaissances scientifiques ; ceux liés au dynamisme des situations diverses ; les défis qui concernent la mise en œuvre des projets de réduction des inégalités ; ceux entourant les obstacles qui parfois se présentent ; et enfin, d’autres défis qui impliquent simultanément les enjeux de vulnérabilité et de justice.
Du point de vue de la connaissance scientifique, sur les sujets qui nous intéressent, les défis sont nombreux. Ce sont : des débats parfois polarisés, incluant sur le plan idéologique (Saydeh et Bissonnette), des capacités de recherche et de diffusion fort variées entre les pays, autant en quantité qu’en qualité (Déry ; Huynh et al.), la dilution des messages scientifiques dans les milliards de messages produits par les lobbys (Buclet et Lagrée), ce qui rend difficile la production de « connaissances qui informent une transformation profonde des systèmes socioéconomiques » (Buclet et Lagrée). La faible reconnaissance des connaissances locales dans l’adaptation aux changements climatiques constitue aussi un défi problématique à relever (Bleau et Després ; Egah et al., 2024).
Le dynamisme des situations socioéconomiques diverses est analysé aussi d’une manière plus particulière par Hiwasaki et al. lorsqu’elles incitent les spécialistes à sortir de la « vue fixe » de la vulnérabilité pour mieux tenir compte des évolutions, c’est-à-dire des différents processus qui ont conduit à la vulnérabilité, bref, la dimension temporelle (Hiwasaki et al.). Baudouin travaille de la même manière avec l’idée de « sobriété », retraçant quelques jalons historiques de l’évolution de son utilisation dans les outils légaux jusqu’à aujourd’hui. Hiwasaki et al. mentionnent aussi le recul de plusieurs pays par rapport à l’atteinte de certains objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, en particulier pour les objectifs 10 et 16, qui concernent respectivement la réduction des inégalités et la paix et la justice (Hiwasaki et al). Enfin, un défi général dans la poursuite de la réduction des inégalités réside dans l’alternance gouvernementale dans les pays plus démocratiques : « le problème vient de la facilité de poser des pierres à l’édifice des inégalités et de la difficulté de les enlever. Inversement, il est difficile de poser de pierres à l’édifice des efforts pour le bienêtre collectif ; alors qu’il est beaucoup plus facile de démolir ces mêmes édifices » (Déry), y compris au sens propre, comme on peut le constater avec les guerres qui font rage dans le monde en 2024.
Pour le cas spécifique de la mise en œuvre de projets de réduction des inégalités ou de projets qui tendent vers cet objectif sans que ce ne soit explicite, les défis soulevés dans les quelques études de cas proposées dans les articles sont nombreux. On peut les classer spontanément en fonction de défis plus « horizontaux » (de même niveau d’intervention) ou plus « verticaux » (séquentiels dans le temps). Les défis en termes d’intégration « horizontale » ne sont pas évoqués très souvent. On trouve trois exemples dans les articles du numéro ou dans un article paru en 2023 dans VertigO. Mizaba, discute par exemple du caractère dual du socle juridique de gestion des forêts communautaires en République démocratique du Congo : un droit moderne juxtaposé – ou superposé ? – au droit coutumier (Mizaba, 2023). Buclet et Lagrée évoquent pour leur part les difficultés liées à l’intégration des divers programmes de recherche, qui poursuivent chacun des objectifs louables, qui visent à mieux comprendre des défis sociétaux, mais en parallèle (Buclet et Lagrée). On peut aussi placer dans cette catégorie les problèmes liés à la néolibéralisation des États, qui les placent en situation de compétition plutôt que de collaboration entre eux, quel que soit le domaine d’intervention (Déry).
Sur le plan séquentiel (ou vertical), les apports sont multiples et diversifiés. D’une manière plus générale, on peut d’abord rappeler le caractère inéluctable dans la progression de la flèche du temps. Contrairement à ce que plusieurs économistes prétendent, on ne peut jamais retourner à un état antérieur, quelles que soient les ressources mises en œuvre (Déry). Aussi, pris d’une manière générale, la mise en œuvre de projets ou de programmes de réduction des inégalités bute régulièrement sur un problème, à savoir le fossé institutionnel entre pays donateurs et pays receveurs de l’aide, alors que beaucoup trop de projets sont planifiés sur le court terme, dans un contexte où les pays qui reçoivent de l’aide ont des besoins à moyen ou à plus long termes (Hiwasaki et al. ; Labossière). Ceci étant dit, les différentes étapes de la mise en œuvre de projets de réduction des inégalités peuvent toutes représenter des défis, la première n’étant pas de moindre importance : l’étape de la définition des priorités, où les voix ne sont pas toutes entendues sur le même pied (Buclet et Lagrée ; Huynh et al. ; Mizaba, 2023), comme celles des autochtones (Bleau et Després), alors que, par exemple, les organismes subventionnaires orientent les débats vers certains intérêts comme la sécurité alimentaire plutôt que d’autres comme la souveraineté alimentaire (Saydeh et Bissonnette). Définir les priorités, mais aussi définir les concepts : là réside un second défi, autant au niveau national (France) ou régional (Europe) (Baudouin) qu’à l’échelle internationale (Hiwasaki et al.). Car de là découle l’utilisation de méthodes spécifiques (de calcul, de comparaison, et cetera) qui, selon les systèmes de référence, produisent des résultats d’analyses différents qui servent ensuite à orienter les investissements et les actions (Lacoste, 1976 ; Saydeh et Bissonnette). L’étape suivante, c’est la prise de décision, qui en elle-même représente tout un défi : comment prendre la bonne décision, que les informations disponibles soient trop nombreuses ou pas assez (Buclet et Lagrée ; Huynh et al.), et s’assurer qu’elle n’aboutira pas à de la maladaptation (Bleau et Després) ? Choisir de renforcer certains moyens de subsistance, c’est aussi choisir d’en négliger d’autres (Egah et al., 2024 ; Hiwasaki et al.). Ce qui, une fois les projets réalisés, peut se traduire par une augmentation générale des inégalités, même si certains groupes ont pu bénéficier du projet. L’aide au développement produit ainsi très souvent des impacts différenciés, comme en Haïti (Labossière) ou République démocratique du Congo (Mizaba, 2023), ou parfois ne tient pas compte des capabilités différenciées des groupes différents (Mizaba, 2023 ; Hiwasaki et Minh, 2023 pour le cas vietnamien). Il s’agit de projets de développement économique où les gains économiques ciblés sont occultés par la dégradation des conditions chez d’autres acteurs économiques, comme pour la construction de barrages, la mise en place d’aires protégées[8], ou la commercialisation de l’agriculture (Huynh et al.). Enfin, les conséquences néfastes de projets peuvent être accentuées plusieurs fois en fonction du degré d’intersectionnalité présent chez certains groupes : les vulnérabilités vécues sont alors amplifiées (Bleau et Després).
Une autre série de défis socioenvironnementaux est liée aux obstacles qui peuvent se présenter dans le processus de réduction des inégalités. Il peut s’agir d’obstacles mis en place volontairement, des verrous, pour empêcher cette réduction et donc permettre à certains groupes ou à certaines classes de conserver leurs privilèges (Déry). Ces obstacles peuvent émerger lorsque la priorité est donnée à l’amélioration de certaines conditions, comme le renforcement du capital naturel, mais que cela a pour effet de laisser à la traine les capitaux sociaux et culturels (Hiwasaki et al.). Aussi, des articles de ce numéro soulignent que les dégradations écologiques produites par certaines initiatives – exemple, l’expansion de l’agriculture - peuvent contribuer à la fois à l’augmentation des inégalités, à la dégradation de la biodiversité, tout comme représenter des obstacles à la « reconstruction écologique » (Buclet et Lagrée ; Saydeh et Bissonnette).
Enfin, les articles de ce numéro font ressortir des défis liés aux questions de justice qui émergent de la progression de la vulnérabilité. En particulier, Huynh et al. en parlent dans un contexte de droits et d’écologie politique (Huynh et al.). Sont aussi évoqués les problèmes de justice et de croissance de la vulnérabilité en lien avec les choix des donateurs pour améliorer certains moyens de subsistance (Hiwasaki et al.) ou les conséquences en termes de vulnérabilité dans un contexte de justice climatique (Bleau et Després), d’autant plus en contexte d’intersectionnalité, comme souligné précédemment (Bleau et Després).
Les ramifications systémiques – questions de méthodes
On est toujours quelque part à un moment donné de la flèche du temps, bref dans un contexte multiscalaire spatiotemporel. Mais certains aspects de la complexité des sources de production d’inégalités et des défis socioenvironnementaux qui y sont rattachés présentent des ramifications systémiques qui ressortent peut-être davantage, surtout lorsque vient le temps de penser aux approches, aux méthodes, ou aux outils qu’on veut utiliser pour réduire ces inégalités. D’une manière très générale, les blocages ou verrous insérés un peu partout, à tous les niveaux, dans le système socioéconomique mondial doivent être mieux compris, justement en raison de leur organisation systémique (Déry), organisation qui construit et reproduit des iniquités intersectionnelles (Bleau et Després). Ces ramifications systémiques interviennent aussi dans la production de connaissances, souvent complexe et multidisciplinaire (Saydeh et Bissonnette), ou fortement orientées, comme pour la « gestion et la conservation des ressources » (Huynh et al.). Quatre exemples, parmi d’autres, constituent des illustrations de ces ramifications dans le système économique : celui des paradis fiscaux (Déry), celui de la gestion des déchets (Baudouin), celui de la gestion des forêts, impliquant divers acteurs (État, ONG, acteurs locaux divers) (Mizaba, 2023), et celui de l’agriculture, avec des modèles généralement plus intensifs au nord qui se construisent parallèlement au mouvement conservationniste (Saydeh et Bissonnette). « A fortiori, l’objectif d’utilisation prudente et rationnelle des ressources […] et des matières premières primaires rattache la sobriété – outre à l’objectif de développement durable – au principe de solidarité écologique » (Baudouin).
Sur le plan systémique, le plus gros morceau reste sans contredit l’État, dans ses multiples ramifications institutionnelles. Autant sa structure interne propre varie d’un État à l’autre, autant toute une panoplie d’organisations gravite aussi sur son pourtour à différents niveaux, plus ou moins dépendantes de ses financements, ce qui comprend des Organisations non-gouvernementales (ONG) de différents niveaux (par exemple Labossière ; Mizaba, 2023), mais aussi les institutions internationales, forums où les États tentent de collaborer à la gestion de notre monde. Dans le système spécifique du développement, un État peut être donateur ou bénéficiaire. Et les institutions internationales qui gouvernent les relations entre États indépendants tentent de travailler ensemble pour résoudre des problèmes partagés. Première chose à garder en tête : les États ne sont pas monolithiques. Ils sont construits sur la base de gouvernements, de fonctions publiques où les luttes de pouvoir sont communes, d’autant plus que de nombreux lobbys tentent d’y faire entrer leurs idées (Déry). Au niveau international, cette complexité systémique est multipliée plusieurs fois autour des nombreuses institutions parties du Système des Nations unies, en particulier dans la manière dont elles définissent et mettent en œuvre les accords signés entre les parties, alors que des effets sont évidents aux niveaux global, local en plus de tous les niveaux intermédiaires (Hiwasaki et Leahy). Un exemple de ce caractère systémique est celui du Québec qui a mieux résisté à la hausse généralisée des disparités de revenus en raison « de normes sociales plus égalitaristes » que dans le reste du Canada, alors que l’égalité homme-femme est inscrite dans la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, la présence de congés parentaux généreux, et cetera (Bleau et Després).
Solutions : Comment peut-on réduire les inégalités pour réaliser un monde plus équitable et juste ?
Comme mentionné précédemment, atteindre l’équité en s’attaquant aux inégalités comme moyen de parvenir à un monde juste doit d’abord passer par une compréhension multiscalaire et systémique des sources complexes des inégalités et des défis socioenvironnementaux qui en découlent. Une fois cette étape franchie, ne serait-ce que partiellement, des solutions peuvent alors être mises en œuvre. Et selon les intérêts, les leadeurships, ou l’information et l’énergie disponibles, les solutions prendront place dans l’un ou l’autre des systèmes à une échelle plus locale, plus globale, ou à l’une des multiples échelles intermédiaires, dont l’échelle nationale.
Lorsque les solutions démarrent au niveau local, la question temporelle est cruciale. À la base, les adaptations procèdent souvent par essai – erreur sur le court terme, en réaction à des évènements plus ou moins dramatiques, comme chez les agriculteurs du Bénin touchés par les transformations climatiques (Egah et al., 2024). Mais la planification, elle, doit s’organiser dans la moyenne ou la longue durée, autant en termes de production et de partage d’information et de connaissances que d’investissements (Déry). Le « temps juridique », qui n’est pas hermétique, doit s’accorder avec le « temps social » et avec celui de l’environnement (Baudouin). Et une bonne planification doit s’adapter aux « réalités locales », d’abord dans l’appareil législatif en utilisant le principe de subsidiarité comme en Europe (Baudouin) – les contre-exemples en démontrent l’importance (Mizaba, 2023) -, ou comme par exemple pour la protection de la biodiversité (Saydeh et Bissonnette). Cette planification doit aussi intégrer divers points de vue, diverses perspectives (Bleau et Després), et intervenir en amont de la mise en place, comme pour les solutions d’adaptation aux changements climatiques (Bleau et Després). Un tel fonctionnement permet d’augmenter l’agencéité des acteurs locaux, leur implication et leur mise en action (Labossière), où ne le permet pas, lorsque justement il n’est pas respecté, ou que les luttes de pouvoir entre acteurs court-circuitent les bonnes intentions (Mizaba, 2023). Lorsque l’adaptation est laissée aux populations locales, les risques sont plus grands que certaines catégories de personnes (femmes, personnes âgées) soient négativement affectées (Egah et al., 2024).
Plusieurs solutions émergent du niveau national, ce qui est un peu normal, car l’État dispose normalement de moyens autant informationnels (connaissances, expertises) qu’énergétiques (au sens raffestinien = financiers, monétaires), qui lui permettent d’intervenir et d’aplanir les différences sur de grands espaces et sur le long terme, bref, de développer des outils collectifs (Déry). On retrouve de tels outils par exemple en éducation, produisant et diffusant des connaissances orientées vers la « gestion et la conservation des ressources » (Huynh et al.), en renforçant les « capacités ciblant les établissements d’enseignement supérieur et de recherche » (Buclet et Lagrée) ; le rôle de la science est fondamental, comme « système de production de connaissances vérifiables » (Saydeh et Bissonnette). C’est aussi le cas en santé, où réduire les inégalités fait partie des solutions vers une transition plus juste (Buclet et Lagrée qui citent Laurent, 2023). Le niveau national est aussi l’un des niveaux privilégiés pour rendre les solutions plus justes – c’est après tout le niveau du cadre légal (Mizaba, 2023), en particulier à travers la justice climatique : distributive, de reconnaissance, et procédurale (Bleau et Després). La sobriété peut devenir un outil conceptuel fort dans un système juridique pour « lutter contre les excès », surtout si elle met de l’avant la solidarité écologique pour devenir une « sobriété écologique » (Baudouin).
Au niveau transnational ou global, quelques idées de solutions émanent des articles du numéro spécial. En particulier, Hiwasaki et al. discutent de l’intégration des processus internationaux (c’est-à-dire le Programme 2030 pour le développement durable, le Cadre de Sendai et l’Accord de Paris) en priorisant la réduction des vulnérabilités (Hiwasaki et al.). Aussi, spécifiquement en Asie du Sud-Est, des développements au sein de l’ASEAN favorisent « une nouvelle forme de développement économique collaboratif », car la compréhension des enjeux ne peut rester au niveau national, d’où un projet d’Alliance des universités, regroupant chercheurs, décideurs et société civile (Buclet et Lagrée).
Au total, le multiscalaire reste fondamental pour aller plus loin dans la compréhension d’enjeux, comme par exemple le débat et l’opposition entre le land sharing et le land sparing : mieux intégrer les différentes variables socio-écono-écologiques dans les recherches le permettrait (Saydeh et Bissonnette). Il est aussi important de garder à l’esprit le caractère multiscalaire des solutions à y apporter.
Remarques conclusives
« Il était une fois… »… Cette formule pour amorcer la lecture d’un conte, ou sa déclamation, qui, selon les époques, vise à donner des leçons, ou à faire rêver, ouvre le monde des possibles, mais aussi celui de la création et des mises en œuvre éventuelles. Pour nous, elle sert à poser des briques à l’édifice d’un bienêtre commun, construisant ainsi un monde plus équitable, juste et résilient, à l’aide des matériaux « positifs » disponibles actuellement (et dans le futur) pour s’éloigner des difficultés et des problèmes du système socioéconomique contemporain.
Le constat se dresse plutôt simplement et clairement : la littérature, tout comme les articles de ce numéro spécial, en particulier lorsqu’ils sont considérés ensemble, contribuent à démontrer qu’on ne peut pas solutionner les problèmes « environnementaux » ou amenuiser leurs impacts sans réduire les inégalités, en amont ou parallèlement, pour atteindre l’équité. Aborder les grands enjeux de notre temps sans s’attaquer d’abord aux inégalités, revient en quelque sorte à tenter de freiner une hémorragie avec un diachylon. Le défi des changements climatiques, ou celui de la 6e grande extinction, pour ne nommer que ceux-là, restent, à la base, des défis socioéconomiques avant d’être environnementaux.
Parmi les modèles de compréhension des liens entre les systèmes socioéconomiques et la nature, la bioéconomie de René Passet (1996)[9], dont les travaux sont basés entre autres sur les lois de la thermodynamique, est celui qui nous fournit les meilleures clés pour nous orienter vers l’objectif à atteindre, un monde des humains dont l’écoumène respecte la biosphère et la planète. Pour l’instant, il est certain que, collectivement, malgré des efforts ici et là, nous n’allons pas dans cette direction. Les quelques articles de ce numéro mettent l'épaule à la roue pour nous y amener un peu plus, pas à pas.
Appendices
Remerciements
La plupart des textes de ce numéro ont été présentés sous forme de communication (à distance) lors du colloque #654 « Réduire les inégalités pour sauver la planète : par quel bout commencer? », tenu dans le cadre du congrès de l’ACFAS, « Sciences, Innovations, Sociétés », du 9 au 13 mai 2022, Québec, Université Laval. Des financements ont été obtenus respectivement du Budget de développement de la recherche (Faculté de foresterie, de géographie, et de géomatique, Université Laval) pour un appui à l’organisation du colloque et du « Faculty Career Enhancement Program » (University of Rhode Island) pour l’organisation d’un atelier d’écriture en juillet 2022. Des remerciements sont adressés à Weldy Saint-Fleur, pour sa collaboration à la préparation du colloque, aux divers participants, pour leurs questions et commentaires constructifs, ainsi qu’aux évaluateurs de cette introduction pour leurs commentaires constructifs.
Notes
-
[1]
Certes, l’idée de « fin du monde » est tout sauf nouvelle ; elle est même très ancienne (confer certains écrits bibliques, pour ne nommer que ceux-là). Plus près de nous, au 20e siècle, la guerre froide a aussi bien sûr suscité de telles craintes apocalyptiques, étant donnée la puissance de destruction des arsenaux nucléaires constitués. Ce risque, même s’il suscite moins de craintes dans l’espace public, reste tout de même bien présent (Fortmann, 2019). Sur l’Anthropocène : Bonneuil et Fressoz (2016) ; Gemenne et Rankovic (2019).
-
[2]
Pour plus d’information, voir le site internet de Global Footprint Network, [En ligne] URL : www.footprintnetwork.org
-
[3]
Le nombre de publications sur le sujet a explosé depuis les années 2010. Il existe aussi en ligne des « calculateurs » d’empreinte hydrique virtuelle depuis la fin des années 2010 . Pour plus d’information, voir le site internel Water Footprint Calculator [En ligne] URL : https://www.watercalculator.org/footprint/what-is-virtual-water/) et Water Footprint Network (En ligne] URL : https://www.waterfootprint.org/resources/interactive-tools/.
-
[4]
« C’est souvent dans les exploitations agricoles de taille modeste que, dans une région donnée, la productivité de la terre (valeur ajoutée nette/surface agricole utile) est de loin supérieure, et que les incantations appelant à une amélioration de la productivité agricole (confondue, comme on le sait, avec le rendement...) n’ont guère de sens tant que le mot « productivité » est utilisé à tort et à travers [...] » (Cochet, 2015, p.20).
-
[5]
Données tirées du site Internet de la Banque mondiale [En ligne] URL : https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD?end=2021&start=1960&view=chart
-
[6]
Calcul effectué pour une moyenne de sept milliards d’habitants. L’exactitude du chiffre moyen n’est pas pertinente ; c’est son ampleur qui sert à illustrer le problème.
-
[7]
Voir aussi Izoard (2024), qui traite de la question spécifique de l’exploitation minière.
-
[8]
Pour ce cas spécifique en Asie du Sud-Est, voir Déry (2007).
-
[9]
Livre d’abord publié en 1979.
Bibliographie
- Agrawal, A., 1995, Dismantling the Divide Between Indigenous and Scientific Knowledge, Development and Change , 26, pp. 413–39.
- Altieri M.A., C.I. Nicholls, A. Henao, et M.A. Lana, 2015, Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems, Agronomy for Sustainable Development , 35, 3, pp. 869-890.
- Bai X., T. Elmqvist, N. Frantzeskaki, T. McPhearson, D. Simon, D. Maddox, M. Watkins, P. Romero-Lankao, S. Parnell, C. Griffith, et D. Roberts, 2018, Synthesis - New Integrated Urban Knowledge for the Cities We Want, dans T. Elmqvist, X. Bai, N. Frantzeskaki, C. Griffith, D. Maddox, T. McPhearson, S. Parnell, P. Romero-Lankao, D. Simon, et M. Watkins (dir.), 2018, Urban Planet. Knowledge towards Sustainable Cities, Cambridge University Press , pp 462-482. https://www.cambridge.org/core/books/urban-planet/new-integrated-urban-knowledge-for-the-cities-we-want/B6F332134C95D24B22A38DD524F462EF/core-reader
- Bairoch P., 1994, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, Paris, La Découverte (Série « Économie »), 288 p.
- Bentirou Mathlouthi, R., A. Pomade (dir.), 2023, Vulnérabilité(s) environnementale(s). Perspectives pluridisciplinaires, Paris, L’Harmattan, 612 p.
- Bihr, A., Pfefferkorn, R., 2008, I. Le champ des inégalités, dans Alain Bihr (dir.), Le système des inégalités, Paris, La Découverte, pp. 8-29.
- Bonneuil, C., 2017, Capitalocène. Réflexions sur l’échange écologique inégal et le crime climatique à l’âge de l’Anthropocène, ÉcoRev’, 1-44, pp. 52-60.
- Bonneuil, C., J.-B. Fressoz, 2016, L’événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 332 p.
- Bookchin, M., 1993, Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté, Montréal, Écosociété, 300 p.
- Bourguignon, F., 2012, La mondialisation de l’inégalité. Paris, Seuil, 112 p.
- Boyce, J. K., 2018, The Environmental Cost of Inequality, Scientific American, Novembre, pp. 73–77.
- Bricas, N., B. Daviron, 2008, De la hausse des prix au retour du « productionnisme » agricole : les enjeux du sommet sur la sécurité alimentaire de juin 2008 à Rome, Hérodote, 131, 4, pp. 31-39.
- Brunel, S., J.-R. Pitte (dir.), 2010, Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, Paris, Jean-Claude Lattès, 352 p.
- Bush, E. D., S. Lemmen (dir.), 2019, Rapport sur le climat changeant du Canada, Ottawa, Gouvernement du Canada, 446 p.
- Byskov, M. F., K. Hyams, P. Satyal, I. Anguelovski, L. Benjamin, S. Blackburn, M. Borie, S. Caney, E. Chu, G. Edwards, K. Fourie, A. Fraser, C. Heyward, H. Jeans, C. McQuistan, J. Paavola, E. Page, M. Pelling, S. Priest, K. Swiderska, M. Tarazona, T. Thornton, J. Twigg, et A. Venn, 2021, An agenda for ethics and justice in adaptation to climate change. Climate and Development, 13, 1, 1–9. [En ligne] URL : https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1700774, page consultée le 25 janvier 2024.
- Capra, F., 2004, Les connexions invisibles. Une approche systémique du développement durable, Monaco, Éditions du Rocher, 341 p.
- Carson, R., 1962, Printemps silencieux, Paris, Plon, 319 p.
- Ceballos, G., P. R. Ehrlich, et P. H. Raven, 2020, Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction, Proceedings of the National Academy of Sciences , 117, 24, pp. 13596-13602.
- Chancel, L., T. Piketty, E. Saez, et G. Zucman, 2021, Rapport sur les inégalités mondiales 2022, Paris, Seuil et World Inequality Lab, 492 p.
- Chapin, F. S., E. U. Weber, E. M. Bennett, R. Biggs, J. van den Bergh, W. N. Adger, A.-S. Crépin, S. Polasky, C. Folke, M. Scheffer, K. Segerson, J. M. Anderies, S. Barrett, J.-C. Cardenas, S. R. Carpenter, J. Fischer, N. Kautsky, S. A. Levin, J. F. Shogren, B. Walker, J. Wilen, et A. de Zeeuw, 2022, Earth stewardship: Shaping a sustainable future through interacting policy and norm shifts, Ambio , 51, pp. 1907–1920.
- Charvet, J.-P., 2012, Atlas de l’agriculture. Comment nourrir le monde en 2050?, Paris, Autrement, 96 p.
- Cochet, H., O. Ducourtieur, et N. Garambois, 2019, Systèmes agraires et changements climatiques au Sud, Versailles, Quae, 282 p. [En ligne] URL : https://books.openedition.org/quae/21087.
- Cochet H., 2015, Controverses sur l’efficacité économique des agricultures familiales : indicateurs pour une comparaison rigoureuse avec d'autres agricultures, Tiers Monde, 221, pp. 9-25.
- Cole, R., J. Rigg, 2019, Lao peasants on the move: Pathways of agrarian change in Laos, The Australian Journal of Anthropology , 30, pp. 160-180.
- Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED), G. H. Bruntland, 1988, Notre avenir à tous, Montréal et Québec, Éditions du Fleuve et Publications du Québec, 454 p.
- Costanza, R., R. de Groot, P. Sutton, S. van der Ploeg, S. J. Anderson, I. Kubiszewski, S. Farber, et R. K. Turner, 2014, Changes in the global value of ecosystem services, Global Environmental Change , 26, pp. 152-158.
- Crutzen, P. J., E. F. Stoermer, 2000, The ‘Anthropocene’, Global Change Newsletter , 41, mai, pp. 17-18
- De Koninck, R., 2015, Une décroissance de la production agricole mondiale est-elle souhaitable?, Nouveaux Cahiers du socialisme, 14, pp. 148–155.
- De Koninck, R., 2019, L’Asie du Sud-Est. Paris, Armand Colin, 362 p.
- De Koninck, R., J.-F. Rousseau, 2012, Gambling with the land: the contemporary evolution of Southeast Asian agriculture , Singapour, National University of Singapore Press, 250 p.
- De Koninck, R., J.-F. Rousseau, 2013, Pourquoi et jusqu'où la fuite en avant des agricultures sud-est asiatiques? L'espace géographique, 42, 2, pp. 143-164.
- Deldrève, V., Lewis, N., Moreau, S. et K. Reynolds, 2019, Les nouveaux chantiers de la justice environnementale. Introduction, VertigO, 19, 1. [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/vertigo/24863.
- Déry, S., 2006, Réflexions théoriques sur l’organisation des niveaux géographiques, Cahiers de géographie du Québec, 50, 141, décembre, pp. 337-345.
- Déry, S., 2007, Les parcs nationaux en Asie du Sud-Est, une manifestation de la transformation de l’État moderne. Le cas du parc national Cat Tien au Vietnam, Géocarrefour, 82,4, pp. 219-230.
- Déry, S., W. Saint-Fleur, 2021, Réduire les inégalités pour sauver la planète : par quel bout commencer? Communication présentée au colloque « Bridging regional responses to marginalization and disparities in a globalized world » de la Commission de l’UGI « Commission on Marginalization, Globalization and Regional and Local Responses C20.32 », 9-10 aout 2021, Conférence virtuelle ; Hôte : Cluj-Napoca University, Roumanie.
- Déry, S., M. Tremblay, 2009, L’implantation des aires protégées au Vietnam : quels impacts pour les populations locales? Une étude de cas dans la province de Lâm Dông, VertigO, 8, 3. [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/vertigo/8059.
- Déry, S., W. Leimgruber, et W. Zcilincsar, 2012, Understanding Marginality: Recent Insights from a Geographical Perspective. Geografski glasnik, 74, 1, pp. 5-18.
- Déry, S. M. Lucas, et L. Boisclair, 201 9 a, Agrarian and urban transitions in Lâm Đồng province, Vietnam: adaptation or marginalisation for ethnic minorities? (traduction W. Leimgruber), dans W. Leimgruber, Chang-yi (dir.), Rural areas in the process of globalization – Rural areas between regional needs and global challenges – Challenges for rural areas in an epoch of globalization , Cham, Springer (collection « Perspectives on Geographical Marginality », 4), pp. 123-146.
- Déry, S., L. Dubé, et B. Chanthavong, 201 9 b, Protected areas, marginality, and the evolution of socio-economic networks since 1990 in Luang Nam Tha province, Lao PDR, dans W. Leimgruber, Chang-yi (dir.), Rural areas in the process of globalization – Rural areas between regional needs and global challenges – Challenges for rural areas in an epoch of globalization , Cham, Springer (collection « Perspectives on Geographical Marginality », vol. 4), pp. 277-306.
- Després, E., 2021, État des connaissances sur les enjeux d’inégalités associées aux solutions d’adaptation aux changements climatiques, Rapport présenté à Ouranos et à l'Observatoire québécois des inégalités, Montréal, 46 p. + annexes, [En ligne] URL : https://www.ouranos.ca/sites/default/files/2023-02/proj-202025-mv-despres-rapport-stage.pdf
- Ducourtieux, O., M. Mounayar, S. Déry, et Nguyen N. T., 2019, Dynamiques touristiques et révolutions paysagères dans les montagnes du Lam Dong (Vietnam), dans M.-C. Fourny (dir.), Trajectoires territoriales. Dynamiques d’innovations intégratives en montagne, Grenoble, Presses de l’Université de Grenoble (collection « Montagne et Innovation »), pp. 117-145.
- Dufumier, M., 2019, L'agroécologie peut nous sauver, Arles, Éditions Actes Sud, 176 p.
- Dufumier, M., 2020, De la terre à l'assiette. 50 questions essentielles sur l'agriculture et l'alimentation, Paris, Allary Éditions, 233 p.
- Durand, S., C. Granjou, C. et Mounet, 2022, Connaissances et expériences ordinaires des dérèglements climatiques : enquête en milieu montagnard, Journal des anthropologues, 168-169, pp. 97-116.
- Egah, J., E. Dimon, J.M. Odou, E. Houngue et M.N. Baco, 2024, Analyse genrée de la vulnérabilité et du mécanisme d’adaptation au changement climatique au Nord-Bénin, VertigO, section « Regards / Terrain » [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/vertigo/42852.
- Emmanuel, A., 1969, L’échange inégal : essai sur les antagonismes dans les rapports économiques internationaux, Paris, Maspero, 364 p.
- Fabregoule, C., 2023, « Vulnérabilité », « gouvernance », « résilience » : des mots forts du droit de l’environnement entre convergences et divergences conceptuelles et méthodologiques, dans R. Bentirou Mathlouthi, A. Pomade (dir.), Vulnérabilité(s) environnementale(s). Perspectives pluridisciplinaires. Paris, L’Harmattan, pp. 97-120.
- FAO, 2015, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2014. Ouvrir l’agriculture familiale à l’innovation, Rome, FAO, 157 p.
- FAO, 2017, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2017. Mettre les systèmes alimentaires au service d’une transformation rurale inclusive, Rome, FAO, 178 p.
- FAO, 2019, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2019. Aller plus loiin dans la réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires, Rome, FAO, 175 p.
- FAO, 2023, COP28 : les systèmes agroalimentaires mondiaux sont la solution face au changement climatique, selon la déclaration faite par le Directeur général de la FAO devant des dirigeants mondiaux, Rome, FAO, 1er décembre 2023, [En ligne] URL : https://www.fao.org/newsroom/detail/cop28-global-agrifood-systems-are-the-climate-solution--fao-director-general-tells-world-leaders/fr
- Folke, C., S. Polasky, J. Rockström, V. Galaz, F. Westley, M. Lamont, M. Scheffer, H. Österblom, S. R. Carpenter, F. S. Chapin III, K. C. Seto, E. U. Weber, B. I. Crona, G. C. Daily, P. Dasgupta, O. Gaffney, L. J. Gordon, H. Hoff, S. A. Levin, J. Lubchenco, W. Steffen, et B. H. Walker, 2021, Our future in the Anthropocene biosphere, Ambio, 50, pp. 834-869.
- Fonds mondial pour la nature (WWF), 2010, Rapport Planète Vivante 2010. Biodiversité, biocapacité et développement, [En ligne] URL : http://awsassets.wwf.ca/downloads/lr_wwf_lpr2010_fr.pdf
- Fonds mondial pour la nature (WWF), 2020, Rapport Planète Vivante 2020. Infléchir la courbe de la biodiversité, [En ligne] URL : https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/lpr_2020_synthese_pays_francophones.pdf
- Fonds mondial pour la nature (WWF), 2022, Rapport Planète Vivante 2022. Pour un bilan « nature » positif, [En ligne] URL : https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2022-10/LPR%202022%20VFINAL_Page_pageBD.pdf
- Fortmann, M., 2019, Le retour du risque nucléaire, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 59 p.
- Fouilleux, E., N. Bricas, A. Alpha, 2017, ‘Feeding 9 billion people’: global food security debates and the productionist trap, Journal of European Public Policy, 24, 11, pp. 1658-1677.
- Friederichsen, R., A. Neef, 2010, Variations of Late Socialist Development: Integration and Marginalization in the Northern Uplands of Vietnam and Laos, European Journal of Development Research, 22, pp. 564-581.
- Friis C., 2017, Land use change in a globalised world: Exploring the relevance of the telecoupling framework in the case of banana plantation expansion in northern Laos, thèse de doctorat (PhD), Berlin, Humboldt-Universität, Geographisches Institut, 175 p.
- Fukuda-Parr, S., 2019, Keeping Out Extreme Inequality from the SDG Agenda – The Politics of Indicators, Global Policy , 10, 51-janvier, pp. 61-69
- Galland, O., Y. Lemel, 2018, Sociologie des inégalités, Paris, Armand Colin, 352 p.
- Galli, A., T. Wiedmann, E. Ercin, D. Knoblauch, B. Ewing, et S. Giljum, 2012, Integrating Ecological, Carbon and Water footprint into a « Footprint Family » of indicators: Definition and role in tracking human pressure on the planet, Ecological Indicators , 16, mai, pp. 100-112.
- Gemenne, F., A. Rankovic, 2019, Atlas de l’anthropocène, Paris, Presses de Science Po, 159 p.
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2007, Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié sous la direction de~)], Genève, GIEC, 103 p.
- Gravel, N., 2018, Antecedentes y trayectoria de la gobernanza participativa de los recursos naturales: lecciones de Canadá, Costa Rica y Brasil [Antécédents et trajectoire de la gouvernance participative des ressources naturelles : leçons du Canada, du Costa Rica et du Brésil, dans Gilles Massardier (dir.) Politiques publiques en Amérique latine, Mexico, CIRAD et Université nationale de Mexico, pp. 470-515.
- Grignon, P., 2010, L’argent-dette, Documentaire vidéo, Moonfire Studio, 52:15 (version révisée, originale de 2006), [En ligne] URL : https://www.youtube.com/watch?v=kgA2-bWXSN4
- Guibert, M., Y. Jean (dir.), 2011, Dynamiques des espaces ruraux dans le monde, Paris, Armand Colin, 407 p.
- The George Washington University – Milken Institute School of Public Health (GW-UMT), 2020, Equity vs. Equality: What’s the Difference? George Washington University Online Master of Public Health Program . GWU, 5 novembre 2020, [En ligne] URL : https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/
- Hall, D., 2009, The 2008 World Development Report and the political economy of Southeast Asian agriculture. The Journal of Peasant Studies , 36, 3, pp. 603-609.
- Hamann, M., K. Berry, T. Chaigneau, T. Curry, R. Heilmayr, P. J. G. Henriksson, J. Hentati-Sundberg, A. Jina, E. Lindkvist, Y. Lopez-Maldonado, E. Nieminen, M. Piaggio, J. Qiu, J. C. Rocha, C. Schill, A. Shepon, A. R. Tilman, I. van den Bijgaart, et T. Wu, 2018, Inequality and the biosphere, Annual Review of Environment and Resources , 43, pp. 61–83.
- Head, L., 2010, Cultural ecology: adaptation - retrofitting a concept?, Progress in Human Geography , 34, 2, pp. 234-242.
- Hiwasaki, L., E. Luna, Syamsidik, et R. Shaw, 2014, Process for integrating local and indigenous knowledge with science for hydro-meteorological disaster risk reduction and climate change adaptation in coastal and small island communities, International Journal of Disaster Risk Reduction , 10, pp. 15–27.
- Hiwasaki, L., E. Luna, Syamsidik, et J. A. Marçal, 2015, Local and indigenous knowledge on climate-related hazards of coastal and small island communities in Southeast Asia, Climatic Change , 128, pp. 35–56.
- Hiwasaki, L., C. Culas, Minh T. T., S. Senaratna Sellamuttu, B. Douthwaite, M. Elias, N. Kawarazuka, C. McDougall, et E. Pannier, 2016, Guidelines to engage with marginalized groups in agricultural research for development in the Greater Mekong , Hanoi, Vietnam, ICRAF, 30 p.
- Hiwasaki, L., Minh, T. T., 2022, Negotiating marginality: Towards an understanding of diverse development pathways of ethnic minorities in Vietnam, Journal of International Development , 34, 8, novembre, pp. 1455-1475 .
- Hoekstra, A. Y. (dir.), 2003, Virtual water trade: Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade, Value of Water Research Report Series No.12, UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.
- Hoekstra, A. Y., A. K. Chapagain, et P. R. Van Oel, 2017, Advancing Water Footprint Assessment Research: Challenges in Monitoring Progress towards Sustainable Development Goal, Water, 9, 6, pp. 438. [En ligne] URL : https://www.mdpi.com/2073-4441/9/6/438
- Hours, A., Lapierre, C., 2012, Pour une économie écologique et équitable. Paris, Association 4-D (coll. « Dossiers et Débats pour le Développement Durable », 123 p.
- IPCC, 2022, Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, et A. Okem (dir.)], dans, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, et B. Rama (dir.)], Cambridge (UK) et New York (NY, USA), Cambridge University Press, 34 p, [En ligne] URL : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
- IPCC, 2023, Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Équipe de rédaction principale, H. Lee et J. Romero (dir.). IPCC, Genève (Suisse) pp. 35-115, [En ligne] URL : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
- Islam, S. Nazrul, 2015, Inequality and Environmental Sustainability . UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Working Papers, 145 p.
- Izoard, C., 2024, La ruée minière au XXIe siècle, Paris, Seuil, 352 p, et Montréal, Éditions de la rue Dorion, 344 p.
- Kamau, M., P. Chasek, et D. O’Connor, 2018, Transforming Multilateral Diplomacy: The Inside Story of the Sustainable Development Goals , Londres et New York, Routledge, 341p.
- Kelman, I., 2020, Disaster by Choice: How our actions turn natural hazards into catastrophes , Oxford University Press, 167 p.
- Kelman, I., J. C. Gaillard, 2010, Chapter 2 Embedding climate change adaptation within disaster risk reduction, dans R. Shaw, J. M. Pulhin, J. Jacqueline Pereira (dir.), Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction: Issues and Challenges , 4, Leeds, Emerald Group Publishing Limited, pp. 23–46.
- Kempf, H., 2007, Comment les riches détruisent la planète, Paris, Seuil, 150 p.
- Kempf, H., 2009, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, Paris, Seuil, 154 p.
- Kempf, H., 2017, Tout est prêt pour que tout empire. 12 Leçons pour éviter la catastrophe, Paris, Seuil, 107 p.
- Klein, N., 2015, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Montréal, Lux (coll. « futur proche »), 632 p.
- Klein, N., 2019, Naomi Klein on the Case for a Green New Deal [Video]. The Laura Flanders Show, 12 décembre, 26:46. [En ligne] URL : https://youtu.be/oARjibprWa8
- Krol, M. S., M. J. Booij, R. J. Hogeboom, F. Karandish, J. F. Schyns, et R. Wang, 2022, Arjen Y. Hoekstra: A Water Management Researcher to Be Remembered, Water , 14, 1, p. 50.
- Lacoste, Y., 1976 et 2012, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, Maspéro (1976 : « Petite collection Maspéro ») et La Découverte, 245 p.
- Latouche, S., 1986, Faut-il refuser le développement?, Paris, Presses universitaires de France, 216 p.
- Latouche, S., 2006, Le pari de la décroissance. Paris, Fayard, 302 p.
- Latouche, S., 2010, Sortir de la société de consommation, Paris, Les liens qui libèrent, 221 p.
- Laurent, É., 2021, Sortir de la croissance. Mode d’emploi, Paris, Les liens qui libèrent, 254 p.
- Laurent, É., 2023, Économie pour le XXI e siècle. Manuel des transitions justes, Paris, La Découverte, 288 p.
- Leach, E. R., 1954, Political Systems of Highland Burma. London, Bell.
- Leakey, R., R. Lewin, 2011, La sixième extinction. Évolution et catastrophes, Paris, Flammarion (édition originale de 1995 en anglais), 352 p.
- Leimgruber, W., 2004, Between Global and Local. Marginality and Marginal Regions in the Context of Globalization and Deregulatio, Aldershot, Ashgate, 321 p.
- Lemmen, D. S., F. J. Warren, 2004, Impacts et adaptation liés au changement climatique : perspective canadienne, Ottawa, Ressources naturelles Canada, 219 p., [En ligne] URL : https://natural-resources.canada.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/perspective/pdf/report_f.pdf
- Maret I., T. Cadoul, 2008, Résilience et reconstruction durable : que nous apprend La Nouvelle-Orléans? Annales de Géographie, 663, pp. 104-124.
- Meadows, D. H., D. L. Meadows, J. Randers, et W. W. Behrens III, 1972, The limits to growth. A report for THE CLUB OF ROME’S project on the Predicament of Mankind, New York, Universe Books, 211 p.
- Mérenne-Schoumaker, B., 2020, Atlas mondial des matières premières, Paris, Autrement (3e édition), 95 p.
- Mizaba, I.R., S.M. Wabasa et B.K. Mbilizi, 2023, Foresterie communautaire et autonomisation des communautés locales dans la gestion des forêts à Walikale (R.D. Congo), VertigO, 23, 2, [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/vertigo/41251.
- Moore, J. W., 2015, Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital , Londres, Verso, 316 p.
- Moulin, S., 2016, Inégalités : mode d’emploi. L’injustice au travail au Canada, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 354 p.
- National Geographic – France, 1993, Que serait la Terre sans les hommes?, National Geographic, janvier, 108 p.
- Nussbaum, M. C., 2011, Creating Capabilities: The Human Development Approach, Boston, Harvard University Press, 256 p.
- O’Keefe, P., G. O’Brien, Z. Gadema, et J. Swords, 2010, Geographers and geography: making waves for the wrong reasons, Area , 42, 3, pp. 258-261.
- Oliver-Smith, A., 2009, Sea level rise and the vulnerability of coastal peoples responding to the local challenges of global climate change in the 21st century , Bonn, Intersections: interdisciplinary security connections, UNU Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), 54 p.
- Olivier, A., 2021, La révolution agroécologique. Nourrir tous les humains sans détruire la planète. Montréal, Écosociété, 296 p.
- Organisation des Nations unies, 2015 et 2024, Objectifs de développement durable, [En ligne] URL : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
- Ouranos, 2020, Plan quinquennal 2020-2025 : La science au service du réseau pour accélérer l’adaptation aux changements climatiques, Montréal, 124 p.
- Park, E. R., 1928, Human Migration and the Marginal Man, American Journal of Sociology , 33, 6, pp. 881-893.
- Passet, R., 1996, L'économique et le vivant, Paris, Economica, 291 p.
- Passet, R., 2010, Les grandes représentations du monde et de l’économie, Paris, Les liens qui libèrent, 950 p.
- Peemans, J.-P., 2015, The place of a “peasant way of development” in the search for sustainable rural development in Southeast Asia, dans P. Lebailly, J.-P. Peemans, Vu D. T. (dir.), Développement rural et petite paysannerie en Asie du Sud-Est. Leçons d'expériences au Vietnam et au Cambodge, Paris, L'Harmattan, pp. 389-416.
- Piketty, T., 2013, Le capital au XXI e siècle, Paris, Seuil, 967 p.
- Piketty, T., E. Saez, 2003, Income inequality in the United States, 1913-1998, Quarterly Journal of Economics , 118, 1, pp. 1-39.
- Polanyi, K., 1944 (1983), La Grande Transformation, Montréal, Gallimard, 476 p.
- Préfontaine, A. 2024, Impacts différenciés des effets des changements climatiques ainsi que des solutions d’adaptation sur les personnes en situation d’itinérance, Montréal, Ouranos, Observatoire québécois des inégalités, 138 p.
- Pruneau, D., C. Vautour, N. Prévost, N. Comeau, et J. Langis, 2009, Construire des compétences d’adaptation aux changements climatiques, grâce à l’éducation relative à l’environnement, Éducation et francophonie, 37, 2, pp. 132–151.
- Raffestin, C., 1980, Pour une géographie du pouvoir, Paris, LITEC, 249 p.
- Raffestin, C., 2019, Pour une géographie du pouvoir, Lyon, ENS Éditions (2e édition), 344 p.
- Rastoin, J.-L., 2018, Éditorial. Accélérer la transition vers une alimentation durable par un changement de paradigme scientifique et économique et des politiques publiques innovantes, Systèmes alimentaires / Food Systems, 3, pp. 17-27.
- Rawls, J., 2008, La justice comme équité : Une reformulation de Théorie de la justice, Paris, La Découverte (édition originale : 2001), 288 p.
- Reclus, É. (avec commentaires de B. Giblin), 1998, L'homme et la terre, Paris, La Découverte (édition originale parue essentiellement entre 1906 et 1908), 398 p.
- Rigg, J., P. Vandergeest (dir.), 2012, Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia , Singapour, NUS Press, 376 p.
- Robinne, F., M. Sadan (dir.), 2007, Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia. Reconsidering Political Systems of Highland Burma by E.R. Leach, Boston et Leiden, Brill (coll. « Handbook of Oriental Studies/Handbuch der Orientalistik », vol. 18), 331 p.
- Rousseau, J.-F., O. Durand, et R. De Koninck (dir.), 2009, Une seule Terre à cultiver. Les défis agricoles et alimentaires mondiaux, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 176 p.
- Sachs, J., 2005, The End of Poverty . Economic possibilities for our time , New York, Penguin Books, 397 p.
- Scott, J. C., 2017, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States , New Haven, Yale University Press, 312 p.
- Sen, A., 1992, Inequality reexamined , Oxford, Oxford University Press, 207 p.
- Sen, A., 2000, Repenser l’inégalité, Paris, Seuil, 281 p.
- Stankovich, A., 2020, Intermarginalité et plurimarginalité : les actions revendicatrices des groupes marginaux, un moteur de changement favorable à l’inclusion, Mémoire de maitrise, Université du Québec à Rimouski, Canada, 156 p.
- Stockholm Resilience Centre, 2016, The SDGs wedding cake, Stockholm, Stockholm Resilience Centre, 14 juin 2016, [En ligne] URL : https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html
- Talberth, J., K. Wolowicz, J. Venetoulis, M. Gelobter, P. Boyle, et B. Mott, 2006, The Ecological Fishprint of Nations. Measuring Humanity's Impact on Marine Ecosystems , Oakland, Redefining Progress, [En ligne] URL : http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/the_ecological_fishprint_of_nations01102008.pdf
- Tavoillot, P., 2013, La justice entre idéalisme et pragmatisme : les débats de la philosophie contemporaine, dans M. Wieviorka (dir.), Rendre (la) Justice, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, pp. 265-275.
- The Shift Project, 2022, Climat, crises ; comment transformer nos territoires, Première édition, 216 p.
- Veblen, T., 1899, The theory of the leisure class , New York, MacMillan, 183 p.
- VertigO, 2019, Les nouveaux chantiers de la justice environnementale, VertigO, 19, 1, [En ligne] URL : https://journals.openedition.org/vertigo/23912
- Wackernagel, M., W. Rees, 1999, Notre empreinte écologique. Comment réduire les conséquences de l’activité humaine sur la Terre, Montréal, Écosociété, 207 p.
- Waridel, L., 2019, La transition, c’est maintenant. Choisir aujourd’hui ce que sera demain, Montréal, Écosociété, 376 p.
- Weichselgartner, J., 2001, Disaster mitigation: The concept of vulnerability revisited. Disaster Prevention and Management , 10,2, pp. 85–94.
- Wilkinson, R., K. Pickett, 2009, The Spirit Level , New York, Berlin et London, Bloomsbury Press, 334 p.
- Wisner, B., J. C. Gaillard, et I. Kelman, 2012, Framing disaster: Theories and stories seeking to understand hazards, vulnerability and risk, dans B. Wisner, J. C. Gaillard, et I. Kelman (dir.), Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction , London, Routledge, pp. 18–34.
- Wisner, B., A. Lavell, 2017, The Next Paradigm Shift: From ‘Disaster Risk Reduction’ to ‘Resisting Disaster Risk Creation’ (DRR > RDRC), Communication présentée à la conférence « Dealing with Disasters », Durham, University of Durham, 20 septembre, [En ligne] URL : https://www.researchgate.net/publication/320045120_The_Next_Paradigm_Shift_From_'Disaster_Risk_Reduction'_to_'Resisting_Disaster_Risk_Creation
- Wisner, B., H. R. Luce, 1993, Disaster Vulnerability: Scale, Power and Daily Life, GeoJournal , 30, 2, pp. 127–40.
- World Resources Institute (WRI), Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G), Washington, WRI, [En ligne] URL : https://www.wri.org/initiatives/partnership-green-growth-and-global-goals-p4g
List of figures
Figure 1
Remettre l’économie à sa place : un phénomène social… partie de la nature
NOTE : Presque 25 ans après le Sommet de la Terre de Rio, on a aussi vu réapparaitre cette idée dans les travaux du Stockholm Resilience Centre pour décrire la relation entre les ODD (https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html). Et d’autres chercheurs ont développé des variantes plus ou moins complexes selon les thèmes abordés (par exemple Bleau, 2020). À noter que le livre dans lequel Passet a publié son schéma est initialement paru en 1979.
Figure 2
Complexité de la matrice des paysages et des écosystèmes naturels
NOTE : Matrice de paysages et d’écosystèmes naturels qui fournissent, pour le bienêtre humain, d’importants services écologiques aux systèmes physiques et socioéconomiques qui composent les milieux urbains et ruraux. Cette structure et ces liens sont dynamiques et évolutifs, avec des voies non linéaires.