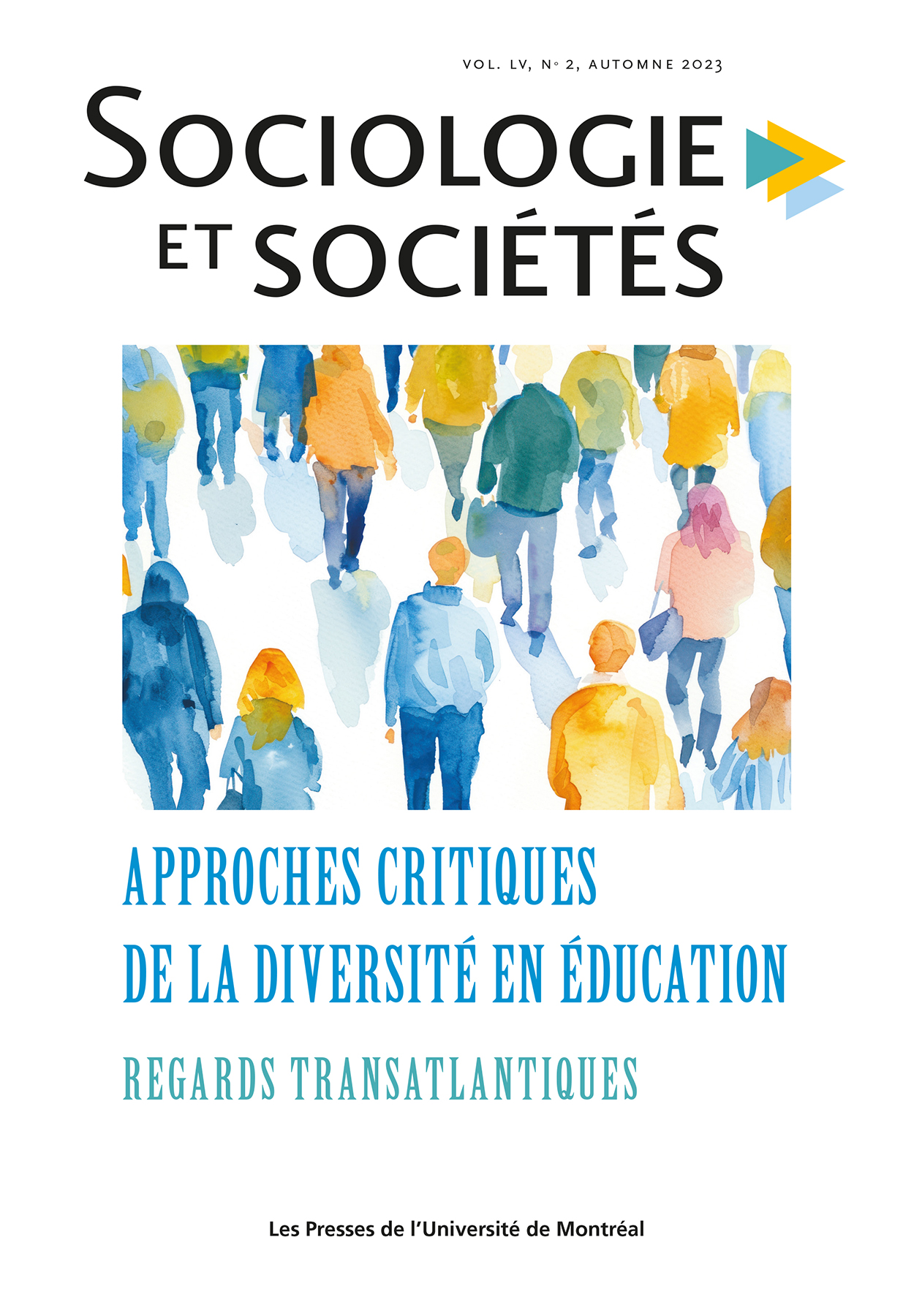Abstracts
Résumé
En raison de leur portée critique, les sciences sociales produisent des démythifications du monde qui peuvent conduire à un désenchantement démobilisateur, pour le·la chercheur·se comme pour nos interlocuteurs·rices. Cet article propose d’interroger cet écueil en y apportant des pistes concrètes centrées sur nos postures épistémologiques et méthodologiques. À partir de deux recherches portant sur des pratiques professionnelles, réalisées ces quinze dernières années, plusieurs types de démythification emblématiques sont présentés. Ce constat se poursuit par l’exposé de quatre postures épistémologiques reliant le·la chercheur·se à ses objets, sur un continuum allant de l’objectivation scientifique à l’élaboration de leviers d’action par des pratiques de co-recherche. Cette variation de postures conduit alors à typologiser différents types de connaissances qui alimentent des raisons d’être critique, sans renoncer à l’espérance. Ainsi, cet article propose des voies pour faire des sciences sociales une pratique intellectuelle qui ouvre les possibles tout en cultivant l’exigence de scientificité.
Mots-clés :
- critique,
- espérance,
- possibles,
- épistémologies impliquées,
- émancipation
Abstract
Due to their critical scope, the social sciences tend to have a demystifying effect. This can lead to disenchantment and a loss of motivation, among researchers as well as their audiences. This article offers an examination of this pitfall and proposes concrete responses centred around our epistemological and methodological positions. Using two studies on professional practices, both conducted within the past fifteen years, several emblematic types of demystification are presented. This finding is followed by an exploration of four epistemological positions linking researchers to their subjects on a continuum from scientific objectification to developing possibilities for action through co-research practices. This variation of position then leads to typologizing different types of knowledge that nourish critical purposes without turning our backs on hope. As such, this article proposes means by which the social sciences can serve as an intellectual practice that opens the door to possibility all while cultivating the rigours required of scientific research.
Keywords:
- Critique,
- hope,
- possibilities,
- implied epistemologies,
- emancipation
Resumen
A raíz de su alcance crítico, las ciencias sociales desmitifican el mundo y pueden conducir a un desencanto disuasorio, tanto para el/la investigador/a como para sus interlocutores/as. El presente artículo propone analizar este obstáculo y sugiere alternativas concretas centradas en nuestras posiciones epistemológicas y metodológicas. A partir de dos investigaciones sobre prácticas profesionales, realizadas en los últimos quince años, se presentan varios tipos emblemáticos de desmitificación. Este hallazgo se completa con la exposición de cuatro posturas epistemológicas que vinculan a los/las investigadores/as con sus objetos, en un continuo que va desde la objetivación científica hasta el desarrollo de mecanismos de acción a través de prácticas de investigación conjunta. En consecuencia, esta variación en las posturas nos conduce a tipificar las diferentes clases de conocimientos que alimentan las razones para ser críticos, sin renunciar a la esperanza. Así, el presente artículo propone opciones para hacer de las ciencias sociales una práctica intelectual que abra nuevos horizontes sin dejar de lado la exigencia inherente a la investigación científica.
Palabras clave:
- crítica,
- esperanza,
- posibilidades,
- epistemologías implicadas,
- emancipación
Article body
introduction
La dimension politique est intrinsèque à l’activité scientifique, à son ontologie même, quand bien même elle serait « axiologiquement neutre » dans ses protocoles[1] : c’est justement parce que cette activité s’est en partie délestée de la question supposément non scientifique « du sens et de la finalité du geste » (Barreau, 2023, p. 47) qu’elle embarque en réalité en passager clandestin une importante charge politique — et, en l’occurrence et dans bien des cas, destructrice du vivant. Que les sciences soient physiques, naturelles ou sociales, leur dimension performative sur le monde semble en fait en être un trait constitutif. D’une autre façon, la sociologie est quant à elle soumise à une double exigence : définir son utilité sociale d’un côté et démontrer sa neutralité de l’autre ou, plus justement et réalistement, sa scientificité (Lahire, 2004), et c’est sans doute ce double aspect qui structure en partie les représentations que nous nous faisons de notre métier. C’est donc chargé d’un bagage indispensable au voyage, mais quelque peu volumineux, que les chercheur·se·s en sciences sociales font leur chemin : le mandat et même la licence (Hughes, 1996) pour produire une scientificité qui, fondamentalement et dans le même temps, soit porteuse d’une portée sociale, éventuellement transformative du monde. Par ailleurs, le regard critique des mondes que nous étudions est non seulement possible, mais aussi constitutif de nos disciplines[2]. C’est particulièrement le cas pour les adeptes des approches mettant en leur coeur ce rôle émancipateur des sciences sociales : sociologie critique, diverses « studies », sociologie et anthropologie des futurs et des politiques préfiguratives : dans ces dernières, « les universitaires promeuvent le changement social et s’engagent en tant que “créateurs d’avenir” » [traduction libre] (Bell et Mau cité dans Suckert, 2022, p. 396)[3] ; d’autres conçoivent l’anthropologie du futur désirable comme étant essentielle au devenir de l’anthropologie (Appadurai, 2013, chapitre 15) ; d’autres enfin, à la suite d’E. Bloch par exemple, entendent « réarmer la critique face à ce contexte de critique de la critique et des sciences » (Guégen et Jeanpierre, 2022, p. 288) en faisant le pari épistémologique d’étudier en premier lieu la réalité des espérances attendues et vécues. Par-delà les paradigmes adoptés, il nous semble que des sciences à la fois réflexives sur elles-mêmes et tendant à la rigueur de l’objectivation scientifique sont, inévitablement, porteuses d’une dimension critique.
D’un point de vue strict, cette dernière renvoie, selon les espaces géographiques et sociaux du monde académique, tantôt au paradigme bourdieusien tantôt à Foucault ou à l’École de Francfort. Ces sources d’inspiration forment différents « styles critiques » : certains empreints d’une forte dimension réflexive grâce aux apports de la Théorie critique (Renault, 2012, p. 87)[4], également à même de rendre compte du champ des possibles émancipatoires ou autoritaires (Guéguen et Jeanpierre, 2022b), d’autres de transformation des perspectives et d’interrogation des représentations vécues comme des réalités dans une optique dite « généalogique » (Fassin, 2017). Elles constituent en tout cas un effort de totalisation visant à identifier de façon critique les structures profondes de l’ordre social, sous-jacentes à des cas singuliers, en couplant le respect des règles scientifiques à l’aspiration à l’émancipation (Granjon, 2021). On peut également les lire comme l’alliance de trois dimensions de la connaissance, à partir du triptyque d’Horkheimer pour décrire la sociologie critique — explicative, normative et pratique (De Munck, 2011) : cognitive, avec la description du réel (la production empirique) et son explication à l’aide d’un appareil conceptuel ; évaluative avec l’identification de dysfonctionnements (domination, évolution des formes sociales, hiérarchies et segmentations du monde…) ; transformative, par la formulation de recommandations, voire la réalisation d’actions à même de modifier le réel. Il nous semble d’ailleurs important de nuancer la séparation stricte entre ces dimensions puisque la seule fonction cognitive est déjà productrice d’une transformation du réel[5] par la remise en question du normal et du pathologique, du naturel et de l’acquis, entre autres. Également, parce que nommer le réel, c’est déjà le concevoir sous un prisme particulier : parler d’injustices, de segmentation, de hiérarchies, d’alliance ou de reproduction, c’est en même temps penser leurs absences ou leurs contraires (l’injustice, l’unité, l’égalité, la liberté et l’agency…). Ainsi, la dimension cognitive semble déjà en elle-même transformative et c’est peut-être ce trouble heureux entre pensée et action dans la production de savoir qui génère de nombreuses controverses médiatiques au sujet du caractère supposément « idéologique » des sciences sociales.
En fin de compte, la portée sociopolitique des sciences sociales ne se réduit pas à une fonction de porte-voix des acteurs·rices de terrain. Sans revenir sur le dense corpus épistémologique relatif au statut scientifique de nos disciplines, l’on peut spécifier que la rigueur analytique passe par une approche intransigeante et non complaisante : à la fois distante des normativités hégémoniques, proche de la subjectivité des enquêté·e·s, mais sans concession sur leurs pratiques. Cela fait aussi écho à la proposition de D. Fassin, exposant qu’une science sociale critique peut se situer dans un juste milieu entre la « hautaine radicalité » et la « compréhension complaisante », ou encore, entre le « dévoilement » et la « traduction », ces approches polarisées faisant référence à la sociologie critique d’un côté et à la sociologie pragmatiste de la critique dans la sociologie française, de l’autre (Fassin, 2009). Autrement dit, étudier des espaces sociaux, même ceux porteurs d’utopie, c’est aussi accepter de mettre en lumière leurs limites ou ambivalences et, par conséquent, contribuer à leur désenchantement ou démythification.
Ceux-ci touchent d’abord les acteurs·rices qui les investissent : l’effritement d’une conception institutionnelle homogène, cohérente et vertueuse de ces organisations n’est par exemple pas sans effet sur le moral et les ressources des membres du groupe. Mettre en lumière ces aspects moins valorisés ou valorisants, c’est en effet potentiellement ancrer les acteurs·rices dans une posture d’erreur sans offrir d’outils pour la dépasser et donc, prendre le risque d’une analyse démobilisatrice[6]. Enfin, exposer les limites de ces initiatives et organisations, c’est aussi envisager de porter au grand jour des tensions internes à un espace vers l’extérieur de celui-ci et ainsi risquer de mettre certains acteurs·rices en difficulté vis-à-vis des contraintes exogènes auxquelles ils et elles doivent faire face (organisations concurrentes, financeurs, etc.). Pour ne citer qu’une seule de ces ambivalences, mais emblématique, l’on peut se référer aux inégalités de genre dans la division sexuelle du travail et dans la répartition des rétributions — symboliques et statutaires — dans certains espaces professionnels à prétention égalitariste (Bajard, 2021) ou au sein d’actions collectives « progressives, anti-patriarcales et anticapitalistes » (Rozencwajg, 2021). Cette illustration suffit à faire comprendre pourquoi la question des « déceptions et des défections » irrigue aussi toute une partie de la littérature sur les possibles (Sallustio, 2021)[7].
Devant ces difficultés de déployer pleinement la portée critique de nos disciplines, l’on pourrait donc en conclure à un « triste destin » des sciences sociales, asséché de toute volonté d’en faire un outil émancipateur face au défi de l’action. Il devient alors aisément compréhensible que les chercheur·se·s en sciences sociales soient animé·e·s d’une inquiétude persistante liée au sens du travail intellectuel : « que faire de la sociologie ? », question récurrente dans plusieurs initiatives éditoriales et professionnelles depuis les années 2000 (Hirschhorn, 2014). À quoi sert-elle ?, pour reprendre le titre de l’ouvrage éponyme de B. Lahire, ou autrement posée : « Qu’est-ce qu’on fout là ? »[8], question fondamentale adressée au groupe social que constituent les chercheur·se·s. Si cette dimension critique conduit nécessairement à objectiver les limites, ambiguïtés ou contradictions des mondes que nous étudions, comment vivre avec l’idée que nous participons peut-être, ce faisant, à éroder leur solidité ? Sous quelles formes nos pratiques intellectuelles pourraient-elles déployer leur dimension critique et satisfaire l’exigence de scientificité, tout en se constituant comme utopies réelles[9] à visée émancipatrice ?
L’intention de cet article est d’offrir des pistes concrètes de réponse et c’est pourquoi il focalise sur une dimension très précise de la recherche : les postures épistémologiques définissant la relation entre le·la chercheur·se et son objet de recherche. L’épistémologie, en tant que « liant » des ingrédients que constituent les matériaux empiriques, les méthodes et la théorie, est essentielle car elle permet de circuler entre ces différentes dimensions de la recherche. En appuyant mon propos sur deux recherches achevées auxquelles je renvoie[10], je reviens dans cet article sur quatre types de « désenchantement » que j’ai produits ou craint de produire, aussi bien chez les enquêté·e·s que ceux pouvant me toucher. Il en existe sans doute de nombreux autres et certains travaux ont d’ailleurs abordé ces « épreuves de véridiction », c’est-à-dire les « là où ça fait mal », au sein d’un groupe ou d’une institution (Fassin, 2009). Je propose ensuite de montrer que de tels écueils s’accompagnent aussi, rétrospectivement, de perspectives plus ouvertes grâce à la construction de différentes postures épistémologiques le long d’un continuum entre les deux polarités évoquées en amorce de cet article : l’objectivation scientifique d’un côté (épistémologies « impliquées » éthiquement pour le·la chercheur·se) et l’identification de leviers pour l’action (épistémologies « impliquantes » pour les acteur·rice·s). Cet article expose finalement comment, en différents endroits de ce continuum, ont été produits six types de connaissances donnant au·à la lecteur·rice des raisons de continuer à être critique sans renoncer à l’espérance.
1. quatre types de démythification produits par les sciences sociales : le (triste ?) destin des sciences sociales
Au gré de différentes enquêtes et divers objets de recherche, j’ai cherché à comprendre comment des individus tentent de façonner un avenir qu’ils pensent meilleur, les moyens déployés à cette fin, comme les limites et difficultés de ces initiatives. Pour le dire autrement, ce sont les conditions sociales — individuelles et collectives — de la projection vers un horizon désirable qui m’ont intéressée. Les deux objets d’enquête sur lesquels je reviendrai ici sont, de fait, considérés comme des expériences, elles-mêmes considérées comme des « alternatives » (politiques, professionnelles ou sociétales), des pratiques à dimension utopique par ses acteur·rice·s : il s’agit d’un milieu professionnel vécu comme progressiste et égalitariste pour l’un, et de structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour l’autre. Toutefois, leur étude m’a conduite à exposer un certain nombre de leurs limites, ambiguïtés, tensions internes, et je donnerai ici des exemples de situations illustrant la mise en lumière de quatre types de démythification[11]. Dans les deux premiers cas, cela s’est traduit par l’exposé de certaines dimensions peu valorisantes ou décevantes des milieux que j’étudiais : le revers problématique d’un aspect ayant par ailleurs des effets sociaux appréciés par les acteur·rice·s ; un sentiment d’impuissance ou d’immuabilité face aux structures sociales. Dans les deux cas suivants, j’ai mis en lumière des décalages entre les attentes théoriques et les valeurs promues d’un milieu, et les pratiques réelles observables dans celui-ci : chez des individus dans une configuration, sur le plan institutionnel et organisationnel dans l’autre. Les formes de désenchantement exposées ici ne sont de toute évidence pas exhaustives mais, parce que leur typologisation permet de leur donner une valeur paradigmatique, le·la lecteur·rice saura reconnaître des mécanismes de ce type dans ses propres objets de recherche.
1.1 Le revers « négatif » d’une dimension jugée « positive » par les acteurs·rices
Certaines dimensions présentées par les enquêté·e·s comme particulièrement louables ou bénéfiques à l’échelle individuelle et collective peuvent, sous le regard objectivant du·de la chercheur·se, laisser apparaître des revers plutôt négatifs pour celles et ceux qui les vivent. Certains impensés ou euphémisations du monde social permettent en effet aux acteurs·rices sociaux·ales d’agir de manière vivable, heureuse et durable dans leur réalité. Pourtant, des aspects douloureux ou décevants ainsi éludés n’en existent pas moins, et c’est aussi le travail du·de la sociologue de les décrire. Ce fut le cas de la « sympathie » qui régnait au sein du métier que j’avais étudié et dont j’avais tenté de comprendre le poids en tant que dimension informelle et affective des relations professionnelles (Bajard, 2023a). En l’occurrence, ses effets étaient significatifs : à la fois liant et source de solidarité, elle était perçue comme une véritable source de bien-être psychologique et matériel par les professionnel·le·s elles·eux-mêmes. Développer des sociabilités professionnelles qui étaient en même temps affectives et amicales constituait en effet l’une des importantes rétributions non monétaires pour les membres de ce groupe. Cependant, être « sympa » conditionnait beaucoup l’accès aux espaces de sociabilité et de commerce et n’était donc pas sans influence sur les hiérarchies professionnelles et les effets de réputation. Certaines inégalités de consécration s’en trouvaient ainsi invisibilisées puisque la croyance en leur légitimité s’appuyait sur la primauté apparente de compétences techniques et artistiques, alors que les formes de classement et les affinités professionnelles étaient aussi en partie forgées par ces dimensions affectives. La « sympathie » était, de surcroît, une qualité personnelle résultant notamment de l’adéquation d’un individu avec l’éthique et les visions du monde forgées par un segment très singulier — et dominant — du groupe professionnel : la génération fondatrice du tissu associatif et de la culture de métier dans les années 1980 (essentiellement des hommes âgés d’environ soixante-dix ans et plus aujourd’hui). Mettre en évidence les effets de ces normes culturelles mais aussi la segmentation hiérarchisée du groupe était donc de nature à noircir l’une des dimensions les plus agréables du métier pour la très grande majorité des enquêté·e·s — une forme de rétribution importante et en partie compensatoire de conditions économiques précaires — et ainsi effriter l’image de « grande famille » promue au sein du groupe (Bajard, 2018, chapitre 6, 2023a).
1.2 Le sentiment d’impuissance ou l’immuabilité des structures sociales
Une autre forme de désenchantement tient à la récurrence des mécanismes qui produisent et reproduisent les inégalités. Au fil de nos différentes enquêtes, cela est susceptible de conduire, pour nous chercheur·se·s, à un sentiment d’impuissance face à ce qui peut être interprété comme une forme de déterminisme social. Cette négativité de la critique se traduit par exemple par un « hyperpessimisme », décliné aussi bien dans le misérabilisme culturel percevant des agents inéluctablement agis par les structures de domination (dans certains travaux se revendiquant notamment de la sociologie bourdieusienne) ou dans une conception totale de la sujétion des individus à la raison instrumentale (Granjon, 2012, p. 83). Si l’analyse offre généralement des résultats plus nuancés, comment ne pas éprouver malgré tout une certaine lassitude lorsqu’on constate que ce que nous appelons les variables lourdes (sexe, classe sociale, rapports sociaux-raciaux, âge, etc.) pèsent avec tant de poids dans la construction des hiérarchies ordinaires ? Qui plus est, lorsque ces constats se répètent au gré de différents terrains d’enquête ? Ce saisissement est renforcé lorsque les variables qui se déploient dans des relations sociales se transforment en qualités perçues par les acteur·rice·s comme intrinsèques, ou en positions immuables à leurs yeux. Lorsque des dimensions ayant un poids dans certaines interactions deviennent une essence, l’affrontement de ces structures sociales doit alors se doubler d’un travail de dénaturalisation scientifique, parfois coûteux moralement. Ce fut par exemple le cas du capital culturel et des rapports de classes au sein du métier que j’étudiais, qui pouvaient générer chez les enquêté·e·s un classique sentiment de « don » ou au contraire « d’incapacité » ou « d’incompétence » dans certaines dimensions sociales du métier (par exemple dans ce qui avait trait à la valorisation du travail auprès de client·e·s ou d’intermédiaires culturel·le·s). Sous une autre forme, ce fut le cas de la variable genre, qui faisait dire avec grand naturel à des enquêtés qu’ils ne « savaient pas » ou « n’aimaient pas » s’occuper des « paperasses », pour justifier la délégation de cette tâche administrative aux conjointes, la rhétorique du goût ou du don étant également mobilisée par certaines enquêtées elles-mêmes.
1.3 Des contradictions et hiatus entre valeurs et pratiques individuelles
Un autre type de démythification résultant de l’objectivation scientifique peut conduire à identifier des ambiguïtés, voire des contradictions entre valeurs et pratiques, chez des individus. La déception est particulièrement marquée lorsque les acteur·rice·s agissent de façon opposée à des principes qu’ils et elles revendiquent par ailleurs. En l’occurrence, il s’agissait de la présence d’inégalités de genre dans un espace du travail indépendant artistique pensé et vécu comme progressiste : ce dernier est en effet fortement féminisé, investi par des femmes dont la plupart sont fortement dotées en capitaux culturels, structuré par une culture professionnelle se voulant égalitariste, choisi au nom d’une volonté d’accomplissement personnel et vécu comme une solution de rechange à d’autres formes de domination. C’est pourquoi j’avais proposé une série d’explications à la fois matérielles et idéelles, déclinées à l’échelle des individus comme du collectif professionnel, de ce qui apparaissait comme un véritable paradoxe (Bajard, 2021). Porter au jour ces mécanismes devait permettre de déterminer les leviers pouvant être mobilisés pour opérer des rééquilibrages au sein des maisonnées, comme dans la communauté professionnelle. Il n’en reste pas moins que la lecture de certains écrits avait pu se révéler bouleversante pour certaines enquêtées, telle une qui m’avait confié avoir pleuré en lisant les propos qu’elle avait pu tenir en entretien à l’aune de la distance créée par le texte sociologique, ou encore une autre, triste de réaliser nettement qu’elle se situait dans une relation de domination genrée avec son conjoint alors qu’elle ne faisait que le pressentir jusque-là. De manière générale, les démythifications liées à des hiatus entre valeurs et pratiques sont particulièrement marquantes dans les espaces pensés comme des alternatives à des formes structurelles de domination.
1.4 Des hiatus entre valeurs et pratiques organisationnelles
Dans la même veine que le précédent type de démythification, ce hiatus concerne aussi les déceptions causées par l’écart entre ce que nous pouvons espérer des institutions sociales et ce qu’elles produisent. Qu’il s’agisse d’organisations (associations, syndicats, collectifs, etc.) ou de dispositifs d’action publique, ces formes institutionnelles ne génèrent pas toujours des pratiques à la hauteur des espérances dont elles sont théoriquement porteuses. C’est tout particulièrement le cas de celles qui revendiquent une part de transformation sociale et/ou de protection des individus, et qui jouissent d’ailleurs, pour certaines, d’une forme d’« intouchabilité morale » à l’instar des organisations humanitaires (Fassin, 2009), mais aussi, et de façon non exhaustive, des syndicats et leur vocation de solidarité et de défense des travailleurs, de l’économie sociale et solidaire, des mouvements politiques progressistes, etc. Dans nos recherches sur les coopératives d’activité et d’emploi (CAE), un type particulier d’organisation de travail de l’économie sociale et solidaire en France, de multiples facteurs à la fois organisationnels et individuels ont pu expliquer des écarts entre les cadres formels établis concernant la protection sociale et leurs usages par les membres de ces organisations ; ou encore entre le fonctionnement attendu d’une coopérative et la réalité observée en termes de participation à sa vie démocratique. Le sous-usage important des droits sociaux, la culture syndicale parfois relativement effacée, la connaissance parfois parcellaire des fonctionnements d’une entreprise coopérative, voire le peu d’intérêt pour le sociétariat de la part de certain·e·s de ses membres, apparaissaient comme autant de déclinaisons démythifiées des ambitions théoriques et législatives promues par l’ESS[12].
À travers ces quatre types de démythification, on comprend qu’exposer les limites, ambiguïtés, pratiques informelles ou difficultés internes de certains processus ou groupes sociaux, c’est d’abord aller à rebours d’une conception institutionnelle homogène, cohérente et vertueuse de ces organisations. Mais, et c’est sans doute le plus délicat, cela peut aussi potentiellement mettre en difficulté ses acteur·rice·s, au regard de l’extérieur (tiers financeurs, institutions officielles, collectifs concurrents, etc.) autant qu’en interne entre différents segments du groupe. C’est aussi potentiellement ancrer les acteur·rice·s dans une posture d’erreur sans mettre à leur disposition les outils pour dépasser ces situations[13]. Pour autant, ce travail de « démythification » semble nécessaire, y compris, et paradoxalement, pour nourrir les espérances. C’est pourquoi la section qui suit montre que ce qui semble parfois s’apparenter à un triste destin des sciences sociales s’est aussi doublé de perspectives plus ouvertes grâce à plusieurs postures épistémologiques offrant différents registres possibles de production de connaissances.
2. des épistémologies « impliquantes » et « impliquées » : quatre types de relation à nos objets d’enquête
À l’aune des démythifications consubstantielles aux pratiques de recherche, l’on pourrait facilement tomber dans un certain désarroi. Pourtant, dans le cadre de mes enquêtes, il ne s’agissait pas d’en conclure que toute alternative porte en elle les germes de son échec, mais plutôt de se mettre en situation de pouvoir esquisser des voies d’évolution. Il s’agit là d’un enjeu tout à fait crucial qui peut être qualifié de « pari épistémologique », fondé sur l’identification des principes de viabilité (intellectuelle et politique) de certaines pratiques émancipatrices mais aussi de faisabilité (leur dimension opérationnelle) (Wright, 2017). Or, il m’a semblé que les différentes postures épistémologiques qui me liaient à mes objets — sur un continuum entre objectivation scientifique et formulation de leviers pour l’action — étaient toutes de nature à produire des énoncés susceptibles d’alimenter cette ambition.
Les sciences sociales se situent, de manière classique, du côté de l’objectivation scientifique et requièrent ce que j’appelle ici une forme d’épistémologie « impliquée » de la part du·de la chercheur·se : cela ne désigne pas ici un·e scientifique porte-voix ou un·e intellectuel·le organique des causes qu’il·elle étudie ni un·e chercheur·se embarqué·e dans la participation observante et tirant parti de ses liens personnels avec son terrain. J’entends ici par « implication » l’idée de se mettre soi-même, en tant que chercheur·se, en posture d’autosurveillance épistémologique dans le souci d’honorer nos objets ou enquêté·e·s d’une analyse rigoureuse. C’est donc en ce sens que j’entends ici l’implication : vis-à-vis des personnes que nous étudions. Les deux déclinaisons de cette implication présentées ici constituent deux manières de produire des connaissances avec une ambition de « rigueur du qualitatif » (Olivier de Sardan, 2004), notamment parce qu’elles se fondent toutes deux sur une importante réflexivité du·de la chercheur·se. Elles sont donc indispensables à la pratique de la sociologie en tant que science[14]. La troisième posture consiste à prolonger la portée critique de la recherche dans l’identification de leviers d’action sur la réalité observée : il ne s’agit alors ni de prescrire des solutions ni de faire nécessairement avec les enquêté·e·s dans des formes de coécriture de l’enquête, mais d’engager un dialogue qui leur sera utile pour faire pour et par elles·eux-mêmes. Enfin, la quatrième posture épistémologique me semble nettement relever de ce que j’appellerais une dimension « impliquante » pour les acteur·rice·s des milieux que nous étudions : elle consiste à diversifier les sources d’énoncés sur le monde étudié et explorer de nouvelles formes d’expression ou écriture, en impliquant les enquêté·e·s dans des formes de co-recherche. Les postures présentées ici ne constituent pas un panorama exhaustif des postures épistémologiques mais peuvent, à partir d’une analyse rétrospective portée sur mes travaux, fournir au·à la lecteur·rice des grilles de lecture de ses propres pratiques.
2.1 Honnêteté critique et critique honnête : les vertus de l’objectivation de soi
Pour qu’advienne la première posture d’épistémologie « impliquée » vis-à-vis des enquêté·e·s, une réflexivité minimale est requise, dont l’une des illustrations les plus connues et enseignées dans les cursus académiques aujourd’hui constitue sans doute la pratique de l’auto-socioanalyse, c’est-à-dire de « l’objectivation du sujet de l’objectivation » (Hamel, 2015). Cette distance et ce recul permettant de nous regarder parmi les autres êtres humains que nous regardons (Élias, 1991), et la réflexion sur nos dispositions sociales, y compris proprement académiques (Bourdieu, 2003), est sans doute un maillon essentiel pour conquérir nos objets contre les obstacles épistémologiques, à commencer par le sens commun dont nous sommes également les porteurs (Bachelard, 1967). Cette posture permet aussi de faire preuve d’honnêteté dans le regard critique que nous posons sur nos objets d’étude, c’est-à-dire en évitant les « règlements de compte » inconscients avec les enquêté·e·s ou avec ce qu’ils·elles incarnent ; également, en s’astreignant à une non-complaisance avec elles et eux, quand bien même se tisserait un lien de proximité, voire d’affection. C’est par exemple ce type d’épistémologie qui m’avait, dans les premières années de recherche, permis d’objectiver l’espace professionnel que j’étudiais alors même que j’avais de nombreuses affinités avec celui-ci, afin de parvenir à certaines des démythifications exposées plus tôt. C’est encore cette tentative d’objectivation de soi qui me semble, toujours aujourd’hui, indispensable à la pratique ordinaire du travail de recherche, irriguant aussi bien mes réflexions sur mon rapport à l’objet que sur les façons de déployer certaines méthodes dans le cours des interactions. Cette posture constituant un classique des méthodes d’enquête — largement écrite, transmise, enseignée — dans les sciences sociales au niveau académique, je ne la développe pas davantage.
2.2 Une subjectivité réflexive : la relation d’enquête au service d’une rigueur épistémologique
Dans une autre conception, toujours fondée sur une implication du·de la chercheur·se dans la quête de rigueur épistémologique, j’ai développé cette seconde posture qui n’était alors pas une voie épistémologique dominante au sein de la sociologie qualitative en France. En m’intéressant aux apports des recherches sur les implications affectives et politiques de l’observateur·rice, habituellement considérés comme des « biais » dans les sciences sociales à visée « universaliste » (Hamel, 2015, p. 310‑311)[15], l’idée qu’ils peuvent être un combustible pour la recherche a émergé, à condition d’en faire un usage assumé, réflexif et méthodique[16]. La théorie du point de vue situé [standpoint theory] repose par exemple sur l’idée que certaines caractéristiques attachées à la personne du·de la sociologue favorisent la perception immédiate de certaines dimensions d’un phénomène et donc, que leur exposé assumé étaye une « objectivité forte » (Harding, 1984)[17]. C’est en ce sens que je plaidai pour les usages des affects dans les méthodes d’enquête qualitatives, notamment à partir de l’analyse des relations de transfert et de contre-transfert entre enquêtrice et enquêté·e·s, grâce aux apports de l’ethnopsychiatrie (Bajard, 2013). Il s’agissait en d’autres termes de considérer pleinement les enjeux de la relation d’enquête comme relation sociale, qui informe donc en même temps qu’elle se produit. L’emploi de cette subjectivité réflexive au service de la rigueur épistémologique conduit à considérer que les personnes avec lesquelles nous construisons, progressivement et grâce à l’expérience de la communication, un lien social, ne sont pas tant « nos enquêté·e·s » ou « nos informateur·rice·s » — soit de simples « objets sociaux (parlants) » (Chauvier, 2020) — que des sujets : imprévisibles, sensibles, qui nous touchent, nous mentent, nous influencent, nous assignent à des places, et donc susceptibles de façonner la relation d’enquête et de produire des effets sur l’observateur·rice. C’est pourquoi l’explicitation du rapport à l’objet et l’utilisation en connaissance de cause des « perturbations » ainsi engendrées participent d’une démarche aspirant à la neutralité axiologique, conçue non pas comme absence de valeurs, mais comme vigilance à l’égard de leur imposition (Kalinowski, 2005 ; Weber, 2003, p. 15).
2.3 Prolonger la critique : identifier des leviers d’action
À l’aune des analyses en sciences sociales, certain·e·s acteur·rice·s concerné·e·s se retrouvent placé·e·s dans une position d’« erreur » au regard des objectifs qu’ils et elles prétendent atteindre. C’est à ce type de questionnement que j’ai dû faire face, en particulier en abordant la thématique des inégalités de genre évoquée précédemment. Ce constat fut un moment pivot dans le cheminement épistémologique que je retrace ici : il me semblait que je me trouvais alors à mi-chemin entre l’analyse scientifique et la formulation de possibilités d’actions visant à faire autrement. Couplé au désarroi de certaines enquêtées, cela me procurait un goût d’inachevé, puisque cette posture surplombante consistant à souligner les limites de certaines dynamiques sociales ne s’accompagnait pas d’indications pour entreprendre la correction des asymétries, voire de la domination de genre dont il était question. Ce faisant, je contournais en fait le dialogue que cherchaient à établir certaines personnes lorsqu’elles demandaient : « Que pourrait-on faire, à ton avis ? » Le refus de délivrer toute forme de recommandation est bien une voie possible, malgré la difficulté à l’appliquer de façon stricte : cela risque de briser l’échange[18], mais aussi de rompre avec notre éthique du contre-don consistant à accepter de prolonger les échanges vers la réflexion conjointe avec les enquêté·e·s, en vertu du temps et de la confiance dont ils et elles témoignent en participant à notre enquête. À l’inverse, il nous semble problématique de nous inscrire dans ce que les consultant·e·s ou praticien·ne·s des sciences sociales appliquées appellent des « préconisations » ou des « recommandations », nous sortant ainsi du cadre scientifique d’une part, et nous positionnant dans une verticalité relationnelle d’autre part[19]. Pourtant, à défaut du conseil ou de la prescription, il existe des formes intermédiaires consistant à prolonger l’objectivation scientifique par l’identification des aspects sur lesquels les acteur·rice·s peuvent agir ; il s’agit non pas de le faire pour eux·elles ou de le leur prescrire, mais de les accompagner dans l’identification des dimensions nodales de leur monde (cf : infra, point 3.6). Cette démarche peut typiquement s’insérer dans une boucle rétroactive de production de matériaux empiriques et d’analyse. Cette forme de « co-production » inclut « l’élaboration des matériaux empiriques et de leur interprétation théorique en tant que processus interactif entre l’ethnographe et ses interlocuteurs » [traduction libre] (Fassin, 2017, p. 22)[20]. Ce que D. Fassin nomme « ethnographie critique » permet ainsi de réconcilier, dans des allers-retours entre terrain et écriture, les différents regards critiques : ceux que formulent les enquêté·e·s sur le monde comme ceux qui ressortent de notre analyse, en réservant toutefois l’acte final d’écriture au·à la chercheur·se.
2.4 Diversifier les énoncés, leurs lieux de production, leur écriture
La diversification des énoncés suggère une démultiplication de la production des connaissances critiques hors des espaces académiques, notamment grâce à des dispositifs autorisant des relations de pouvoir entre chercheur·se et enquêté·e·s moins asymétriques. La littérature sur les formes de co-recherche est abondante — on ne pourra réaliser un état de l’art ici — et elle se décline sous des formats très variés, dépassant largement le cadre des publications dans des revues scientifiques[21]. Ses déclinaisons épistémologiques et politiques sont également amplement diversifiées, grâce à l’essor de ces pratiques de recherches à l’intersection des mouvements sociaux et réseaux académiques dans les années 1970, et jusqu’à aujourd’hui dans les universités, le travail social rémunéré, comme dans le travail militant et communautaire. On se contentera ici de mentionner que les locuteur·rice·s prennent une autre place dans la production d’analyses, la formulation d’hypothèses, voire même l’écriture anthropologique ou sociologique : il s’agit de faire de la science non pas « sur », mais « avec » les concerné·e·s. Cette réduction des formes de violence symbolique au sein des dispositifs d’enquête peut se traduire jusque dans l’élaboration de textes dans une « raison littéraire » plus inclusive : « les textes permettent d’officialiser un réseau d’attentes. Ils sont un support permanent d’expression et d’action » (Chauvier, 2020). Les techniques associées à ces épistémologies impliquantes demeurent toutefois encore reléguées dans des espaces professionnels moins légitimes sur le plan symbolique, car essentiellement hors du champ académique : les sciences sociales appliquées, l’éducation populaire, l’intervention sociale, etc. C’est précisément pour cela que, contrairement aux précédentes postures présentées, je développe ici quelques dispositifs méthodologiques aptes à produire de telles formes de dialogue. En effet, je n’y avais pas été familiarisée dans mon cursus académique et il me semblait par ailleurs que s’asseoir autour d’une table avec les enquêté·e·s ne suffirait pas à prétendre faire de la co-recherche. C’est pourquoi j’ai emprunté des chemins de traverse au sein des sciences sociales pour aller découvrir des outils issus de la sociologie, de la psychanalyse et de l’éducation populaire : l’entraînement mental[22], la socianalyse[23] et des techniques d’éducation populaire basées sur l’idée de « penser le groupe pour ne plus avoir à le panser »[24]. Certaines de ces techniques n’ont pas été pratiquées dans la recherche-action elle-même, mais ont alimenté ces réflexions ainsi que certains dispositifs expérimentés ; d’autres ont été directement utilisées dans ce but.
Tableau 1
Synthèse des postures épistémologiques adoptées et leurs outils méthodologiques correspondants
3. des raisons d’être critique : quelques types de connaissances et leurs vertus pour l’espérance
Au moyen de ce panel de postures épistémologiques développées au cours de ces quinze années de recherche, on entrevoit d’ores et déjà comment celles-ci autorisent divers types de connaissances, certains ayant précisément pour vocation d’ouvrir ou de maintenir ouvertes des brèches pour l’action. Ainsi, malgré une possible fragilisation des espérances face au désenchantement produit par l’analyse critique, il nous semble utile de recenser différents types de réflexions émancipatrices produites à l’aide de ces postures.
3.1 Connaître les déterminations pour s’en libérer
Ce premier type de connaissances peut bien entendu être produit par l’ensemble des postures décrites, mais la première, permettant une critique honnête et une honnêteté critique, est particulièrement propice. L’objectivation du réel — des limites, contradictions, ambiguïtés des mondes sociaux étudiés — constitue déjà un pas franchi vers l’action : c’est d’ailleurs l’un des projets originels des sciences sociales en général, critiques en particulier, que de chercher à connaître les déterminations qui entravent afin de pouvoir s’en libérer. Ainsi, on peut sans grande surprise noter que porter au jour les oppressions systémiques et désingulariser les difficultés permet d’abord de conjurer plusieurs écueils pesant sur les individus : la psychologisation ou la personnalisation des difficultés, la moralisation, culpabilisation et condamnation des individus dans ce qui leur arrive. De ce point de vue, la discipline a évolué en montrant combien les acteur·rice·s étudié·e·s sont doté·e·s de réflexivité leur permettant également de réaliser en partie ce travail d’objectivation, le·la chercheur·se n’étant plus la seule figure détentrice de capacité de « dévoilement ». Il n’en reste pas moins que les sciences sociales, grâce aux enquêtes approfondies, restent un espace privilégié d’analyse des nécessités que le social tend à dissimuler avec efficacité.
3.2 Une vision dialectique du pouvoir : cartographier les pratiques de liberté dans la contrainte
La critique approfondie, si elle démythifie en partie, recèle des facettes émancipatrices qui apparaissent particulièrement bien lorsque l’on s’intéresse aux histoires de vie des enquêté·e·s-Sujets. C’est donc un type de connaissance auquel l’on peut accéder en tout point du continuum épistémologique liant le·la chercheur·se à son objet. Cette attention aux subjectivités permet d’observer l’articulation entre émancipation et contraintes, les situations étudiées n’étant en général justiciables ni d’une agentivité totale ni d’une domination implacable, mais situées sur un continuum entre ces deux pôles. Ainsi, objectiver de près une situation en apparence pétrie de domination permet aussi d’y déceler toutes les formes de libertés et de résistances qui s’y nichent. Identifier les espaces de changement et se demander pourquoi il y a mouvement, maintien de soi, résistance, plutôt qu’immobilisation, exit ou renoncement, permet de ne pas sous-estimer la résistance des subalternes ou de celles et ceux que l’on pense comme tel·le·s. D’une façon plus large, cela conduit à distinguer avec nuance la « défaite politique » qui peut structurer la vie politique dans nos États contemporains (victoires de l’extrême droite dans différents pays, de l’Inde à l’Argentine en passant par l’Europe ; l’autoritarisme et les glissements dans l’illibéralisme de certains gouvernements européens ; etc.) des « victoires anthropologiques » qui rythment la vie sociale (aspirations au progressisme sur des questions de genre, décoloniales, d’exigence démocratique, etc.) (El Miri, 2022). Ces victoires peuvent être ainsi qualifiées en raison de leur caractère largement partagé par des individus au regard des situations historiques antérieures, même si elles sont corrélatives des vagues réactionnaires et d’importants modes de défense conservateurs. Il s’agit, en d’autres termes, de considérer celles et ceux que nous rencontrons comme des Sujets sans réduire leur condition au seul statut de victime de certains processus ou conditions historiques, sociales, administratives, d’emploi, etc.
3.3 Tracer la route entre ici et là-bas : saisir la trace des imaginaires, aspirations et anticipations
À partir de cette même posture — l’attention aux subjectivités —, la formulation des projections personnelles est importante parce qu’elle constitue en soi un acte langagier suggérant de nouvelles réalités, même en creux et de façon imaginaire dans un premier temps. Formuler le possible, c’est bâtir des outils de projection dans une réalité alternative, ouvrir des chemins vers ce qu’il est souhaitable et faisable : ni potentialité (chose en puissance) ni possibilité déjà advenue, la formulation d’un possible est synonyme de traces utopiques déjà contenues dans le réel d’une part, et elle détermine aussi les actions à choisir dans le présent pour que d’autres se réalisent d’autre part (Guéguen et Jeanpierre, 2022a, p. 102). L’imagination (d’autre chose), l’aspiration (à la « vie bonne ») et la formulation des anticipations sont en fait constitutives de ce qu’A. Appadurai appelle le futur, et leur mise en relation permet de dessiner un chemin entre « maintenant et plus tard » et « ici et là-bas » (Appadurai, 2013). Cette dimension générative de l’utopie est, par exemple, au coeur de travaux de l’École de Francfort où l’espérance devient un mouvement en avant (Bloch, 1976), une véritable pratique sociale justiciable de méthodes ethnographiques capables de saisir les traces et indices de ces projections dans l’avenir (Bajard et El Miri, 2024). À l’instar de la pédagogie de l’opprimé proposée par P. Freire, qui s’inspire de cette conception blochienne du futur, c’est l’utopie en tant que transformation des êtres qui devient observable : ni espace politique établi ni représentation seulement idéelle, l’utopie est une mise en mouvement faite de la « dénonciation » (denuncio) d’une réalité déshumanisante et de « l’annonce » (anuncio) d’une réalité dans laquelle l’être humain sera plus qu’il n’est à présent (Freire, 2010, p. 84)[27]. Cette dimension générative existe aussi dans les travaux contemporains, où une dimension politique imprègne les pratiques utopiques, « non pas en tant que praxis institutionnalisée, mais comme formation émergente et générative qui affecte l’“être” des personnes qui y participent » (Blanes et Bertelsen, 2021, p. 14)[28]. En bref, la formulation des projections est une véritable source de mise en mouvement dans le présent et elle peut se déployer aussi bien par des méthodes et des épistémologies « impliquantes » que dans des formes plus classiques de méthodes qualitatives et d’épistémologies « impliquées » : en particulier, l’entretien ou l’ethnographie permettent d’être à l’écoute de ces possibilités formulées par les enquêté·e·s, même sous des formes balbutiantes ou quasi silencieuses. De même, la faible directivité en entretien permet à l’enquêteur·rice d’aider l’enquêté·e à « sortir de lui[·elle]-même » (Bourdieu, 1993) et à formuler des énoncés qui n’avaient pas toujours été élaborés dans un récit antérieur.
3.4 Maintenir vivantes les alternatives par leur récit
La pratique de la recherche revient parfois à désirer regarder les indésiré·e·s. Sans illusions sur les changements produits structurellement ni aveuglement quant au risque de voyeurisme lorsque sont en jeu des populations qui n’ont pas demandé à faire de la recherche avec nous, il semble important de s’arrêter — à la fois physiquement et cognitivement — sur certains groupes et espaces sociaux. Non pas par charité, comme on le ferait sur des « indésirables », ni par intérêt sous prétexte que le·la chercheur·se vit aussi de ses objets de recherche, mais par éthique de reconnaissance de ces « indésirés ». D’ailleurs, le·la sociologue qui, à la façon du·de la psychologue ou du·de la conteur·se, prend acte des récits, offre ce faisant un support de transaction pouvant inciter l’enquêté·e à parler : l’officialisation de sa voix par l’inscription de celle-ci dans une recherche scientifique. Que les enquêté·e·s prennent ou non part à l’écriture scientifique dans des formes de co-recherche ou non, la dimension narrative des sciences sociales prend alors toute son importance, en ce qu’elle permet de préserver autant que possible l’expérience singulière des enquêté·e·s et de ne pas tomber dans une forme de désinterlocution (Chauvier, 2017). La parole vivante et le récit constituent des modes de survivance de la pensée libre, des contre-récits, des subjectivités (Gori, 2013) et l’enquête en sciences sociales en constitue dès lors l’un des véhicules.
3.5 Documenter et unifier des expériences de manière cumulative
Documenter des expériences singulières, ce que font en particulier les méthodes qualitatives, ce n’est pas nécessairement tomber dans l’hyperparticularisme, y compris lorsqu’il s’agit d’expériences sociales interstitielles et qui n’occupent pas le devant de la scène. C’est se donner la possibilité d’en constituer une mémoire sociale en collectant les traces et déroulés de leurs pratiques ; c’est également permettre d’en faire une histoire globale en établissant des connexions entre elles et en en identifiant des traits communs par-delà les apparentes différences ; enfin, c’est autoriser des transmissions de pratiques d’une organisation à l’autre et une réflexivité collective, forger une « culture du précédent »[29]. Les réactions des participant·e·s à nos journées de recherche-action sur la protection sociale en coopératives témoignaient par exemple de la nécessité d’une telle cumulativité de connaissances et de pratiques, renforcée par l’absence de protocole ou de « mode d’emploi » de ces initiatives, encore expérimentales dans l’ESS. Autrement dit, c’est peut-être parce que certaines formes sociales demeurent singulières, balbutiantes, inachevées, imparfaites ou minoritaires, que leur objectivation par les outils permis par les sciences sociales (entre autres) semble d’autant plus nécessaire : c’est alors qu’elles prennent corps, que leurs traces subsistent ainsi archivées et que cette « culture du précédent » peut prendre consistance.
3.6 Identifier des leviers d’action
L’identification des endroits « nodaux » par lesquels peut se déployer la transformation sociale permet de mettre à l’épreuve la faisabilité de certaines expériences et d’en faire évoluer d’autres. Il s’agit concrètement d’interroger un certain nombre d’éléments clés des groupes, processus ou institutions sociales, sur lesquels les dispositifs méthodologiques à dimension impliquante en particulier font converger l’attention[30]. Par exemple et de manière non exhaustive :
-
La fonction du lieu, du groupe ou de l’institution sociale en question et l’explicitation libre des rôles endossés par chacun·e (une autre déclinaison de la question fondamentale « Qu’est-ce qu’on fout là ? » ou de « l’objet » du collectif)[31].
-
L’argent : par qui est-il versé, avec quelles contreparties, quelles formes de redistribution, géré par qui, et selon quels principes ?
-
Les frontières spatiales et sociales du groupe, soit les droits d’entrée : qui peut en faire partie ou pas, avec quel degré d’ouverture sur l’extérieur, et avec quels risques de dissolution ou d’effritement ?
-
La distribution spatiale et les rapports de pouvoir : comment s’agence l’espace, qui occupe quelle place (endroit, surface, etc.) et comment cela a-t-il été décidé ?
-
Les modes de décisions des actions individuelles ou collectives : quel degré de contrainte et de formalisation de ces décisions, quelles modalités de délibération, etc. ?
Les réflexions déployées par les acteur·rice·s sur ces différents éléments couvrent alors de nombreuses dimensions constitutives de l’ordre social, par-delà les règles établies ou les cadres formels : l’ordinaire (versus les grands rituels et événements professionnels), l’informel et le travail réel (versus les normes formelles et édictées), le hors-travail et le travail non rémunéré (versus la sphère strictement professionnelle et le travail bénévole/domestique, etc.), etc.
3.7 Démocratiser les possibles
La prolongation du dialogue avec les enquêté·e·s dans des formes de co-recherche permet de produire un dernier type de connaissances, non soumis au filtre cognitif du·de la chercheur·se. L’activité de recherche permet alors de co-élaborer des leviers intellectuels et politiques avec une pluralité d’acteur·rice·s, d’ouvrir des brèches et d’envisager d’autres voies possibles en termes de savoirs théoriques, ainsi diversifiés dans leurs épistémologies et conditions de production, historiquement eurocentrée et masculine (cf : supra). Cette idée de « démocratisation de la connaissance » constitue une réponse aux demandes de « justice épistémique » ou de « justice cognitive » (Godrie et al., 2022, p. 12). Cela suppose bien entendu d’accepter que l’élaboration du savoir ne se produise pas seulement dans l’espace scientifique, mais aussi à l’échelle ordinaire des acteur·rice·s. Elle implique également, de la part des chercheur·se·s, une capacité de réflexivité et d’évaluation critique des effets de leur activité, en termes de réduction (ou non) de ces injustices épistémiques[32]. Cette démultiplication des points de vue et cette démocratisation des possibles permettent de rompre avec un réalisme centripète qui code le réel selon des critères d’énonciation établis depuis une position académique. Elle s’écarte aussi, et c’est l’un de ses buts premiers, des critères de faisabilité établis depuis les positions politiques dominantes. Dans le même temps, cela suppose une vigilance à l’égard du potentiel brouillage des frontières entre chercheur·se et militant·e, notamment grâce à la mise en oeuvre d’une épistémologie « impliquée » rigoureuse. De ce point de vue, nos positions convergent avec les recherches participatives radicales qui prônent l’élaboration de nouveaux critères de scientificité fondés non pas sur des critères de validité propres au paradigme positiviste et aux méthodes hypothético-déductives, mais aux critères de rigueur rattachés au courant interprétatif en sciences sociales, dans lequel nous nous inscrivons[33].
conclusion
La sociologie est traversée et structurée par deux polarités : une sociologie « expérimentale » qui se rapprocherait ainsi de la science pour la science et une sociologie « sociale » qui tenterait de contribuer aux luttes sociales (Lahire, 2004). On retrouve ces écarts dans différents « styles » de sociologie : sociologie publique, policy sociology, sociologie professionnelle, sociologie critique (Burawoy, 2006). Il s’agit là d’idéaltypes construits sur le degré de réflexivité ou, au contraire, d’utilité instrumentale du savoir, ainsi que sur les publics (extra-académique ou académique) à qui celui-ci est destiné. La réalité sociale est donc nécessairement plus complexe, puisque les pratiques de recherche se déploient généralement selon plusieurs styles. Comme indiqué en introduction, il nous semble d’abord essentiel de prendre acte des apports de la sociologie « critique » et de sa dimension réflexive à la sociologie « professionnelle », à forte ambition théorique et scientifique. De manière plus singulière, au cours de notre expérience de recherche participative, notre posture rejoignait par exemple celle d’autres chercheur·se·s réfutant l’idée que la seule légitimité de la recherche participative — sociologie publique donc selon ces catégorisations — consisterait « en son rapport à l’action et au champ politique sans que soient envisagés ses apports méthodologiques et conceptuels » (Bacqué et Demoulin, 2022, p. 3). De même, nous ne souhaitions pas gommer ou atténuer notre pratique de sociologie « professionnelle », assumée en tant que chercheuse en poste au sein d’un institut de recherche national, mais au contraire la mettre en discussion (cf : encadré supra). Pour toutes ces raisons, nous rejoignons les travaux montrant l’importance de travailler les possibilités de circulations entre ces « styles » : on peut alors, par exemple, reconnaître l’apport scientifique des recherches participatives ainsi que les véritables compétences requises pour « apprendre à voir d’en bas » (Bacqué et Demoulin, 2022, reprenant une expression de Donna Haraway, p. 4-5).
Ainsi, cet article n’avait pas pour ambition la classification des modes de production de connaissances comme l’on chercherait à avoir une armoire de dossiers bien ordonnés, mais plutôt à approfondir sous un jour plus mobilisateur les constats désenchanteurs auxquels mène souvent le savoir critique. Il ne s’agissait pas non plus d’en conclure que toutes ces formes d’épistémologies impliquantes, telle la recherche participative, doivent nécessairement être mises en oeuvre. En revanche, il nous semble utile d’interroger nos pratiques de recherche à l’aune de leur caractère émancipateur sous une forme très concrète, c’est-à-dire à l’aide des postures épistémologiques établies dans la relation avec nos objets, elles-mêmes traduites en pratiques de recherche. Cette cartographie permet surtout de penser la manière dont les déclinaisons diverses de la sociologie publique notamment — soit « amener la sociologie à entrer en conversation avec des publics, c’est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes engagés dans des conversations » (Burawoy, 2006) — irriguent nos pratiques.
Car en réalité, la vie sociale du savoir lui donne un statut de pratique sociale objectivable plus que celui de vérité sur le monde. Les sciences se font et se vivent en partie indépendamment du·de la seul·e chercheur·se : l’orientation de l’enquête au gré des relations changeantes avec les enquêté·e·s, la pratique de l’écriture et des modes de narration, les restitutions auprès de ces enquêté·e·s ou d’un public non académique ou, encore, les appropriations diverses que fait un lectorat du travail de recherche en sont des illustrations non exhaustives. C’est pourquoi des enquêtes sur ce que nos travaux ont produit, une « sociologie de l’usage social de la sociologie » (Hirschhorn, 2014, p. 229‑230) afin de mesurer à quel point ceux-ci auront été vecteurs de transformation, constituent par exemple un programme de recherche intéressant. Si les enquêtes sur les effets sociaux des sciences sociales sont encore peu développées, les expériences de recherches participatives suggèrent qu’il y a là matière à opérer des tentatives : sans nous situer de manière figée dans l’une ou l’autre des catégories (sociologie publique/professionnelle/critique/policy sociology), le regard rétrospectif porté sur nos expériences de recherches montre plutôt l’intérêt de circuler entre ces domaines. Car, quelle que soit la position adoptée sur le continuum entre objectivation et participation, les différents types de savoirs qui découlent des postures épistémologiques exposées ici illustrent l’idée que c’est finalement dans la réalité des espérances, certes, mais aussi dans la critique des utopies — de leurs ambiguïtés, limites, inachèvements, etc. — que se logent des voies possibles des sciences sociales critiques. Nous rejoignons en effet le projet intellectuel consistant à faire le « pari » (Guéguen et Jeanpierre, 2022a, p. 11) qu’une sociologie des possibles — complémentaire ou alternative à celle des régularités — doit permettre de faire vivre des sciences sociales critiques, par ailleurs menacées dans un contexte politique et épistémique de « critique de la critique et des sciences » (Guéguen et Jeanpierre, 2022b, p. 3). La démythification de certains mondes peut ainsi, paradoxalement, devenir mobilisatrice si l’on prend la peine de la compléter et de la prolonger par d’autres regards. Ainsi, loin d’envisager la pensée comme une seule idée sans effets performatifs, c’est bien une conception de l’activité scientifique comme pratique sociale qui ouvre les possibles, sans renoncer à l’exigence de scientificité que nous défendons ici : de la même manière que les anticipations de l’avenir et les espérances ne sont pas uniquement des abstractions mais bien des actes, les épistémologies choisies comme les méthodes d’enquête ne constituent pas seulement des dispositifs et compétences techniques, mais bien des manières d’engager un rapport éthique et politique au monde que nous étudions. Dès lors, attribuer à l’énonciation et à l’écriture scientifiques des effets réels, casser la frontière entre terrain/acteur·rice·s et écriture/chercheur·se, réhabiliter les enquêté·e·s comme Sujets sans les réduire à leur condition, oeuvrer à la formulation de possibles, etc., en sont autant d’illustrations non exhaustives et demandant à être démultipliées[34].
Appendices
Notes
-
[1]
L’astrophysicien A. Barreau plaide pour une « poétisation » de la science à même de produire un rapport au matériau scientifique beaucoup plus ouvert aux étrangetés de l’univers comme à ses propres contradictions et incohérences, et assumant son pouvoir de redéfinition du monde (Barreau, 2023, p. 126).
-
[2]
La sociologie critique bourdieusienne, de même que les studies portées sur l’étude des individus minorisés (gender studies, post-colonial studies, cultural studies…), ou encore la critique pragmatiste (L. Boltanski) en sont des illustrations contemporaines importantes, à la suite de bien d’autres penseurs tels N. Élias, pour qui l’une des tâches du sociologue consistait à débusquer les mythes sur lesquels sont bâtis les mondes sociaux. D’une autre façon, les premiers écrits sociologiques étaient déjà empreints d’une visée transformatrice du social et plus précisément, de résolution de certains problèmes sociaux, dont les travaux de Durkheim et leur forte dimension politique sont une belle illustration.
-
[3]
« scholars promote social change and engage themselves as a “maker of the future” ».
-
[4]
La réflexivité de la discipline est à la fois « épistémologique (sur les principes et les méthodes), sociologique (sur la position sociale du·de la chercheur·se) et politique (sur la valeur sociale de ses choix d’objet et les conséquences politiques de ses prises de position) » (Renault, 2012).
-
[5]
À rebours de la conception boudonienne de la sociologie, qui oppose la fonction cognitive, gage de scientificité, aux autres fonctions « littéraire », d’« expertise » et « critique » (Boudon, 2010, cité dans De Munck, 2011, p. 226).
-
[6]
C’est pourquoi l’écriture sociologique s’accompagne généralement d’une réflexion sur la formulation de ces dimensions critiques ainsi que sur la sélection de ce qui peut figurer dans une production écrite finale, afin d’éviter certains effets négatifs sur les personnes auprès de qui nous avons enquêté.
-
[7]
La conscientisation de ces écueils est donc intrinsèque à une conception éthique du terrain, conçu non comme un territoire « sur » lequel on va et duquel on « sort » comme on le ferait sur un « champ de pommes de terre » (Laplantine, 2010) pour recueillir des informations, mais bien comme un espace relationnel avec des personnes sensibles, dotées d’affects, de jugements, d’objectifs, d’émotions. Il s’agit dès lors de prendre en compte ces paramètres caractéristiques de sujets en même temps, voire avant, de considérer qu’il ne s’agit que « d’enquêté·e·s » (Bajard, 2023b).
-
[8]
Cette interrogation basique, à la fois éthique — que faire ? — et épistémologique — à travers quel champ ou quelle modalité d’action ? —, posée par plusieurs fondateurs·rice·s de la psychothérapie institutionnelle, est devenue une question clé pour penser les pratiques, sans jamais les considérer comme allant de soi. Elle est très utilisée aujourd’hui au sein des espaces se revendiquant des approches collectives en psychanalyse, ou dans l’éducation populaire.
-
[9]
Les utopies réelles étant bien des pratiques sociales et non les seules images idéales d’un horizon en attente (Guéguen et Jeanpierre, 2022b).
-
[10]
Ce texte est donc constitué d’analyses rétrospectives et réflexives sur des travaux antérieurs dans lesquels j’étaye des résultats énoncés ici. C’est pourquoi j’y fais régulièrement référence sans développer à nouveau ces démonstrations, afin de consacrer uniquement ce texte aux réflexions épistémologiques que j’en tire.
-
[11]
Je n’évoquerai pas ici une autre forme de désenchantement potentiel chez les enquêté·e·s, lié à la déception produite par la personne/personnalité du·de la sociologue (déception découlant elle-même souvent de la confusion entre la représentation du travail sociologique et le·la sociologue en tant qu’individu).
-
[12]
Évidemment, c’est bien au regard de la problématique de la démythification que nous exposons ces aspects-là, mais il est important de souligner que cet écart entre le travail prescrit et le réel ou encore, entre la loi et les cadres formels et leur application, produit également des adaptations vertueuses, inventives, stratégiques et réflexives au sein de ces organisations (Bajard et Leclercq, 2021).
-
[13]
En raison de ces dilemmes moraux, nous avons dans nos publications porté une grande attention à la formulation de ces dimensions critiques ou sélectionné au cas par cas les éléments — légal ou illégal, risqué ou non en termes d’exposition de certain·e·s acteur·rice·s — pouvant figurer dans nos écrits. Et ce, alors même que nos terrains ne mettaient pas en jeu des individus encourant des peines d’emprisonnement ou des risques vitaux, comme ce peut être le cas lors d’une enquête impliquant des publics particulièrement vulnérabilisés.
-
[14]
À cette vigilance épistémologique s’ajoutent d’autres sources de scientificités : l’aspiration à la théorisation dans la description et l’explication, ainsi que l’inscription du travail en sciences sociales dans une communauté scientifique qui caractérise son régime de validation (De Munck, 2011).
-
[15]
Pour la bibliographie associée à ces postures, voir l’article de 2013 précité.
-
[16]
C’est d’ailleurs à cette démarche que renvoient certaines utilisations de l’épithète « impliqué » dans la littérature en sciences sociales, en tant que la « reconnaissance et l’exploitation fructueuse que fait l’anthropologue de sa présence dans la fabrication de son enquête » (É. Chauvier, 2020).
-
[17]
Reprenant Donna Haraway, Isabelle Clair mentionne : « Une nausée et des maux d’estomac persistants, voilà ce qui nous donne un sens aigu de ce qu’est une connaissance située » (Haraway, 2007, p. 327, dans Clair, 2022). Reprenant plus loin Joan Scott, elle rappelle que l’expérience ne vaut cependant pas une preuve : l’expérience devient « ce que nous cherchons à comprendre, ce sur quoi du savoir sera produit » (Scott, 2009 [1992], p. 80-81, dans Clair, 2022).
-
[18]
Il peut être intéressant d’appliquer un exercice simple à partir de nos pratiques de recherche : comptabiliser les fois où, lors de l’expression formelle ou informelle de résultats issus du travail d’enquête, l’on a également émis des opinions sur les formes que pourraient prendre les actions de nos interlocuteurs. De même, chacun·e pourra s’exercer à recenser les réponses apportées à la question classique que posent de nombreux·ses enquêté·e·s : « À ton avis, que devrait-on faire ? »
-
[19]
En décalage avec l’intervention sociale dans ses conceptions les plus descendantes et verticales, certain·e·s tenant·e·s de l’éducation populaire développent ainsi, dans leurs principes philosophiques comme dans leurs méthodes, l’idée que « ce que l’on ne fait pas avec les gens, on le fait contre eux ».
-
[20]
« the elaboration of both the empirical material and its theoretical interpretation as an interactive process between the ethnographer and his interlocutors ».
-
[21]
Le terme renvoie à un vaste ensemble de pratiques décrites comme de la sociologie publique, recherche-action, recherche-action participative (RAP), recherche participative (RP), recherche partenariale et collaborative. Très variées sur le plan épistémologique, elles vont de formes institutionnalisées de recherches financées par des organismes publics, privés ou des institutions internationales visant à impliquer des publics (par simple consultation, proposition ou délibération) en passant par l’intervention et le travail social, jusqu’à des formes autogérées issues des mouvements sociaux et communautaires, et fondées sur une optique de transformation sociale et des épistémologies radicales décoloniales, féministes, etc. Elles ont également connu des modes de développement différencié depuis leur émergence dans les années 1970, notamment entre les espaces Amérique latine, Québec, France. Sur les recherches partenariales et collaboratives, voir par exemple Tremblay et Gillet, 2017 ; sur le second pôle, fondé sur les épistémologies radicales de ce continuum, voir par exemple Godrie et al., 2022.
-
[22]
Technique de pensée collective co-fondée par J. Dumazedier, sociologue des loisirs. Cette technique permet de déplier les plis d’une problématique et de la pensée des différents individus composant un collectif. Elle croise l’analyse intellectuelle et les pratiques de coopération, à l’instar des outils de l’éducation populaire, auxquelles elle se rattache. Formation effectuée avec l’organisme « l’Escargot migrateur » en 2021.
-
[23]
Dispositif d’intervention sociologique issue de l’analyse institutionnelle, de la psychanalyse et de l’autogestion (sur certains de ces courants et leur mise en application, voir par exemple Schaepelynck, 2018, ainsi que Gabarron-Garcia, 2021), basé sur une analyse du groupe par lui-même aidé d’intervenant·e·s extérieur·e·s (les socianalystes). Elle permet de porter un regard sur le groupe en tant qu’institution plutôt que sur les personnalités et leurs psychologies. Formation organisée par l’organisme « Pivoine » en 2022 et animée par C. Gillon et P. Ville, considérés comme des figures fondatrices.
-
[24]
Ces techniques reposent pour la plupart sur l’hybridation des « savoirs froids » (académiques) et des « savoirs chauds » (expérientiels). Formation effectuée avec les organismes Le point de croix et La Mèche en 2022.
-
[25]
Au sein de la structure [Anonymisation], qui développe des techniques d’animation et de coopération de groupes et de mise en forme des savoirs académiques sous forme de conférences gesticulées.
-
[26]
Il s’agit d’une technique de lecture collective issue des cercles ouvriers, facilitant l’appropriation de textes académiques ou difficiles d’accès théoriquement par la mutualisation du travail et la mise en discussion des idées.
-
[27]
Notre traduction : « unidade inquebrantavel entre […] a denuncia de uma realidade desumanizante e anuncio de uma realidade em que os homens posam ser mais ».
-
[28]
Notre traduction : « anthropology of utopian confluences, where the political appears not as institutionalised praxis but as an emergent and generative formation that affects the ‘‘being-ness’’ of the selves that take part in it » (p. 14).
-
[29]
D. Vercauteren parle par exemple de créer « une mosaïque de situations-problèmes », visant à produire une analyse reposant non pas sur l’exhaustivité mais sur la « culture des précédents » : il s’agit alors d’« évaluer la différence qualitative et intensive de nos modes d’existence en les rapportant aux situations-problèmes qui les ont précédés » (Vercauteren, 2018, p. 32).
-
[30]
Sur ces aspects appliqués à des tiers-lieux, voir par exemple Lallement, 2015.
-
[31]
La « fonction » ou « l’objet » sont au coeur de l’idée de « problémer » au sein d’un groupe, c’est-à-dire de fabriquer ensemble les enjeux et les solutions qui se dégagent de ce processus (Vercauteren, 2018, p. 145). Elle peut aussi renvoyer à l’idée « d’analyseur » en socianalyse, c’est-à-dire une dimension potentiellement clivante au sein d’un groupe social, tout particulièrement produite ou mise en lumière dans les situations de crise ou de dérangement. L’analyseur est fondamental, car il est une voie d’accès au groupe et à sa compréhension (Gilon et Ville, 2018, p. 96 en particulier).
-
[32]
Voir par exemple la grille d’autoévaluation, à destination des universitaires et de ceux et celles prenant part aux recherches participatives sous l’angle des injustices épistémiques, créée par Godrie et al., 2020. Cet outil méthodologique est mis à leur disposition sous licence Creative Commons CC BY 4.0 (donc partageable et modifiable) en appendice de l’article.
-
[33]
Pour un état de l’art des différents travaux de recherches participatives radicales qui ont proposé de repenser les critères de scientificité, voir Godrie et al., 2022, p. 19-22 en particulier.
-
[34]
Je remercie Maya Leclercq, anthropologue et fondatrice de l’atelier de sciences sociales appliquées Sociotopie, avec qui j’ai mené certaines parties des enquêtes qualitatives afférentes aux coopératives et, en particulier, l’expérience de recherche participative exposée dans cet article. J’ai pu partager avec elle mes réflexions épistémologiques, méthodologiques et éthiques tout au long de notre fructueuse et amicale collaboration.
Je remercie également Mustapha El Miri pour les nombreux échanges intellectuels qui ont, en particulier, alimenté certaines perspectives développées dans la dernière partie de cet article portant sur les « raisons d’être critiques » et leurs vertus pour l’espérance.
Enfin, j’adresse également mes remerciements aux évaluateurs·rices de la revue, dont le regard à la fois rigoureux et constructif a permis l’approfondissement et le renforcement de certains points de ce travail.
Bibliographie
- Appadurai, A. (2013). The Future as Cultural Fact : Essays on the Global Condition. Verso Books.
- Bachelard, G. (1967). La formation de l’esprit scientifique (5e édition). Librairie philosophique J. Vrin.
- Bacqué, M.-H. et Demoulin, J. (2022). La recherche au défi de la participation. Sociologie,13(3). https://journals.openedition.org/sociologie/10549
- Bajard, F. (2013). Enquêter en milieu familier. Comment jouer du rapport de filiation avec le terrain ? Genèses — Sciences sociales et Histoire, (90), 7-24.
- Bajard, F. (2018). Les céramistes d’art en France. Sens du travail et styles de vie. Presses Universitaires de Rennes, Collection Le Sens social. [hal-01806453]
- Bajard, F. (2021). De l’atelier à la cuisine chez les céramistes : arrangements de couple et inégalités de genre dans un métier indépendant « égalitariste ». Travail et Emploi, 2021, (161), 61-92. [hal-03209513]
- Bajard, F. (2023a). « Être sympa », la bonne morale professionnelle des céramistes d’art : informalité des relations et constitution du groupe. Dans C. Comer, B. Lechaux et P. Rouxel (dir.), Le travail éthique dans les professions indépendantes (p. 19-50). Presses Universitaires de Vincennes. [hal-04106820]
- Bajard, F. (2023b). Ceux que nous appelons « enquêtés » : construire, vivre et analyser le terrain comme tissu relationnel. Journées d’études internationales — MIJMA La Migration Internationale des Jeunes et Mineurs Africains vers l’Europe, Mohammedia, Morocco. [hal-04081275]
- Bajard, F. et El Miri, M. (2024, mai). Enquêter des traces, diversifier les objets, réviser les catégories ? Séminaire Utopies et possibles insoupçonnés, Aix-en-provence, France. [hal-04437678]
- Bajard, F. et Leclercq, M. (2021). Les Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) aux prises avec les enjeux de protection sociale. Propositions pour un modèle d’analyse qualitatif applicable aux zones grises de l’emploi. Sociotopie ; LEST CNRS UMR 7317. [hal-03453700]
- Bajard, F., Leclercq, M. et van Melle, L. (2022). « Esquisses et trouvailles » — Livret conclusif des journées de recherche-action CAE et protection sociale. [hal-03550759]
- Barreau, A. (2023). L’Hypothèse K. La science face à la catastrophe écologique. Grasset.
- Blanes, R. L. et Bertelsen, B. E. (2021). Utopian confluences : Anthropological mappings of generative politics. Social Anthropology, 29(1), 5‑17. https://doi.org/10.1111/1469-8676.13003
- Bloch, E. (1976). Le principe espérance : Tome 1. Gallimard.
- Bourdieu, P. (dir.) (1993). Comprendre. Dans La misère du monde (p. 1389‑1447). Seuil.
- Bourdieu, P. (2003). L’observation participante. Actes de la recherche en sciences sociales, 150(5), 43‑58.
- Burawoy, M. (2006). Pour la sociologie publique. Socio-logos. Revue de l’association française de sociologie, 1. https://doi.org/10.4000/socio-logos.11
- Chauvier, É. (2017). Anthropologie de l’ordinaire. Une conversion du regard. Éditions Anacharsi. www.editions-anacharsis.com/Anthropologie-de-l-ordinaire
- Chauvier, É. (2020). « L’anthropologie impliquée ». Dans B. Traimond (dir.), L’anthropologie appliquée aujourd’hui (p. 295‑302). Presses universitaires de Bordeaux. http://books.openedition.org/pub/30098
- Clair, I. (2022). Nos objets et nous-mêmes : Connaissance biographique et réflexivité méthodologique. Sociologie,13(3). https://journals.openedition.org/sociologie/10578
- De Munck, J. (2011). Les trois dimensions de la sociologie critique. SociologieS. https://doi.org/10.4000/sociologies.3576
- Élias, N. (1991). La société des individus. Fayard.
- El Miri, M. (2022, 21 décembre). La migration internationale des jeunes, un chemin heurté vers l’émancipation. Conférence au Conseil de la communauté marocaine à l’étranger [CCME].
- Fassin, D. (2009). Une science sociale critique peut-elle être utile ? Tracés. Revue de Sciences humaines,(9), 199-211. https://doi.org/10.4000/traces.4465
- Fassin, D. (2017). The endurance of critique. Anthropological Theory, 17(1), 4‑29. https://doi.org/10.1177/1463499616688157
- Freire, P. (2010). Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra.
- Gabarron-Garcia, F. (2021). Histoire populaire de la psychanalyse. La Fabrique.
- Gilon, C. et Ville, P. (2018). Le manuel de socianalyse. Réveiller les loups.
- Godrie, B., Boucher, M., Bissonnette, S., Chaput, P., Flores, J., Dupéré, S., Gélineau, L., Piron, F. et Bandini, A. (2020). Injustices épistémiques et recherche participative : Un agenda de recherche à la croisée de l’université et des communautés. Gateways : International Journal of Community Research and Engagement, 13(1). https://doi.org/10.5130/ijcre.v13i1.7110
- Godrie, B., Juan, M. et Carrel, M. (2022). Recherches participatives et épistémologies radicales : Un état des lieux. Participations, 32(1), 11‑50. https://doi.org/10.3917/parti.032.0011
- Gori, R. (2013). La dignité de penser. Actes Sud.
- Granjon, F. (2012). La critique est-elle indigne de la sociologie ? Sociologie, 3(1), 75‑86. https://doi.org/10.3917/socio.031.0075
- Granjon, F. (2021). Savoirs nomologiques versus connaissances critiques. En écho au « Manifeste pour la science sociale » de Bernard Lahire. Savoir/Agir, 58(4), 67‑73. https://doi.org/10.3917/sava.058.0069
- Guéguen, H. et Jeanpierre, L. (2022a). La perspective du possible ; Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire. La Découverte.
- Guéguen, H. et Jeanpierre, L. (2022b). Une critique alternative (en sciences sociales) : enquêter sur le front des possibles. Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée politique, 27. https://doi.org/10.4000/asterion.8553
- Hamel, J. (2015). Brèves remarques sur deux manières de concevoir l’objectivation et l’objectivité. L’objectivation participante (Bourdieu) et la standpoint theory (Haraway). Recherches qualitatives, 1(34), 157‑172.
- Harding, S. (1984). Standpoint Theory as a site of political, philosophic et scientific debate. Dans S. Harding (dir.), The feminist standpoint theory reader : Intellectual and political controversies (p. 1‑15). Routledge.
- Hirschhorn, M. (2014). Est-il vraiment utile de s’interroger sur l’utilité de la sociologie ? Plus de dix ans de débats. Revue européenne des sciences sociales. European Journal of Social Sciences, 52(2). https://doi.org/10.4000/ress.2891
- Hughes, E. C. (1996). Le regard sociologique : Essais choisis. EHESS.
- Kalinowski, I. (2005). Leçons wébériennes sur la science et la propagande. Agone.
- Lahire, B. (dir.) (2004). Utilité : Entre sociologie expérimentale et sociologie sociale. Dans À quoi sert la sociologie ? (p. 43‑66). La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.lahir.2004.01.0043
- Lallement, M. (2015). L’âge du faire : Hacking, travail, anarchie. Seuil.
- Laplantine, F. (2010). La description ethnographique. Armand Colin.
- Olivier de Sardan, J.-P. (2004). La rigueur du qualitatif. L’anthropologie comme science empirique. Espace Temps, 84-86, 38-50.
- Renault, E. (2012). De la sociologie critique à la théorie critique ? Sociologie, 3(1), 87‑89. https://doi.org/10.3917/socio.031.0087
- Rozencwajg, R. (2021). Le « travail utopique » est-il sexiste ? Les collectifs écologiques et égalitaires à l’épreuve de la division sexuelle du travail. Civilisations. Revue internationale d’anthropologie et de sciences humaines, 70. https://doi.org/10.4000/civilisations.6783
- Sallustio, M. (2021). Collectifs utopiques en milieu rural—Introduction. Civilisations, 70(1), 9‑26. https://doi.org/10.4000/civilisations.6603
- Schaepelynck, V. (2018). L’Institution renversée. Folie, analyse institutionnelle et champ social. Eterotopia.
- Suckert, L. (2022). Back to the Future. Sociological Perspectives on Expectations, Aspirations and Imagined Futures. European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie, 63(3), 393‑428. https://doi.org/10.1017/S0003975622000339
- Tremblay, D.-G. et Gillet, A. (2017). Les recherches partenariales et collaboratives.Presses universitaires de Rennes et Presses de l’Université du Québec. https://pur-editions.fr/product/7906/les-recherches-partenariales-et-collaboratives
- Vercauteren, D. (2018). Micropolitiques des groupes, pour une écologie des pratiques collectives. Amsterdam.
- Weber, M. (2003). Économie et société. 1, Les catégories de la sociologie. Presses Pocket.
- Wright, E. O. (2017). Utopies réelles. La Découverte.
List of tables
Tableau 1
Synthèse des postures épistémologiques adoptées et leurs outils méthodologiques correspondants