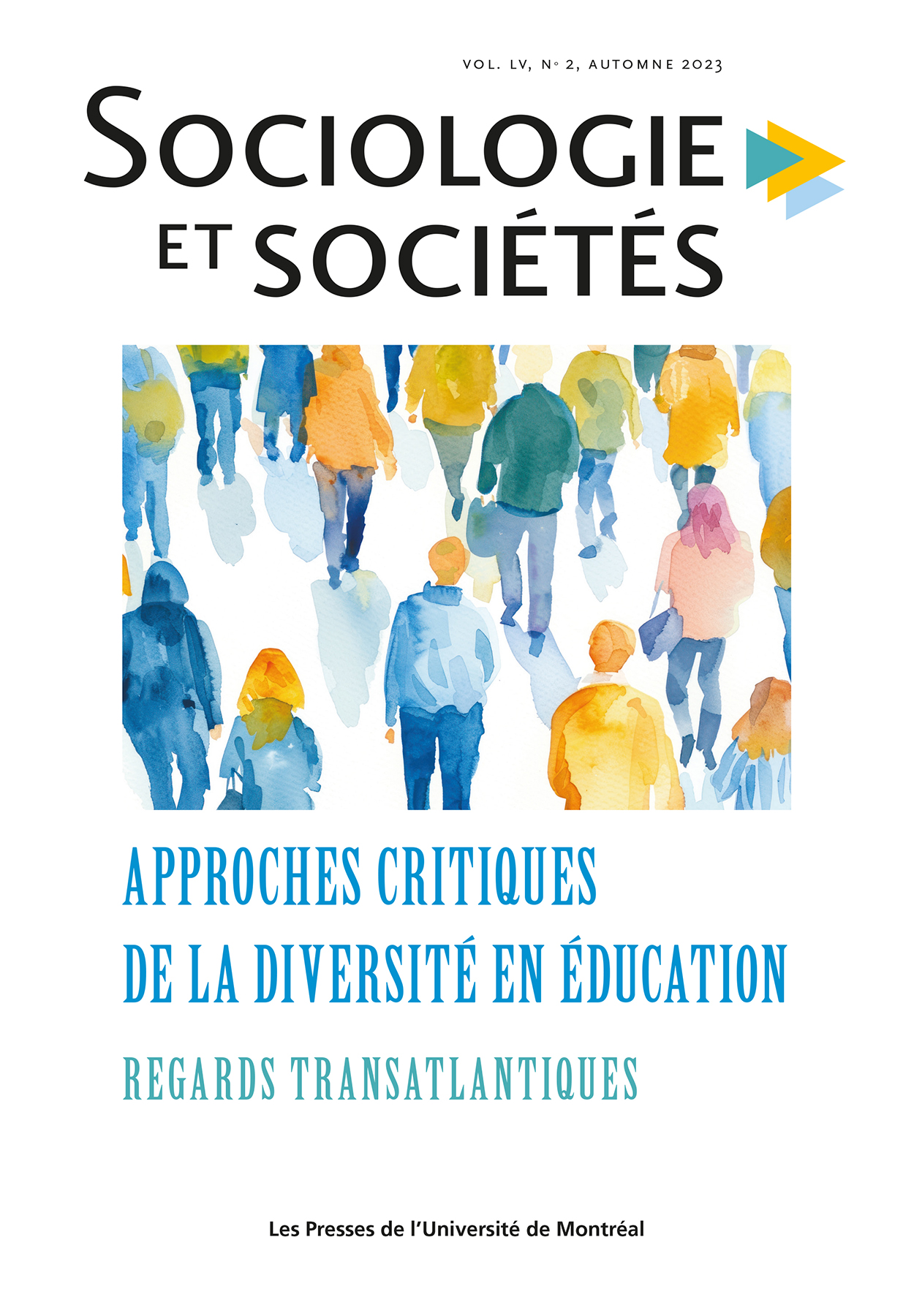Abstracts
Résumé
Le haut niveau sportif produit de multiples rapports au corps. À l’appui d’une enquête par questionnaire (n = 1342) auprès d’individus ayant évolué dans une quarantaine de disciplines, interrogés sur leurs pratiques dans différents domaines (modalités de l’entraînement, alimentation, prise de médicaments, rapport à la douleur, etc.), cet article propose de dégager une typologie des engagements corporels qu’engendre le sport de haut niveau. Se distinguant selon trois dimensions issues d’une ACM (l’autopréservation, l’instrumentalité et la compétition), six profils sont identifiés par une analyse de classification. Plus ou moins proches ou éloignés de l’« habitus du champion », ces profils sont tous compatibles avec une carrière de haut niveau. Une analyse de régression montre que si les caractéristiques de la socialisation sportive, à savoir le type de discipline et l’emprise du dispositif sportif, constituent les facteurs explicatifs les plus prédictifs de l’engagement corporel des athlètes, la part que celui-ci doit aux socialisations antérieures ou parallèles (p. ex. : socialisation familiale, genre, classe) est non négligeable mais plus diffuse.
Mots-clés :
- sport de haut niveau,
- corps,
- socialisation,
- genre,
- origine sociale
Abstract
High-level sports encourage athletes to develop multiple relationships to the body. Using a questionnaire (n = 1342) to survey individuals who have participated in any of forty disciplines about various aspects of their practices (training methods, diet, use of medication, relationship to pain, etc.), this article proposes a typology of bodily commitments that emerge in top-level sports. Distinguished by three dimensions derived from an MCA (self-preservation, instrumentality and competition) a classification analysis was used to identify six profiles. More or less similar to or distant from the ‘champion habitus,’ these profiles are all compatible with a high-level career. A regression analysis shows that, while sports socialization characteristics —i.e., the type of discipline and the influence of the sport system—are the most predictive explanatory factors for athletes’ physical commitment, the share they owe to previous or parallel socializations (e.g., family socialization, gender, class) is non-negligible but more diffuse.
Keywords:
- Top-level sport,
- body,
- socialization,
- gender,
- social origin
Resumen
El deporte de alto rendimiento produce numerosos efectos en el cuerpo. Mediante un cuestionario realizado en el marco de una encuesta (n = 1342) a individuos que han participado en unas cuarenta disciplinas y a quienes se les preguntó sobre sus prácticas en materia de métodos de entrenamiento, alimentación, toma de medicamentos, relación con el dolor, etc., el presente artículo propone identificar una tipología de los compromisos corporales generados por el deporte de alto rendimiento. Con base en tres dimensiones derivadas de un análisis de componentes múltiples (autopreservación, instrumentalidad y competencia), un análisis de clasificación identificó seis perfiles. En mayor o menor grado de proximidad al “habitus del campeón”, todos estos perfiles son compatibles con una carrera de alto rendimiento. Un análisis de regresión muestra que, si bien las características de la socialización deportiva, es decir, el tipo de disciplina y la influencia del sistema deportivo, constituyen los factores más predictivos del compromiso corporal de los atletas, la contribución de las socializaciones anteriores o paralelas (por ejemplo, la socialización familiar, el sexo, la clase social) no es despreciable sino más difusa.
Palabras clave:
- deporte de alto rendimiento,
- cuerpo,
- socialización,
- género,
- origen social
Article body
introduction
L’origine et les trajectoires des sportif·ve·s de haut niveau ont été abordées dans nombre de travaux. Ils ont décrit les effets croisés des appartenances sociales, qu’elles soient de genre (Guérandel et Mardon, 2022), de classe (Bertrand et Rasera, 2019) ou de race (Damont et Pégard, 2017), sur la manière dont les individus entrent dans des carrières sportives de haut niveau, les mènent différentiellement (p. ex. : double formation sportive et scolaire, niveau atteint) et les arrêtent pour des raisons distinctes (p. ex. : blessures, vie familiale). Mais que sait-on vraiment des usages que les sportif·ve·s font de leur corps (p. ex. : gestion des douleurs, pratiques alimentaires, consommation sanitaire) ?
Il existe des recherches sur la « fabrique » des champion·ne·s (Bertrand, 2012 ; Rasera, 2016 ; Wacquant, 1989), autrement dit sur la manière dont les institutions produisent une multitude de corps sportifs. Toutefois, la plupart des travaux s’intéressant aux effets du sport de haut niveau sur les expériences corporelles des athlètes circonscrivent leurs analyses à des domaines précis de pratiques : par exemple la prise de médicaments (Read et al., 2022), le contrôle du poids (Nouiri-Mangold, 2019), la consommation de produits psychoactifs (Leroux, 2002), la sexualité (Sablik et Mennesson, 2008). Les recherches qui examinent l’engagement corporel des sportif·ve·s dans différents domaines sont plus rares. Qui plus est, les travaux s’intéressant aux pratiques corporelles des athlètes de haut niveau optent souvent pour une approche monographique (Pouillaude, 2022 ; Dalgalarrondo, 2015)[1] ou privilégient la comparaison entre deux disciplines (Clément, 2014). Le type de corps considéré comme légitime varie en effet d’un sport à l’autre (Pociello, 1995) ; certains valorisent par exemple la prise de risque (Penin, 2012), d’autres l’optimisation de l’apparence (Pouillaude, 2022). Essentiels pour analyser les spécificités des cultures corporelles de chaque sport, les apports de ces travaux constituent le socle de notre réflexion visant à mettre en regard les pratiques corporelles d’athlètes de divers sports et leurs déterminants.
À l’appui d’une recherche auprès d’ex-pratiquant·e·s ayant évolué dans une quarantaine de disciplines, et focalisée sur leurs habitudes corporelles dans différents domaines (santé, alimentation, sport), cet article propose de dégager une typologie des engagements corporels que produit le sport de haut niveau et d’identifier ses facteurs explicatifs. Enquêter auprès d’ex-sportif·ve·s plutôt qu’auprès de sportif·ve·s en activité constitue une originalité qui s’avère avantageuse. Une telle stratégie permet non seulement d’appréhender l’ensemble de la carrière et d’inclure sa durée dans les analyses, mais aussi de cibler, pour certains thèmes, le sommet de la carrière tout en identifiant l’âge auquel les individus ont atteint ce sommet.
Après avoir proposé une définition de l’engagement corporel adossée à une perspective dispositionnaliste, nous présentons notre typologie. Nos analyses ambitionnent ensuite de déterminer dans quelles mesures l’engagement corporel des sportif·ve·s varie selon les caractéristiques du dispositif sportif (type de discipline, intensité de l’emprise), le genre des pratiquant·e·s, leur origine sociale et leur socialisation familiale au sport. Par ailleurs, les effets produits par certaines imbrications[2] de socialisations sont considérés — p. ex. : être une femme dans un sport masculin, être de milieu populaire au sein d’un dispositif sportif à forte emprise.
1. s’engager dans le sport de haut niveau : le corps en première ligne
1.1 Définir l’engagement corporel
Fréquemment mobilisée en sociologie du sport, la notion d’« engagement » est le plus souvent réduite à la description de son intensité, à la détermination de ses facteurs explicatifs[3] et de sa durée, ou encore à l’étude de son pendant, le « désinvestissement sportif » (Forté, 2018). Le versant corporel de l’engagement sportif est en revanche rarement étudié de manière transversale[4], c’est-à-dire en considérant plusieurs domaines de pratiques tels que l’activité physique, la santé, l’alimentation, etc. Les travaux antérieurs ont cependant relevé avec précision les dispositions particulièrement orientées vers la réussite sportive que les individus souhaitant faire carrière doivent incorporer. Viaud parle d’un « savoir-être corporel » (Viaud, 2008, p. 62) et montre par le truchement de quels processus et sous quelles conditions (mise à distance de la famille, « logique de l’urgence », subordination des médecins du sport aux entraîneur·se·s, etc.) se réalise l’inculcation de cet « habitus du champion » consistant à trouver le meilleur équilibre entre la « sur-utilisation organique nécessaire à la victoire sportive et la préservation fondamentale de [l’]intégrité physique » (Viaud, 2008, p. 58). Bertrand (2012) balise lui aussi les principales injonctions à l’oeuvre dans les dispositifs sportifs : ascétisme, dépassement de soi et écoute corporelle.
En partant de leurs conclusions, nous souhaitons déplacer la focale, en prêtant attention à la variabilité des engagements que produit la « fabrique » des champion·ne·s. Pour ce faire, nous définissons l’engagement corporel comme l’ensemble des représentations, pratiques, savoirs et savoir-faire que les sportif·ve·s mobilisent durant leur carrière en réponse aux attendus du sport de haut niveau : performer sans s’user[5]. L’ambition est de distinguer différents types de mise en jeu des corps, différents non seulement par leur intensité mais aussi par leurs modalités (pouvant s’actualiser différemment selon les domaines de pratique) et les intentions qui les sous-tendent (qui ne se réduisent pas à la simple recherche de l’exploit).
1.2 Aborder l’engagement corporel par les dispositions
Les recherches et textes programmatiques visant à analyser les pratiques sportives comme un révélateur de la variabilité des usages du corps selon les groupes sociaux (Bourdieu, 1979 ; Lahire, 2004 ; Mennesson, 2004) font état de deux perspectives complémentaires : la première s’intéressant à l’influence des dispositions acquises antérieurement (p. ex. : socialisation familiale, de genre, de classe) sur la pratique sportive, la seconde renversant le questionnement en considérant dans quelle mesure la pratique sportive agit sur les dispositions (schéma 1).
Ce schéma présente les principaux facteurs explicatifs de l’engagement corporel des sportif·ve·s, déterminé d’une part par la socialisation sportive (type de sport et emprise du dispositif), d’autre part par les socialisations antérieures ou parallèles (socialisation familiale, genre, classe). Détaillons les implications de cette imbrication de socialisations et les types d’engagement corporel susceptibles d’en découler.
Schéma 1
Principaux déterminants de l’engagement corporel dans le sport de haut niveau
1.3 La part des cultures corporelles des disciplines
Le concept de « culture somatique », qui désigne les normes et règles culturelles en tant qu’elles découlent de « la retraduction dans l’ordre culturel des contraintes économiques » (Boltanski, 1971, p. 209), a été mobilisé en sociologie du sport pour qualifier le « système de pratiques, de techniques et de valeurs propres » qui caractérise chaque discipline (Pociello, 1995, p. 23). Si nous partageons l’idée selon laquelle il existe des « homologies socialement pertinentes entre des sports, au sens large, et des “cultures” ou subcultures de classes » (Clément, 1995)[6], ces liens entre groupes sociaux et types de sport ne sont pas absolus et peuvent se modifier. D’une part, les évolutions du recrutement des pratiquant·e·s (en termes de genre ou de position sociale, etc.) influent sur les valeurs, représentations et pratiques des disciplines. D’autre part, le type de sport porte en lui des conceptions propres de mise en jeu des corps, liées tant à son histoire (p. ex. : « régime de genre »[7] des disciplines), qu’au type de performance attendue (p. ex. : explosivité versus endurance, contact avec l’adversaire ou non). Les individus sont ainsi inégalement prédisposés à pratiquer tel ou tel sport — selon notamment leur appartenance de genre (Aceti et Jaccoud, 2012 ; Laberge et Sankoff, 1988) ou de classe (Clément, 1995). Réciproquement, le cadre dans lequel les sportif·ve·s de haut niveau évoluent peut être considéré comme un dispositif[8] qui agit sur les dispositions des pratiquant·e·s, étant par conséquent susceptible de les transformer (Lahire, 2004). Les chercheur·se·s qui se sont intéressé·e·s au culte de la douleur dans le sport (Read et al., 2022 ; Young, 2005) montrent bien la force socialisatrice de la pratique de haut niveau (variable selon les types de sport) sur l’acquisition de dispositions stoïcistes. Pour désigner cette force socialisatrice des disciplines dont le contenu peut fluctuer selon le type de sport, nous emploierons le terme de « cultures corporelles »[9] entendues comme les représentations sociales et les pratiques corporelles « légitimes » au sein d’une discipline ou ensemble de disciplines apparentées (p. ex. : sports collectifs)[10].
Effectivement, tandis que certains sports (p. ex. : football, tennis) permettent des morphologies hétérogènes, d’autres (p. ex. : gymnastique, sport de combat), davantage individuels et genrés, tendent à sélectionner et former des morphologies plus standardisées (Mennesson et al., 2012). Cette spécificité implique une surveillance accrue des corps dans ces sports au sein desquels les athlètes sont régulièrement pesé·e·s et où les attentes de leur autocontrôle (notamment alimentaire) sont importantes pour les entraîneur·se·s (Papin, 2007). Tout porte à croire, étant donné ces différences entre disciplines, que développer un engagement corporel sous-tendu par l’autocontrainte est plus probable dans les sports impliquant une forte standardisation des morphologies. À l’inverse, on peut s’attendre à ce que les disciplines collectives, au sein desquelles les pratiques festives sont fréquentes et légitimes[11] (Saouter, 2000), favorisent des comportements hédonistes ou un contrôle corporel « à éclipses » (Bertrand, 2012) variable selon les domaines de pratique (p. ex. : une forte consommation d’alcool n’empêchant pas une forte ascèse alimentaire).
Le fonctionnement des dispositifs sportifs (p. ex. : degré d’institutionnalisation, type d’encadrement médical) peut, en outre, prendre des formes variées. Si certains s’apparentent à une « institution quasi totale » (Wacquant, 2014, p. 58), d’autres, moins coercitifs, permettent aux sportif·ve·s de mener différents projets — scolaire, professionnel — en parallèle de leur carrière. On peut ainsi s’attendre à ce que les milieux sportifs les plus cloisonnés, exerçant par là même une emprise forte (p. ex. : internat), soient ceux qui produisent le plus d’engagements corporels alignés sur l’« habitus du champion ».
1.4 Des engagements corporels genrés ?
Si la singularité des différents types de discipline est importante, le sport de haut niveau demeure un bastion viril (Baillette et Liotard, 1999 ; Messner, 2022) qui promeut de manière transversale certaines pratiques (p. ex. : la banalisation de la douleur). Dans ce contexte, l’accès des femmes à la pratique sportive de haut niveau remet en question la représentation de la « fragilité féminine » mais se réalise à ce jour tout en maintenant un certain « ordre du genre ». Il a en effet été montré qu’il est difficile pour les sportives de dissoner avec une féminité « conforme » (Adjepong, 2017 ; Krane, 2001). L’espace sportif continue d’être le lieu de construction dichotomique de corps genrés (Aceti et Jaccoud, 2012 ; Quidu et Bohuon, 2022 ; Théberge, 1995) au sein duquel les manières de pratiquer des hommes et des femmes se distinguent. Certaines recherches relèvent par exemple que les sportives se tournent davantage vers les médecines alternatives (Pike, 2005) et que leur discours est plus critique face à la banalisation de la douleur (Charlesworth, 2004 ; Sabo, 2004). Sans doute lié à la socialisation différentielle des femmes au « care » (Scrinzi, 2016), cet engagement corporel propre aux sportives se vérifie-t-il quelle que soit la discipline pratiquée ? Investiguer si les femmes se singularisent par la détention de dispositions fortes à l’autopréservation constitue une piste dans l’appréhension de ce que les dispositions genrées font à la pratique sportive, qui plus est lorsqu’on réalise des comparaisons entre les disciplines (schéma 2). Les recherches sur les trajectoires des femmes dans les sports masculins (Mennesson, 2004 ; Schmitt et Bohuon, 2022) montrent d’ailleurs l’importance du contexte de pratique sur la manière dont sont retravaillées les dispositions sexuées « inversées » de sportives ayant souvent connu une socialisation familiale à « contre-genre ». À ce titre, le caractère genré de l’autopréservation ne disparaît-il pas au sein des sports masculins où toutes et tous sont socialisé·e·s à la pain culture (Young, 2005) ?
1.5 Des engagements corporels construits dans les familles ?
Explorer la manière dont se combinent les différentes socialisations de genre (« en dehors » et « en dedans » du monde du sport), c’est insister sur le fait que les dispositifs sportifs n’agissent pas sur des corps vierges (Darmon, 2006). Dans cette lignée, les nombreux travaux sur le rôle central du façonnage des corps dans les stratégies éducatives des familles (Mennesson et al., 2016), au prisme de la classe sociale, invitent à considérer cette instance de socialisation (schéma 2). Tous les individus ne disposent pas du même bagage sportif à l’aube de leur carrière. À la suite de Forté et Mennesson (2012), qui ont montré que la sportivité des parents participe grandement à la manière dont se construisent les vocations[12], il est essentiel d’investiguer sur ce que la socialisation familiale au sport produit sur l’engagement corporel des sportif·ve·s. Des dispositions à l’ascétisme sont-elles par exemple plus prégnantes parmi les « héritier·ère·s »[13] dont on sait qu’ils et elles sont généralement issu·e·s des classes supérieures (Forté et Mennesson, 2012, p. 2) et mieux préparé·e·s au caractère contraignant du sport (Bertrand, 2012 ; Schotté, 2015) ?
Des recherches ont montré les réticences de sportif·ve·s issu·e·s de classes populaires dans l’acquisition de certaines pratiques de contrôle corporel (Bertrand, 2012 ; Rasera, 2012 ; Wacquant, 1989). Pour autant, l’imbrication entre les dispositions antérieures, socialement situées, et la socialisation sportive de haut niveau est plus complexe qu’il n’y paraît. Pour preuve, un attendu crucial du sport de haut niveau est la dénégation des maux au profit de la performance, une posture qui semble davantage alignée sur les cultures somatiques des milieux populaires (Boltanski, 1971). Des recherches suggèrent que la brièveté des carrières des athlètes issu·e·s des classes supérieures s’explique en partie par leur fort engagement scolaire (Forté et Mennesson, 2012), et que ce phénomène d’auto-exclusion est encore renforcé dès lors qu’apparaissent des blessures (Longchamp et al., 2023). Dans la continuité de ces travaux, nous souhaitons mettre à l’épreuve l’influence de l’origine sociale des sportif·ve·s sur leur manière de s’engager. Les individus issus de classes moyennes et supérieures sont-ils mieux armés pour développer un « habitus de champion » que ceux issus des classes populaires, plus enclins au sacrifice corporel ? Plus encore, l’origine sociale des individus n’est-elle pas susceptible de moduler l’effet de l’emprise du dispositif (schéma 2) ? Lorsque celle-ci est forte, les répercussions ne sont-elles pas plus coûteuses pour les individus issus de milieux populaires ?
2. données et stratégies d’analyse
2.1 Données
Les données sont issues d’une enquête par questionnaire, réalisée entre octobre 2021 et mars 2022, auprès d’ex-sportif·ve·s de haut niveau sur leurs habitudes corporelles (alimentation, santé, activité physique et sportive, esthétique) durant leur carrière et au moment de l’enquête[14]. Les ex-sportif·ve·s devaient avoir participé au minimum à des compétitions nationales dans leur discipline et résider en Suisse. L’échantillon est composé de 1342 ex-sportif·ve·s (848 hommes et 494 femmes) provenant de 47 disciplines sportives (tableau A1[15]), âgé·e·s de 18 à 65 ans.
Notre enquête par questionnaire ne vise pas la représentativité statistique des ex-sportif·ve·s de haut niveau, qui nous fut impossible à atteindre eu égard au fait que la plupart des fédérations sportives contactées ne nous ont fourni aucune liste — confirmant le relatif désintérêt des instances sportives pour le devenir des ex-sportif·ve·s en Suisse[16] (Moret et Ohl, 2018) comme ailleurs (Fleuriel et Schotté, 2011). Notre échantillon a été construit en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons constitué une liste d’ex-sportif·ve·s de 11 disciplines[17] en utilisant de multiples sources (listes de fédérations et d’associations sportives, listes et classements disponibles sur internet). Lorsque le nombre d’ex-sportif·ve·s était trop élevé dans un sport, nous avons retenu celles et ceux ayant pratiqué au plus haut niveau. La part la plus importante du travail a été de trouver un moyen de contacter ces individus en cherchant sur internet un courriel, une adresse, un numéro de téléphone ou un compte sur un réseau social (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). LimeSurvey a été ensuite utilisé pour envoyer des invitations personnalisées pour participer au questionnaire. Pour le questionnaire en ligne, 1473 invitations ont été envoyées et 696 ex-sportif·ve·s ont répondu (taux de réponse de 47,3 %). Un questionnaire papier a été envoyé à 292 ex-sportif·ve·s (ceux et celles dont nous avions uniquement une adresse postale) pour 61 retours (taux de réponse de 20,9 %). Dans un deuxième temps, nous avons diffusé le questionnaire en ligne à travers de nombreux canaux de communication, ce qui a conduit à une plus grande diversité des disciplines mais aussi des âges (n = 585). L’objectif était de disposer d’une « puissance statistique » suffisante pour détecter de petits effets (Cohen, 1988) et pour effectuer des analyses séparées (par exemple, par type de sport ou par sexe).
2.2 Mesure de l’engagement corporel
L’engagement corporel au sommet de la carrière sportive est mesuré à l’aide de 31 variables (tableau 1) relevant de l’alimentation, de la consommation d’alcool et de tabac, de la prise de médicaments, du contrôle du poids, des attentes vis-à-vis des professionnel·le·s de la santé, de la perception, la gestion et l’écoute de son corps, du rapport à la douleur, du rapport à l’entraînement et à la compétition[18].
Tableau 1
Indicateurs de l’engagement corporel au sommet de la carrière sportive[19]
Note : Pour le détail du codage des variables et les fréquences des modalités, tableau A4.
a Réponse à la proposition : « Sans médicaments antidouleur et/ou des anti-inflammatoires, je n’aurais pas pu avoir la carrière que j’ai eue. »
2.3 Mesure de la socialisation par le dispositif sportif
La socialisation par le dispositif sportif est mesurée avec deux variables. La première renvoie à l’emprise du dispositif sportif pendant la carrière. Cette variable est la première dimension d’une ACM portant sur 26 variables et 69 modalités actives (tableau A2). Une forte emprise se caractérise notamment par le fait d’avoir un·e préparateur·rice physique, une surveillance du poids et des sanctions inhérentes, des conseils nutritionnels, 30 heures et plus d’entraînement par semaine, par le fait de quitter le logement parental pour se consacrer à sa carrière sportive ou d’avoir subi des formes de maltraitance psychique et physique de la part de l’encadrement sportif.
La deuxième variable captant la socialisation par le dispositif sportif est le type de sport pratiqué pendant la carrière (tableau 2). Les disciplines ont été regroupées en quatre catégories : sports masculins collectifs, sports masculins individuels, sports féminins et sports mixtes (tableau A1). Le poids de l’orientation genrée des sports (masculin, féminin) sur la culture corporelle des disciplines nous a conduits à faire primer cette catégorisation tout en dissociant les disciplines individuelles et collectives dans les sports masculins afin de distinguer les sports de combat et arts martiaux qui socialisent différemment leurs pratiquant·e·s à l’usage agoniste du corps (Ryou et Lee, 2023)[20].
2.4 Mesure de la socialisation familiale au sport
La socialisation familiale au sport est mesurée avec la première dimension d’une analyse des correspondances multiples (ACM) portant sur 9 variables (tableau A3) dont les pratiques sportives du père et de la mère lorsque le·la répondant·e était enfant/adolescent·e, le plus haut niveau de compétition sportive du père et de la mère, la fréquence de la pratique d’une activité sportive avec son père et sa mère, la place du sport dans les conversations familiales, le fait d’assister en famille à des compétitions sportives et d’avoir les trophées sportifs (Forté, 2022 ; Ohl, 2003)[21] exposés dans le salon/hall d’entrée. Cette dimension capte l’essentiel de l’information avec un taux d’inertie corrigé de Benzécri de 91,1 % et représente l’intensité de la socialisation sportive familiale.
2.5 Facteurs explicatifs de l’engagement corporel
Les facteurs explicatifs des types d’engagement corporel (tableau 2) sont constitués par des variables sociodémographiques (genre, origine sociale), par des variables relatives à la socialisation sportive familiale et par des variables relatives à la carrière sportive, renvoyant notamment aux cultures corporelles des disciplines et au type d’encadrement sportif (type de sport pratiqué pendant la carrière, possession d’un statut professionnel, emprise du dispositif sportif, blessures aiguës et subites, douleurs chroniques) et à la temporalité des carrières (âge minimum au sommet de la carrière[22], période au sommet de la carrière[23], durée de la carrière). Près de la moitié de notre échantillon pratique un sport mixte, un tiers un sport masculin collectif, un dixième un sport féminin, enfin un quinzième un sport masculin individuel (dont les deux tiers pratiquent des arts martiaux et sports de combat). Un peu plus des trois quarts sont d’origine sociale moyenne ou supérieure (non populaire), presque les deux tiers sont des hommes et un peu moins du quart sont des sportif·ve·s professionnel·le·s.
Tableau 2
Facteurs explicatifs des types d’engagement corporel
Notes : N = 1342. Les variables mesurant la fréquence des blessures aiguës et subites et celle des douleurs chroniques durant la carrière (codées jamais, rarement, parfois, souvent et en permanence) ont été recodées comme des variables numériques variant de 0 (jamais) à 4 (en permanence), le BIC indiquant un meilleur ajustement du modèle de régression.
2.6 Méthodes
Pour dégager des types d’engagement corporel, nous avons réalisé, dans un premier temps, une analyse des correspondances multiples (ACM) sur les indicateurs de l’engagement corporel au sommet de la carrière sportive (tableau 1) puis, dans un second temps, une classification ascendante hiérarchique selon la méthode de Ward avec une consolidation k-means sur les axes retenus de l’ACM[24]. L’analyse des correspondances multiples (ACM) et les représentations graphiques des clusters ont été réalisées avec le package R GDAtools (Robette, 2023), alors que la classification hiérarchique avec consolidation k-means a été effectuée avec le package R FactoMineR (Lê et al., 2008).
Pour évaluer l’impact des facteurs explicatifs sur la probabilité d’avoir un type d’engagement corporel plutôt qu’un autre, nous avons effectué une régression logistique multinomiale. Les différents types d’engagement corporel constituent la variable dépendante. Les huit variables indépendantes introduites dans le modèle sont celles présentées dans le tableau 2. Afin de mesurer les effets produits par les imbrications de socialisations, nous avons inclus deux termes d’interaction : genre * type de sport pratiqué, emprise du dispositif * origine populaire. Tous les termes constitutifs des interactions ont été inclus dans le modèle. L’introduction de ces effets d’interaction permet d’évaluer, d’une part, si les effets du genre sont modérés par le type de sport pratiqué et, d’autre part, si les effets de l’emprise du dispositif sont modérés par l’origine sociale. La régression logistique multinomiale a été estimée avec le package R nnet (Venables et Ripley, 2002).
Pour faciliter l’interprétation des résultats du modèle de régression logistique multinomiale, nous présentons les effets marginaux moyens des variables indépendantes et les effets marginaux conditionnels calculés à partir des effets d’interaction. L’effet marginal moyen indique l’effet moyen des variables indépendantes sur la probabilité d’avoir un type d’engagement corporel. L’effet marginal conditionnel calcule l’effet d’être une femme pour chacun des types de sport (interaction genre * type de sport) et l’effet du dispositif sportif pour chacune des origines sociales (interaction emprise du dispositif * origine populaire). L’autre avantage de calculer des effets marginaux est qu’ils fournissent tous les tests statistiques permettant de tester une hypothèse conditionnelle impliquant une interaction. Les analyses ont été réalisées sur R version 4.4.1 (R Core Team, 2023). Les effets marginaux ont été calculés avec le package R marginaleffects (Arel-Bundock, 2023).
Dans les parties suivantes, nous présentons les facteurs de structuration de l’engagement corporel, dégagés à l’aide d’une ACM (partie 3) ainsi que les six types résultant d’une analyse de classification (partie 4), avant de détailler les analyses relatives à notre modèle de régression (partie 5).
3. autopréservation, instrumentalité et compétition : les trois dimensions de l’engagement corporel
L’ACM porte sur 1342 individus et 31 variables (comprenant au total 89 modalités actives). La forte décroissance des taux corrigés d’inertie nous a conduits à retenir et interpréter les trois premières dimensions (tableau A5).
Les trois premiers axes renvoient respectivement à l’autopréservation, à l’instrumentalité du corps et à la compétition (tableau A6). La plupart des individus se situent à droite du premier axe et se singularisent par des représentations et pratiques associées à une forte autopréservation corporelle. Ils déclarent avoir une bonne hygiène de vie et faire attention à leur alimentation, qu’ils estiment tout à fait adaptée à leur pratique sportive. Ils ne sont, entre autres, jamais ivres en soirée et ne consomment jamais de tabac. Ils estiment ne pas être prêts à mettre leur santé en danger pour battre un adversaire. Ils évitent au maximum la prise de médicaments pour soigner leurs douleurs et préfèrent avoir recours à des moyens naturels.
À l’opposé, les individus situés à gauche du premier axe évaluent leur hygiène de vie comme ni bonne ni mauvaise, voire comme mauvaise ou plutôt mauvaise, et n’accordent pas d’attention à leur alimentation qu’ils ne jugent pas adaptée à leur activité sportive. Leur vie nocturne est intense et accompagnée d’ivresse, de consommation de tabac et de cannabis. Ils déclarent être prêts à mettre leur santé en danger pour battre un adversaire. Ils estiment les médicaments antidouleur et les anti-inflammatoires indispensables à leur carrière et attendent des professionnel·le·s de la santé qu’ils·elles leur en prescrivent.
Le second axe oppose les individus qui présentent un rapport au corps instrumental à ceux dont le rapport au corps est beaucoup plus éloigné de cette représentation. Indépendamment des considérations de santé, les individus situés en haut de cet axe semblent dédiés à l’optimisation de leurs performances. Ils disent être capables de se sublimer en compétition et attendent des professionnel·le·s de la santé une amélioration de leurs performances ainsi qu’une atteinte de leurs objectifs malgré les blessures. Afin de favoriser leur réussite, ils n’hésitent pas à adopter des comportements très ascétiques tels que la surveillance quotidienne de leur poids. Mais cette ascèse n’est pas nécessairement synonyme de santé. En témoigne le fait que ces individus se disent prêts à la mettre en danger pour battre un adversaire et que les médicaments allopathiques occupent une place centrale dans la gestion de leurs douleurs.
À l’opposé, les individus situés en bas de cet axe se tiennent à distance (relative) de tout ce qui fait habituellement l’« habitus du champion ». Bien qu’ils aient atteint un haut niveau, ils considèrent que le sport n’est pas « toute leur vie » et n’adhèrent que faiblement aux valeurs de la compétition. Dans la même veine, ils ne se prêtent pas à des techniques de contrôle corporel telles que la surveillance du poids. Pourtant, et bien qu’ils présentent certaines tendances hédonistes (sortie le soir, consommation de cannabis), ils gardent aussi à distance les pratiques de mise à l’épreuve du corps : ils renoncent à s’entraîner lorsqu’ils sont blessés ou malades, et ne consomment pas de médicaments antidouleur ou d’anti-inflammatoires.
Enfin, le troisième axe oppose les individus très compétitifs à ceux peu compétitifs. S’ils se montrent relativement distants des normes sanitaires (ils ne prêtent pas tellement attention à leur alimentation, sont parfois ivres, etc.), les individus situés en haut de cet axe se distinguent en revanche par le fait qu’ils se sentent plus forts en compétition qu’à l’entraînement et qu’ils s’estiment capables de se sublimer le jour de la compétition. À l’opposé, ceux situés en bas de cet axe se distinguent prioritairement par leur absence d’appétence pour la compétition.
4. six profils d’engagement corporel
C’est sur ces trois premiers axes de l’ACM qu’a été réalisée une classification ascendante hiérarchique selon la méthode de Ward avec une consolidation k-means. La partition retenue est constituée de 6 classes qui se rapportent à des profils d’engagement corporel. Les sous-nuages d’individus correspondant aux 6 classes sont représentés à l’aide d’enveloppes convexes[25] sur le plan factoriel 1-2 (graphique 1) et sur le plan factoriel 1-3 (graphique 2).
Graphique 1
Six profils d’engagement corporel. Partition issue d’une analyse de classification sur le plan factoriel 1-2
Graphique 2
Six profils d’engagement corporel. Partition issue d’une analyse de classification sur le plan factoriel 1-3
Les ex-sportif·ve·s se caractérisant par un engagement de type maximaliste pendant leur carrière représentent plus du quart de l’échantillon (27,5 %, tableau 3). Les opportunistes (22,1 %) et les prophylactiques (21,9 %) sont un peu moins nombreux que les maximalistes. Les sacrificiel·le·s (12,0 %) et les démobilisé·e·s (8,9 %) représentent environ un individu sur dix. Enfin, les hédonistes ne forment qu’une petite part de notre échantillon (7,6 %).
Tableau 3
Les 6 types d’engagement corporel
4.1 Les maximalistes
Qu’il s’agisse de l’autopréservation, de l’instrumentalité ou de la compétition, les sportif·ve·s se caractérisant par un engagement de type maximaliste tendent à se situer aux pôles positifs des trois axes de notre ACM. Pour ces individus, le sport représente « toute leur vie » et ils estiment avoir le corps idéal pour leur discipline[26]. Ils préfèrent les entraînements difficiles et la compétition. Mais cette dureté au mal s’accompagne de pratiques de préservation de l’intégrité physique, avec notamment un évitement des médicaments et une préférence pour les moyens naturels dans la gestion des douleurs. Ce souci de préservation est encore renforcé par des pratiques d’autocontrôle, qu’il s’agisse du soin accordé à l’alimentation, de la rareté des sorties nocturnes et de l’ivresse, ou encore de l’absence de consommation de tabac. Finalement, les maximalistes sont les individus qui incarnent le mieux l’« habitus du champion », avec une très forte illusion sportive et une capacité à « user de leur corps sans l’user ».
4.2 Les prophylactiques
Les prophylactiques se singularisent par le soin qu’ils et elles apportent à la préservation de leur intégrité physique. S’ils se situent au pôle positif de l’axe de l’autopréservation, ces individus sont en revanche plus en retrait sur les axes de l’instrumentalité et, dans une moindre mesure, de la compétition. Absolument pas enclins à mettre leur santé en danger pour battre un adversaire, évitant la prise de médicaments antidouleur et d’anti-inflammatoires, n’aimant pas les entraînements difficiles, ces individus, peu compétiteurs, semblent chercher à tenir les souffrances et le dépassement corporel à distance. Ils paraissent y parvenir puisqu’ils n’évoquent jamais avec les professionnel·le·s de la santé la question du soulagement de douleurs. Néanmoins, quand le besoin se fait sentir, ils privilégient des moyens naturels (glace, étirements, etc.). Ce sens de l’épargne s’étend à d’autres domaines : alimentation adaptée à leur statut de sportif·ve de haut niveau, bonne hygiène de vie, pas de contrôle de leur poids au quotidien, jamais d’ivresse. En cohérence avec une telle attitude précautionneuse, ces individus considèrent que le sport n’occupe pas une place centrale dans leur vie.
4.3 Les opportunistes
Les opportunistes présentent le profil le plus compétitif de tous les types d’engagement corporel. Ils et elles sont en revanche en retrait tant sur l’axe de l’autopréservation que sur celui de l’instrumentalité. Ces individus aiment la compétition et le jour J est un moment lors duquel ils se subliment et se sentent plus forts qu’à l’entraînement. Leur disposition compétitive est si prégnante qu’ils n’hésitent pas à mettre leur santé en danger pour battre un adversaire. Mais à la différence des maximalistes qui mettent tout en oeuvre pour favoriser la performance, les opportunistes se singularisent par un relâchement relatif dans les autres domaines de pratique. Il leur arrive d’être parfois ivres en soirée, ils fument du tabac occasionnellement, ne prêtent pas tellement attention à leur alimentation. Quant à leur hygiène de vie, ils estiment qu’elle n’est ni bonne ni mauvaise, voire, pour certains d’entre eux, plutôt bonne, et pour d’autres encore, parfois bonne, parfois mauvaise, ce qui rappelle un ascétisme « à éclipses ». Peut-être que cette hésitation est une bonne synthèse de ce type d’engagement que l’on qualifie d’opportuniste, dont la principale caractéristique est l’absence d’intensité et une forme d’attentisme. Effectivement, bien que ces sportif·ve·s estiment que leur corps n’est pas vraiment « idéal » pour leur discipline, ils et elles déclarent ne pas du tout faire attention à leur alimentation, ne pas contrôler leur poids et ne pas attendre des professionnel·le·s de la santé une aide pour améliorer leur performance. Ces individus semblent ne pas chercher à maximiser leurs capacités ou à rentabiliser leur carrière, mais plutôt à profiter de leurs acquis.
4.4 Les sacrificiel·le·s
Tout en se situant dans la moyenne s’agissant de l’autopréservation et de la compétition, les sacrificiel·le·s sont les plus proches du pôle positif s’agissant de l’instrumentalité. Ces individus sont ceux qui adhèrent le plus à la « logique du temps sportif » (Viaud et Papin, 2012, p. 11), avec des pratiques corporelles qui « pren[nent leur] sens dans l’urgence propre au calendrier des compétitions sans qu’ils considèrent leur équilibre corporel à plus long terme au-delà des échéances sportives » (Viaud et Papin, 2012, p. 11). Ils semblent ainsi entièrement tournés vers l’objectif de performance, sans véritable considération pour les questions de santé. Privilégiant les antalgiques et les anti-inflammatoires à d’autres moyens naturels (homéopathie, glace, etc.) dans la gestion de leurs douleurs, ces individus déclarent qu’ils n’auraient pas pu avoir la même carrière sans médicaments. Bien qu’elle ne soit pas spécialement marquée, leur disposition compétitive vient renforcer cette tendance au sacrifice. À leurs yeux, s’entraîner n’a de sens qu’en regard de la compétition à venir, lors de laquelle ils se sentent capables de se sublimer, quitte à mettre leur santé en péril. Préférant les entraînements difficiles, déclarant que les douleurs font partie intégrante de leur vie, leur volontarisme s’illustre aussi par des pratiques de surveillance corporelle assez importantes : ils affirment ainsi faire très attention à leur alimentation et contrôler leur poids au quotidien. Sans que leur quotidien soit une parfaite ascèse (ils déclarent être rarement ou parfois ivres en soirée), toutes les sphères de leur vie semblent tournées vers la réussite sportive. Ils estiment par exemple que les relations de couple (y compris les aventures) ont plutôt eu un effet positif sur leur carrière et qu’elles n’ont pas affaibli leur engagement.
4.5 Les démobilisé·e·s
Être sportif·ve de haut niveau, mais n’avoir aucune appétence ni pour la compétition, ni pour le dépassement de soi, ni pour la maîtrise de son corps. Difficile à concevoir, ce paradoxe résume l’engagement corporel de ce profil (minoritaire de l’échantillon) situé près des pôles négatifs sur les trois axes de notre ACM. Bien que ces individus présentent certaines pratiques qui convergent avec l’impératif d’autocontrôle caractéristique du sport de haut niveau — ils ne sortent jamais avec des ami·e·s, ne sont jamais ivres et ne fument jamais de tabac — la logique qui sous-tend leur rapport au corps s’apparente à une forme de dilettantisme. Ces individus estiment en majorité ne pas posséder le corps idéal pour leur discipline et semblent s’en accommoder, ne prêtant guère attention à leur alimentation et déclarant une hygiène de vie « mauvaise ou plutôt mauvaise » ou, dans une moindre mesure, « ni bonne, ni mauvaise ». Ils déclarent que le sport n’est pas « toute leur vie » et leur engagement s’avère perméable à d’autres enjeux comme ceux de la vie conjugale. Ces sportif·ve·s estiment ainsi que les relations de couple (y compris les aventures) ont eu des effets négatifs sur leur carrière.
4.6 Les hédonistes
Ne formant qu’une petite partie de notre échantillon, les hédonistes se singularisent par leur proximité avec le pôle négatif de l’axe d’autopréservation. Ils et elles occupent ainsi une position diamétralement opposée à celle des maximalistes et des prophylactiques. Qu’il s’agisse de leur consommation de cannabis, de tabac (régulière ou occasionnelle) et d’alcool (la majorité déclare avoir souvent ou toujours été ivre en soirée au cours de leur carrière, une minorité parfois), ou encore de leur type d’alimentation (qu’ils et elles estiment peu adapté à leur vie sportive), leurs pratiques dissonent avec les attentes d’autocontrôle propres aux dispositifs sportifs. Ces sportif·ve·s se singularisent par le fait de ne pas faire le maximum pour préserver leur intégrité physique, ils·elles considèrent leur hygiène de vie comme mauvaise ou plutôt mauvaise, consomment assidûment des médicaments et sont prêt·e·s à mettre leur santé en danger pour battre un adversaire. Cela dit, et à la différence des opportunistes, cette logique non préservative n’est pas associée à une forte disposition compétitive. Pour ces individus, le sport n’est pas forcément « toute leur vie », et leur distance envers l’impératif de performance se décèle encore par le fait qu’ils attendent des professionnel·le·s de la santé un soulagement de leurs douleurs ou la mise au repos, mais non l’amélioration de leurs performances.
5. les principaux déterminants de l’engagement corporel : qui s’engage comment ?
Ces six profils d’engagement corporel dans le sport de haut niveau mettent l’accent sur l’importante variabilité des façons d’« être » sportif·v·e et de mener une carrière de haut niveau[27]. Certain·e·s font primer la compétition et l’atteinte de performances coûte que coûte tandis que d’autres manifestent une plus grande précaution à l’égard de leur intégrité physique (schéma 2). Quels sont les facteurs favorisant l’appartenance à un type d’engagement plutôt qu’à un autre ?
Schéma 2
Association entre les 6 types d’engagement corporel et les dimensions de l’ACM
Notes : La taille des symboles renvoie aux valeurs-tests présentées dans le tableau A7. Les symboles + renvoient à des valeurs positives, les symboles — à des valeurs négatives.
Une régression logistique multinomiale permet de déterminer ce que l’appartenance à tel ou tel type de profil d’engagement doit à l’origine sociale, à la socialisation sportive familiale, au genre ou encore au dispositif sportif. La fréquence des blessures aiguës, les douleurs chroniques, le statut de sportif·ve professionnel·le[28] et les variables temporelles sont des facteurs pouvant influencer le type d’engagement corporel qui seront traités comme des variables de contrôle. Le modèle de régression est présenté en annexe (tableau A8).
Cette approche nous permet de clarifier l’influence des principaux facteurs de l’engagement corporel, à savoir ceux liés à la socialisation sportive d’une part (type de sport et emprise du dispositif), et ceux liés aux socialisations antérieures ou parallèles d’autre part (genre, socialisation sportive familiale et origine sociale).
5.1 Les effets du dispositif sportif
5.1.1 La force socialisatrice du type de sport pratiqué
Parmi l’ensemble des variables intégrées dans la régression, le sport pratiqué apparaît comme le facteur le plus prédictif du type d’engagement corporel (tableau 4). La pratique d’un sport masculin individuel, composé majoritairement de pratiquant·e·s de sports de combat et arts martiaux, favorise par exemple l’adoption d’un engagement de type maximaliste ou démobilisé. Ce sont ainsi deux profils diamétralement opposés qui se côtoient dans ces sports masculins individuels. Cette spécificité est probablement à mettre sur le compte des catégories de poids, qui produisent un effet clivant sur les combattant·e·s selon qu’ils et elles se trouvent dans une catégorie inférieure à leur poids habituel (l’ascétisme maximaliste s’impose[29]) ou, au contraire, dans une catégorie supérieure à leur poids habituel (les démobilisé·e·s se caractérisent par le fait d’estimer ne pas avoir le « corps idéal » tout en ne prêtant guère attention à leur alimentation).
Les individus qui pratiquent un sport masculin collectif (p. ex. : football, handball) ont quant à eux une probabilité élevée de présenter un profil opportuniste ou hédoniste, ce qui confirme certains travaux (Saouter, 2000 ; Rasera, 2012). Ces disciplines valorisent un usage agoniste du corps et font peu de cas des dispositions à l’autopréservation, tout comme les sports de combat, mais se singularisent par une moindre surveillance des corps. N’exerçant qu’un faible contrôle des morphologies (Longchamp et al., 2023 ; Mennesson et al., 2012), ces disciplines autorisent des temps de relâchement corporel tels que les sorties nocturnes et l’ivresse — comme Rasera (2012) l’a montré pour les footballeurs —, ce qui éclaire sans doute leur association avec les types hédoniste et opportuniste.
Si tous les sports masculins (qu’ils soient collectifs ou individuels) ne produisent pas les mêmes types d’engagement corporel, nos résultats montrent qu’ils ont en commun d’être négativement associés au profil prophylactique. Recoupant la littérature, nous relevons une relation entre l’orientation genrée des sports et le caractère genré des pratiques corporelles de leurs pratiquant·e·s ; le stoïcisme (antonyme de la prophylaxie) étant symboliquement associé à la virilité.
De leur côté, les sports féminins (p. ex. : gymnastique, natation synchronisée) sont davantage associés aux types d’engagements prophylactique et démobilisé. Tout comme les sports de combat, le très fort contrôle du poids caractérise ces disciplines, avec un clivage entre d’une part les athlètes qui, sans véritable effort, présentent le poids attendu par les entraîneurs, et d’autre part ceux et celles pour qui l’atteinte de ce poids s’accompagne de contraintes permanentes[30]. Ce sont sans doute ces individus en lutte avec leur poids qui tendent à se démobiliser. À l’inverse, dans ces sports féminins, ceux et celles dont l’illusio est intact tendent probablement à favoriser l’engagement de type prophylactique, soit un sens de l’épargne corporelle particulièrement prononcé. Ce résultat est inattendu car ces disciplines sont connues comme étant les plus exigeantes en matière de quête de rentabilité sportive dans « l’urgence » (Viaud et Papin, 2012)[31].
Enfin, la pratique d’un sport mixte (p. ex. : volleyball, course à pied, tennis) est celle qui est associée à la plus large palette d’engagements corporels puisqu’elle augmente à la fois les probabilités d’engagements maximaliste, prophylactique et démobilisé. Le plus souvent individuelles, ces disciplines mixtes favorisent une forme de prise en main autonome qui peut être sous-tendue par une représentation du corps-outils (maximaliste) autant que par une représentation du corps-santé (prophylactique). Et tout comme les sports masculins individuels et féminins, les sports mixtes sont aussi le théâtre d’une forme de démobilisation, certains individus pouvant s’y engager de manière dilettante.
À la lumière de nos analyses, seul le type sacrificiel n’est pas caractérisé par le type de sport pratiqué.
5.1.2 L’emprise du dispositif et le rapport instrumental au corps
Le renforcement de l’emprise du dispositif entraîne une augmentation de la probabilité d’un engagement de type maximaliste (tableau 4), soit cet « habitus du champion » permettant aux sportif·ve·s d’« user de leur corps sans l’user » (Wacquant, 2014, p. 128). Si ce résultat va dans le sens attendu — une tendance coercitive du dispositif sportif diminuant également la probabilité d’avoir un engagement hédoniste, opportuniste ou prophylactique —, il faut toutefois relever que l’emprise forte est associée à un engagement de type sacrificiel, ce qui confirme le rôle de l’encadrement des sportif·ve·s (entraîneur·se·s, équipe médicale) dans l’imposition d’une « logique de l’urgence » mettant le corps à rude épreuve (Viaud et Papin, 2012). Parmi tous les facteurs introduits dans l’analyse, l’emprise du dispositif sportif est d’ailleurs le seul qui favorise l’engagement de type sacrificiel. En définitive, plus l’emprise du dispositif sportif est forte, plus les individus incorporent une représentation de leur corps comme un outil, mais l’acquisition de dispositions à l’autopréservation n’est, elle, pas systématique. D’ailleurs, l’emprise du dispositif sportif semble ne pas autoriser cette forme d’écoute corporelle sans logique de performance puisqu’elle diminue la probabilité d’un engagement prophylactique.
Tableau 4
Effets marginaux moyens (A) et effets marginaux conditionnels (B)
Notes : N = 1114. Effets marginaux calculés à partir du modèle de régression logistique multinomiale. Est. : signifie estimation et ES, erreur standard. En gras, les effets marginaux avec une valeur p < 0,05. Pour les variables indépendantes catégorielles, les catégories de référence sont : homme, origine sociale non populaire, sport masculin collectif.
5.1.3 Les effets de l’emprise du dispositif sportif : un « quitte ou double » plus coûteux pour les individus issus des classes populaires
En contraste avec la littérature dispositionnaliste sur le sport de haut niveau, l’origine sociale n’exerce aucun effet direct sur l’engagement corporel (tableau 4, partie A). En revanche, l’origine sociale modère l’effet de l’emprise du dispositif sportif sur la probabilité de développer tel ou tel engagement corporel (tableau 4, partie B). Le fait qu’une emprise forte du dispositif sportif favorise l’« habitus du champion » (maximalistes) n’est valable que pour les sportif·ve·s de classes moyennes et supérieures. Même constat pour l’association d’une faible emprise aux types hédoniste, opportuniste et prophylactique qui n’est valable que parmi les classes moyennes et supérieures. Inversement, le fait qu’une emprise forte du dispositif sportif favorise un engagement sacrificiel se vérifie quelle que soit la classe sociale, mais cet effet est bien plus fort pour les sportif·ve·s de classes populaires que pour ceux et celles de classes moyennes et supérieures (tableau 4, partie B). Concernant l’engagement démobilisé, moins coûteux corporellement ou en tout cas plus éloigné de l’« habitus du champion », il n’y a pas d’effet de l’emprise du dispositif ni d’effet modéré par l’origine sociale des athlètes.
Une forte emprise du dispositif semble donc agir comme un révélateur des cultures somatiques, le « corps instrumental » des classes populaires s’opposant à un corps plus « formel » et « expressif » des classes moyennes et supérieures (Boltanski, 1971). Ce résultat peut être mis en regard des différentes stratégies éducatives familiales, socialement situées, relevées par des travaux antérieurs ; l’« adhésion “enchantée’’ » (Forté et Mennesson, 2012, p. 11) aux vertus d’une carrière de haut niveau qui tend à caractériser les parents de sportif·ve·s de milieux populaires explique probablement cette vulnérabilité des sportif·ve·s issu·e·s des classes populaires face à l’influence du dispositif sportif (Longchamp et al., 2023). Lefèvre (2007) l’a notamment montré à propos de la formation et la réalisation de la vocation de cycliste, particulièrement efficace pour les individus appartenant à des familles des classes populaires « plus à même de s’accorder avec les efforts et les violences physiques qu’impose ce sport de haut niveau » (Longchamp et al., 2023, p. 53).
5.2 Les effets du genre
5.2.1 L’autopréservation contrastée, le sacrifice en commun
Alors que les femmes présentent une probabilité supérieure de développer un engagement corporel prophylactique ou, dans une moindre mesure, démobilisé, les hommes présentent quant à eux une probabilité supérieure de développer un engagement maximaliste, opportuniste ou hédoniste (tableau 4, partie A). Tout se passe comme si l’adhésion aux injonctions liées au haut niveau prenait la forme d’un engagement prophylactique pour les femmes quand elle prend la forme d’un engagement maximaliste pour les hommes. Cette déclinaison genrée se répète lorsque les individus se tiennent à distance de ces injonctions, les femmes s’engageant alors de manière démobilisée, les hommes de manière hédoniste ou opportuniste.
Le genre ne produit en revanche pas d’effet sur l’engagement sacrificiel : tant les sportifs que les sportives peuvent être amené·e·s à pousser leur corps jusqu’à la rupture. Tout comme certaines recherches ont montré qu’il est des espaces sociaux où les habitus genrés quant à l’usage de la force physique se dissolvent (Beunardeau, 2019), nos résultats suggèrent que la « violence héroïque » (Bourdieu, 1998, p. 74) constitue une valeur autant valorisée par les hommes que les femmes dans l’espace du sport de haut niveau.
5.2.2 Les effets du genre modérés par le type de discipline : l’autopréservation et l’hédonisme, des dispositions genrées qui ne s’activent pas dans tous les contextes
Les effets du genre que nous venons de constater ne se vérifient pas dans toutes les disciplines (tableau 4, partie B). Si les femmes sont plus prophylactiques que les hommes d’une manière générale, cela n’est pas le cas dans les sports féminins et dans les sports masculins individuels au sein desquels, en réaction respectivement à la « logique de l’urgence » (Papin, 2007 ; Mennesson, Visentin et Clément, 2012) ou à la « culture de la douleur » (Beauchez, 2017), prônée par leur encadrement, toutes et tous semblent faire preuve de prophylaxie. Au sein des disciplines masculines individuelles, l’écart entre hommes et femmes s’estompe quant à l’engagement prophylactique, dû à une moins forte préservation des femmes ; au sein des disciplines féminines, c’est la plus forte préservation des hommes que l’on constate.
Une autre modération des effets de genre par le type de discipline s’observe pour le type d’engagement démobilisé. Si les femmes sont plus souvent démobilisées sur le plan global, cette relation ne se vérifie qu’au sein de ces mêmes sports féminins et, dans une moindre mesure, dans les sports mixtes. Ce qui tend à montrer que la démobilisation des femmes dans le sport de haut niveau résulte d’un type d’encadrement extrêmement contrôlant, notamment en ce qui concerne le poids corporel.
Quant aux hommes, ils sont certes plus souvent maximalistes que les femmes mais cet effet de genre ne vaut que dans les sports mixtes. De la même façon, leur tendance à l’hédonisme se vérifie que dans les sports masculins collectifs et dans les sports mixtes mais pas dans les sports féminins et masculins individuels. Ces disciplines ont en commun de sélectionner et de former des morphologies standardisées qui socialisent à l’autocontrainte et légitiment une surveillance poussée des corps (Papin, 2007), laissant peu d’espace pour le relâchement, y compris pour les hommes.
Si les tendances générales ne se vérifient pas dans toutes les disciplines, la modération des effets du genre par le type de sport continue de révéler une spécificité de l’engagement sacrificiel qui n’est nullement associé au genre des pratiquant·e·s, et ce, quel que soit le type de discipline. On constate que dans les sports masculins, collectifs ou individuels, la socialisation à l’usage agonistique du corps produit des effets similaires sur les femmes et les hommes quant à la probabilité de sacrifice de l’intégrité physique. Ce résultat nous permet de nuancer les recherches ayant montré qu’au sein des sports masculins, les sportives adhèrent au culte de la douleur tout en étant critiques dans leur discours sur cette norme virile (Berg et al., 2023 ; Channon et Phipps, 2017). En définitive, il semble plutôt que dans le sport de haut niveau, la mise en danger du corps dans sa forme extrême (sacrificielle) n’est pas genrée. Le discours des pratiquantes est peut-être critique envers les valeurs virilistes du sport mais leur engagement corporel n’est pas moins « viril » que celui des hommes.
5.3 La socialisation sportive familiale et l’« habitus du champion »
Si les modalités de la socialisation sportive sont déterminantes dans la constitution de l’engagement corporel, nos analyses objectivent également le poids du passé incorporé. L’intensité de la socialisation sportive familiale tend à augmenter la probabilité d’un engagement de type maximaliste sous-tendu par l’ascétisme et à diminuer celle d’un engagement de type hédoniste et démobilisé (tableau 4, partie A). Toutes choses égales par ailleurs, les individus qui ont grandi au sein d’une famille dans laquelle le sport occupait une place centrale (leurs parents étaient sportifs, pratiquaient un ou plusieurs sports avec eux, les conversations familiales tournaient souvent autour du sport, etc.) tendent à développer un « habitus de champion », soit un engagement total associant des dispositions autopréservatives, instrumentales et compétitives. Nos résultats recoupent ainsi ceux de travaux antérieurs (Bertrand, 2011 ; Collins et Buller, 2003) ayant montré que l’implication familiale, et notamment le passé de pratiquant des parents, favorisent la constitution de dispositions propices durables et « l’opportunité de réaliser son potentiel sportif » (Forté, 2006, p. 60). Ainsi, bien qu’étant déterminante, la socialisation exercée par le dispositif sportif doit composer avec les dispositions produites par la socialisation familiale.
5.4 Les effets du temps
Les variables « temporelles » de notre modèle n’ont pas une grande portée explicative sur l’engagement corporel (tableau A8). En revanche, leur intégration permet de contrôler la robustesse des résultats susmentionnés. Un seul type d’engagement (le type hédoniste) est associé à ces variables temporelles. La précocité de la carrière augmente la probabilité d’avoir un engagement hédoniste, tout comme le fait d’avoir fait carrière après 1990. Les plus vieux ou vieilles retraité·e·s, dont le sommet de carrière a eu lieu entre 1970 et 1989, ont ainsi de plus fortes chances d’être maximalistes qu’hédonistes. Si l’on ne peut exclure un effet d’illusion rétrospective (les plus ancien·ne·s auraient tendance à surévaluer la part maximaliste de leur engagement de l’époque), il faut également tenir compte du fait que les contours et enjeux du champ de l’élitisme sportif se sont profondément transformés au cours des dernières décennies (Jaccoud et al., 2000) : à une période où les dispositifs sportifs étaient moins organisés (p. ex. : moindres enjeux financiers, moindre professionnalisation des entraîneur·se·s, voir Bertrand, 2012), les athlètes ne pouvaient probablement pas se permettre de se relâcher s’ils·elles voulaient faire carrière.
Hormis l’engagement démobilisé (dont la probabilité diminue à mesure que la carrière se prolonge), aucun type d’engagement corporel n’est associé à la longévité des carrières. Autrement dit, il est tout autant probable de mener une longue carrière sur le mode prophylactique que sur le mode sacrificiel, opportuniste, hédoniste ou maximaliste.
conclusion
Étudier les pratiques des sportif·ve·s donne la possibilité aux sociologues « de placer le corps au centre de l’analyse sans en faire un simple support où s’imprime la peine et s’incarne l’aliénation » (Dalgalarrondo, 2015, s. p.). L’apport principal de cet article a ainsi été de documenter la variabilité des manières de s’engager dans le sport de haut niveau en enquêtant qui plus est auprès d’ex-sportif·ves. En incluant de façon décloisonnée des pratiquant·e·s issu·e·s d’une quarantaine de disciplines et en les interrogeant sur divers domaines de pratique, nous avons souhaité ajouter aux connaissances issues de travaux qui privilégient le plus souvent l’étude d’une seule discipline, d’un seul domaine de pratique, voire d’un seul profil de sportif·ve.
On a tendance à distinguer les sportif·ve·s selon le niveau atteint, la durée de leur carrière, leurs blessures, leur statut professionnel. Nous avons relevé à quel point leurs engagements corporels sont divers et particularisent aussi largement leurs trajectoires. Nos résultats montrent que ces engagements sont sous-tendus par trois dimensions du rapport au corps : l’autopréservation, l’instrumentalité et la compétition. La combinaison de ces dimensions permet de distinguer six profils qui, bien qu’étant plus ou moins proches ou éloignés de l’« habitus du champion », n’en demeurent pas moins compatibles avec la réalisation d’une carrière de haut niveau. Certain·e·s s’engagent dans leur rôle de sportif·ve avec en ligne de mire la performance, leur usage du corps s’alignant alors sur les impératifs du « savoir-être corporel » du haut niveau (Viaud, 2008). D’autres s’en éloignent, privilégiant la préservation de leur santé ou valorisant un rapport hédoniste au monde. Pourquoi ?
Notre enquête montre l’importance de la socialisation sportive, à savoir le type de discipline pratiquée et l’emprise du dispositif. On relève notamment un éventail des possibles corporels bien plus large au sein des sports mixtes qu’au sein des sports individuels féminins et masculins. Ces disciplines genrées ont en commun d’engendrer des engagements corporels aux antipodes : prophylactiques et démobilisés pour les sports féminins, maximalistes et démobilisés pour les sports masculins individuels. Tout se passe comme si les cultures corporelles de ces sports ne permettaient que des réponses « extrêmes » : dans le contrôle corporel intense ou très relâché. Cela rejoint en partie ce à quoi l’on pouvait s’attendre ; les disciplines caractérisées par un important contrôle des morphologies favorisent des engagements sous-tendus par une forte autosurveillance, même si elles peuvent également générer le rejet de la contrainte corporelle.
Si la pratique sportive exerce des effets socialisateurs puissants sur le type d’engagement corporel, il faut aussi prendre en considération la part que cet engagement doit aux socialisations antérieures ou parallèles (p. ex. : socialisation familiale, genre, classe). Force est de constater que l’effet de ces facteurs est moins net. La pratique sportive de haut niveau « n’écrase » évidemment pas les dispositions acquises antérieurement — une socialisation familiale sportive intensive favorise un engagement maximaliste, une origine populaire expose davantage aux sacrifices corporels qu’engendre l’emprise du dispositif sportif —, mais elle rebat fortement les cartes. Les manières genrées de s’engager corporellement dans le haut niveau constituent une illustration exemplaire puisque les effets de genre que nos analyses ont relevés sont inextricablement liés à des contextes spécifiques, c’est-à-dire à des types de disciplines. Les femmes présentent par exemple une propension à l’autopréservation plus élevée que les hommes, y compris au sein des sports masculins collectifs. Ainsi, la socialisation sexuée inversée que connaissent les femmes qui pratiquent ces disciplines (Mennesson, 2004 ; Schmitt et Bohuon, 2022) ne suffit pas à gommer les écarts avec les hommes, ce qui souligne la force des dispositions genrées. Pour autant, relevons que l’engagement corporel sacrificiel, qui se distingue comme le plus viril (p. ex. : glorification de la douleur), n’est pas davantage le fait des hommes. Le sport de haut niveau est donc bien un espace propice aux transgressions de genre.
Une question encore peu formulée par la sociologie du sport s’impose alors : qu’advient-il des dispositions conduisant à ces différents engagements corporels lors de l’après-carrière ? Au coeur de nos travaux, l’étude de cette question devrait permettre de mieux comprendre les conditions de perpétuation, de mise en veille ou encore de transfert des dispositions.
Appendices
Annexes
disciplines sportives et types de sport
La catégorisation des disciplines sportives selon leur orientation genrée s’est déroulée en trois étapes. Nous avons effectué une première classification sur la base des apports de la littérature et du « régime de genre » (Connell, 2014 ; Mennesson, 2007) qui caractérise les disciplines. Dans un deuxième temps, nous avons fixé des seuils selon le taux de participation féminine : 30 % ou moins pour les sports dits « masculins », de 31 à 69 % pour les sports dits « mixtes », 70 % et plus pour les sports dits « masculins ». La classification d’une discipline issue de notre première étape était confirmée lorsqu’elle présentait les critères fixés dans au moins l’un des quatre derniers rapports sur l’activité et la consommation sportives de la population suisse (Lamprecht et al., 2008, 2014, 2020 ; Lamprecht et Stamm, 2000). Trente disciplines ont été classées selon cette logique.
Dix-sept disciplines n’ont pu être classées selon ce procédé car elles ne figuraient pas dans les rapports précités. La troisième étape a donc consisté à classer ces disciplines. Nous nous sommes d’abord basé·e·s sur le sex-ratio observable dans des pays où les disciplines concernées sont largement pratiquées et où les données sont disponibles. Le CrossFit (Dominski et al., 2020), le curling[1], le triathlon[2] et l’ultimate frisbee[3] ont ainsi été classés parmi les sports mixtes.
Les disciplines pour lesquelles il n’existe à notre connaissance aucune statistique concernant le sex-ratio ont été classées sur la base de travaux spécifiques et/ou selon l’époque de l’introduction de catégories féminines aux Jeux olympiques. Suivant en cela Émilie Sablik et Christine Mennesson (2008), nous avons classé le football américain, le water-polo et le rugby parmi les sports masculins, en cela qu’ils impliquent « un engagement et un contact physique relativement intense » (p. 88). Parmi les sports masculins se trouvent encore l’escrime — qui s’est développé tout au long du xxe siècle comme un symbole de masculinité (Liu, 2022) et dont les compétitions féminines n’ont été pleinement admises aux Jeux olympiques qu’en 2004 —, les sports urbains — qui révèlent une discrimination de genre très marquée par l’accaparement des infrastructures urbaines par les hommes (Raibaud, 2022) —, le snowkite — le plus souvent classé parmi les « sports à risque » davantage prisés des hommes —, la force athlétique (haltérophilie) — qui, en tant que discipline de force musculaire, réunit les caractéristiques associées au masculin (Mennesson, 2005) — et le bobsleigh — perçu par le grand public comme un sport très « masculin » (Greer et Jones, 2013) et dont les femmes n’ont été admises aux Jeux olympiques qu’à partir de 2002. Bien qu’il soit généralement rangé dans la catégorie générique « athlétisme », nous avons décidé de considérer le lancer du poids comme un sport « masculin ». De fait, parmi les disciplines athlétiques mentionnées par nos répondants, il s’agit de la seule qui réunit les caractéristiques physiques (grande taille, musculature développée) traditionnellement attribuées au masculin, et l’on sait par ailleurs que les lanceuses de poids sont généralement perçues comme très éloignées des stéréotypes féminins (Torcolacci, 1997).
Le patinage de vitesse a été classé parmi les sports mixtes en raison de ses caractéristiques d’une part (absence de corps à corps) et de la participation relativement précoce des femmes dans cette discipline aux Jeux olympiques d’autre part (comme sport de démonstration dès 1931, puis comme discipline officielle dès 1960)[4]. Le pentathlon moderne a également été rangé dans la catégorie des sports mixtes car il comprend à la fois des sports masculins (escrime, tir au pistolet), féminins (équitation) et mixtes (natation, course à pied).
Le plongeon a été classé parmi les sports féminins en raison des qualités physiques qu’il requiert (grâce, souplesse, agilité), semblables à celles que l’on retrouve dans un sport tel quel la gymnastique rythmique (Mennesson et al., 2012). Enfin, la natation artistique a été considérée comme un sport féminin. Cette discipline a été pour ainsi dire exclusivement réservée aux femmes jusqu’à présent, et ça n’est qu’en 2024 que les hommes ont été autorisés à y participer aux Jeux olympiques.
Tableau A1
Catégorisation des disciplines sportives
l’emprise du dispositif sportif
La variable mesurant l’emprise du dispositif sportif est la première dimension d’une analyse des correspondances multiples (ACM) portant sur la carrière sportive. Elle inclut 26 variables et 69 modalités actives. Cette dimension capte la majorité de l’information avec un taux d’inertie corrigé de Benzécri de 57,7 % et représente l’emprise du dispositif sportif.
Le tableau présente les fréquences des variables actives de l’ACM sur la carrière sportive et la contribution des modalités à la première dimension mesurant l’emprise du dispositif (tableau A2).
Tableau A2
Fréquences des variables actives de l’ACM sur la carrière sportive et contribution des modalités à l’emprise du dispositif sportif (première dimension de l’ACM)
Notes : N = 1342. Les données manquantes ont été traitées comme des modalités passives (elles ne contribuent pas à la construction des axes). En gras, les modalités dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne des modalités (100/69 = 1,45).
a De la part de son entraîneur·se et/ou de son encadrement sportif.
b En lien avec sa pratique sportive.
la socialisation familiale au sport
La socialisation familiale au sport est mesurée avec la première dimension d’une analyse des correspondances multiples (ACM) portant sur 9 variables (tableau A3). Cette dimension capte l’essentiel de l’information avec un taux d’inertie corrigé de Benzécri de 93,3 % et représente l’intensité de la socialisation familiale au sport.
Tableau A3
Fréquences des variables actives de l’ACM sur la socialisation familiale au sport et contribution des modalités à l’intensité de la socialisation familiale au sport (première dimension de l’ACM)
Notes : N = 1342. Les données manquantes ont été traitées comme des modalités passives (c’est-à-dire qu’elles ne contribuent pas à la construction des axes). En gras, les modalités dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne des modalités (100/24 = 4,17).
l’engagement corporel
Tableau A4
Fréquences des variables mesurant l’engagement corporel
Note : N = 1342.
a Au sommet de la carrière, le degré d’accord avec la variable « avoir le corps idéal pour sa discipline » sur une échelle allant de 0 (pas du tout d’accord) à 10 (tout à fait d’accord).
Tableau A5
Taux modifiés d’inertie de l’ACM de l’engagement corporel
Tableau A6
Contribution des modalités actives de l’engagement corporel
Notes : N = 1342. Les données manquantes ont été traitées comme des modalités passives (elles ne contribuent pas à la construction des axes). En gras, les modalités dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne des modalités (100/89 = 1,12).
a Au sommet de la carrière, le degré d’accord avec la variante « avoir le « corps idéal pour sa discipline » sur une échelle allant de 0 (pas du tout d’accord) à 10 (tout à fait d’accord).
Tableau A7
Caractérisation de chaque cluster par les 3 premières dimensions de l’ACM de l’engagement corporel
Notes : N = 1342. Une valeur-test représente un écart « standardisé » entre la moyenne des individus du cluster (moyenne dans le cluster) et la moyenne générale (moyenne globale). Les valeurs-tests permettent de classer les dimensions pour caractériser chaque cluster (Lebart et al., 2006). La valeur des valeurs-tests constitue une mesure de similarité (lorsque la valeur est positive) ou de dissimilarité (lorsque la valeur est négative) entre le cluster et la dimension.
Tableau A8
Modèle expliquant l’appartenance à un type d’engagement corporel
Notes : N = 1114. Régression logistique multinomiale estimée avec le package R nnet (Venables et Ripley, 2002). Les coefficients sont des log-odds, ES signifie erreur standard. En gras, les coefficients avec une valeur p < 0,05. Pour les variables indépendantes catégorielles, les catégories de référence sont : homme, origine sociale non populaire, sport masculin collectif, sportif professionnel au sommet de la carrière, fin du sommet de la carrière avant 1990.
Notes
-
[1]
Les attentes vis-à-vis des professionnel·le·s de la santé ont été considérées comme des indicateurs d’engagement corporel, au contraire des consultations de ces professionnel·le·s qui ont été considérées comme relevant de l’emprise du dispositif sportif (tableau A2).
-
[2]
Voire propre à un groupe particulier au sein d’une discipline (p. ex. : les femmes dans une discipline masculine, Mennesson, 2004).
-
[3]
Précisons que dans cet article, nous examinerons les produits de ces imbrications de socialisations et non leurs modalités.
-
[4]
Parmi les plus étudiés : l’adhésion familiale au projet (Croquette, 2004) et la socialisation par les pairs (Bertrand, 2011).
-
[5]
Étudiant les sports de nature impliquant un danger d’accident, Routier et Soulé (2012) définissent l’engagement corporel comme « un type d’exposition au danger, conscient et assumé, dont sont porteuses certaines modalités de pratique » (2012, p.64-65). Notre usage de ce terme est nettement distinct.
-
[6]
Dans la lignée de Wacquant (1989), Viaud (2008) parle du paradoxe d’un « double corps ».
-
[7]
Chaque sport étant « en affinité avec les champs d’intérêt, les goûts, les préférences d’une catégorie sociale déterminée » (Bourdieu, 1987, p. 204), il a été montré que certains sont prisés par les classes moyennes et supérieures quand d’autres le sont plutôt par les classes populaires (Breuer et al., 2011 ; Clément, 1995). Ces tendances s’observent en Suisse où des sports tels que le golf, la voile, le tennis, le ski alpin ou la course à pied sont davantage pratiqués par les individus percevant un revenu supérieur à la moyenne nationale (Lamprecht et al., 2014).
-
[8]
Concept proposé par Connell (2014).
-
[9]
Un dispositif se définit comme un « ensemble relativement cohérent de pratiques, discursives et non discursives, d’architectures, d’objets ou de machines, qui contribue à orienter les actions individuelles et collectives dans une direction » (Lahire, 2005, p. 323).
-
[10]
La notion de « culture somatique » sera, quant à elle, employée dans sa version originelle (Boltanski, 1971) pour désigner la différenciation des rapports au corps selon les milieux sociaux.
-
[11]
Au sein de chaque discipline ou ensemble de disciplines apparentées, on peut identifier des « corps légitimes » qui peuvent être envisagés comme « les corps socialement construits comme des références — implicites ou explicites — et participant à la différenciation et à la hiérarchisation entre groupes sociaux » (Boni-Le Goff, 2016, p. 159).
-
[12]
Notamment dans les temps d’après-match, ces « moments libératoires où peuvent s’immiscer des pratiques réputées déviantes » du quotidien (Rasera, 2012, p. 473).
-
[13]
Ces chercheuses montrent néanmoins que l’absence de capital sportif parental ne préjudicie pas à la réussite sportive en raison notamment de « l’adhésion ‘‘enchantée’’ » (2012, p. 11) des parents non détenteurs d’un capital sportif, appartenant souvent aux classes populaires.
-
[14]
Dans le sens où au moins l’un de leurs parents pratique ou a pratiqué une activité physique et sportive (Forté et Mennesson, 2012).
-
[15]
Le questionnaire a été soumis à un comité de 5 expert·e·s en sociologie du sport, de la socialisation et du corps, puis prétesté auprès de 27 ex-sportif·ve·s de haut niveau. Le questionnaire est propre à l’étude mais utilise également des questions provenant d’échelles et de questionnaires validés (p. ex. : European Social Survey, enquête suisse sur la santé, Panel suisse de ménages).
-
[16]
Lorsque le numéro du tableau ou du graphique est accolé à la lettre A, cela signifie que celui-ci se situe en annexe.
-
[17]
Il n’existe en Suisse aucun registre officiel des ex-sportif·ve·s de haut niveau à partir duquel un échantillon puisse être tiré. Certaines fédérations disposaient d’une liste d’ex-sportif·ve·s mais n’ont pas souhaité collaborer avec nous, d’autres fédérations n’étaient même pas en possession d’une liste de ce type.
-
[18]
Le choix des disciplines reposait sur 3 critères : 1) le type d’entraînement pratiqué, à savoir entraînement de type endurance, de type explosivité, ou de type mixte (Bäckmand et al., 2010) ; 2) l’aspect individuel, collectif ou mixte de la discipline ; 3) le régime de genre.
-
[19]
Les variables retenues pour mesurer l’engagement se limitent à la période du sommet de la carrière, définie dans le questionnaire comme telle : « période durant laquelle vos performances sportives étaient les plus élevées ».
-
[20]
Notre regroupement implique certaines concessions. Même s’il est vrai que les sports de combat et arts martiaux ne sont pas totalement homogènes en termes de culture corporelle — certaines disciplines privilégiant par exemple la souplesse des corps ou l’esthétique des combats quand d’autres valorisent les logiques de « corps à corps » (Clément, 1981), nous avons fait le choix de cette catégorisation les distinguant des sports masculins collectifs dont les logiques de groupe influencent considérablement les pratiques corporelles.
-
[21]
Dans un article consacré au pouvoir socialisateur des objets de consécration sportive, Forté (2022) montre que ces objets « chargés d’une symbolique forte […] peuvent être consciemment ou inconsciemment utilisés (par les athlètes, leur entourage proche et l’institution sportive) pour modeler et consolider les vocations » (Forté, 2022, p. 80) et qu’au sein des familles, le rapport aux trophées est variable selon les milieux sociaux.
-
[22]
La valeur minimale de 7 ans peut sembler très basse. Elle est liée au fait que notre échantillon compte 2 individus dont l’âge minimal au sommet de leur carrière était respectivement de 7 et 8 ans. Nous avons contrôlé les modalités de carrière : ces ex-sportives ont pratiqué la gymnastique (un sport précoce), ont participé à des compétitions internationales, s’entraînaient plus de 20 heures par semaine et ont mis fin à leur carrière après 16 ans.
-
[23]
Cette variable permet de mesurer les effets possibles des transformations du champ sportif, être une footballeuse en 1990 n’équivalant pas à être une footballeuse en 2010. Son ajout dans notre modèle permet aussi de limiter les biais de notre analyse qui pourraient survenir en raison d’une illusion rétrospective.
-
[24]
Nous avons réalisé une variante de l’ACM qui permet de traiter les données manquantes comme des catégories passives (des catégories ne contribuant pas à la détermination des axes) tout en conservant l’ensemble des individus. L’utilisation des dimensions de l’ACM plutôt que les variables initiales pour la classification visait à obtenir des classes plus homogènes sans perdre d’information (Nakache et Confais, 2000) et à supprimer le bruit des données (Husson et al., 2010).
-
[25]
« Une enveloppe convexe est le polygone convexe le plus petit parmi ceux qui contiennent un ensemble de points » (Robette, 2023).
-
[26]
La description des clusters utilise les variables qui ont servi à réaliser l’ACM.
-
[27]
Quel que soit le profil, la proportion de sportif·ve·s de niveau international est toujours majoritaire. C’est parmi les hédonistes qu’elle est la plus faible (53,9 %) et parmi les maximalistes qu’elle est la plus élevée (84,0 %).
-
[28]
L’exercice d’une activité professionnelle parallèle à la carrière sportive implique des contraintes temporelles susceptibles d’influencer l’engagement (p. ex. : nombre d’heures d’entraînement, de sommeil).
-
[29]
Chez les pratiquant·e·s de sports de combat et arts martiaux, 66,7 % répondent « plutôt d’accord ou tout à fait d’accord » à l’affirmation « Je contrôlais mon poids au quotidien ».
-
[30]
Plus de la moitié des individus pratiquant un sport féminin (53,9 %) répondent « plutôt d’accord ou tout à fait d’accord » à l’affirmation « Je contrôlais mon poids au quotidien ». Ils sont par ailleurs 41,3 % à déclarer subir des sanctions en cas de prise de poids.
-
[31]
Pas moins de 69,0 % des pratiquant·e·s de sports féminins déclarent être victimes de maltraitance (physique ou psychologique) de la part de leur entraîneur·se ou de leur encadrement sportif. En comparaison, les proportions pour les autres disciplines varient de 18,8 % pour les sports masculins individuels, 28,9 % pour les sports mixtes à 46,2 % pour les sports masculins collectifs.
-
[1]
www.curling.ca/about-curling/business-of-curling/surveys-and-reports/
- [2]
- [3]
-
[4]
https://olympics.com/fr/infos/le-patinage-de-vitesse-feminin-pour-la-premiere-fois- aux-jeux
Bibliographie
- Aceti, M. et Jaccoud, C. (2012). Sportives dans leur genre ? : Permanences et variations des constructions genrées dans les engagements corporels et sportifs. Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Adjepong, A. (2017). ‘We’re, like, a cute rugby team’ : How whiteness and heterosexuality shape women’s sense of belonging in rugby. International Review for the Sociology of Sport, 52(2), 209‑222.
- Arel-Bundock, V. (2023). marginaleffects : Predictions, Comparisons, Slopes, Marginal Means, and Hypothesis Tests. R package version 0.11.1. Repéré le 15 juin 2023 à https://vincentarelbundock.github.io/marginaleffects/
- Bäckmand, H., Kujala, U. M., Sarna, S. et Kaprio, J. (2010). Former Athletes’ Health-Related Lifestyle Behaviours and Self-Rated Health in Late Adulthood. International Journal of Sports Medicine, 31(10), 751‑758.
- Baillette, F. et Liotard, P. (1999). Sport et virilisme. Association Osiris.
- Beauchez, J. (2017). La « douce science » des coups : La boxe comme paradigme d’une sociologie de la domination. Revue française de sociologie, 58(1), 97‑120.
- Berg, A., Duffy, D. et DuBois, S. (2023) Elegant violence : the promise and peril of a new ‘‘feminine’’ sport ethic. Sport in Society, 26(2), 335‑349.
- Bertrand, J. (2011). La vocation au croisement des espaces de socialisation. Étude sociologique de la formation des footballeurs professionnels. Sociétes contemporaines, 82(2), 85‑106.
- Bertrand, J. (2012). La fabrique des footballeurs. La Dispute.
- Bertrand, J. et Rasera, F. (2019). Au-delà du « miracle » et de la « chute » : jeunesses populaires et centres de formation au métier de footballeur. Dans S. Faure et D. Thin (dir.), S’en sortir malgré tout : parcours en classes populaires (p. 131‑152). La Dispute.
- Beunardeau, P. (2019). Filles et conduites “viriles” : L’identité féminine réinventée des “Niafou” Dans S. Ayral et Y. Raibaud (dir.), Pour en finir avec la fabrique des garçons. Volume 1 : À l’école (p. 83‑108). Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.
- Boltanski, L. (1971). Les usages sociaux du corps. Annales, 26(1), 205‑233.
- Boni-Le Goff, I. (2016). Corps légitime. Dans J. Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre (p. 159-169). La Découverte.
- Bourdieu, P. (1979). La Distinction. Critique sociale du jugement. Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P. (1987).Chose dites. Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P. (1998). La domination masculine. Seuil.
- Breuer, C., Hallmann, K. et Wicker, P. (2011). Determinants of sport participation in different sports. Managing Leisure, 16(4), 269‑286.
- Channon, A. et Phipps, C. (2017). Pink gloves still give black eyes : Exploring ‘Alternative’ Femininity in Women’s Combat Sports. Martial Arts Studies, (3), 24‑37.
- Charlesworth, H. (2004). Sports-related injury, risk and pain : the experiences of English female university athletes [thèse de doctorat, Loughborough University]. Loughborough University Institutional Repository. https://core.ac.uk/reader/288390199
- Clément, J.-P. (1981). La force, la souplesse et l’harmonie. Étude comparée de trois sports de combat : (Lutte - Judo - Aïkido) Dans C. Pociello et al. (dir.)Sports et société : approche socio-culturelle des pratiques (p. 281‑301) Vigot,.
- Clément, J.-P. (1995). Processus de socialisation et expressions identitaires : l’apport de la théorie de l’habitus et du champ en sociologie du sport Dans J.-P. Augustin et J.-P. Callède (dir.), Sport, relations sociales et action collective (p. 117‑126). Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.
- Clément, X. (2014). Sport et masculinités : hybridation des modèles hégémoniques au sein du champ [thèse de doctorat, Université Paris 11 et Université de Montréal]. Papyrus. http://hdl.handle.net/1866/11945
- Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. L. Erlbaum Associates.
- Collins, M. F. et Buller, J. R. (2003). Social Exclusion from High-Performance Sport. Are all Talented Young Sports People Being Given an Equal Opportunity of Reaching the Olympic Podium ?. Journal of Sport and Social Issues, 27(4), 420‑442.
- Connell, R. (2014). Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, Éditions Amsterdam.
- Croquette, E. (2004). Les sportives de haut niveau d’origine nord-africaine : type d’investissement sportif, cadres de socialisation et configurations familiales. Staps 66(4), 179‑193.
- Dalgalarrondo, S. (2015). Les dispositifs de prise de risques dans le rugby professionnel. Sociologie du travail. 57(4), 516‑531.
- Damont, N. et Pégard, O. (2017). Le masculin haut en couleurs. L’apprentissage du football professionnel. Ethnologie française, (165), 131‑140.
- Darmon, M. (2006). La socialisation. Armand Colin.
- Dominski, F. H., Serafim, T. T., Siqueira, T. C. et Andrade, A. (2020). Psychological variables of CrossFit participants : a systematic review. Sport Sciences for Health,17(1), 21‑41.
- Fleuriel, S. et Schotté, M. (2011). La reconversion paradoxale des sportifs français : Premiers enseignements d’une enquête sur les sélectionnés aux jeux olympiques de 1972 et 1992. Sciences sociales et sport,4(1), 115‑140.
- Forté, L. (2006). Fondements sociaux de l’engagement sportif chez les jeunes athlètes de haut niveau. Science & Motricité, (59), 55‑67.
- Forté, L. (2018). Les effets socialisateurs de la blessure : de l’érosion au renforcement des vocations athlétiques de haut niveau. Sciences sociales et sport,12(2), 85‑111.
- Forté, L. (2022). Fabriquer une élite athlétique : le pouvoir socialisateur des objets de consécration sportive. Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, 118(4), 79‑90.
- Forté, L. et Mennesson, C. (2012). Réussite athlétique et héritage sportif. SociologieS. https://doi.org/10.4000/sociologies.4082
- Greer J. D. & Jones A. H. (2013). Beyond Figure Skating and Hockey. How US Audiences Gender Type Winter Olympic Sports. The International Journal of Sport and Society,3(4), 129‑140.
- Guérandel, C. et Mardon, A. (2022). Introduction. Socialisations de genre durant la jeunesse : la part du sport. Agora débats/jeunesses, 90(1), 58‑69.
- Husson, F., Josse, J. et Pagès, J. (2010). Principal component methods – hierarchical clustering – partitional clustering : why would we need to choose for visualizing data ? (Rapport technique).
- Jaccoud, C., Tissot, L. et Pedrazzini, Y. (2000). Sports en Suisse : traditions, transitions et transformations. Éd. Antipodes « Existences et société ».
- Krane, V. (2001). We Can Be Athletic and Feminine, But Do We Want To ? Challenging Hegemonic Femininity in Women’s Sport. Quest, 53(1), 115‑133.
- Laberge, S. et Sankoff, D. (1988). Activités physiques, habitus corporel et styles de vie. Dans J. Harvey et H. Cantelon (dir.), Sports et pouvoir : les enjeux sociaux au Canada (p. 277-299). Presses de l’Université d’Ottawa.
- Lahire, B. (2004). Sociologie dispositionnaliste et sport. Dans Dispositions et pratiques sportives. Débats actuels en sociologie du sport (p. 23‑36). L’Harmattan.
- Lamprecht, M., Bürgi, R. et Stamm, H. (2020). Sport Suisse 2020. Activité et consommation sportives de la population suisse. Office fédéral du sport OFSPO.
- Lamprecht, M., Fischer, A. et Stamm, H. (2008). Sport Suisse 2008. Activité et consommation sportives de la population suisse. Office fédéral du sport OFSPO.
- Lamprecht, M., Fischer, A. et Stamm, H. (2014). Sport Suisse 2014. Activité et consommation sportives de la population suisse. Office fédéral du sport (OFSPO).
- Lamprecht, M. et Stamm, H. (2000). Sport Suisse 2000. Activité et consommation sportives de la population suisse. L&S Institut de recherche sociale et conseil.
- Lê, S., Josse, J. et Husson, F. (2008). FactoMineR : An R Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical Software, 25, 1‑18.
- Lefèvre, N. (2010). Construction sociale du don et de la vocation de cycliste. Sociétés contemporaines, 80(4), 47-71.
- Leroux, M. (2002). Consommations intégrées et sport de haut niveau. Dans C. Faugeron et M. Kokoreff (dir.), Société avec drogues (p. 79‑97). Érès.
- Liu G. C. (2022). Breaking the Barriers in Women’s Fencing : Historical Roots, Title IX and Empowerment of Women. Journal of International Women’s Studies, 24(3). https://vc.bridgew.edu/jiws/vol24/iss3/6
- Longchamp, P., Braizaz, M., Tawfik, A. et Toffel, K. (2023). Après l’effort… que devient le corps ? Ruptures et continuités corporelles chez les ex-sportif·ve·s de haut niveau. Sciences sociales et sport, (21), 7‑32.
- Mennesson, C. (2004). Être une femme dans un sport « masculin ». Modes de socialisation et construction des dispositions sexuées. Sociétés contemporaines, 55(3), 69‑90.
- Mennesson, C. (2005). Être une femme dans le monde des hommes. Socialisation sportive et construction du genre. L’Harmattan.
- Mennesson, C. (2007). Les sportives ‘professionnelles’ : travail du corps et division sexuée du travail. Cahiers du Genre, 42(1), 19‑42.
- Mennesson, C., Bertrand, J. et Court, M. (2016). Forger sa volonté ou s’exprimer : les usages socialement différenciés des pratiques physiques et sportives enfantines. Sociologie, 7(4), 393‑412.
- Mennesson, C., Visentin, S. et Clément, J.-P. (2012). L’incorporation du genre en gymnastique rythmique. Ethnologie française, 42(3), 591‑600.
- Messner, M. (2022). Idéologie du genre, sport de jeunes et production de l’essentialisme mou. Sciences sociales et sport, 19(1), 155‑185.
- Moret, O. et Ohl, F. (2019). Social class, the elite hockey player career and educational paths. International Review for the Sociology of Sport, 54(8), 899-920.
- Nakache, J.-P. et Confais, J. (2000). Méthodes de classification – avec illustrations SPAD et SAS, Cisia-CERESTA.
- Nouiri-Mangold, S. (2019). À cheval sur le poids. Ethnographie d’un bricolage corporel à visée professionnelle : le cas des jockeys de galop. Anthropologie & Santé, 18. https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.5002
- Ohl, F. (2003). Les objets sportifs : Comment des biens banalisés peuvent constituer des référents identitaires. Anthropologie et Sociétés, 2(27), 167‑184.
- Papin, B. (2007). Conversion et reconversion des élites sportives : Approche socio-historique de la gymnastique artistique et sportive. Éditions L’Harmattan.
- Penin, N. (2012). Les sports à risque. Sociologie du risque, de l’engagement et du genre. Artois Presses Université.
- Pike, E. C. J. (2005). ‘Doctors Just Say “Rest and Take Ibuprofen”’ : A Critical Examination of the Role of ‘Non-Orthodox’ Health Care in Women’s Sport. International Review for the Sociology of Sport, 40(2), 201‑219.
- Pociello, C. (1995). Les cultures sportives. PUF.
- Pouillaude, A. (2022). Au-delà de l’apparence : les coulisses du travail sportif des pratiquantes de twirling bâton à travers le prisme de l’âge. Agora débats/jeunesses, 90(1), 103‑114.
- Quidu, M. et Bohuon, A. (2022). La Méthode Lafay de musculation : une instance de façonnage anatomiquement différencié des corps des femmes et des hommes. SociologieS. https://doi.org/10.4000/sociologies.18848
- R Core Team (2023). R : A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.. Repéré le 15 juin 2023 à https://www.R-project.org/.
- Raibaud Y. (2022). Genre, urbanité et pratiques sportives. Une étude des espaces du temps libre à Bordeaux et Genève. Sciences sociales et sport, 20(2), 15‑35.
- Rasera, F. (2012). Le métier de footballeur. Les coulisses d’une excellence sportive. Université Lumière Lyon 2.
- Rasera, F. (2016). Des footballeurs au travail : Au coeur d’un club professionnel. Agone.
- Read, D., Smith, A. C. T. et Skinner, J. (2022). Theorising painkiller (mis)use in football using Bourdieu’s practice theory and physical capital. International Review for the Sociology of Sport, 58(1), 66-86.
- Robette, N. (2023). GDAtools : Geometric Data Analysis in R. version 2.0.
- Routier, G. et Soulé, B. (2012). L’engagement corporel : une alternative au concept polythétique de sports à risque en sciences sociales. Science et Motricité, 3(77), 61‑71.
- Ryou, J. et Lee, E. (2023). Capital game : male athletes’ rationalisation of playing hurt and reproduction of the risk, pain, and injury custom in professional combat sports. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 1(16), 1‑18.
- Sablik, E. et Mennesson, C. (2008). Carrières sexuelles et pratiques sportives. Sciences sociales et sport, (1), p. 79‑113.
- Sabo, D. (2004). The Politics of Sports Injury : Hierarchy, Power, and Pain Principle. Dans K. Young (dir.), Sporting bodies, damaged selves : Sociological studies of sport-related injury (vol. 2, p. 59‑80), Elsevier.
- Saouter, A. (2000). « Être rugby ». Jeux du masculin et du féminin. Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
- Schmitt, A. et Bohuon, A. (2022). Et si le surfeur des plus grosses vagues au monde était une femme ? La subversion de la bi-catégorisation sexuée par les pionnières du surf xxl Politix, 136(4), 103‑126.
- Schotté, M. (2015). Dans la course. La construction d’une hiérarchie en action. Actes de la recherche en sciences sociales, 209(4), 100‑115.
- Scrinzi, F. (2016). Care. Dans J. Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre, La Découverte.
- Théberge, N. (1995). Sport, caractère physique et différenciation sexuelle. Sociologie et sociétés, 27(1), 105‑116.
- Torcolacci M. (1997). Social factors which influence Canadian women’s participation in the shot put [Queen’s University]. OMNI. https://ocul-qu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/01OCUL_QU/r9dor2/alma9910956003405158
- Venables, W. N. et Ripley, B. D. (2002). Modern Applied Statistics with S. Springer.
- Viaud, B. (2008). L’apprentissage de la gestion des corps dans la formation des jeunes élites sportives. La revue internationale de l’éducation familiale, (24), 57‑76.
- Viaud, B. et Papin, B. (2012). Temps sportif, santé du champion et logique de l’urgence. Staps, 96-97(2), 9‑27.
- Vigarello, G. (dir.) (2011). Virilités sportives. Dans A. Corbin et J.-J. Courtine (dir.), Histoire de la virilité : Tome 3, La virilité en crise ? Le xxe-xxie siècle. Seuil.
- Wacquant, L. J. D. (1989). Corps et âme. Notes ethnographiques d’un apprenti-boxeur. Actes de la recherche en sciences sociales, 80(1), 33‑67.
- Wacquant, L. (2014). Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur. Agone.
- Young, K. (2005). Sporting Bodies, Damaged Selves : Sociological Studies of Sports-Related Injury. Emerald Publishing Limited.
List of figures
Schéma 1
Principaux déterminants de l’engagement corporel dans le sport de haut niveau
Graphique 1
Six profils d’engagement corporel. Partition issue d’une analyse de classification sur le plan factoriel 1-2
Graphique 2
Six profils d’engagement corporel. Partition issue d’une analyse de classification sur le plan factoriel 1-3
Schéma 2
Association entre les 6 types d’engagement corporel et les dimensions de l’ACM
List of tables
Tableau 1
Indicateurs de l’engagement corporel au sommet de la carrière sportive[19]
Tableau 2
Facteurs explicatifs des types d’engagement corporel
Notes : N = 1342. Les variables mesurant la fréquence des blessures aiguës et subites et celle des douleurs chroniques durant la carrière (codées jamais, rarement, parfois, souvent et en permanence) ont été recodées comme des variables numériques variant de 0 (jamais) à 4 (en permanence), le BIC indiquant un meilleur ajustement du modèle de régression.
Tableau 3
Les 6 types d’engagement corporel
Tableau 4
Effets marginaux moyens (A) et effets marginaux conditionnels (B)
Notes : N = 1114. Effets marginaux calculés à partir du modèle de régression logistique multinomiale. Est. : signifie estimation et ES, erreur standard. En gras, les effets marginaux avec une valeur p < 0,05. Pour les variables indépendantes catégorielles, les catégories de référence sont : homme, origine sociale non populaire, sport masculin collectif.
Tableau A1
Catégorisation des disciplines sportives
Tableau A2
Fréquences des variables actives de l’ACM sur la carrière sportive et contribution des modalités à l’emprise du dispositif sportif (première dimension de l’ACM)
Notes : N = 1342. Les données manquantes ont été traitées comme des modalités passives (elles ne contribuent pas à la construction des axes). En gras, les modalités dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne des modalités (100/69 = 1,45).
a De la part de son entraîneur·se et/ou de son encadrement sportif.
b En lien avec sa pratique sportive.
Tableau A3
Fréquences des variables actives de l’ACM sur la socialisation familiale au sport et contribution des modalités à l’intensité de la socialisation familiale au sport (première dimension de l’ACM)
Tableau A4
Fréquences des variables mesurant l’engagement corporel
Tableau A5
Taux modifiés d’inertie de l’ACM de l’engagement corporel
Tableau A6
Contribution des modalités actives de l’engagement corporel
Notes : N = 1342. Les données manquantes ont été traitées comme des modalités passives (elles ne contribuent pas à la construction des axes). En gras, les modalités dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne des modalités (100/89 = 1,12).
a Au sommet de la carrière, le degré d’accord avec la variante « avoir le « corps idéal pour sa discipline » sur une échelle allant de 0 (pas du tout d’accord) à 10 (tout à fait d’accord).
Tableau A7
Caractérisation de chaque cluster par les 3 premières dimensions de l’ACM de l’engagement corporel
Notes : N = 1342. Une valeur-test représente un écart « standardisé » entre la moyenne des individus du cluster (moyenne dans le cluster) et la moyenne générale (moyenne globale). Les valeurs-tests permettent de classer les dimensions pour caractériser chaque cluster (Lebart et al., 2006). La valeur des valeurs-tests constitue une mesure de similarité (lorsque la valeur est positive) ou de dissimilarité (lorsque la valeur est négative) entre le cluster et la dimension.
Tableau A8
Modèle expliquant l’appartenance à un type d’engagement corporel
Notes : N = 1114. Régression logistique multinomiale estimée avec le package R nnet (Venables et Ripley, 2002). Les coefficients sont des log-odds, ES signifie erreur standard. En gras, les coefficients avec une valeur p < 0,05. Pour les variables indépendantes catégorielles, les catégories de référence sont : homme, origine sociale non populaire, sport masculin collectif, sportif professionnel au sommet de la carrière, fin du sommet de la carrière avant 1990.