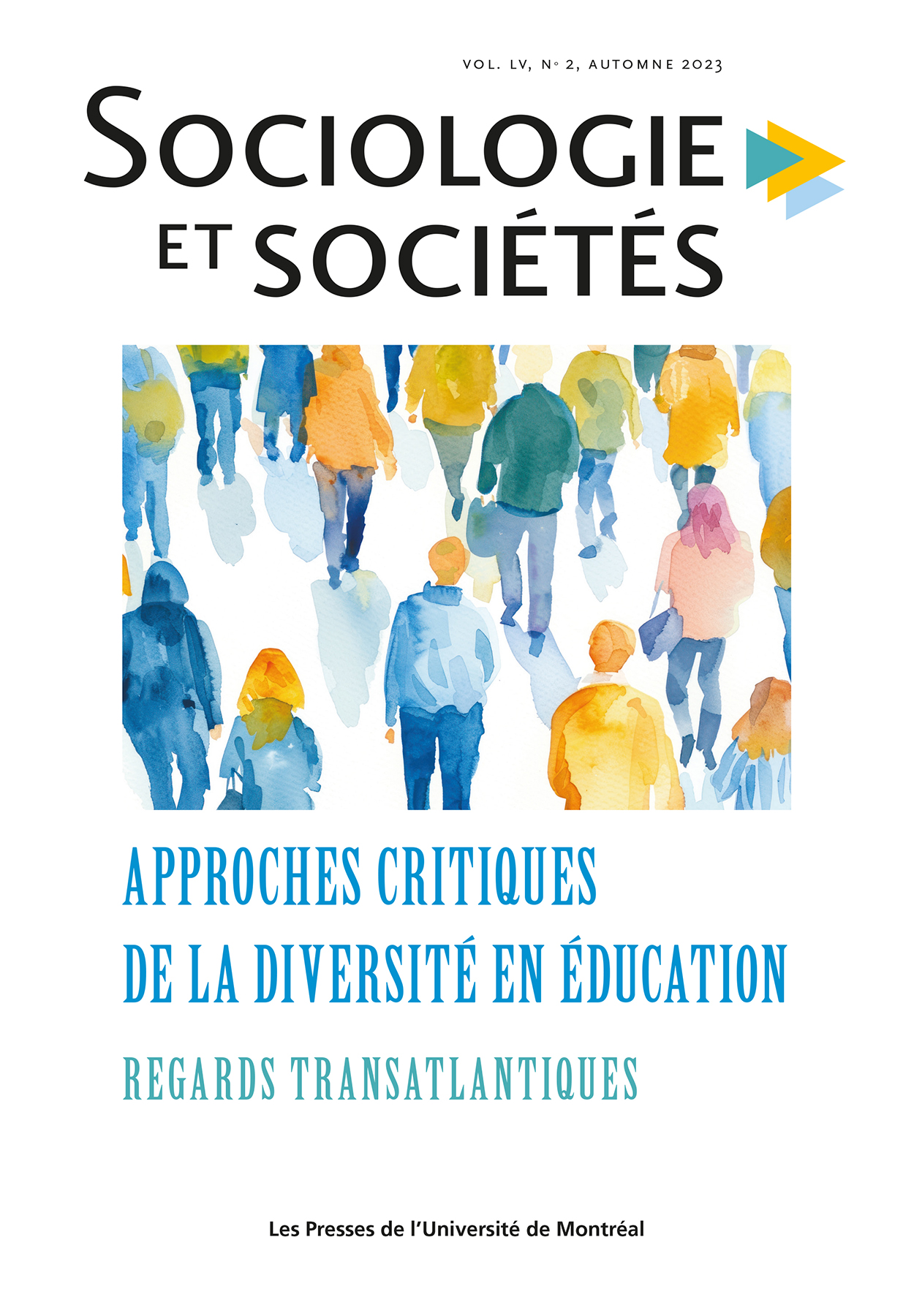Abstracts
Résumé
Depuis 2015, le Québec a instauré des politiques de prévention de la radicalisation violente, particulièrement dans les cégeps. Cet article analyse l’impact de ces mesures sur les jeunes musulman·e·s racisé·e·s, principalement issu·e·s des communautés maghrébines. Basée sur les récits de 52 étudiant·e·s, cette étude met en lumière comment l’association de leur appartenance raciale et religieuse les expose à des dynamiques de suspicion accrue, de contrôle et de marginalisation. À travers quatre études de cas, l’article illustre les conséquences de ces politiques sur l’expérience socioscolaire des étudiant·e·s musulman·e·s racisé·e·s et invite à repenser ces approches sécuritaires afin de préserver l’inclusion et la réussite éducative pour tous·tes.
Mots-clés :
- radicalisation violente,
- prévention,
- cégep,
- racialisation,
- islamophobie
Abstract
Since 2015, Quebec has introduced policy to prevent violent radicalization, especially in CEGEPs. This article analyzes the impact of these measures on racialized Muslim youth, most of whom were from North African communities. Based on the experiences of 52 students, this study highlights how the association of their race and religious affiliation exposes them to dynamics of increased suspicion, control and marginalization. Through four case studies, this article illustrates the consequences of these policies on the socio-academic experiences of racialized Muslim students and invites us to rethink these safety approaches to maintain the inclusion and educational success of all students.
Keywords:
- Violent radicalization,
- prevention,
- CEGEP,
- racialization,
- Islamophobia
Resumen
Desde 2015, Quebec pone en práctica políticas para prevenir la radicalización violenta, en particular en las instituciones de estudios preuniversitarios (CÉGEP). El presente artículo analiza el impacto de estas medidas en los/as jóvenes musulmanes/as racializados/as provenientes de comunidades magrebíes. En función de los relatos de 52 estudiantes, el estudio pone de relieve de qué forma la combinación de su raza y su religión los expone a dinámicas de mayor sospecha, control y marginalización. Mediante cuatro estudios de casos, el artículo ilustra los efectos de las mencionadas políticas sobre la experiencia social y educativa de los/as estudiantes musulmanes/as racializados/as y propone replantearse estos enfoques seguros para preservar la inclusión y el éxito académico de todo el mundo.
Palabras clave:
- radicalización violenta,
- prevención,
- cégep,
- racialización,
- islamofobia
Article body
En 2015, le Québec a été marqué par une série d’événements qui ont cristallisé le débat public sur la « radicalisation violente ». À la mi-janvier, les médias rapportent que six jeunes musulman·e·s québécois·e·s, dont quatre élèves de cégep[1], seraient parti·e·s rejoindre des groupes armés en Syrie (Radio-Canada, 26 février 2015). Quelques mois plus tard, dix autres jeunes, soupçonné·e·s de vouloir quitter le Québec pour la Syrie, ont été arrêté·e·s à l’aéroport de Montréal (Radio-Canada, 20 mai 2015). Ces événements ont poussé le gouvernement à élaborer des stratégies de prévention cherchant à compléter les mesures répressives alors jugées insuffisantes pour lutter contre la violence politique (Rousseau, 2019). Le Québec a ainsi été la première province canadienne à se doter d’un plan d’action gouvernemental intitulé « La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble », projet qui visait à coordonner les efforts de plusieurs ministères pour lutter contre la radicalisation (Québec, ministère de l’Immigration, 2015). La même année, le gouvernement a également lancé deux initiatives majeures : un partenariat avec l’UNESCO pour la création de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, et la mise en place du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), fruit d’une collaboration entre la Ville de Montréal et son service de police. Ces initiatives québécoises s’inspiraient largement des approches développées dans les pays européens pionniers en la matière, dont l’Angleterre, les Pays-Bas et le Danemark (McLaughlin, 2023). Bien que ces programmes aient souvent été présentés comme ayant une portée préventive universelle, ils ont généralement visé de manière disproportionnée les communautés musulmanes (Abbas, 2019 ; Crettiez, 2016 ; Lacroix, 2018), notamment les jeunes musulman·e·s racisé·e·s dans les milieux scolaires, en associant leurs pratiques religieuses ou culturelles à des risques de radicalisation violente (Arènes, 2014 ; El-Difraoui et Uhlmann, 2015 ; Kundnani, 2012 ; Ragazzi, 2017). Ils ont ainsi généralement contribué à la stigmatisation des musulman·e·s racisé·e·s en Europe, renforçant leur marginalisation et leur sur-surveillance dans le cadre des politiques de sécurité nationale (Ragazzi et Walmsley, 2024).
Au Québec aussi, les discussions médiatiques et politiques autour de la radicalisation violente se sont progressivement focalisées sur les jeunes musulman·e·s, racisé·e·s, en particulier au cégep (Riley et Bdeir, 2024). Le milieu éducatif cégépien est devenu un lieu central pour la mise en place d’initiatives de prévention contre la radicalisation (Michalon-Brodeur et al., 2018), avec des approches qui, tout comme en Europe, visent principalement les personnes racisées de confession musulmane (Ducol, 2015 ; Jamil, 2016 ; Rousseau, 2019). Cet article propose d’interroger la manière dont, à partir d’une catégorisation institutionnelle qui associe racialisation et religion, ces jeunes se retrouvent exposé·e·s à une double peine : non seulement ils·elles subissent des formes d’islamophobie ordinaire et de discrimination structurelle documentées (Bakali, 2016 ; Tiflati, 2017 ; Zine, 2008), mais ils·elles doivent également composer avec le poids supplémentaire de la stigmatisation liée aux politiques de prévention de la « radicalisation violente ».
Pour cela, nous nous concentrons sur un aspect particulier de notre recherche doctorale portant sur le vécu de 131 familles maghrébines et musulmanes dont les enfants ont été signalés pour radicalisation violente et/ou djihadisme politique, à savoir la manière dont ces initiatives marquent et redéfinissent les expériences et les parcours socioscolaires, des cégepien·ne·s. Nous nous appuyons en particulier sur le concept d’expérience socioscolaire, qui offre un cadre analytique permettant d’examiner simultanément les dimensions éducatives, sociales et relationnelles du vécu des élèves. Nous mettons ainsi en lumière la manière dont ces jeunes construisent leur trajectoire éducative à travers des interactions sociales marquées par des formes d’exclusion et de discrimination au quotidien, tout en explorant comment la catégorisation autour de la (dé)radicalisation vient s’imposer dans leur vie scolaire. Les recherches antérieures ont en effet documenté plusieurs défis auxquels ils·elles font face dans les milieux scolaires, notamment les difficultés académiques, sociales et familiales (Kanouté et Lafortune, 2011 ; Nadeau-Cosette, 2012), ainsi que les expériences de discrimination et d’islamophobie (Bakali, 2016 ; Khan, 2009 ; Riley et Bdeir, 2024 ; Sensoy et Stonebanks, 2009 ; Tiflati, 2017 ; Zine, 2008). Cependant, peu d’études se sont penchées sur l’impact des politiques de prévention de la radicalisation violente, mises en place dans les cégeps québécois et leur incidence sur l’expérience socioscolaire de ces étudiant·e·s au Québec.
C’est l’objectif du présent article. Nous commençons par revenir sur la littérature qui définit les principales composantes de l’expérience socioscolaire des jeunes musulman·e·s, en particulier ceux et celles issu·e·s des communautés maghrébines. Nous présentons ensuite notre cadre théorique et méthodologique, avant d’analyser quatre études de cas qui illustrent à la fois des dynamiques communes dans ces processus et des expériences uniques. Nous interrogeons pour conclure les coûts individuels, sociaux et politiques, induits par la participation du champ éducatif — en théorie, lieu de réflexions critiques et d’épanouissement personnel — aux politiques sécuritaires de la (dé)radicalisation.
l’expérience socioscolaire dans la littérature scientifique
L’école est reconnue dans la littérature scientifique comme un espace clé de socialisation qui devrait favoriser la réussite personnelle des élèves (Hassani et Kanouté, 2023 ; Kanouté et Lafortune, 2011 ; Potvin, Audet et Bilodeau, 2013 ; Van Zanten, 2015 ; Vatz Laaroussi, Kanouté et Rachédi, 2008). L’analyse des trajectoires scolaires des jeunes se fonde souvent sur le concept d’« expérience socioscolaire », permettant d’aborder les dimensions académiques, affectives et sociales de manière intégrée, ce qui reflète la complexité de leur vécu à l’école. Cette approche met l’accent sur l’importance des environnements scolaires et des interactions sociales pour
mieux comprendre les processus par lesquels les jeunes construisent leur expérience scolaire au fil de leur parcours de vie, à partir des processus d’adaptation socioculturelle, liés à l’expérience migratoire des jeunes ou de leur famille, des logiques proprement scolaires et des socialisations plurielles provenant de l’interaction avec la famille, les pairs et les acteurs scolaires.
Potvin, Audet et Bilodeau, 2013, p. 520
Dans la littérature, l’expérience socioscolaire est analysée comme un phénomène multidimensionnel, articulé autour de quatre axes principaux : individuel, scolaire, social et familial. Sur le plan individuel, les recherches mettent en lumière des facteurs cognitifs, émotionnels et comportementaux, tels que la perception de soi, la motivation et la gestion du stress, influencés par des variables sociodémographiques telles que l’âge, le genre et l’origine ethnique (Beekhoven et Dekkers, 2005 ; Blaya, 2010 ; Lessard et al., 2006). Sur le plan scolaire, le poids des caractéristiques structurelles et organisationnelles des établissements est souligné, incluant les méthodes pédagogiques, l’attitude du personnel et le climat scolaire (Blaya, 2010 ; Bridgeland, Dilulio et Morison, 2006 ; Hrimech et al., 1993 ; Janosz, 2000 ; Lecocq, Fortin et Lessard, 2014 ; Robertson et Collerette, 2005). La dimension sociale met en lumière, quant à elle, le rôle des interactions interpersonnelles, notamment les relations avec les pairs et enseignants, et leur impact sur l’intégration et le bien-être des élèves (Blaya, 2010 ; Bruno, Félix et Saujat, 2017 ; Fortin et al., 2004). La dimension familiale souligne enfin la part des conditions socioéconomiques, de l’implication parentale et du climat familial dans la réussite scolaire (Archambault et al., 2017 ; Deslandes, 2010 ; Janosz et al., 2000 ; Lessard et al., 2006 ; Potvin, Audet et Bilodeau, 2013 ; Suárez-Orozco, 2018).
Un autre corpus de la littérature prend spécifiquement pour objet l’expérience socioscolaire des jeunes issu·e·s de l’immigration et/ou racisé·e·s (Kamanzi et Collins, 2018 ; Kanouté et al., 2008 ; Martineau, 2003 ; Mc Andrew, 2016 ; Potvin, Audet et Bilodeau, 2013 ; Vatz Laroussi et al., 2005). Bien qu’iels partagent certains défis communs avec leurs pairs, leurs trajectoires apparaissent marquées aussi par des particularités liées à leur statut plurilingue, pluriethnique et pluriculturel, les obligeant à naviguer entre plusieurs espaces d’interactions sociales (Nadeau-Cosette, 2012 ; Ngo et Schleifer, 2005 ; Sabatier, 2008). Dès 1989, Laperrière souligne l’impact du racisme vécu par les jeunes immigrant·e·s sur leurs stratégies identitaires et d’inclusion, souvent marquées par un isolement ethnique et la création de frontières symboliques (Kanouté et al., 2016 ; Potvin, Audet et Bilodeau, 2013). Quelle que soit leur origine, les jeunes racisé·e·s sont confronté·e·s à des discriminations systémiques qui affectent leur adaptation cognitive et émotionnelle (Amin, 2012 ; Kanouté, 2002). Ce phénomène est renforcé par des normes scolaires en décalage avec celles de l’environnement familial (Kanouté et Lafortune, 2011). La recherche sur le stress scolaire des jeunes immigrant·e·s racisé·e·s met en lumière des défis d’acculturation, de barrières linguistiques et de difficultés d’adaptation psychosociale (Potvin et Leclercq, 2010 ; Mehana et Reynolds, 2004 ; Kushnick, 1999). Certaines études montrent aussi les stratégies de résistance développées par les jeunes face aux structures scolaires qui les marginalisent (Nieto, 2009).
Au Canada et au Québec, un autre pan d’études (Bakali, 2016 ; Khan, 2009 ; Riley et Bdeir, 2024 ; Sensoy et Stonebanks, 2009 ; Tiflati, 2017 ; Zine, 2008) révèle le poids de l’islamophobie qui frappe les étudiant·e·s musulman·e·s racisé·e·s. Comme le soulignent Zine (2008) et Bakali (2016), souvent perçu·e·s comme potentiellement violent·e·s ou enclin·e·s à la radicalisation, ces jeunes rencontrent des obstacles académiques uniques. L’exclusion et la discrimination qui marquent leurs expériences socioscolaires apparaissent exacerbées par l’intensification des politiques de prévention de la radicalisation qui les ciblent en particulier (Bakali, 2016 ; Ducol, 2015 ; Tiflati, 2017). Déployée dans les établissements collégiaux québécois, la notion de « radicalisation violente » s’inscrit dans un contexte global sécuritaire où l’islam est fréquemment associé au terrorisme (Amiraux, 2015). Ce biais est exacerbé par les politiques préventives qui empruntent à des modèles européens (Rousseau, 2019).
En effet, de l’autre côté de l’Atlantique, c’est à la suite des attentats du 7 juillet 2005 à Londres que le concept de « radicalisation violente » prend son essor, face à l’idée de « terroristes de l’intérieur », désignant des jeunes nés et éduqués en Occident qui attaquent leur propre pays (Amiraux, 2015). Pour prévenir ce phénomène, il est proposé d’examiner les dynamiques préalables à l’acte violent ou terroriste, mettant l’accent sur les facteurs psychologiques, sociaux, politiques et économiques qui y conduisent (Neumann, 2013a). Amorcé en 2005 en Europe et en 2015 au Québec, ce tournant politique reflète une transformation majeure : la radicalisation, notion associée historiquement de manière positive aux luttes sociales collectives (Lacroix, 2018), est désormais redéfinie comme un processus individuel menant au terrorisme. Dans cette réinterprétation devenue dominante, la radicalisation violente est presque exclusivement associée à l’islam et au terrorisme islamique (Amiraux, 2015 ; Kundnani, 2012). La stratégie CONTEST et son volet « Prevent », au Royaume-Uni, ouvrent la voie au développement de programmes de prévention spécifiques, suivis par des initiatives similaires à travers l’Europe[2].
Ces initiatives ont toutefois fait l’objet de vives critiques en raison de leur caractère stigmatisant, ciblant de manière disproportionnée les jeunes musulman·e·s racisé·e·s (Kundnani, 2012 ; Ragazzi et Walmsley, 2024), dont elles contribuent ainsi à renforcer la racialisation sous prétexte de sécurité nationale (Amiraux, 2015 ; Bonelli et Carrié, 2018). Ce glissement de la radicalisation à la racialisation opère aussi par la surexposition de ces problèmes dans l’espace public (Abbas, 2019 ; Kundnani, 2012 ; Rousseau, 2019). Bien que la radicalisation violente soit un phénomène rare (Ragazzi et Walmsley, 2024), son traitement disproportionné dans les discours publics et au sein des institutions éducatives influence profondément les parcours des jeunes musulman·e·s racisé·e·s (Coolsaet, 2024).
S’il observe un retard par rapport aux programmes européens en matière de (dé)radicalisation, le Québec s’en inspire, néanmoins, particulièrement de « Prevent » (McLaughlin, 2023), reproduisant ainsi des dynamiques similaires de contrôle et de surveillance dans les établissements collégiaux (Michalon-Brodeur et al., 2018 ; Rousseau, 2019). Bien qu’affichant une prétendue universalité, ces politiques se concentrent de fait principalement sur les étudiant·e·s musulman·e·s racisé·e·s, les désignant comme des « sujets à risque » (Bakali, 2016 ; Michalon-Brodeur et al., 2018). Si des recherches ont démontré que ces initiatives exacerbent l’exclusion et la stigmatisation des jeunes musulman·e·s racisé·e·s en Europe (Bonelli et Carrié, 2018 ; Coolsaet, 2024 ; Ragazzi et Walmsley, 2024), peu d’études se sont penchées sur leurs répercussions au Québec. De plus, nous manquons de connaissances précises en ce qui concerne les expériences vécues de ces jeunes. Aussi, l’objectif qui guide cette recherche est de chercher à combler cette lacune en analysant, à partir d’une enquête qualitative d’ampleur et de récits de vie et d’expérience, les effets de ces mesures sur l’expérience socioscolaire des jeunes musulman·e·s racisé·e·s : quelle est leur incidence sur le quotidien scolaire, ainsi que leurs effets en matière d’inégalités ?
Approche théorique et méthodologique
Pour cela, nous adoptons une perspective théorique qui croise la conceptualisation de Colette Guillaumin (1972) des processus de raci(ali)sation avec l’approche développée par Dorothy Roberts (1990) de « l’intersectionnalité des oppressions systémiques ». Ce cadrage théorique permet en particulier d’approfondir la compréhension des mécanismes de discriminations multiples et cumulatives qui façonnent les expériences socioscolaires des étudiant·e·s musulman·e·s racisé·e·s. Pour Guillaumin, la racisation désigne le processus par lequel certains groupes sont catégorisés sur la base de caractéristiques perçues comme naturelles, afin de justifier des rapports de domination : ils forment alors des « catégories aliénées et opprimées (au nom d’un signe biologique irréversible, donc “racisées”) » (Guillaumin, 1972, p. 7). Dans la perspective développée par Guillaumin, la racisation recouvre donc avant tout un rapport social asymétrique, fondé en essence et qui revêt en conséquence une dimension ontologique pouvant concerner également d’autres formes d’inégalité (d’âge, de sexe, de classe).
Bien que développé de manière autonome et en amont des travaux anglophones sur le sujet (Doytcheva et Gastaut, 2022), le concept de racisation de Guillaumin rejoint les approches critiques de la racialisation dans la littérature contemporaine en ce que les deux soulignent, au-delà de la question des représentations, la dimension structurelle du racisme, ses dynamiques intrinsèques de super/subordination, d’essentialisation, sa nature évolutive[3]. En tant que mise en ordre hiérarchique du monde et technologie de pouvoir fondée sur un processus irréversible de naturalisation, la raci(ali)sation concerne des populations qui ne sont pas définies a priori en des termes raciaux : les migrants, les Roms, les musulmans (Selod et Embrick, 2013 ; Hajjat et Mohammed, 2013).
Dans cet article, nous faisons le choix de suivre Guillaumin en utilisant le terme « racisé·e » pour désigner les identités minoritaires. En accord avec la littérature internationale, nous utiliserons la notion de racialisation pour évoquer les dynamiques davantage organisationnelles et institutionnelles de ces processus ; les rapports de pouvoir qui sous-tendent une allocation différentielle des positions et des ressources. Dans les milieux scolaires, la racialisation se traduit non seulement par la stigmatisation des appartenances religieuses et ethniques des élèves minoritaires, mais également par leur affectation à des positions subalternes dans l’espace scolaire qui contribuent à renforcer leur marginalisation systémique. Par l’association qu’elles opèrent entre identité religieuse et supposée « dangerosité » des étudiant·e·s musulman·e·s, les initiatives de déradicalisation s’inscrivent à l’intérieur de ces processus de racialisation dont elles actualisent, voire amplifient, les effets. À cette analyse s’ajoute celle de l’intersectionnalité des oppressions systémiques, proposée par Roberts (1990), qui met en lumière l’interdépendance des différentes formes d’oppression — notamment de race, de genre, de religion et de classe sociale — et la manière dont elles se renforcent mutuellement. Dans le contexte des politiques de prévention, les étudiant·e·s musulman·e·s sont soumis·e·s à une surveillance constante en raison de leur appartenance religieuse qui vient corroborer et renforcer les effets de leur racialisation. Cette nouvelle épreuve, ce « fardeau de plus » pour reprendre les termes de nos participant·e·s, pèse lourdement sur leurs trajectoires scolaires et sociales.
Avec ce cadre théorique, il devient possible de comprendre comment racialisation et (dé)radicalisation s’entremêlent dans les politiques publiques : c’est en leur double qualité de musulman·e·s et racisé·e·s que ces étudiant·e·s sont construit·e·s comme une menace à la sécurité nationale et à la société. De plus, Roberts permet de comprendre comment ces jeunes, confronté·e·s à des formes multiples de discrimination, développent des stratégies de résistance. Les contre-narrations qu’ils et elles créent deviennent ainsi des outils essentiels pour déconstruire les stéréotypes et revendiquer une justice sociale et éducative.
Avec cette double perspective théorique, nous proposons de porter une attention particulière aux mécanismes structurels et institutionnels qui façonnent l’expérience socioscolaire des étudiant·e·s musulman·e·s racisé·e·s. Nous nous fondons pour cela sur un corpus d’entrevues semi-structurées d’une durée d’une à deux heures, conduites auprès de 37 étudiantes et 15 étudiants, âgé·e·s de 19 à 32 ans, d’origine algérienne (20), marocaine (17) et tunisienne (15), résidant au Québec. Ces entretiens avaient pour objectif d’explorer leurs expériences au cégep, en se concentrant sur plusieurs thématiques clés : la construction identitaire, le sentiment d’appartenance au milieu collégial, les expériences en classe et au sein du groupe de pairs, les enjeux de la « radicalisation ».
Il est à noter que ces données s’insèrent dans le corpus plus large de notre recherche doctorale, en cours (Braa, en cours), portant sur 131 familles issues des communautés maghrébines et musulmanes. Au cours de nos entretiens avec les fratries, ainsi qu’avec leur entourage et leurs ami·e·s, l’école fut souvent mentionnée comme un lieu de prime expérience de la question de la radicalisation et où celle-ci a pris une place significative dans leur vie. En réponse à cette observation, nous avons proposé une seconde rencontre avec ces jeunes étudiant·e·s, afin d’approfondir l’analyse de leurs expériences socioscolaires.
Cette démarche fut complétée par d’autres stratégies de recrutement, y compris en prenant contact avec diverses associations d’étudiant·e·s musulman·e·s, le recrutement dans des espaces communautaires (par exemple, des centres islamiques et des mosquées), ainsi que le bouche-à-oreille, facilité par des relations de confiance établies lors des travaux antérieurs. L’objectif était de garantir une diversité des perspectives et des expériences, tout en reconnaissant que celles-ci varient en fonction de multiples facteurs, tels que le genre, l’origine ethnique et le parcours migratoire (Riley et Bdeir, 2024). Cette approche nous a permis de saisir la pluralité des vécus dans le contexte cégépien et éviter des généralisations simplificatrices (Roberts, 2014).
Les entrevues ont été enregistrées avec le consentement des participant·e·s, puis rigoureusement transcrites en vue de l’analyse. L’analyse des données s’est déroulée en plusieurs étapes. Tout d’abord, une lecture immersive et répétée des transcriptions a permis de déterminer des concepts récurrents et des inflexions dans les récits individuels. Ensuite, une phase de codage inductif a été réalisée à l’aide du logiciel d’analyse qualitative NVivo, facilitant ainsi l’organisation des données autour de thèmes émergents, tels que : « sentiment d’appartenance », « discrimination perçue », « stratégies de résistance » et « gestion de la visibilité religieuse ». Cette approche nous a permis de rendre compte des tensions complexes entre inclusion et exclusion dont ont fait état les récits des participant·e·s, ainsi que des stratégies développées par ces jeunes pour échapper à l’étiquette de la radicalisation violente dans des environnements marqués par l’islamophobie, tout en essayant de préserver leur identité. De plus, l’analyse thématique a été complétée par une analyse intersectionnelle, prenant en compte les imbrications des rapports sociaux de genre, d’ethnicité, de classe sociale et de religion (Roberts, 1990). Cette démarche analytique nous a permis de révéler comment ces différents facteurs structurent les trajectoires éducatives et les expériences vécues des étudiant·e·s musulman·e·s. Afin d’assurer la validité interprétative, plusieurs techniques de triangulation ont été employées. D’une part, les résultats ont été comparés aux données existantes issues de la littérature sociologique et des études sur l’islamophobie en milieu scolaire, en particulier. D’autre part, les participant·e·s ont été impliqué·e·s dans une démarche de « retour des résultats » pour valider la pertinence des interprétations proposées et s’assurer que leurs voix et expériences étaient fidèlement représentées dans l’analyse.
expériences socioscolaires d’étudiant·e·s musulman·e·s maghrébin·e·s au cégep : quatre portraits
Dans cette section, nous présentons quatre études de cas d’étudiant·e·s musulman·e·s issu·e·s des communautés maghrébines, dont les récits éclairent des expériences souvent marginalisées dans les débats sur la radicalisation violente au Québec. Sur notre terrain, quatre types de profil se sont dégagés, fondés principalement sur les manières dont les élèves négocient leurs identités racisées et musulmanes dans des espaces où leurs moindres faits et gestes sont contrôlés, avec le risque constant de signalement pour « radicalisation violente ». Ces profils illustrent également différentes logiques de résistance à l’oeuvre, déployées tout au long des parcours socioscolaires. Leur analyse idéaltypique permet tout à la fois d’examiner de manière approfondie les témoignages recueillis des étudiant·e·s et de procéder à une analyse critique des dynamiques sociopolitiques dans lesquelles ils et elles évoluent. Afin de garantir l’anonymat des participant·e·s, tous les noms ont été remplacés par des pseudonymes et certains détails ont été ajustés.
La posture coopérative : l’exemple de Ryan
Comme d’autres élèves, Ryan, étudiant musulman d’origine algérienne de 18 ans, exprime la nécessité de coopérer avec les politiques de prévention en adoptant des comportements jugés adaptés à la situation. Cela implique pour lui de surveiller chacun de ses gestes afin de rassurer l’autorité scolaire et de « prouver le contraire » de ce qui pourrait être soupçonné à son égard. Cette adaptation inclut des redressements dans sa manière de se comporter, de se présenter aux autres et de construire son identité. Les propos de Ryan témoignent de l’incidence d’une vigilance constante imposée par la société, particulièrement après les départs pour la Syrie en 2015. Cette surveillance pèse sur les interactions quotidiennes, le poussant à contrôler en permanence ses actions — un effort qu’il accepte, comprend et parfois même justifie. Tout au long de l’entretien, Ryan décrit un changement radical du climat scolaire, marqué par une méfiance croissante à l’égard des élèves musulman·e·s :
Tu sais, à partir du moment où les attentats se sont multipliés, on en a ressenti les effets ici aussi. Au Canada, c’est toujours un peu comme ça, les choses se passent en Europe, et les effets finissent par arriver ici, en retard, mais ils arrivent. Moi, comme mes amis, ceux qui, disons (sourire), me ressemblent un peu, qui paraissent trop maghrébins et trop musulmans, on en a ressenti les conséquences. Plus de contrôles, plus de soupçons, plus de questions mais je comprends, ils ont peur et se posent des questions, et je comprends ça. Donc je me fais poser plus de questions qu’avant, je dois faire attention à ce que je dis, ce que je fais tout.
Rayan exprime une compréhension vis-à-vis des réactions de la société face aux attentats terroristes de matrice islamiste. Son discours illustre une internalisation de la peur collective et montre une forme de résilience dans la manière dont il interprète le regard d’autrui : il ne condamne pas les attitudes hostiles ou méfiantes qu’il rencontre à l’école, mais les attribue à la peur et à la désinformation. À plusieurs reprises, Rayan insiste sur la distinction entre l’islamophobie qu’il subit en tant que musulman et la radicalisation violente. Il explique :
Ce sont deux choses différentes. L’islamophobie, elle existe, on le sait, et quand ça t’arrive, ça fait mal, tu le prends personnellement, mais tu avances. Je sais pas comment expliquer, elle a toujours été là. Et on la subit, c’est les autres qui nous font du mal. La radicalisation violente, c’est quelque chose de nouveau, tu comprends ? C’est un fardeau de plus. C’est arrivé pendant qu’on était là, d’un jour à l’autre, l’atmosphère a changé, tu la ressens, que tu la vives directement ou indirectement ! Et là, avec la radicalisation, on t’accuse d’être le mal, de vouloir probablement faire du mal, alors que tu n’as rien fait, rien demandé. Elle s’impose sur nous, c’est fou ! Donc, en fait, on est actifs, on a tous peur d’y tomber, on doit faire doublement attention, ça peut vraiment te poser des problèmes si tu ne fais pas attention, parce qu’on t’accuse au fond.
Tous les élèves que nous avons rencontrés apportent cette nuance importante : la radicalisation violente, telle que perçue et relatée par les participant·e·s, s’est imposée dans leurs vies cégépiennes de manière soudaine, sous-tendue par une accusation implicite, essentiellement étayée par des facteurs ethnoraciaux et religieux. Ryan rajoute :
Si t’es maghrébin et musulman, tu as dix fois plus de chances d’être signalé, pour n’importe quoi, juste un mot mal placé, un comportement que la psychologue trouve suspect. Tu es signalé ? Tu imagines ? On marche sur des oeufs chaque jour.
À plusieurs reprises, Rayan fait preuve de générosité en justifiant ces mesures et les attitudes des personnes qui le perçoivent, pour reprendre ses termes, comme un « porteur de quelque chose de mal » :
Les gens ont juste peur, donc, ils vont te regarder de loin, ils vont te scruter, te soupçonner, mais ils ne vont pas vraiment oser s’approcher de toi. Moi perso, je pense pas qu’ils sont méchants, ils jugent parce qu’ils ne savent pas. Tout ce qui s’est passé, les médias, les gouvernements, nous construisent comme des monstres. Donc après, il faut pas s’étonner si les gens ont peur de nous. C’est à nous de leur prouver le contraire et de s’affirmer musulmans. Leur montrer que les musulmans, c’est autre chose, et pas ces gens qui font ces choses ignobles.
Rayan se sent responsable de la manière dont il est perçu en tant que musulman. Son discours dévoile une tension entre son identité personnelle et l’image projetée par les médias et la société. Il se sent obligé de corriger cette image fausse en « prouvant » aux autres qu’il n’est pas ce que les stéréotypes laissent croire. Ces résultats font écho aux travaux de Bakali (2016) et Tiflati (2017) sur la construction identitaire des minorités dans des contextes qui les stigmatisent, se caractérisant par l’adoption de comportements destinés à rassurer ou à éduquer autrui. Le processus d’autosurveillance rappelle également le concept de « double conscience » que Du Bois (2006) met en exergue au sujet des Afro-Américain·e·s au début du xxe siècle, divisé·e·s entre deux perspectives : d’une part, le désir de s’affirmer et de s’épanouir en tant qu’individu·e·s autonomes, d’autre part, l’obligation de se conformer ou de répondre aux attentes de la société qui les juge principalement à travers le prisme du préjugé racial. Dans son cas, Rayan décrit la nécessité de constamment surveiller ses propos et ses actions pour ne pas être perçu comme une menace, ce qui reflète le devoir non seulement de naviguer son identité multiple, mais aussi de gérer la perception qu’en ont les autres. Pour Rayan, à l’intersection de plusieurs cultures et appartenances, son identité pourrait « poser problème », ce qui l’oblige à faire des efforts en permanence pour « changer les mentalités des gens » :
Après, faut pas croire, je sais que le racisme et les préjugés existent. Même, on sait que les Québécois sont très racistes, mais c’est parce qu’ils ne savent pas […]. Moi, je fais très attention à ce que je fais, j’essaye de moduler mes pensées, surtout celles que j’exprime. Je prends le temps d’expliquer aux gens, de parler avec eux… Tu sais, une fois on était tous ensemble pour manger et j’ai pas osé faire le relou en demandant « c’est quoi comme viande ? », sinon je sais qu’après ils vont penser que je suis un musulman radical, bam, petite alarme qui sonne, non, je veux éviter ça moi, il faut éviter ça, on le sait, c’est comme ça, si tu veux pas te retrouver à parler avec un policier et ta mère à côté, il faut. Mes amis ont été convoqués après avoir dit certaines choses, ils ont été signalés, pour des choses banales, mais je leur ai dit, fallait pas ! Ils ne sont pas du tout des terroristes (rires) mais vraiment pas du tout, mais comme je te disais maintenant c’est comme ça, il faut faire attention à ce que tu dis à l’école, surtout si t’es basané et musulman, c’est comme ça, c’est une réalité. On le sait tous […]. J’essaye dans ma vie de tous les jours de donner un bon exemple de l’islam, qui s’intègre bien. J’y tiens, que ma professeure rentre avec une bonne idée de nous, parce qu’eux [les terroristes] nous abîment. Mais c’est pas l’islam, ça. […] Moi, je suis très content quand on me dit : « Ah, si tous les musulmans étaient comme toi ! » Pour moi c’est une fierté.
Face au climat de contrôle et de suspicion croissante, Rayan adopte une posture où il se sent obligé de moduler ses comportements afin d’être vu comme un « bon musulman », intégrable et rassurant, loin de la radicalisation violente et du terrorisme. Cette autosurveillance constante révèle une intériorisation de la peur du signalement qui l’oblige à un hyperconformisme pour éviter les jugements négatifs. Dans ce processus, Rayan tente de dissocier son identité religieuse des représentations négatives véhiculées par les discours publics. À la question de savoir si cette situation lui pèse, il répond :
C’est naturel pour moi. Je n’ai pas le choix, si je veux faire partie de la société, je me dois de faire des efforts. Je sais que c’est une période délicate, on nous surveille là, nous sommes dans les viseurs, il faut ! Pas le choix.
Il accepte donc de porter le fardeau de la preuve pour déconstruire les stéréotypes qui relient islam-radicalisation-terrorisme (Amiraux, 2015).
Peur et ajustement : l’expérience de Sonia
Les mesures sécuritaires, qui se concentrent particulièrement sur les étudiant·e·s racisé·e·s musulman·e·s, génèrent un dilemme identitaire pour certain·e·s dont la religiosité devient trop visible et donc trop exposée au risque d’être perçu·e·s comme des radicalisé·e·s. Cette situation est bien illustrée par l’expérience de Sonia, jeune femme de 22 ans, musulmane d’origine marocaine, qui navigue entre sa pratique religieuse et la pression sociale qui pèse sur elle pour éviter d’être associée à la radicalisation. Dans son récit, Sonia met en lumière la manière dont l’expression visible de sa foi (en l’occurrence le port du voile) dans les espaces scolaires devient un marqueur de survisibilité, de vulnérabilité et d’association latente avec la radicalisation violente, la poussant à ajuster ses comportements pour éviter stigmatisation et isolement.
Elle se présente ainsi avec humour et dérision :
Je suis une femme, je suis musulmane, je suis aussi maghrébine… (rires) et au début de mes études, je portais le voile ! Plus minorisée que ça, il n’y a pas ! (rires) Pas le meilleur profil pour vivre sereinement les études quoi (rires).
Dès ses premiers mots, Sonia met en lumière la superposition de plusieurs facteurs de discrimination — le genre, la religion, l’origine ethnique — qui font d’elle une figure hypervisible dans le milieu scolaire. Son récit montre que le cumul de vulnérabilités a marqué son expérience socioscolaire, particulièrement dans des contextes de prévention de la radicalisation, rendant difficile une inclusion fluide et naturelle dans un environnement majoritairement non musulman. Sonia explique qu’elle ne se sentait pas à l’aise de porter son voile dans le milieu éducatif ni de pratiquer sa religion, car cela l’obligeait à surveiller constamment ses faits et gestes :
Je faisais vraiment attention à tout, pour ne pas être associée à ces choses, aux jihadistes, etc. Je le sentais, dans les regards des gens, dans les comportements de mes professeurs, même de mes amis… tout le monde avait peur. Je devais vraiment toujours m’assurer de ne pas être associée à tout ça. Je me souviens, à un moment, j’allais toujours prier sous cet escalier, pendant les pauses, puis j’ai arrêté, parce que j’avais peur d’être associée à autre chose, vu que deux filles qui avaient prié là sont parties ensuite [pour la Syrie] et moi je me suis fait signaler à deux reprises. J’ai un peu honte de te dire tout ça, excuse-moi. En fait, j’ai honte parce que j’ai arrêté de pratiquer beaucoup de choses par peur d’être associée à autre chose… mais c’est vraiment difficile pour nous, tu comprends ? On doit exister, mais pas trop […]. Ma mère pense encore que j’ai retiré mon voile pour cette raison… mais depuis que je l’ai retiré, beaucoup de choses ont changé. Les gens ont moins de méfiance envers moi, j’ai beaucoup moins peur d’être signalée qu’avant… avant, je vivais cela comme une angoisse constante, je me rendais à l’école tous les jours avec une peur immense. Maintenant je dois quand même faire attention, mais moins qu’avant.
— Attention à quoi ?
— À ne pas être signalée (rires), je sais ça paraît stupide, mais crois-moi, c’est un risque de tous les jours ici. Un professeur nous avait dit « attention, vous êtes sous le feu des projecteurs » et c’est vrai (rires).
Le témoignage de Sonia met en lumière la survisibilisation que vivent de nombreuses jeunes femmes musulmanes (Zine, 2008). Elle révèle une tension entre sa pratique religieuse et son besoin de sécurité dans un environnement qu’elle perçoit comme hostile. Le fait de devoir surveiller constamment ses comportements par crainte d’être associée à la radicalisation violente illustre la pression que subissent les musulman·e·s, en particulier les femmes voilées, dans un climat de suspicion. L’angoisse de Sonia de « trop » pratiquer sa religion de peur d’être assimilée à un danger montre à quel point les discours sécuritaires affectent l’autonomie et la liberté des jeunes musulmanes. Le changement qu’elle a ressenti après avoir retiré son voile a influé sur ses interactions avec les autres et son propre sentiment de sécurité. C’est ce qui lui a permis de prendre conscience a posteriori des effets des jugements et regards extérieurs sur son expérience scolaire. Porter le voile était devenu, pour elle, un marqueur de survisibilité qui, dans l’esprit des institutions, pouvait être associé à une radicalisation potentielle :
Il y a même des amies avec qui je ne parle plus. Parce qu’elles disaient souvent : « Non, mais il faut réagir, il ne faut pas se laisser faire. » Elles parlaient souvent du fait que nous, les musulmanes, devons nous mobiliser contre ces structures islamophobes… moi, je ne veux rien de tout ça (rires), je veux juste rester tranquille et finir mon parcours scolaire. Je veux mon diplôme en paix, sans avoir de problèmes, c’est tout ce que je veux.
Son choix de s’éloigner d’amies plus militantes et son retrait de toute mobilisation contre « les structures islamophobes » expriment ainsi une volonté de réduire les conflits et de se conformer à une norme sécurisante. Ce retrait symbolique s’inscrit dans une stratégie de protection de soi et de survie dans un contexte où l’affirmation identitaire religieuse est perçue comme source de tension. En refusant de s’engager dans des luttes militantes, Sonia manifeste une priorité : réussir ses études sans rencontrer d’obstacles supplémentaires.
Son témoignage met en lumière les dilemmes et les nécessaires transactions identitaires auxquels sont confronté·e·s les jeunes musulman·e·s dans les institutions éducatives québécoises. Comme le souligne Dubar (1992), l’identité n’est jamais figée : elle se construit et évolue constamment à travers les interactions sociales. Les transactions identitaires, ou processus de négociation entre l’individu et son environnement, sont influencées par les rapports de pouvoir, les normes sociales et les attentes qui émanent du contexte. Les institutions, comme l’école, jouent un rôle central en fournissant des cadres normatifs qui structurent et orientent la construction identitaire des jeunes. Lorsqu’un décalage apparaît entre l’identité pour soi (la manière dont l’individu se perçoit et se définit) et l’identité pour autrui (la manière dont il est perçu et défini par les autres), des tensions, voire des crises identitaires, peuvent émerger (Dubar, 1992). Ces moments de rupture incitent l’individu à réévaluer et à ajuster son identité pour rétablir un équilibre entre ces deux dimensions. Le parcours de Sonia montre comment certains aspects de sa pratique religieuse, en particulier le port du voile, sont perçus comme des obstacles à son intégration et à son bien-être. Cette réalité découle non seulement de l’islamophobie déjà documentée, mais aussi de sa crainte d’être associée à la radicalisation violente. Face à un climat de suspicion généralisée, la priorité devient de se rendre invisible, en minimisant les risques de signalement pour se concentrer sur la réussite scolaire, au prix de renoncer à certaines pratiques religieuses. Sonia incarne ainsi, dans notre analyse, une forme de résilience silencieuse, où la quête de reconnaissance passe par une adaptation, voire un effacement partiel de sa diversité.
Réaction et opposition : le cas de Sami
Certain·e·s participant·e·s toutefois rejettent catégoriquement la surveillance des étudiant·e·s musulman·e·s racisé·e·s imposée par les politiques de prévention de la radicalisation violente et s’y opposent fermement. Iels expriment leurs frustrations face à cette nouvelle modalité de la stigmatisation subie au quotidien, soulignant le cumul des attitudes discriminatoires qui marquent désormais leur parcours. Ces personnes se décrivent comme étant constamment sous surveillance en raison de leur identité musulmane et maghrébine ; elles refusent de se conformer à un système perçu comme de plus en plus injuste. Explorons leurs démarches de résistance aux institutions avec le cas de Sami, jeune Tuniso-Algérien de 23 ans.
Sami se présente de manière directe : « Je suis né ici, donc je suis aussi d’ici, que ça leur plaise ou non. Un musulman, légèrement marron, maghrébin, ne peut pas être d’ici aussi ? C’est ton problème, pas le mien. Les papiers disent autre chose. » Le discours de Sami met en lumière une frustration profonde, celle de ne pas être reconnu comme membre de la société à part entière en raison de son origine ethnique et de sa religion. Cette révolte verbale est le reflet d’une lutte interne, mais aussi sociale, contre les attentes imposées par la société. Sami exprime une colère profonde envers le climat qu’il dit avoir respiré tout au long de sa scolarité :
Sincèrement, j’en ai marre. Ces trucs-là, une vraie prise de tête, mais une de ces prises de tête… même dans des espaces normaux, où on socialise, où on parle, où on joue, où on regarde des vidéos. Ils ont été diabolisés, ils ont mis des sentinelles pour nous surveiller, pour s’assurer qu’on n’explose pas d’un coup… mais c’est une blague ? Crois-moi, à chaque fois. Tu participes à un débat en classe, tu exprimes ton opinion, exactement comme Jérémie, mais toi, ton opinion, ah là là ! Attention à ce que tu dis, Sami, parce que ça pourrait être rattaché à des discours dangereux et donc au risque de radicalisation. Tu veux aller prier, ah attention Sami, cache-toi, sinon après on va te soupçonner et tu vas les avoir sur tes côtes[4]. Tu veux manger halal, ah attention Sami, ça veut dire quoi ça ? T’es radical ? Tu dois réfléchir à tout, avant de parler, de manger, de respirer. Mais s’ils pensent que je vais marcher sur des oeufs pour eux, ils se trompent complètement.
Tout au long de notre rencontre, Sami décrit une expérience socioscolaire marquée par un climat de suspicion constante, exacerbé par la lutte contre la radicalisation violente. Il se sent constamment scruté et jugé différemment des autres, simplement en raison de son identité musulmane et maghrébine. La « prise de tête » qu’il mentionne fait référence à la pression d’une surveillance implicite, où chaque geste ou parole peut être interprété de manière négative. En réaction, Sami adopte une posture de défi, refusant de modérer ses actions ou paroles pour s’adapter à une société qu’il perçoit comme injuste à son égard :
Oui, oui, ils m’ont signalé plusieurs fois, pour des trucs vraiment insignifiants, nuls, puis rien. Ils l’ont dit à la police, ma mère est venue deux ou trois fois, ils ont essayé de comprendre ce qui se passe à la maison, ils lui ont juste demandé de faire attention, de bien me surveiller, et c’était tout. Moi, je m’en fiche, je ne vais pas arrêter d’être moi-même pour eux. J’exprime mes désaccords, j’exprime mes opinions, j’ai le droit. Ils te signalent comme bon leur semble, pour des trucs rien à voir ! Une fois, on m’a signalé parce que j’ai demandé d’enlever le drapeau LGBT et de remettre celui de la Palestine. On m’a accusé d’être homophobe et donc radicalisé ! Tu vois le décalage ? Je leur ai expliqué trente fois que ce n’était pas à cause du drapeau, mais parce qu’il y avait celui de la Palestine avant. Pourquoi l’enlever et mettre l’autre sans nous consulter ? C’est notre espace, celui-là ! Ce n’est pas de la provocation ? Ils nous cherchent tout le temps. Mais moi, si tu me cherches, tu vas me trouver ! L’école, ce n’est pas à eux, c’est à nous aussi. Il faut se calmer à un moment donné.
Sami relève de manière critique les effets de la guerre contre le terrorisme sur le climat scolaire et les interactions au sein des établissements. Il fait allusion à la manière dont les espaces de socialisation, comme les discussions de classe ou les moments de détente, sont perçus comme des lieux potentiellement dangereux ou suspects pour les étudiant·e·s musulman·e·s. Cela crée un climat où la routine des échanges est perturbée par une méfiance omniprésente, affectant non seulement les élèves, mais aussi les enseignant·e·s et l’institution en général. La surveillance devient alors un fardeau quotidien pour Sami, un poids qu’il rejette :
Je te donne un autre exemple. Le prof dit à mon ami : « Viens, je te donne un verre d’eau », parce que mon ami ne se sentait pas bien. Et il lui a dit « Non, je ne peux pas boire », parce qu’on était en ramadan, tu vois. Le prof a commencé un sermon : « Non, mais la santé, ça vient avant tout, c’est suspect là, vous ne pouvez pas risquer la vie pour votre religion, c’est toujours la même chose, VOUS, les musulmans… » Mais son discours était tellement chargé, ça se voyait qu’il n’était pas bien, il en avait trop sur le coeur (rires). Il a sorti un sermon et ça se voyait que même lui, il était en pression. Ça va ! Je me suis énervé et je lui ai dit de vite redescendre parce qu’il mélangeait des trucs qui n’avaient rien à voir. Non, j’en peux plus, ma patience est à bout.
Dans cet extrait, Sami relate une situation où un simple geste de refus de boire pendant le ramadan déclenche une réaction jugée disproportionnée de l’enseignant. En insistant sur la primauté de la santé sur la pratique religieuse, ce dernier laisse transparaître une incompréhension de la foi musulmane et des pratiques qui y sont associées. L’intervention de Sami révèle la frustration d’être constamment confronté à des jugements paternalistes et des sermons moralisateurs. Pour lui, l’enseignant, par son discours « chargé », exprime non seulement un malaise personnel face à la religion, mais aussi une pression sociale accrue pour surveiller les comportements religieux dans un contexte de lutte contre la radicalisation. Cet exemple illustre bien la manière dont des interactions quotidiennes, comme le fait de refuser de boire de l’eau pendant le ramadan, peuvent être interprétées de manière excessive dans un climat de méfiance et de suspicion généralisée. Sami se sent obligé d’intervenir, non seulement pour défendre son camarade, mais aussi pour rappeler à l’enseignant que ces situations ne justifient pas un discours alarmiste. Ce moment reflète également l’état de tensions qui affecte les relations entre les étudiant·e·s et enseignant·e·s. Sami décrit ainsi les coûts de son expérience marquée par des signalements répétés :
Ça m’a coûté cher, oui, bien sûr. Parce que j’ai été signalé à plusieurs reprises, par les profs, les intervenantes… mais je m’en fous, parce que ce sont des trucs nuls. J’ai trop prié, j’ai dit une phrase homophobe, j’ai fait semblant de tirer… non, mais sérieusement. Oui, parfois je suis maladroit, mais tout le monde l’est, mes profs aussi sont très maladroits lorsqu’il s’agit de diversité ! Ils disent des trucs parfois, je te jure, tu saignes des oreilles. Mais nous, on est constamment sous surveillance, ça c’est un fait, je te dis, tu vas parler avec les autres aussi, c’est devenu invivable. J’ai même plus envie d’étudier, si c’est pour être dans des structures comme ça… j’en veux pas de leur diplôme.
Ce passage met en lumière la lassitude de Sami face à une institution qu’il perçoit comme discriminatoire à son égard, en tant que jeune musulman, mais aussi en raison de son identité maghrébine. Il le souligne : « Ce n’est pas que je suis juste musulman. Je suis maghrébin, je ne suis pas blanc, pour le dire autrement. Jo, le converti, tu penses vraiment qu’il va être signalé ? C’est moi, à cause de ma tête. » Les signalements, qui devraient en théorie être des mécanismes de prévention ou de protection, sont vécus par Sami comme des attaques personnelles et discriminatoires. Le fait qu’il ait été « signalé » pour des actes perçus comme mineurs — prier trop souvent ou dire une phrase maladroite — illustre comment certains comportements sont pathologisés ou jugés déviants simplement parce qu’ils sont ceux d’un·e étudiant·e musulman·e et maghrébin·e. Sami souligne également l’hypocrisie et la maladresse de l’institution dans sa gestion de la diversité. Il montre du doigt leur manque de sensibilité culturelle, en remarquant que leurs propos peuvent parfois être tout aussi blessants ou maladroits que ceux des élèves qu’ils surveillent. En d’autres termes, Sami met en lumière l’asymétrie des relations de pouvoir dans les établissements éducatifs : alors que les enseignant·e·s ont la possibilité de commettre des erreurs sans en subir les conséquences, lui et d’autres étudiant·e·s minoritaires sont sous pression et jugé·e·s pour chaque faux pas.
L’exemple des signalements montre aussi comment les institutions éducatives peuvent renforcer des dynamiques de racialisation. En mettant certains comportements sous surveillance (comme le fait de prier ou d’exprimer des opinions divergentes), elles contribuent à créer un contexte inhospitalier aux étudiant·e·s minoritaires. Pour Sami, cette surveillance constante devient un fardeau insupportable, au point de remettre en question la valeur même de l’éducation et du diplôme qu’il pourrait obtenir. Sa phrase finale, « je n’en veux pas de leur diplôme », témoigne d’un désaveu profond de l’institution scolaire, qu’il perçoit comme incapable d’offrir un environnement inclusif.
Son positionnement montre comment la surveillance et la suspicion affectent non seulement le quotidien des étudiant·e·s musulman·e·s et maghrébin·e·s, mais aussi leur motivation et leur désir de réussir dans le système éducatif. Loin de se conformer aux attentes de l’institution, Sami choisit de rejeter toute transaction, mettant en évidence le fossé qui se creuse entre son identité personnelle, ses croyances et les normes dominantes imposées par l’école. Il incarne ainsi une forme de résistance dans le contexte de surveillance qui pèse sur les étudiant·e·s musulman·e·s dans les milieux éducatifs québécois. Contrairement à d’autres élèves qui choisissent de modérer leurs comportements ou d’adapter leur discours pour éviter des malentendus ou des conflits, Sami adopte une posture de défi. Rejetant l’idée selon laquelle son identité ou sa religion devraient le placer dans une situation particulière qui justifie des mesures exceptionnelles, la vraie question réside pour lui dans l’incapacité de la société québécoise à accepter sa diversité religieuse et culturelle.
Fatigue émotionnelle et sortie : le choix de Leila
Un quatrième type de parcours s’esquisse enfin dans les récits des personnes rencontrées. Les élèves qui en sont concernés décrivent une surcharge émotionnelle due à l’accumulation des discriminations qu’ils et elles ont subies et auxquelles la prévention de la radicalisation violente est venue ajouter un « fardeau de trop ». Pris·e·s dans un système où chaque parole ou geste semble scruté et soupçonné, certain·e·s choisissent, pour reprendre leurs mots, « d’abandonner le bateau ». Leur quotidien scolaire est marqué par une fatigue émotionnelle profonde et un sentiment de résignation, où la seule option possible est de quitter le système scolaire : le climat de méfiance engendré par ces politiques exacerbe leur épuisement, les poussant vers la sortie. Leurs parcours reflètent l’impact insidieux de la déradicalisation, qui transforme l’espace éducatif en un lieu de contrôle et de méfiance plutôt qu’en un lieu d’apprentissage et d’inclusion.
Explorons cette dynamique à l’aide de l’exemple de Leila, étudiante de 19 ans, d’origine tunisienne, qui se trouve profondément affectée par les mesures de prévention mises en place autour d’elle. Elle témoigne d’une surcharge émotionnelle face à une situation où « les discriminations quotidiennes » s’ajoutent à un climat sécuritaire pesant :
Il ne manquait plus que ça. On a déjà assez de difficultés, entre le racisme et les discriminations quotidiennes qui sont malheureusement omniprésentes, que ce soit à l’école ou au travail, et puis s’ajoute cette atmosphère pesante de signaler les terroristes, ou bien les suspects, qui en réalité n’est qu’une énième chasse à notre encontre, c’est épuisant.
Le climat décrit par Leila est ainsi celui d’une « chasse » qui cible les communautés musulmanes. Censées protéger, les politiques de prévention de la violence sont vécues comme un « énième » mécanisme d’oppression qui intensifie la racialisation des musulman·e·s. Mais Leila exprime également sa frustration vis-à-vis des membres des communautés musulmanes, qui, selon elle, participent de cette racialisation en adoptant des comportements religieux trop visibles :
Mais as-tu vraiment besoin de porter ce niqab à l’école ? Tu ne peux pas t’en passer ? Le Coran ne dit même pas de le porter, pourquoi ? Ceux qui se font remarquer, mais pourquoi ? Tu dois vraiment prier à l’école ? Tu ne peux pas attendre d’être chez toi et prier chez toi ? Non ?
Tout en exprimant de la colère envers la visibilité des communautés musulmanes, qui se font trop remarquer, d’après elle, Leila se fait également critique à l’égard de la société québécoise :
On ne sait même pas ce qu’ils surveillent ni ce qui déclenche le signalement. J’en ai entendu de toutes sortes ! Je te donne un exemple : des jeunes, des Arabes, étaient dans leur local habituel, ils parlaient comme d’habitude, et une intervenante les observait… les surveillait. La dame pensait avoir vu un couteau dans la poche de l’un des étudiants. C’était un peigne, pour ses cheveux. Mais c’est monté jusqu’en haut, et ça a fait tout un drame inutile, avec la police, les parents c’était un peigne ! Mais c’est comme ça. Ce climat de méfiance est insoutenable et lourd. On le ressent de loin, et c’est en train de pourrir toutes nos relations […]. Moi, j’ai vraiment ouvert les yeux sur la société, sur le Québec. Moi, je suis née ici, pour moi c’est chez moi, tu comprends ? Avec ces histoires de radicalisation, ils m’ont bien fait comprendre que je ne peux pas considérer cet endroit comme chez moi. Ils ne veulent pas de nous, de nos identités, c’est trop compliqué pour eux. Mais le pire c’est vraiment qu’ils ont un problème avec les musulmans. C’est l’islam qui les dérange, et c’est dégoûtant. Ils me dégoûtaient : tout le monde, les enseignants, tout ! Je ne pouvais plus rester.
Son témoignage revient enfin sur les sentiments de fatigue émotionnelle et d’épuisement :
Je me souviens qu’à un moment donné, je faisais très attention à tout, à chacun de mes gestes, et je voulais que tout le monde fasse de même. Je me disais : nous devrions tous le faire, pour réduire le risque à zéro. On contrôlait nos moindres mouvements. Je me disais : si on ne leur donne aucune raison de nous signaler ou de douter de nous, petit à petit, ils nous laisseront tranquilles, j’imagine. Cette histoire de radicalisation va finir par disparaître […]. Je te dis la vérité : je suis fatiguée rien que d’y penser. T’imagines, deux ans de cégep comme ça, à faire attention à tout, juste parce que ton identité dérange ? Cette période-là, au cégep, m’a épuisée. J’étais prise dans un cercle vicieux. Encore aujourd’hui, chaque fois que j’entends parler de ce sujet, je m’en vais […]. Ils m’ont vidée. Je n’avais pas le choix : il fallait que je quitte et que je fasse des formations à côté, en ligne, avant d’aller à l’université. […] Le cégep, c’est mort. Même mes enfants, je ne les laisserai pas y aller (rires).
Le récit de Leila converge sur les effets délétères de la surveillance au quotidien en train de « pourrir toutes les relations ». Si la vigilance accrue et le contrôle de soi représentent une stratégie de réduction de la visibilité qui caractérise également, nous l’avons vu, d’autres postures, la fatigue émotionnelle de Leila face à cette situation aboutit à un abandon stratégique. Cette attitude témoigne d’une stratégie de survie, où la fuite ou la sortie, au sens de Hirschman (1970), devient la seule option viable pour échapper à un système oppressant et sans espoir de changement. Comme beaucoup d’autres jeunes musulmanes, Leïla exprime ainsi un désir de désengagement, dans un contexte où tout espoir de dialogue ou d’amélioration semble perdu.
discussion : loyauté, prise de parole, défection ou invisibilisation face à la (dé)radicalisation ?
Au terme de cette recherche, nous avons mis en évidence quatre positionnements relativement à l’injonction institutionnelle de la déradicalisation en milieux scolaires au Québec. Cette analyse idéaltypique rend compte des réponses individuelles à la stigmatisation et la surveillance générée par les politiques dites de prévention, dont l’expérience vécue par les étudiants oscille entre résilience et opposition. En référence aux travaux classiques de Hirschman (1970), leurs démarches peuvent être appréhendées dans les termes de la loyauté (loyalty), de la prise de parole (voice) et de la sortie (exit), ou défection pour la traduction en français. Le premier profil dont nous avons rendu compte, celui de Ryan, peut ainsi être vu comme incarnant la posture de la loyauté en ce qu’il accepte la surveillance et le contrôle de l’institution : cherchant à prouver qu’il n’est pas une menace, Ryan adopte une posture d’exemplarité. Sami, quant à lui, se rapproche d’une logique de prise de parole et de dénonciation en rejetant la passivité face aux politiques préventives stigmatisantes, il manifeste sa colère et une résistance active contre cette surveillance ciblée. Leila illustre la stratégie de la sortie ou défection, choisissant de quitter l’environnement éducatif en raison de la pression constante et de l’épuisement émotionnel qui en est généré. Sonia, enfin, s’écarte de cette tripartition en ce qu’elle adopte une démarche hybride, optant pour la discrétion et la minimisation de sa visibilité en tant que musulmane, tout en se maintenant dans le milieu éducatif.
Pour construire ce cadre d’analyse idéaltypique, dans cette étude nous avons privilégié la dimension subjective de l’expérience vécue et en particulier celle des réponses émotionnelles et affectives aux politiques de prévention. Ce qui confère une coloration propre à chaque profil, ce sont ainsi les émotions dominantes et les réactions affectives face à la stigmatisation et la surveillance généralisée. L’expérience vécue de ces jeunes est en effet profondément marquée par des émotions fortes telles que la colère, la peur, la frustration, la résignation ou encore le désespoir. Comme le soulignent les extraits d’entretien, le travail accompli pour y faire face façonne leurs conduites. À l’instar de Ryan, 7 participant·e·s sur 52 ont adopté une posture de loyauté parce qu’iels ressentent un besoin de validation et d’acceptation, ce qui les pousse à se conformer aux attentes de l’institution. Ces postures sont aussi animées par un sentiment de responsabilité et un désir de prouver qu’iels sont de « bon·ne·s musulman·e·s ». Dans une proportion similaire, 8 participant·e·s sur 52 ont exprimé à l’image de Sami une profonde frustration et une colère face à la stigmatisation, qui les poussent à résister activement, à faire entendre leur voix pour dénoncer les injustices auxquelles iels sont confronté·e·s. Épuisé·e·s par la stigmatisation, les jeunes comme Leila (6 participant·e·s sur 52) ont exprimé un sentiment de découragement et de désespoir, voyant dans le désengagement la seule forme de protection de soi. Toutefois, la majorité des participant·e·s à notre enquête rejoignent plutôt le profil de Sonia (31 participant·e·s sur 52). Réagissant à une émotion ressentie de peur et à la recherche de protection de soi, iels choisissent de se rendre invisibles pour éviter d’être perçu·e·s comme une menace par l’institution. Iels agissent ainsi par précaution, en minimisant leur exposition aux risques de stigmatisation. En référence aux catégories forgées par Hirschman, la prévalence de cette tactique hybride, qui semble s’opposer à la prise de parole sans pour autant se confondre avec la loyauté, est un résultat original de l’enquête qui mérite approfondissement. La racialisation des organisations et du système éducatif pourrait fournir ici une clé de lecture de la transformation de la loyauté en invisibilisation et « effacement ».
Nous avons mis à l’épreuve cette analyse idéaltypique dans notre démarche de « retour des résultats », lorsque nous avons rencontré les participant·e·s pour les questionner et recueillir leur avis sur la pertinence des interprétations proposées. Lors de ces entretiens, il fut intéressant de noter comment les étudiant·e·s se sont montré·e·s attaché·e·s à l’authenticité de leurs récits et expériences vécues et opposé·e·s à ce que ceux-ci soient « édulcorés », par exemple pour des raisons d’anonymat. Lorsque des détails comme celui du drapeau de la Palestine rapporté par Sami ou du peigne de Leila avaient été omis pour préserver leur identité, ces participant·e·s ont insisté pour au contraire les inclure afin de donner un aperçu fidèle du climat cégépien. Leur volonté de mettre en lumière les réalités vécues s’inscrit dans un contexte où l’émotion est au coeur des (ré)actions : l’angoisse, la colère, la résilience, la peur ou la frustration s’avèrent des moteurs essentiels qui façonnent leur rapport à l’institution. Malgré la tendance à l’invisibilisation, de nombreux·ses étudiant·e·s ont revendiqué la nécessité de nommer les injustices subies, révélant ainsi qu’iels ne disposaient pas dans l’immédiat de suffisamment d’espaces pour le faire.
Ces conduites et les quatre portraits dressés ne sont pas toutefois uniquement le produit d’expériences individuelles et subjectives. L’analyse révèle au contraire le poids de variables sociales et contextuelles. Le genre en est, tout d’abord, une dimension essentielle. Comme le soulignent Benhadjoudja (2017) et Awada (2021), les femmes musulmanes sont en effet souvent perçues à travers des prismes genrés de vulnérabilité ou de menace, ce qui peut avoir pour conséquence de les exposer à des formes de contrôle et de surveillance plus intrusives, en lien avec les stéréotypes sexistes dominants. Dans ce contexte, des jeunes femmes comme Sonia, portant le voile, peuvent ressentir une pression particulière pour se rendre invisibles. Comme le note Aziz (2012) au sujet du port du voile, celui-ci reste « le marqueur du terroriste, de la femme du terroriste, de l’étranger non désiré et de la femme opprimée » (2012, p. 229). D’autres jeunes femmes, comme Leila, accablées par le poids constant de la surveillance, optent plutôt pour le désengagement et la sortie du système éducatif. Dans tous les cas, le genre constitue une variable importante de l’expérience socioscolaire (Choudhury, 2007 ; Korteweg et Yurdakul, 2020 ; Zine, 2009).
La majorité des étudiant·e·s rencontré·e·s dans le cadre de cette recherche sont né·e·s au Québec (36 sur 52) ou y sont arrivé·e·s très jeunes, entre 0 et 5 ans (14 sur 52). De ce point de vue, nos résultats reflètent la dynamique migratoire d’ensemble des communautés maghrébines au Québec (Manaï, 2015). La plupart proviennent de familles issues de classes moyennes, ce qui peut également influer sur leurs expériences socioscolaires. Les jeunes issus de milieux plus favorisés, comme Leila, peuvent avoir davantage de ressources économiques, sociales et culturelles qui leur permettent de « quitter » le système ou de faire face à la stigmatisation de manière moins contraignante. À l’inverse, les jeunes issus de milieux populaires, comme Sami, ressentent souvent une pression plus forte pour résister ou lutter contre l’injustice systémique. Leur colère (parfois l’indignation) face à l’inégalité des chances devient dès lors un moteur puissant de résistance. Majoritairement issu·e·s des classes moyennes, la plupart de nos participant·e·s optent toutefois pour des stratégies d’invisibilisation et de protection de soi. Afin de survivre dans un environnement hostile, iels n’ont souvent d’autre choix que de « serrer les dents » et de « marcher sur des oeufs », pour reprendre leurs propres paroles.
Dans cette enquête, l’âge constitue aussi un facteur déterminant dans la manière dont les expériences socioscolaires varient. Les jeunes plus âgé·e·s, comme Sami et Sonia, possèdent souvent une plus grande conscience politique et un vécu plus lourd en matière de racisme. Cela leur permet de développer des formes plus affirmées de résistance. Les plus jeunes, en revanche, comme Ryan, sont parfois plus vulnérables aux pressions institutionnelles, ce qui les conduit souvent à privilégier la conformité. Iels sont encore dans un processus de construction identitaire et peuvent avoir moins de ressources pour résister aux stéréotypes associés à leur religion ou origine ethnique — un phénomène que Triki-Yamani, McAndrew et Helly (2008) associent à la vulnérabilité des jeunes adultes dans des contextes de discrimination institutionnalisée.
La discipline d’études, enfin, est une autre variable clé pour comprendre les conduites individuelles face à la radicalisation violente. Comme nous avons pu le constater, les jeunes engagés dans des disciplines sociales ou politiques, où les questions de pouvoir et d’inégalité sont fréquemment abordées, développent une conscience plus aiguë des dynamiques de contrôle, de discrimination et de résistance. À l’image de Sami, les jeunes engagés dans des filières où ces enjeux sont discutés se montrent plus enclins à les dénoncer et à développer des stratégies actives de résistance. Inversement, des jeunes comme Ryan et Sonia, issus de disciplines comme les sciences appliquées ou les disciplines techniques, ressentent de manière plus individuelle la stigmatisation dont ils sont l’objet, ce qui les pousse à vouloir s’adapter et faire la preuve de leur intégration, ou à s’effacer.
Malgré la particularité des postures individuelles, les données collectées convergent pour mettre en évidence l’effet délétère des politiques dites préventives. À l’instar des observations faites en France (Ragazzi, 2017) et en Angleterre (Kundnani, 2012), notre recherche montre la manière dont les politiques de prévention de la radicalisation participent de la racialisation des personnes musulmanes, en stigmatisant, voire en criminalisant, des discours et des comportements perçus comme déviants, sur la base de critères raciaux et religieux. Ces politiques contribuent ainsi à renforcer les préjugés islamophobes, qui pèsent particulièrement sur les jeunes musulman·e·s racisé·e·s. Malgré leurs différences, le thème de la « culture de suspicion » (Ericson, 2007) a été récurrent dans les quatre portraits que nous avons dressés. Déployée dans le cadre des politiques de contre-terrorisme et de contre-radicalisation, la culture de suspicion se caractérise par une surveillance accrue, qui touche à la fois le secteur privé et la vie publique, transformant chaque individu·e et citoyen·ne en observateur·rice et en surveillé·e. Elle impose une défiance et une vigilance constante envers soi-même et les autres. Elle traduit la transition d’une culture du contrôle à une culture de suspicion, où tout signe, aussi anodin soit-il, est systématiquement détecté et signalé, en particulier au sein de la communauté musulmane (Awan, 2012). Les témoignages des jeunes rencontrés montrent qu’au sein du milieu scolaire, chacun·e — des enseignant·e·s aux coach·e·s sportif·ve·s, en passant par les psychologues et les travailleur·se·s sociaux·ales — est invité·e à surveiller des jeunes racisé·e·s musulman·e·s, jugé·e·s plus susceptibles de se radicaliser. Si certains, comme Sami, résistent à ces rôles préétablis et chargés de stigmates, d’autres, comme Ryan, finissent par en intérioriser certains aspects en s’efforçant de donner l’exemple. Dans les deux cas cependant, ces représentations caractérisées par des oppositions manichéennes, des amalgames (comme celui entre islam et terrorisme), ainsi que par la construction de personnages stéréotypés (Awada, 2021) renforcent l’altérité. Elles nourrissent un imaginaire simpliste, où les événements concernant l’islam et les musulman·e·s, tant sur le plan local qu’international, manquent de contextualisation et d’analyse politique et historique approfondie (Amiraux et Beauchesne, 2020).
conclusion
Les politiques de prévention de la radicalisation violente sont arrivées sur le devant de la scène au Québec à partir de 2015, dans un contexte marqué par des départs de jeunes Québécois·es vers la Syrie. Cela a justifié l’instauration de mesures préventives, particulièrement dans les cégeps. Bien que présentées comme universelles, ces politiques ciblent majoritairement les élèves musulman·e·s racisé·e·s, perçu·e·s comme des sujets à risque (Bakali, 2016 ; Michalon-Brodeur et al., 2018 ; Rousseau, 2019). À partir d’un corpus d’entretiens menés auprès de 52 élèves musulman·e·s issu·e·s des communautés maghrébines, cette recherche montre que ces politiques dites préventives s’apparentent en réalité à des mécanismes de contrôle et de surveillance renforcés des jeunes musulman·e·s. L’imbrication de leur appartenance raciale (maghrébine) et religieuse (musulmane) les place au centre de tous les soupçons : ce sont précisément ces deux dimensions, combinées, qui font d’elles et eux des suspect·e·s a priori, justifiant ainsi la surveillance accrue de leurs comportements.
Pour les personnes rencontrées, cette situation constitue une forme de double peine ou de « double fardeau » pour reprendre leurs mots : non seulement elles subissent une islamophobie et un racisme quotidiens, largement documentés, mais elles doivent également composer, depuis 2015, avec une surexposition à la problématique de la radicalisation violente. Ce fardeau supplémentaire aggrave leur marginalisation et impose un climat de méfiance à leur égard, exacerbant les inégalités éducatives. Loin de favoriser un environnement d’apprentissage inclusif, ces mesures transforment les établissements scolaires en lieux de surveillance, où même les interactions les plus anodines peuvent être perçues comme des menaces potentielles. Cela génère une atmosphère oppressante, affectant non seulement les relations entre élèves, mais aussi celles entre les étudiant·e·s et le personnel éducatif. La culture de suspicion et le climat qu’elle instaure contribuent à renforcer le sentiment d’aliénation de ces jeunes, qui, dans leurs récits, se disent visé·e·s, surveillé·e·s en raison de leur appartenance ethnique et religieuse. Plus largement, le milieu éducatif, qui devrait être un espace de soutien et d’émancipation, se transforme pour les musulman·e·s racisé·e·s en un lieu qui les enferme dans des représentations nuisant à la fois à leur épanouissement personnel et leurs perspectives académiques.
Notre article contribue ainsi à la littérature qui interroge de manière critique l’arrimage du secteur sécuritaire au secteur éducatif par l’injonction institutionnelle à la « déradicalisation » et le rôle actif conféré aux cégeps québécois dans ce processus (Michalon-Brodeur et al., 2018). En donnant la parole aux jeunes concerné·e·s, cette recherche a permis de montrer en quoi cet arrimage est source de questionnements plus qu’il n’est porteur de solutions. Partant du postulat que les jeunes construisent leurs identités dans des environnements sociaux, politiques et culturels qui les influencent de manière significative (Dubar, 1992 ; Zine, 2008), et que l’école devrait être un pilier de la cohésion sociale et de l’épanouissement des jeunes, avec pour mission d’instruire, socialiser et renforcer le vivre-ensemble dans un cadre pluraliste (Amiraux, 2016), il paraît urgent d’évaluer les conséquences des politiques dites de prévention de la radicalisation violente, notamment en ce qui concerne leurs incidences sur le sentiment d’appartenance à la communauté scolaire et la réussite éducative. Nos résultats montrent de plus qu’il est urgent de repenser les approches sécuritaires au sein des établissements scolaires, au risque, à défaut, de renforcer la méfiance à l’égard des institutions et d’aggraver les dynamiques ségrégatives.
Appendices
Notes
-
[1]
Le cégep, ou collège d’enseignement général et professionnel, est une institution postsecondaire propre au Québec qui fait le lien entre l’école secondaire et l’université ou le marché du travail. Il propose des programmes préuniversitaires de 2 ans et des programmes techniques de 3 ans, alliant cours généraux et spécialisés.
-
[2]
Voir, par exemple, le « Plan d’action pour la radicalisation et la polarisation », lancé aux Pays-Bas en 2005, le Radicalisation Awareness Network (RAN) mis en place par la Commission européenne en 2011, l’Aarhus Model (2012) au Danemark, le « Plan national de prévention de la radicalisation » (2014-2018) en France, ou le National Center for Preventing Violent Extremism (2018) en Suède.
-
[3]
Sur la distinction entre approches critiques et approches descriptives de la racialisation (Doytcheva et Gastaut, 2022).
-
[4]
« Les avoir sur tes côtes », c’est une locution populaire utilisée par l’étudiant, qui signifie subir des critiques, des reproches ou une pression constante de la part de quelqu’un. D’autres expressions similaires, comme « Ils te tombent dessus », « Ils sont toujours sur ton dos » ou « Ils ne te lâchent pas ».
Bibliographie
- Abbas, T. (2019). Implementing ‘Prevent’ in countering violent extremism in the UK : A left-realist critique. Critical Social Policy, 39(3), 396-412.
- Amin, A. (2012). Stratégies identitaires et stratégies d’acculturation : deux modèles complémentaires. Alterstice, 2(2), 103‐116.
- Amiraux, V. (2015). Après le 7 janvier 2015, quelle place pour le citoyen musulman en contexte libéral sécularisé ?. Multitudes, (2), 83-93.
- Amiraux, V. (2016). Visibility, transparency and gossip : How did the religion of some (Muslims) become the public concern of others ?. Critical Research on Religion, 4(1), 37-56.
- Amiraux, V. et Beauchesne, P. L. (2020). Racialization and the Construction of the Problem of the Muslim Presence in Western Societies. Dans S. Akbarzadeh (dir.), Routledge Handbook of Political Islam (p. 363-382). Routledge.
- Archambault, I., Janosz, M., Dupéré, V., Brault, M. C. et Mc Andrew, M. (2017). Individual, social, and family factors associated with high school dropout among low‐SES youth : Differential effects as a function of immigrant status. British Journal of Educational Psychology, 87(3), 456-477.
- Arènes, C. (2014). Le programme PREVENT et les musulmans en Grande-Bretagne, enjeux et contradictions de la« prévention du terrorisme » [thèse de doctorat, Université Paris 3].
- Awada, D. (2021). La racialisation des musulman.es au Québec : analyse d’un cas de diffamation à caractère islamophobe [mémoire de maitrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/25943
- Awan, I. (2012). “I Am a Muslim Not an Extremist” : How the Prevent Strategy Has Constructed a “Suspect” Community. Politics & Policy, 40(6), 1158-1185.
- Aziz, S. F. (2012). From the Oppressed to the Terrorist : Muslim-American Women in the Crosshairs of Intersectionality. Hastings Race and Poverty Law Journal, 9(1), 191-264.
- Bakali, N. (2016). Islamophobia : Understanding Anti-Muslim Racism Through the Lived Experiences of Muslim Youth. Sense Publishers.
- Beekhoven, S. et Dekkers, H. (2005). Early school leaving in the lower vocational track : triangulation of qualitative and quantitative data. Adolescence, 40(157), 197-213.
- Benhadjoudja, L. (2017). Laïcité narrative et sécularonationalisme au Québec à l’épreuve de la race, du genre et de la sexualité. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 46(2), 272-291.
- Bilge, S. (2009). Théorisations féministes de l’intersectionnalité. Diogène, (1), 70-88.
- Blaya, C. (2010). Décrochages scolaires. L’école en difficultés. Éditions De Boeck Université.
- Bonelli, L. et Carrié, F. (2018). La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français. Éditions du Seuil.
- Bouchamma, Y. et Tardif, C. (2011). Les pratiques des directions d’écoles en contexte de diversité ethnoculturelle. Dans F. Kanouté et G. Lafortune. Familles québécoises d’origine immigrantes - Les dynamiques de l’établissement (p. 87-96). Les Presses de l’Université de Montréal.
- Braa, A. (2025). Les familles des radicalisé·e·s, une comparaison Italie, Québec et Tunisie [thèse de doctorat, Université de Montréal, titre provisoire].
- Bridgeland, J. M., Dilulio, J. J. Jr. et Morison, K. B. (2006). The silent epidemic : Perspectives of high school dropouts. Civic Enterprises.
- Choudhury, T. (2007). The role of Muslim identity politics in radicalisation. Department for Communities and Local Government.
- Coolsaet, R. (2024). ‘Radicalisation’ and ‘countering radicalisation’ : The emergence and expansion of a contentious concept. Dans J. Busher, L. Malkki et S. Marsden (dir.), The Routledge Handbook on Radicalisation and Countering Radicalisation (p. 34-52). Routledge.
- Coppock, V. (2014). ‘Can you Spot a Terrorist in Your Classroom ? ’ Problematising the Recruitment of Schools to the ‘War on Terror’ in the United Kingdom. Global Studies of Childhood, 4(2), 115-125.
- Crettiez, X. (2016). Penser la radicalisation. Une sociologie processuelle des variables de l’engagement violent. Revue française de science politique, 66(5), 709-727.
- Dejean, F., Mainich, S., Manaï, B. et Kapo, L. T. (2016). Les étudiants face à la radicalisation religieuse conduisant à la violence. Mieux les connaitre pour mieux prévenir. Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants. https://iripi.ca/wp-content/uploads/2016/05/iripi-rapport-radicalisation.pdf
- Delgado, R. and Stefancic, J. (1993). Critical race theory : an annotated bibliography. Virginia law review, 79(2), 461-516.
- Deslandes, R. (2010). Le difficile équilibre entre la collaboration et l’adaptation dans les relations école-famille. Dans G. Pronovost (dir.), Familles et réussite éducative (p. 197-215), Actes de colloque du 10e Symposium québécois de Recherche sur la famille. PUQ.
- Doytcheva, M. et Gastaut, Y. (2022). Race, racismes, racialisations : Enjeux conceptuels et méthodologiques, perspectives critiques. Emulations. Revue de sciences sociales, (42), 7-30.
- Dubar, C. (1992). Formes identitaires et socialisation professionnelle. Revue française de sociologie, 4(33), 505-529.
- Du Bois, W. E. B. (2006). Double-Consciousness and the Veil. Dans R. Levine (dir.), Social Class and Stratification : Classic Statements and Theoretical Debates (p. 203-210). Rowman & Littlefield Publishers.
- Ducol, B. (2015). Farhad Khosrokhavar, Radicalisation. Lectures. https://doi.org/10.4000/lectures.17541
- El Difraoui, A. et Uhlmann, M. (2015). Prévention de la radicalisation et déradicalisation : les modèles allemand, britannique et danois. Politique étrangère, (4), 171-182.
- Ericson, R. V. (2007). Crime in an Insecure World. Polity.
- Fortin, L., Royer, É., Potvin, P., Marcotte, D. et Yergeau, É. (2004). La prédiction du risque de décrochage scolaire au secondaire : facteurs personnels, familiaux et scolaires. Revue canadienne des sciences du comportement, 36(3), 219-231.
- Guennouni Hassani, R. et Kanouté, F. (2023). Points de vue de jeunes musulmans issus de l’immigration sur leur expérience socioscolaire à Montréal. Éducation et francophonie, 51(2). https://doi.org/10.7202/1109676ar
- Guillaumin, C. (1972). L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel (Vol. 2). Institut d’études et de recherches interethniques et interculturelles.
- Guillaumin, C. (1981). Femmes et théories de la société : remarques sur les effets thériques de la colère des opprimées. Sociologie et sociétés, 13(2), 19-32. https://doi.org/10.7202/001321ar
- Guillaumin, C. (2002). Racism, Sexism, Power and Ideology. Routledge.
- Hajjat, A. et Mohammed, M. (2013). Islamophobie : comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman ». La Découverte.
- Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty : Responses to decline in firms, organizations, and states. Harvard University Press.
- Hrimech, M., Théorêt, M., Hardy, J. Y. et Gariépy, W. (1993). Étude sur l’abandon scolaire des jeunes décrocheurs du secondaire sur l’Île de Montréal. Conseil scolaire de l’île de Montréal.
- Jamil, U. (2016). The War on Terror in Canada : Securitizing Muslims. Journal of Islamic and Muslim Studies, 1(2), p. 105-110. https://doi.org/10.2979/jims.1.2.12
- Janosz, M. (2000). L’abandon scolaire chez les adolescents : perspective nord-américaine. Enjeux, (122), 105-127. https://doi.org/10.3406/diver.2000.1141
- Janosz, M., LeBlanc, M., Boulerice, B. et Tremblay, R.E. (2000). Predicting different types of school dropouts : A Typological Approach with two longitudinal Samples, Journal of Educationnal Psychology, 92(1), 171-190.
- Kamanzi, P. C. et Collins, T. (2018). The postsecondary education pathways of Canadian immigrants : Who goes and how do they get there ?. International Journal of Social Science Studies, 6(2), 58-68. https://doi.org/10.11114/ijsss.v6i2.2866
- Kanouté, F. (2002). Profils d’acculturation d’élèves issus de l’immigration récente à Montréal. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 171-190.
- Kanouté, F., Gosselin-Gagné, J., Guennouni Hassani, R. et Girard, C. (2016). Points de vue d’élèves issus de l’immigration sur leur expérience socioscolaire en contexte montréalais défavorisé. Alterstice : Revue internationale de la recherche interculturelle, 6(1), 13-25.
- Kanouté, F. et Lafortune, G. (2011). La réussite scolaire des élèves d’origine immigrée : réflexions sur quelques enjeux à Montréal. Éducation et francophonie, 39(1), 80-92.
- Kanouté, F., Vatz Laaroussi, M., Rachédi, L. et Tchimou Doffouchi, M. (2008). Familles et réussite scolaire d’élèves immigrants du secondaire. Revue des sciences de l’éducation, 34(2), 265-289.
- Khan, S. (2009). Integrating Identities : Muslim American Youth Confronting Challenges and Creating Change. Dans Ö. Sensoy et C.D. Stonebanks (dir.), Muslim Voices in School : Narratives of Identity and Pluralism.Sense Publishers.
- Korteweg, A. C. et Yurdakul, G. (2020). The headscarf debates : Conflicts of national belonging. Stanford University Press.
- Kundnani, A. (2012). Radicalisation : The journey of a concept. Race & Class, 54(2), 3-25.
- Kushnick, L. (1999). Over-policy and under-producted. Stephen Lawrence institutional and policy practices. Sociological research online, 4(1), 156-166. https://doi.org/10.5153/sro.241
- Lacroix, I. (2018). Radicalisations et jeunesses : Revue de littérature. Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INGEP). https://shorturl.at/s4JDJ
- Laperrière, A. (1989). La recherche de l’intégrité dans une société pluriethnique : perceptions de la dynamique des relations interethniques et interraciales dans un quartier mixte de Montréal. International Review of Community Development, (21), 109-116.
- Lecocq, A., Fortin, L. et Lessard, A. (2014). Caractéristiques individuelles, familiales et scolaires des élèves et leurs influences sur les probabilités de décrochage : analyses selon l’âge du décrochage. Revue des sciences de l’éducation, 40(1), 11-37.
- Lessard, A., Joly, J., Potvin, P., Fortin, L., Royer, E. et Marcotte, D. (2006). Les raisons de l’abandon scolaire : Différences de genre. Revue québécoise de psychologie.
- Manaï, B. (2015). La « mise en scène » de l’ethnicité maghrébine à Montréal [thèse de doctorat, Institut National de la Recherche Scientifique (Canada)]. Espace INRS. https://espace.inrs.ca/id/eprint/3313
- Martineau, S. (2003). Recension de Mc Andrew, M. (2001). Immigration et diversité à l’école. Le débat québécois dans une perspective comparative. Presses de l’Université de Montréal. Revue des sciences de l’éducation, 29(1), 212-214. https://doi.org/10.7202/009500ar
- Mattsson, C. et Säljö, R. (2018). Violent Extremism, National Security and Prevention. Institutional Discourses and their Implications for Schooling. British Journal of Educational Studies, 66(1), 109-125. https://www.jstor.org/stable/26769271
- McLaughlin, G. (2023). Radicalisation : A Conceptual Inquiry. Routledge, Taylor & Francis.
- Mehana, M. et Reynolds, A. J. (2004). School mobility and achievement : A meta-analysis. Children and Youth Services Review, 26(1), 93-119.
- Michalon-Brodeur, V., Bourgeois-Guérin, É., Cénat, J. M. et Rousseau, C. (2018). Le rôle de l’école face à la radicalisation violente : risques et bénéfices d’une approche sécuritaire. Éducation et francophonie, 46(2), 230-248.
- Nadeau-Cossette, A. (2012). L’intégration socioscolaire des adolescents immigrants : Facteurs influents et implications pour l’intervention. Canadian Social Work Review/Revue canadienne de service social, 29(2), 247-261. https://www.jstor.org/stable/43486281
- Neumann, P. R. (2013a). Options and strategies for countering online radicalization in the United States. Studies in Conflict & Terrorism, 36(6), 431-459.
- Neumann, P. R. (2013b). The trouble with radicalization. International Affairs, 89(4), 873-893.
- Ngo, H. V. et Schleifer, B. (2005). Immigrant children and youth in focus. Canadian issues, Spring, 29-33.
- Nieto, S. (2009). The light in their eyes : creating multicultural learning communities. Teachers college press.
- Potvin, M., Audet, G. et Bilodeau, A. (2013). L’expérience scolaire d’élèves issus de l’immigration dans trois écoles pluriethniques de Montréal. Revue des sciences de l’éducation, 39(3), 515-545.
- Potvin, M. et Leclercq, J.-B. (2010). Les jeunes de 16-24 ans issus de l’immigration à l’éducation des adultes : trajectoires sociales et scolaires et évaluation de deux mesures de soutien à leur égard. Rapport de recherche à la Direction des services aux communautés culturelles (DSCC), ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Université du Québec à Montréal. https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/06/prs_potvinm_rapport_16-24ans.pdf
- Radio-Canada. (2015, 26 février). De jeunes Québécois soupçonnés d’avoir rejoint des djihadistes en Syrie. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/708748/jeunes-quebecois-quitte-pays-syrie-djihadistes
- Radio-Canada. (2015, 20 mai). Quatre des jeunes arrêtés par la GRC étudiaient à Maisonneuve. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/721665/jeunes-arretes-college-maisonneuve-syrie
- Radio-Canada. (2021, 8 juin). Qui sont les victimes de l’attaque de London ? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1799791/victimes-attaque-voiture-london-famille-communaute-musulmane
- Ragazzi, F. (2016). La lutte contre la radicalisation ou deux formes de la pensée magique. Mouvements, 4(88), 151-158. https://doi.org/10.3917/mouv.088.0151
- Ragazzi, F. (2017). Students as suspects. The challenges of counter-radicalisation policies in education in the Council of Europe member states. Interim report. Council of Europe.
- Ragazzi, F., et Walmsley, J. (2024). Who should be involved with counter-radicalisation policy and practice ? Dans J. Busher, L. Malkki et S. Marsden (dir.), The Routledge Handbook on Radicalisation and Countering Radicalisation (p. 276-291). Routledge.
- Riley, K. M., et Bdeir, L. (2024). Entre invisibilité et hypervisibilité : cinq jeunes musulmanes au Québec. Politique et Sociétés, 43(1), 115-140. https://doi.org/10.7202/1110579ar
- Roberts, D. E. (1990). Punishing Drug Addicts Who Have Babies : Women of Color, Equality, and the Right of Privacy. Harvard Law Review, 104(7), 1419-1482.
- Roberts, D. E. (1993). Racism and Patriarchy in the Meaning of Motherhood. American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, (1), 1-38.
- Roberts, D. E. (2011). Prison, Foster Care, and the Systemic Punishment of Black Mothers. UCLA Law Review, 59(6), 1474-1501.
- Roberts, D. E. (2014). Killing the black body : Race, reproduction, and the meaning of liberty. Vintage.
- Robertson, A. et Collerette, P. (2005). L’abandon scolaire au secondaire : prévention et interventions. Revue des sciences de l’éducation, 31(3), 687-707.
- Rousseau, C. (2019). La radicalisation violente au Québec : Comprendre, prévenir et intervenir. Le Genre humain, 61(2), 135-145.
- Sabatier, C. (2008). Ethnic and national identity among second-generation immigrant adolescents in France : The role of social context and family. Journal of adolescence, 31(2), 185-205.
- Selod, S., et Embrick, D. G. (2013). Racialization and Muslims : Situating the Muslim Experience in Race Scholarship. Sociology Compass, 7(8), 644-655.
- Sensoy, Ö. et Stonebanks, C.D. (dir.) (2009). Introduction : Voice & Other Acts of Insubordination. Dans Muslim Voices in School : Narratives of Identity and Pluralism. Sense Publishers.
- Suárez-Orozco, C. et Suárez-Orozco, M. (2018). Education : the experience of Latino immigrant adolescents in the United States. Dans J. Bhabha, J. Kanics et D. Senovilla Hernández (dir.), Research Handbook on Child Migration. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786433701.00039
- Tiflati, H. (2017). Muslim Youth Between Quebecness and Canadianness : Religiosity, Identity, Citizenship, and Belonging. Canadian Ethnic Studies, 49(1), 1-17. https://dx.doi.org/10.1353/ces.2017.0000
- Triki-Yamani, A., McAndrew, M. et Helly, D. (2008). Traitement de l’islam et du monde musulman à l’école : perceptions des jeunes musulmans(es) du cégep au Québec. Centre Métropolis du Québec, Immigration et métropoles, (33).
- Van Zanten, A. (2015). Choisir son école : stratégies familiales et médiations locales. Presses universitaires de France.
- Vatz Laaroussi, M., Kanouté, F. et Rachédi, L. (2008). Les divers modèles de collaboration famille immigrantes-écoles : de l’implication assignée au partenariat. Revue des sciences de l’éducation, 34(2), 291-311.
- Vatz Laaroussi, M., Rachédi, L., Kanouté, F. et Duchesne, K. (2005). Favoriser les collaborations familles immigrantes-écoles. Soutenir la réussite scolaire, Guide d’accompagnement. Université de Sherbrooke.
- Zine, J. (2004). Anti-Islamophobia Education as Transformative Pedadogy : Reflections from the Educational Front Lines. American Journal of Islamic Social Sciences, 21(3), 110-119. https://doi.org/10.35632/ajis.v21i3.510
- Zine, J. (2008). Canadian Islamic Schools : Unravelling the Politics of Faith, Gender, Knowledge, and Identity. University of Toronto Press.