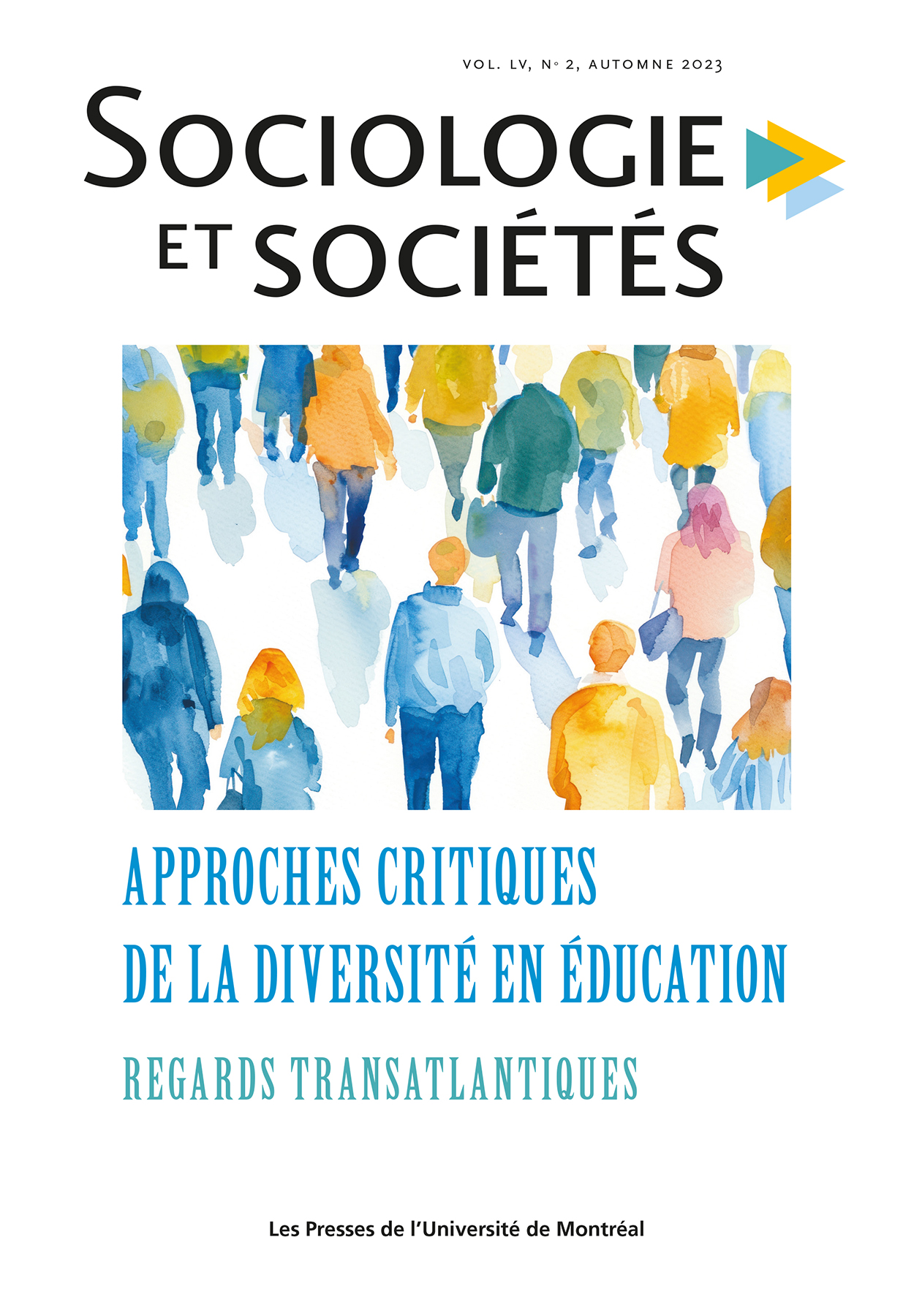Abstracts
Résumé
Cet article propose d’analyser les cadres raciaux, ou les prismes par lesquels les individus interprètent le rôle de la race dans la société, mobilisés par les étudiantes et étudiants blancs de deux universités d’élite étatsuniennes. Pour la plupart d’entre eux, l’entrée dans une université d’élite coïncide avec le renforcement du cadre de la diversité qui met l’accent sur les retombées positives de la diversité culturelle. Beaucoup adoptent, cependant, un cadre de neutralité raciale (colorblidness) qui considère les groupes comme équivalents et les identités raciales comme non significatives. À partir d’une enquête par entretiens approfondis auprès de 47 étudiantes et étudiants blancs nés aux États-Unis et inscrits à Brown et à Harvard (N = 47), nous explorons les tensions et les ambivalences qui parcourent ces deux cadres raciaux, potentiellement divergents ; la manière dont ils influent sur les perceptions étudiantes des politiques d’affirmative action et des relations interraciales sur les campus. Nous soulignons le dynamisme et la plasticité des cadres raciaux montrant les effets que les institutions peuvent avoir sur la construction des perspectives individuelles.
Mots-clés :
- race,
- université,
- affirmative action,
- diversité,
- neutralité raciale,
- élites
Abstract
This article examines race frames, the interpretive lenses through which individuals understand the role of race in society, as mobilized by white students at two elite U.S. universities. For most of them, entering an elite institution reinforces the diversity frame, which emphasizes the benefits of cultural diversity. However, many also adopt a colorblind frame, which sees race groups as equivalent and racial identities as insignificant. Drawing on in-depth interviews with 47 white U.S.-born students enrolled at Brown and Harvard (N = 47), we explore the tensions and ambivalences that arise from these divergent frames and their influence on student perspectives on affirmative action and interracial relations on campus. Emphasizing the mutability of race frames, our findings also highlight the impact of institutional contexts on shaping individual perspectives.
Keywords:
- Race,
- higher education,
- affirmative action,
- diversity,
- color-blindness,
- elites
Resumen
El presente artículo analiza los esquemas raciales — o prismas a través de los cuales que los individuos interpretan el rol de la raza en la sociedad — adoptados por los estudiantes blancos de dos universidades estadounidenses de élite. Para la mayoría, el ingreso a una universidad de élite coincide con el fortalecimiento del esquema de diversidad que hace hincapié en el impacto positivo de la diversidad cultural. Sin embargo, muchos adoptan un esquema de neutralidad racial (daltonismo) que percibe a los grupos como equivalentes y a las identidades raciales como insignificantes. A partir de una encuesta con entrevistas detalladas a 47 estudiantes blancos nacidos en Estados Unidos e inscriptos en Brown y Harvard (N=47), exploramos las tensiones y ambivalencias que atraviesan estos dos esquemas raciales potencialmente divergentes y la forma en que las percepciones de los estudiantes inciden sobre las políticas de acción positiva y las relaciones raciales en el campus. Destacamos el dinamismo y la plasticidad de los esquemas raciales que ponen de manifiesto los efectos potenciales de las instituciones en la construcción de perspectivas individuales.
Palabras clave:
- Raza,
- universidad,
- acción positiva,
- diversidad,
- neutralidad racial,
- élites
Article body
introduction
Si l’abondante littérature sur les attitudes raciales dans la société étatsunienne contemporaine permet de mieux comprendre les positions individuelles en matière de politique sociale, ces travaux se sont moins intéressés aux manières de comprendre la race qui les ont façonnées. Dans cet article, nous développons la notion de cadres raciaux (race frames), à savoir les prismes à travers lesquels les individus interprètent le rôle de la race dans la société, et proposons d’identifier les cadres raciaux communs à la société étatsunienne actuelle. Nous explorons en particulier les cadres raciaux mobilisés par les étudiants des universités d’élite et la manière dont ils façonnent leurs expériences universitaires[1].
Les cadres culturels façonnent les interprétations individuelles du monde environnant ainsi que les comportements. Small, Harding et Lamont (2010, p. 14-15) définissent les cadres culturels comme des prismes « à travers lesquels nous observons et interprétons la vie… Un cadre structure la manière dont nous interprétons les événements et donc la manière dont nous y réagissons. » Les cadres affectent l’interprétation des phénomènes sociaux en mettant en exergue certains aspects et en en occultant d’autres (Goffman, 1974). Par exemple, Small (2004) montre que différentes façons de concevoir son quartier peuvent entraîner différents niveaux de participation civique. En plaçant au premier plan les cadres raciaux, plutôt que les choix politiques qui les sous-tendent (Schuman, Steeh et Bobo, 1997 ; Sears et Henry, 2005), ou les idéologies raciales qu’ils promeuvent (Bonilla-Silva, 2003 ; Feagin, 2006), cet article propose d’apporter un éclairage de sociologie culturelle à l’étude du rôle de la race dans la société actuelle (Skrentny, 2008). Cela nous permet de démêler la complexité des cadres raciaux mobilisés par les individus. Nous montrons en particulier comment les cadres maniés par un même individu peuvent être associés à des choix politiques différents. Nous identifions enfin un mécanisme par lequel ces cadres se développent et évoluent, à savoir le rôle institutionnel de l’enseignement supérieur d’élite.
Dans l’ensemble, nous en savons peu sur les mécanismes d’évolution de notre compréhension de la race et des cadres raciaux (pour des exceptions importantes, voir Goldman, 2012 ; Hochschild, Weaver et Burch 2012 ; Omi et Winant, 1986 ; Roth, 2012). Dans cet article, en nous basant sur une enquête par entretien approfondi (N = 47), nous explorons les cadres raciaux mobilisés par les étudiants et étudiants blancs de premier cycle dans deux universités de la Ivy League. Mieux que les enquêtes quantitatives, les entretiens nous permettent d’appréhender la question des cadres raciaux, dans la mesure où ils donnent à voir comment les étudiants font sens d’idées complexes et parfois contradictoires de la race. Nous montrons en particulier que l’expérience d’une université d’élite coïncide avec un déplacement qui fait advenir au premier plan chez de nombreux étudiants un cadre de la diversité, englobant la diversité raciale, ainsi que la croyance que les membres de différents groupes ont des perspectives différentes sur le monde. Pour beaucoup d’étudiants, toutefois, ce cadre de la diversité se superpose à un cadre antérieur, de neutralité raciale, qu’ils ont acquis notamment durant leurs années de lycée. Nos analyses démontrent de la sorte que les individus peuvent manier plusieurs cadres raciaux simultanément, y compris lorsque ces derniers sont contradictoires. Bien que les deux cadres en question soient présents dans la culture américaine au sens large, nous faisons l’hypothèse que les expériences vécues de l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que de la ségrégation résidentielle, ont tendance à amplifier le cadre de l’indifférence à la race ou de la neutralité raciale, tandis que les expériences vécues dans les universités d’élite amplifient, au contraire, celui de la diversité. Nous discutons en particulier les effets produits par ces cadres raciaux concurrents sur la manière dont les étudiants appréhendent les politiques d’affirmative action[2], d’une part, et les relations interraciales sur les campus, d’autre part.
Plusieurs cadres raciaux coexistent en effet dans la société américaine actuelle. Les personnes qui adoptent un cadre d’indifférence à la couleur (colorblind) considèrent que la race a peu de signification sociale, citant souvent la législation sur les droits civiques, le déclin des attitudes ouvertement racistes et la prospérité croissante de nombreux Noirs américains en appui. De manière aspirationnelle, certains tenants du cadre de la neutralité raciale estiment que la race ne devrait pas compter et tentent d’ajuster leurs comportements en conséquence pour y parvenir. Certains travaux de recherche considèrent de manière positive le cadre de neutralité raciale (par exemple Sniderman et Carmines, 1997), tandis que d’autres affirment, au contraire, que celui-ci est le produit d’une transformation du racisme contemporain, allant d’une forme explicite et ouverte vers une forme plus implicite et subtile (par exemple Bonilla-Silva, 2003 ; Feagin, 2006)[3]. Le cadre du « libéralisme abstrait » et celui de la « minimisation du racisme » identifiés par Bonilla-Silva peuvent être considérés comme faisant partie du cadre de neutralité raciale, dans la mesure où ils admettent tous deux que la race a peu de signification sociale.
D’autres chercheurs ont noté que les opinions négatives sur les Noirs américains jouent souvent un rôle de médiation entre un cadre revendiqué de neutralité raciale et l’opposition aux politiques fondées sur des catégorisations raciales, telles que le bussing ou l’affirmative action (Sears et Henry, 2005 ; Schuman et al., 1997)[4]. L’une des conséquences normatives du cadre colorblind est le fait d’ignorer les identités et les différences raciales dans le but de soutenir des politiques sociales également aveugles à la couleur. Le cadre de la neutralité raciale est donc à l’origine d’une approche individualiste des relations sociales, défavorable aux approches collectives.
Le deuxième cadre — que nous appelons le cadre de la diversité — considère la race comme une identité culturelle positive. Le cadre de la diversité suppose que la race façonne la vision du monde et les pratiques culturelles des individus, et que l’interaction interraciale est importante et positive[5]. L’acceptation générale de la diversité ethnique et raciale et l’attention portée aux contributions positives des cultures non occidentales fut un des acquis majeurs du Mouvement des droits civiques aux États-Unis (Alba et Nee, 2003 ; Kasinitz et al., 2008). Ces transformations culturelles ont conduit à la célébration des différences entre groupes ethnoraciaux, qualifiée parfois de multiculturalisme. Le cadre de la diversité met ainsi l’accent sur les différences entre groupes en matière de pratiques culturelles, de perspectives existentielles et de « goûts », adoptant de la sorte une approche davantage centrée sur le groupe. Nous qualifions ce cadre en termes de diversité dans la mesure où il souligne l’existence d’une diversité de perspectives, pratiques, styles de vie et relations sociales qui découle de la pluralité ethnoraciale et dont il est admis que nous pouvons apprendre et nous instruire. L’une des conséquences normatives de ce cadre est que l’intégration sociale doit traverser les frontières raciales, afin d’enrichir la vie culturelle et la compréhension du monde de chacun. L’affirmative action qui s’appuie sur des catégorisations raciales est l’un des mécanismes par lesquels cette attente normative peut être réalisée.
Dans le même temps, un troisième cadre, le cadre de la culture de la pauvreté, suggère que les inégalités qui affectent les minorités découlent de caractéristiques culturelles telles que l’absence, par exemple, d’une éthique du travail ou, encore, le peu de respect pour le mariage. Ce cadre partage avec le cadre de la diversité une compréhension culturelle des groupes, mais en diverge par son évaluation négative des cultures minoritaires. Les travaux sur les attitudes interraciales montrent l’enracinement de cette perspective, tout en documentant la manière dont le cadre de la culture de la pauvreté va de pair avec une opposition aux politiques dont l’objectif est de réduire les inégalités raciales (Bobo et Charles, 2009 ; Schuman et al., 1997). Huntington (2004) mobilise ce cadre dans son étude critique des Latinos aux États-Unis, Who are We ?, suggérant que la culture latino remet en question la culture américaine dominante ancrée dans l’éthique protestante du travail. L’une des conséquences normatives du cadre de la culture de la pauvreté est que les politiques d’affirmative action ne sauraient s’appliquer dans la mesure où elles récompensent les minorités pour leurs spécificités culturelles négatives[6].
Enfin, ce que nous appelons le cadre d’une analytique du pouvoir met l’accent sur les rapports de pouvoir entre groupes sociaux racialisés, dans une approche davantage structurelle. La conséquence normative en est que les individus devraient activement résister aux idéologies et injustices raciales. Étant donné que ce cadre est adopté par une petite minorité de Blancs, les sondages et enquêtes quantitatives l’ont peu abordé. Pourtant, de nombreuses recherches en sciences sociales, ainsi que des travaux militants défendent cette perspective, parfois qualifiée en termes de « justice sociale » ou de « théorie critique de la race » (par exemple Bonilla-Silva, 2003 ; Feagin, 2006 ; Moore et Bell, 2011 ; Yosso et al., 2004). Bien que d’autres cadrages raciaux puissent être identifiés dans la société étatsunienne contemporaine[7], nous considérons que les quatre cadres construits ici en constituent les exemples principaux au sens où ils sont les plus largement répandus à l’heure actuelle.
cadres raciaux, changement social et éducation
Si les évolutions des définitions ordinaires de la race (Hochschild et al., 2012 ; Omi et Winant, 1986) ou les effets de cohorte et de génération sur les attitudes interraciales (Schuman et al., 1997) ont fait l’objet d’importantes discussions, moins a été dit sur la manière dont les cadres raciaux eux-mêmes sont construits et se transforment dans le temps (voir Sidanius et al., 2008). Dans la période récente, différents travaux ont pris pour objet les effets produits en ce sens par les liens transnationaux (Roth, 2012), l’enseignement à l’université (Morning, 2011), l’évitement de la problématique raciale dans l’enseignement secondaire (Pollock, 2004), ou encore la médiatisation de portraits valorisants de Noirs américains (Goldman, 2012). Des recherches ont analysé la manière dont les institutions telles que l’armée (Lawrence et Kane, 1995) ou l’école secondaire (Lewis, 2003) sont productrices de significations raciales partagées. Dans cet article, nous nous appuyons sur cette importante littérature pour éclairer le rôle joué dans la construction des cadres raciaux par les institutions d’enseignement supérieur. Nous nous focalisons en particulier sur les universités d’élite car, aux États-Unis, elles sont le lieu d’une importante infrastructure organisationnelle en matière de diversité. Nous aborderons ensuite la construction des cadres raciaux dans le contexte plus large de l’éducation.
Des études ethnographiques montrent que les écoles américaines sont souvent des lieux « muets », où les adultes évitent autant que possible de parler de race (Lewis, 2003 ; Pollock, 2004). Pour autant et malgré l’absence de discours explicite sur la race, les minorités ethniques y sont souvent peu valorisées (Lewis, 2003 ; Valenzuela, 1999). En intégrant une université d’élite, au contraire, les étudiants sont confrontés au cadre de la diversité où la race n’est plus mise en sourdine, mais portée en exergue. Ce cadre se voit par la suite renforcé par l’importante infrastructure institutionnelle dont la plupart des universités privées se sont dotées.
Pourquoi les universités d’élite aux États-Unis disposent-elles d’une infrastructure aussi importante en matière de diversité ? À partir des années 1960, les mouvements étudiants, ainsi que le désir des administrateurs d’être perçus comme étant à l’avant-garde de la question raciale, ont conduit à la mise en place par les universités d’efforts significatifs, en particulier sur les campus d’élite. En font partie la création de départements d’études afro-américaines et d’études ethniques, les politiques d’affirmative action dans les procédures d’admission, des programmes et des centres d’études qui s’adressent spécifiquement aux étudiants issus des minorités ethniques (sur le développement historique de cette infrastructure, voir Berrey 2011 ; Chen 2000 ; Rojas 2007 ; Stulberg et Chen 2014). Surtout, à la suite de la décision dans Regents of University of California v. Bakke (1978), la Cour suprême a soutenu le droit des universités à promouvoir la diversité dans la mesure où celle-ci est gage de qualité de l’enseignement dispensé grâce à un environnement d’apprentissage diversifié.
Dans ce contexte, les travaux de recherche montrent en effet que les échanges interraciaux sur les campus, la participation à des ateliers autour de la diversité, tout comme le contenu des cours dispensés, ont une influence positive sur les étudiants (Chang, Astin et Kim, 2004 ; Espenshade, Radford et Chung, 2009 ; Gurin et al., 2002 ; Sidanius et al., 2008). Les effets en sont catalysés par le fait que les études supérieures sont une période durant laquelle les jeunes sont portés à changer leur façon de penser sur une variété de sujets, sous l’influence de changements dans leurs routines quotidiennes et leurs réseaux sociaux, d’une abondance relative de temps libre (Munson, 2010), ainsi que de leur niveau de formation (Sidanius et al., 2008).
Le cadre de la diversité n’est toutefois pas le seul à être présent sur les campus. Ceux-ci ont été également le théâtre de ce qui fut qualifié de « guerres culturelles » (Arthur et Shapiro, 1995), incluant des débats soutenus sur les programmes scolaires (Bryson, 2005 ; Rojas, 2007 ; Small, 1999), les mesures d’affirmative action (Moore et Bell 2011 ; Thernstrom et Thernstrom, 1997), les conceptions du mérite (Warikoo, s.d.), etc. Aujourd’hui, aussi bien dans les établissements élitistes que moins élitistes, il existe un soutien considérable en faveur de l’idéologie conservatrice de la neutralité raciale, même si celle-ci n’est endossée que par une petite, mais bruyante, minorité étudiante (Binder et Wood, 2013).
la fabrique de la diversité et de la neutralité raciale : les cas de brown et de harvard
Nous nous basons ici sur l’analyse de 47 entretiens approfondis, conduits avec des étudiantes et étudiants blancs, nés aux États-Unis et inscrits au premier cycle, respectivement à l’Université de Harvard et à l’Université de Brown. Cette méthode a permis de pleinement recueillir et approfondir les points de vue exprimés sur les effets de la diversité dans la vie de campus, le rôle joué par l’université dans la compréhension de l’ethnicité et de la race, les inégalités et les discriminations raciales. Menés par un doctorant blanc, les entretiens ont duré en moyenne 120 minutes. L’ensemble des personnes interrogées étaient inscrites au moins en deuxième année afin de disposer d’une expérience significative. En amont des entretiens, elles ont également rempli un questionnaire en ligne collectant des informations sur leur milieu social d’origine, leurs identifications selon des lignes raciales, politiques et socioéconomiques, leurs opinions sur des sujets liés au multiculturalisme et à la diversité.
La collecte de ces données a notamment permis de montrer que si le pourcentage médian de Blancs dans les quartiers d’origine est d’environ 82 %, cette proportion n’est que de 40 et 45 %, respectivement sur les deux campus (Brown University Office of Institutional Research 2012 ; Harvard University Office of Institutional Research, 2009). De même, alors que le pourcentage médian de résidents noirs et latinos dans les quartiers d’origine des étudiants était au total de 8 %, leur pourcentage sur les deux campus était plus proche de 15 %. Par conséquent, l’étudiant moyen qui passe du lycée à l’université s’installe dans un environnement comptant moitié moins de Blancs et deux fois plus de Noirs et de Latinos. Ces expériences qui reflètent des tendances nationales en matière de ségrégation scolaire (Orfield, Kucsera et Siegel-Hawley, 2012) s’avèrent particulièrement saillantes pour les étudiants qui poursuivent leurs études supérieures dans des universités d’élite (Espenshade et al., 2009).
À Harvard, les participants à l’enquête ont été recrutés à l’intérieur d’une même résidence universitaire (350-500 personnes) à laquelle ils sont aléatoirement affectés ; à Brown, ils ont été recrutés via des courriels adressés à différentes résidences universitaires non thématiques (environ 400 personnes). Tous les étudiants qui ont accepté de participer à l’enquête ont été inclus dans l’échantillon, un effort particulier a été fait pour les relancer à l’aide de courriels répétés. À la fin de l’entretien, les participants ont été invités à transmettre les coordonnées de l’enquêteur à l’une de leurs connaissances vivant dans la même résidence. Ce procédé n’est pas censé aboutir à un échantillonnage aléatoire ou stratifié. Il a néanmoins permis de capter un éventail diversifié de perspectives. Après avoir comparé les réponses à l’enquête préalable aux données disponibles sur les étudiants des deux universités (discipline principale, type d’école secondaire fréquentée, niveau d’éducation des parents), il est possible de confirmer l’absence de différence notable entre la population enquêtée et celles d’ensemble des deux universités.
L’ensemble des entretiens ont été intégralement retranscrits et codés dans ATLAS.ti. Après un premier codage des données, deux cadres raciaux, que nous qualifions respectivement de neutralité raciale et de diversité, ont émergé. Une analyse approfondie a fait apparaître les cadres de la culture de la pauvreté et de l’analytique du pouvoir. Alors que les débats sur la neutralité raciale et la diversité abondent dans la littérature scientifique, l’identification de ces différents cadres raciaux dans notre corpus a été d’abord et avant tout inductive : loin de les identifier a priori, c’est seulement dans un second temps que nous avons tissé des liens avec différents corpus académiques. À noter également que de nombreux étudiants et étudiantes font part de processus d’évolution dans leur manière de comprendre les expériences et observations racialisées, ce qui nous a amenées à approfondir les aspects liés à l’expérience universitaire dans l’analyse. Là aussi, nous n’avons pas cherché à démontrer l’existence de changements et la révision des cadres raciaux d’origine : ce sont plutôt les récits étudiants des effets de leur entrée à l’université sur la construction de ces cadres qui nous sont apparus de manière cohérente dans l’enquête. Si les regards rétrospectifs peuvent créer une impression de continuité ou attribuer une puissance causale surestimée aux événements passés, il nous semble néanmoins que la cohérence des récits étudiants sur la transformation de leurs perspectives en matière de diversité fut une découverte importante de cette enquête.
Le cadre de la neutralité raciale
Parmi les participantes et les participants à l’enquête, une majorité (24/47) a exprimé d’une manière ou d’une autre son adhésion au cadre de la neutralité raciale ou de l’aveuglement à la couleur. Par exemple, Lissa nous dit : « Personne ne vous regarde [et ne pense] : ‘‘Oh, c’est une personne blanche’’… Ce n’est certainement pas la première chose que je vois. Et je ne pense pas que la majorité des gens ici la voient. » De même, Pat, interrogée sur la manière dont les événements survenus sur le campus ont façonné son point de vue sur la diversité, déclare :
Beaucoup d’étudiants ici sont plutôt indifférents à la race, au sens où j’assiste à beaucoup d’événements où il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les races… Et c’est à peine si je m’en aperçois, jusqu’à ce que j’essaie consciemment d’y penser. Et on ne me le fait pas remarquer non plus.
Pour Lissa et Pat, ne pas voir la race semble être la façon moralement supérieure de se comporter. Megan, à qui l’on demandait si l’inégalité raciale est un problème, répond : « Je ne pense pas qu’il y ait encore beaucoup de problèmes raciaux à notre époque. » Craig a exprimé un point de vue plus critique des programmes d’affirmative action parce que :
j’ai l’impression que les gens [ici] sont suffisamment privilégiés pour ne pas avoir besoin d’un quelconque avantage pour être admis quelque part, juste parce qu’ils appartiennent à une minorité. Cela me dérange, parce qu’ici, tout le monde est à peu près aussi compétent.
Craig a également partagé sa conviction que le recrutement ciblé de femmes et de minorités « crée un certain ressentiment, du moins en ce qui me concerne. » Parmi les personnes interrogées qui adoptent un cadre indifférent à la couleur, deux seulement ont reconnu que la discrimination raciale du passé continue à avoir des effets dans le présent. Hannah nous dit : « La façon dont je vois les choses, c’est que cette histoire de racisme absolument malsain a enfoncé les minorités dans des trappes de pauvreté. Pour moi, c’est historique. » Au prisme de l’indifférence à la couleur, l’inégalité raciale contemporaine est pour elle seulement fonction de l’inégalité de classe : « Ce qui maintient les minorités au plus bas aujourd’hui, ce n’est pas tant le racisme, c’est le fait qu’elles sont tout en bas de la hiérarchie socio-économique en raison de siècles de racisme. »
Le cadre de la diversité
La grande majorité des répondants (40/47) ont exprimé leur adhésion au cadre de la diversité. Pour beaucoup, l’université fut la première expérience d’un environnement racialement diversifié et le fait de l’intégrer semble avoir renforcé la pertinence de ce cadre de référence. James, qui a grandi dans une ville à près de 90 % blanche, explique cette transition également en termes de changement à l’égard de son père, qui est « très opposé à l’affirmative action » :
En venant ici, j’ai beaucoup plus de respect pour le multiculturalisme. Lorsque les gens disaient, « à Brown, il y a beaucoup de diversité », je ne m’arrêtais pas vraiment dessus. Je pensais qu’il s’agissait simplement d’une université, comme d’autres. Depuis que je suis ici, je pense que c’est vraiment important… Je pense que le fait d’être confronté à d’autres cultures, plutôt que d’être confronté à ce qui passe pour du multiculturalisme dans votre petite école maternelle entièrement blanche, a eu une influence sur moi.
De nombreux étudiants et étudiantes ont contrasté leur vision au temps du lycée avec celle acquise à l’université. Ils et elles ont également contrasté les quartiers ségrégués de leur enfance, où on leur a appris à ne pas parler de race, avec les campus racialement diversifiés. Pat, étudiante originaire d’une ville universitaire du Sud, nous décrit ce changement :
Cela m’a permis de réaliser qu’il y avait pour moi davantage d’enjeux personnels. C’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup plus que je ne l’avais imaginé lorsque je vivais dans le Sud et que je n’avais aucune interaction avec la notion de multiculturalisme.
Nous avons ensuite demandé à Pat comment son expérience à l’université avait modifié sa connaissance des minorités, si cela avait été le cas :
Je suis surprise de voir à quel point les minorités ethniques sont prêtes à discuter [de la race] et à en parler ouvertement. Le fait que ce ne soit pas tabou d’avoir une discussion du type « Qu’est-ce que ça fait d’être, vous savez, un universitaire latino de l’Ivy League ? » … alors que si j’étais dans mon état d’esprit d’avant, j’aurais abordé l’interaction avec une personne d’identité ethnique X dans l’état d’esprit spécifique de faire en sorte qu’elle se sente le plus possible comme si elle n’avait pas cette identité.
Plus de 80 % des personnes enquêtées ont ainsi déclaré avoir assisté à un événement en rapport avec la diversité sur le campus. Elizabeth a parlé plus spécifiquement de la façon dont l’infrastructure du campus et la présence de pairs très divers ont façonné ses opinions. À la question « Comment les événements organisés à Harvard ont-ils influencé votre vision du multiculturalisme et de la diversité, si tel est le cas ? », elle a répondu :
Ils m’ont aidée à être plus ouverte. J’ai assisté à de nombreuses conférences et discussions… J’ai participé à l’une d’elles avec une personne immigrée de Cuba. L’un de mes camarades de résidence est cubain. C’était très intéressant. Je pense que cela m’a ouvert les yeux sur l’expérience de l’immigration.
Elizabeth a trouvé aussi que les événements sociaux étaient des occasions pour s’imprégner de la diversité :
Plus que les discussions, c’est avec le côté social et divertissant que j’accroche. Par exemple, j’assiste au spectacle de talents de l’Apollo Night, organisé par l’Association des étudiants noirs, ou ce week-end, j’ai prévu d’aller voir un groupe d’amis dans le cadre d’un spectacle de danseurs irlandais.
Comme l’illustrent ces extraits d’entretien, les récits étudiants montrent clairement qu’ils acquièrent le cadre de la diversité à la faveur de leur immersion dans les campus d’élite, tant en raison de la mixité qui caractérise la composition de ceux-ci que de la culture de la diversité qui y règne. Les propos recueillis montrent aussi que le cadre de la diversité repose sur une conceptualisation culturaliste de la race. Il suppose que l’appartenance raciale signale une identité culturelle spécifique de sorte que le fait d’être Noir se traduit dans des pratiques culturelles, des connaissances, des rituels, des goûts, etc., précis. Cette manière de voir les choses contraste avec une définition de la race en tant que construction sociale — soit marqueur arbitraire qui doit être éliminé (cadre de la neutralité), soit source d’inégalité structurelle aux États-Unis (cadre de l’analytique du pouvoir). Dans les données collectées, certains étudiants blancs semblent puiser dans cette conception essentialiste des identités raciales pour juger de l’authenticité raciale de leurs camarades de couleur. Pour ces étudiantes et étudiants, une rencontre avec un camarade noir dont les expériences de vie ne correspondent pas à leurs attentes en termes de « noirité » donne lieu à des sentiments d’atteinte à la norme et, tout particulièrement, si ce camarade noir est perçu comme bénéficiaire de l’affirmative action. Par exemple, lorsqu’on lui demande si l’université devrait considérer la race ou l’ethnicité dans ses admissions, Karen, une athlète de la Nouvelle-Angleterre, affirme qu’un étudiant qui a une expérience « blanche » ne devrait pas pouvoir prétendre à une bourse pour étudiants Latinos :
Je pense que cela devrait être plus que juste cocher une case. Je connais des gens qui sont, par exemple, un quart Mexicains et qui ont obtenu la bourse pour étudiants Latinos, alors que toute leur expérience est une expérience de Blancs.
Karen relève l’importance d’avoir une expérience « latino » lorsqu’il s’agit de bénéficier de bourses qui ciblent les minorités racisées. Dans le même ordre d’idées, Jack, étudiant en sciences qui se définit comme conservateur, déclare que l’un de ses camarades noirs au lycée ne mérite pas de bénéficier de l’affirmative action :
Dans mon lycée, un jeune Noir a postulé à Harvard et j’aurais été contrarié s’il était admis, car c’était l’une des personnes les plus stupides que j’aie jamais rencontrée de ma vie. L’idée qu’il puisse être admis malgré ses notes médiocres, mais grâce au fait qu’il est Noir, me révulse. Je pense à lui en particulier lorsque je mets en garde contre le poids excessif donné à la race comme indicateur, car même s’il était noir, il était l’enfant le plus blanc que la plupart des gens aient pu rencontrer, au sens où il menait le style de vie cliché d’un gosse riche et blanc.
Ce qui semble inquiéter Jack — à la fois pendant le processus d’admission et rétrospectivement — c’est la possibilité qu’un étudiant noir qui ne correspond pas à l’identité culturelle associée à la noirité aujourd’hui aux États-Unis bénéficie néanmoins de l’affirmative action. L’ensemble des étudiants ci-dessus désapprouvent leurs pairs de couleur qui auraient bénéficié d’une affirmative action bien qu’ayant des expériences de « Blancs » dans leur enfance. Ils considèrent en effet que le fait que leurs collègues de couleur bénéficient de mesures d’affirmative action constitue une atteinte à la norme. Ce faisant, ils associent la blanchité au privilège socio-économique et réduisent la race à une identité culturelle ostensiblement affichée et performée que l’on peut incarner de manière authentique ou non. C’est sur la base de raisonnements de ce type que les étudiants blancs considèrent le fait, pour les étudiants minoritaires, de mériter ou non le bénéfice des mesures d’affirmative action.
Le cadre de la culture de la pauvreté
Si la grande majorité des étudiantes et étudiants ont évoqué le cadre de la diversité à un moment ou à un autre de l’entretien, cinq (5/49) ont également mentionné le cadre de la culture de la pauvreté, et parfois dans la même phrase. En fait, tous les étudiants, à l’exception d’un, s’exprimant sur la culture de la pauvreté, ont également souligné les effets positifs de la diversité dans la vie de campus. Par exemple, Orin nous a dit que l’université doit « absolument » tenir compte de la race et de l’ethnicité dans ses admissions, parce que cela « apporte autant à la classe qu’un pianiste de renommée mondiale ». Pourtant, lorsqu’on lui demande d’expliquer les inégalités raciales, elle cite « les origines culturelles » :
On apprend à faire ce que vos parents vous disent de faire, donc avec mes parents, c’était toujours : tu vas à l’école, tu fais tes devoirs, tu travailles dur… Mais si votre culture ne souligne pas autant l’importance des études ou quoi, vous êtes moins motivé pour aller à l’école.
Orin vient d’une ville de banlieue dont la population est à plus de 90 % blanche. Dans l’ensemble des entretiens, les étudiants qui évoquent la culture de la pauvreté viennent de villes dont la population noire est en moyenne de 5 %. Cela suggère que leurs arguments ne découlent probablement pas d’une connaissance directe et prolongée des Noirs américains.
les cadres raciaux au travail
Bien que le cadre de la neutralité raciale et celui de la diversité soient maniés en même temps par les étudiants, ils ne restent pas moins analytiquement contradictoires. Alors que le principe d’aveuglement à la couleur avec lequel les étudiants ont grandi atténue l’importance de la race, la diversité place celle-ci au contraire au centre des procédures et de la vie universitaire. L’indifférence a pour conséquence normative le fait d’ignorer la race, tandis que la conséquence normative de la diversité est celle de la mixité raciale qui permet de bénéficier d’une pluralité d’expériences et de perspectives. Or toutes les personnes interrogées qui ont mobilisé le cadre de la neutralité, à l’exception d’une, ont également mis en avant celui de la diversité. La réponse de Karen à la question de ce qu’il faudrait faire pour lutter contre les inégalités raciales illustre l’ambivalence qu’engendre l’adoption simultanée des deux cadres : « Que faut-il faire ? Je ne sais pas. Les gens devraient juste être plus conscients des différences et… en même temps, moins conscients. »
Pour autant et bien qu’elles soient analytiquement en contradiction, les deux approches convergent également : toutes deux minimisent la persistance de l’inégalité et des discriminations raciales[8], ce qui ne manque pas de produire des effets sur les opinions étudiantes en matière d’affirmative action, ainsi que leur compréhension des interactions avec les étudiants racisés sur le campus — effets sur lesquels nous proposons de nous pencher à présent.
Les positions sur l’affirmative action
Manier ensemble les cadres de la diversité et de la neutralité raciale conduit certains étudiantes et étudiants à se montrer incertains à l’endroit de l’affirmative action. Plus de la moitié des personnes interrogées se sont ainsi montrées ambivalentes au sujet de ces politiques. D’un côté, elles ont soutenu l’idée, centrale au sein du cadre de la diversité, de son caractère bénéfique d’un point de vue éducatif. D’un autre côté, cependant, en s’identifiant au principe de l’aveuglement institutionnel à la race selon lequel celle-ci ne devrait pas être socialement significative, elles trouvent injuste de fonder des politiques remédiatrices sur des catégorisations raciales et, en particulier, lorsque ces politiques sont supposées leur nuire plus qu’elles ne les avantagent. À la question de savoir si Brown doit tenir compte de la race dans ses admissions, Meredith répond :
Oui, parce que sinon… nous ne bénéficierons pas des avantages de la diversité que nous avons aujourd’hui… Je veux dire que c’est difficile parce que… chez moi, par exemple, … le fait d’admettre les étudiants dans le système public de l’Université de Californie sur la base de la race — beaucoup d’étudiants blancs ont eu l’impression qu’on allait leur refuser l’entrée alors qu’ils la méritaient.
De nombreuses personnes ont exprimé la même ambivalence que celle qui ressort de la réponse de Meredith, en affirmant à la fois un soutien général à la diversité raciale et en s’inquiétant des résultats d’une politique qui serait fondée « uniquement » sur la race et donc désavantageuse pour les Blancs. En d’autres termes, si l’affirmative action devait aller « trop loin », au point que le coût d’un refus d’entrée, de stage ou d’emploi l’emporte sur les avantages que procure un groupe diversifié de pairs, les étudiants blancs ne soutiendraient plus ces politiques, les considérant comme de la « discrimination à l’envers ».
L’enquête a permis d’observer que la crainte que le coût de l’affirmative action n’excède ses avantages supposés découle d’expériences imaginaires bien plus que réelles. Ci-dessous, Serena s’explique sur le sentiment d’être victime de discrimination raciale : « Si je n’avais pas été admise à Harvard, j’aurais eu le sentiment d’être victime de discrimination. Surtout, si quelqu’un que je connais, tout aussi qualifié que moi et appartenant à une minorité, avait été admis. » Pourtant, plus tôt dans l’entretien, lorsqu’on lui a demandé si l’université doit tenir compte de la race, Serena répond : « Je pense qu’elle devrait le faire parce que les différents points de vue que les étudiants d’origines différentes peuvent apporter sont très utiles à l’objectif plus large de l’éducation. » Bien que l’admission de Serena à Harvard lui convient pour le moment, ses propos suggèrent qu’elle adhère au discours de la « discrimination à l’envers » et qu’elle pourrait donc facilement le déployer à une autre occasion, si le résultat de la compétition lui est moins favorable. Jack imagine également la possibilité d’une discrimination à l’envers dans son récit :
Si vous êtes un enfant blanc qui grandit dans une caravane, vous êtes aussi mal loti que l’enfant noir qui grandit à côté de vous, si ce n’est pire… Je pense que si l’on voit un Noir dans cette situation, on dirait : « Oh, c’est la société. Ils n’y peuvent rien ! » En revanche, si c’est une personne blanche, vous dites : « Elle a dû faire quelque chose de mal. » Il y a moins de compassion.
Le scénario imaginé par Jack est donc un scénario où, toutes choses égales par ailleurs, un regard injuste est porté sur les Blancs. En plus des préoccupations liées à l’affirmative action dans les admissions, les étudiants ont également exprimé un certain malaise à l’endroit des prix et récompenses, ou encore des efforts de recrutement racialement ciblés des employeurs. Thomas déclare :
J’ai eu beaucoup de mal à trouver [un stage], et mon colocataire, qui est noir, en a trouvé un de suite. Il a posé sa candidature [à un stage ciblant spécifiquement les minorités] et ce fut comme automatique… Je comprends que, là d’où il vient, avoir cette opportunité est juste incroyable et je suis donc content pour lui en ce sens. Mais en même temps… il est difficile d’accepter que des postes soient réservés pour certaines races en particulier.
Les relations interraciales sur le campus
La concomitance des cadres de la diversité et de la neutralité raciale produit également des effets sur la vision des étudiants blancs des relations interraciales sur le campus. De nombreux étudiantes et étudiants de notre échantillon nous ont ainsi partagé des expériences où ils se sont sentis exclus par leurs pairs de couleur, percevant cette situation comme une atteinte à la norme véhiculée par le cadre de la diversité. Ils et elles considèrent ainsi que la séparation et la non-mixité raciale ne sont pas conformes à l’objectif affiché de la diversité sur le campus, tel qu’ils l’entendent, à savoir celui d’enrichir leurs propres expériences éducatives grâce aux différences culturelles entre groupes. Aussi bien le cadre aveugle à la couleur que celui de la diversité ignorent, nous l’avons vu, les disparités de statut socioéconomique qui pourraient rendre pertinentes sur les campus les interactions avec des étudiants du même groupe. Ci-dessous, Anna explique comment l’objectif d’une vie intégrée sur le campus n’est pas atteint dans les interactions au jour le jour :
Oui, je pense que Harvard est un endroit assez diversifié. Mais je pense… que la diversité… se résume à un grand nombre de groupes différents… qui s’autosélectionnent et s’associent… à l’intérieur de leur culture particulière… Je ne sais pas s’il y a beaucoup d’interactions entre groupes.
Lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense de cette « auto-sélection », Anna élabore :
Cela me gêne vraiment, parce que c’est très difficile de connaître les gens quand on ne fait partie d’aucun de ces groupes — par exemple, je ne vais pas adhérer à l’Association des étudiants noirs. Et la plupart des groupes auxquels j’appartiens ne sont pas [définis par la race] — parce que s’il y avait une association d’étudiants blancs, cela créerait probablement beaucoup d’ennuis… Je pense que c’est un peu triste… parce que l’interaction que j’ai eue avec des personnes d’origines différentes m’a beaucoup apporté, d’autant que je viens d’une école où il n’y avait pas grand-chose de ce genre.
Anna et beaucoup d’autres décrivent ces situations où les étudiants racisés s’associent de manière privilégiée entre eux comme étant en contradiction avec leurs attentes, liées en particulier au cadre de la diversité, selon lesquelles la qualité de leur éducation dépend de leur capacité à interagir avec des pairs minoritaires. Pour Anna, l’existence d’une association d’étudiants noirs, mais pas d’une association d’étudiants blancs, porte atteinte à la fois à la norme d’égalité de traitement que véhicule le cadre de la neutralité et à l’impératif de mixité que suppose le cadre de diversité. Bien que les données disponibles sur la composition démographique de nombreuses organisations étudiantes, dont les étudiants blancs sont membres, réfutent l’affirmation d’Anna (Sidanius et al., 2008), elle a le sentiment que les Blancs ne sont ni autorisés ni encouragés à s’associer sur les campus, alors que les étudiants minoritaires le sont fréquemment.
Natalie souligne le fait que les étudiants noirs semblent souvent attablés de manière séparée dans l’espace potentiellement intégrateur qu’est le réfectoire : « La table des jeunes Noirs dans le réfectoire… J’ai aussi une amie qui est noire et nous nous asseyons avec elle, [donc] ce n’est pas tout le temps. » Natalie ne mentionne pas la ségrégation des Blancs qui sont le groupe numériquement le plus important sur le campus. Elle utilise le « nous » vraisemblablement pour décrire ses camarades blancs. Ni le cadre de la neutralité ni celui de la diversité n’aident Natalie à comprendre que c’est en raison de leur nombre important que les étudiants blancs passent inaperçus quand ils s’assoient ensemble, tout comme les étudiants minoritaires, moins nombreux, sont remarqués quand ils font de même.
Quatre étudiants seulement (4/47) mobilisent le cadre de l’analytique du pouvoir pour rendre compte des inégalités raciales structurelles. Kyle répond ainsi aux critiques de l’affirmative action en évoquant son propre avantage racial :
On dit que [l’affirmative action] est un avantage injuste. Mais en fait, pendant les douze années qui ont précédé l’université, j’ai bénéficié d’un avantage injuste. Les Blancs ont bénéficié d’avantages injustes toute leur vie aux États-Unis. Donc… ce n’est même pas une égalisation.
Cette prise de conscience par Kyle du privilège blanc l’amène en conséquence à soutenir les politiques d’affirmative action.
En décrivant des situations où il a perçu du racisme à l’endroit de ses amis noirs, Jeremy ajoute : « Pour moi, le racisme est vraiment structurel. Le racisme qui compte, c’est le fait que toutes les écoles de [sa ville natale, une grande ville], où les enfants noirs vont, tombent en ruine. C’est un racisme qui a beaucoup plus d’importance que quelqu’un qui ne te tient pas la porte. »
Les perspectives mises en avant par ces étudiants suggèrent ainsi une remise en cause des discours dominants, tant sur le campus que dans la société en général. Bien que nous n’ayons pas ici la place nécessaire pour développer une analyse détaillée de leurs parcours, l’enquête suggère que leurs expériences universitaires jouent un rôle primordial dans l’élaboration de ce cadre racial.
conclusion
Cette enquête a révélé le dynamisme des cadres raciaux. L’analyse montre en particulier que les étudiants blancs des universités d’élite sont fortement imprégnés par le cadre de l’indifférence aux origines qui a dominé leur vie avant d’accéder à l’université. Omniprésent dans la vie sociale, de manière générale, ce cadre semble également façonné par la ségrégation résidentielle et des expériences scolaires de bon nombre de nos répondants. Leur recrutement dans une université d’élite met en avant l’acquisition progressive du cadre de la diversité, marqué par une culturalisation des appartenances raciales, qui conduit les étudiants majoritaires à considérer l’interaction avec des pairs racisés comme partie intégrante d’une formation bien équilibrée. Si le cadre de la diversité est également caractéristique de la société américaine dans son ensemble (Alba et Nee, 2003), il semble trouver un écho particulier sur les campus de l’élite où l’enquête montre en effet l’incidence significative de l’expérience universitaire sur les cadres raciaux, ainsi que leur dynamisme et plasticité, sous l’influence de variables institutionnelles.
Mais les cadres raciaux de la neutralité et de la diversité semblent aussi coexister dans la vie étudiante d’une manière qui les rend ambivalents à l’endroit de politiques et d’expériences racialement marquées. Comme le montrent les résultats de l’enquête, ils peuvent être maniés simultanément par un même individu qui s’appuie tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre, à la manière des individus décrits par Swidler (1986) qui piochent dans différents segments de leurs « boîtes à outils » culturelles pour résoudre des problèmes spécifiques. L’enquête qualitative permet de saisir plus finement ces nuances que ne le font les moyens statistiques. Aussi, l’analyse des attitudes raciales par le prisme de la sociologie culturelle permet d’approfondir notre compréhension des conceptions contemporaines de la race, mettant en lumière la complexité des cadres raciaux, leur évolution dans le temps et leur influence en matière de choix politiques.
De manière importante, bien que les cadres de la neutralité raciale et de la diversité diffèrent, ils partagent un défaut commun d’attention à l’inégalité raciale, qui pourrait s’avérer une justification bien plus puissante des politiques en faveur de la justice raciale. Comme le relèvent Moore et Bell (2011, p. 600), « parce que la diversité offre un moyen de parler de la race sans parler d’inégalité, elle travaille à maintenir les frontières imposées autour des discours sur l’affirmative action » et à forclore les justifications qui s’enracinent dans l’inégalité et le racisme structurel. En effet, la dépendance institutionnelle à l’égard du cadre de la diversité pour justifier l’affirmative action aux États-Unis a sans doute précipité le démantèlement de cette politique. De la fin des années 1970 et jusqu’en 2023, les universités se sont appuyées sur les avantages que la diversité procure à l’ensemble des étudiants sur les campus pour légitimer la prise en compte des catégorisations raciales dans le processus d’admission — étant donné que l’éloge de la diversité fut la seule voie ouverte par la décision de la Cour suprême pour maintenir l’affirmative action en 1978. Bien que l’École de médecine de l’Université de Californie à Davis, dont les politiques étaient mises en cause avait également fait valoir un cadre d’analyse appuyé sur les rapports de pouvoir, cette analyse fut explicitement rejetée par la Cour pour qui la diversité était la seule justification recevable en faveur de ces politiques. Le désaveu de ce raisonnement, relativement faible, était-il peut-être inévitable ? Comme l’atteste la décision récente dans Students for Fair Admissions v. Harvard et Students for Fair Admissions v. University of North Carolina, Chapel Hill (2023), les militants anti-affirmative action ont fini par convaincre la Cour de s’en débarrasser, mettant ainsi un terme à ces politiques dans les universités américaines.
Par conséquent, le temps est peut-être venu pour les universités de réaffirmer et de mettre en avant le cadre de l’analytique du pouvoir pour rendre compte des effets persistants de la race à la fois sur les campus et dans la société en général. Les actions entreprises dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, après le meurtre de George Floyd en 2020, suggèrent en effet une montée en puissance de cette analytique du pouvoir qui se manifeste, par exemple, dans les déclarations antiracistes portées par des universités ou leur définition en tant qu’institutions antiracistes. Lorsque promu par les institutions académiques, le cadre de l’analytique du pouvoir pourrait en effet permettre de cultiver une prise de conscience accrue parmi les étudiants de l’inégalité raciale aux États-Unis. Il pourrait permettre de favoriser une meilleure compréhension de ces enjeux dans un contexte où beaucoup d’étudiantes et d’étudiants se voient confrontés à l’environnement le plus diversifié sur le plan racial qu’elles et ils n’aient jamais expérimenté de leur vie.
Appendices
Notes
-
[1]
Cet article reprend en les actualisant des données initialement parues dans Warikoo, N.K. et De Novais, J., (2015). Colour-blindness and diversity : Race frames and their consequences for white undergraduates at elite US universities. Ethnic and Racial Studies, 38(6), 860-876.
-
[2]
Dans cet article, pour des raisons de précisions, nous faisons le choix de conserver le terme américain d’« affirmative action » au lieu de ces traductions françaises usuelles.
-
[3]
Selon Bonilla-Silva (2003), les cadres raciaux sont des « voies établies pour l’interprétation des informations », ou encore des stratégies sémantiques qui viennent en appui du racisme aveugle à la couleur (colorblind racism). Pour Bonilla-Silva, les cadres raciaux forment en d’autres termes une idéologie qui explique et justifie le statu quo racial du privilège blanc. Dans cet article, nous mettons de côté la question du rôle idéologique pour nous concentrer sur la construction pratique des cadres raciaux que les étudiants manient.
-
[4]
Bien que cet article porte davantage sur les cadres raciaux en tant que tels, plutôt que sur les orientations politiques qu’ils induisent, nous considérons que notre approche est cohérente avec cette littérature.
-
[5]
Un autre modèle de diversité est celui qui repose sur une relative séparation des groupes. Hartmann et Gerteis (2005) le qualifient de « pluralisme fragmenté », en l’opposant au « pluralisme interactif », dans lequel les différents groupes développent des « liens moraux substantiels » entre eux. Dans cet article, nous nous appuyons sur une perspective interactive du pluralisme, car c’est celle que nous avons observée sur le terrain, ainsi que celle qui est couramment mobilisée dans les débats sur la diversité et le multiculturalisme aux États-Unis.
-
[6]
Des recherches récentes ont proposé des analyses plus sophistiquées sur les liens à concevoir entre culture et pauvreté (pour une revue voir Small et al., 2010). Cependant, la plupart des compréhensions ordinaires que nous avons rencontrées ne relèvent pas de cette perspective, mais plutôt d’explications relativement simples fondées sur les notions de valeurs et de priorités propres aux différents groupes.
-
[7]
Ceux-ci incluent également une compréhension biologique de la race et un cadre nationaliste culturaliste qui résonne avec le modèle multiculturel du « pluralisme fragmenté », voir note 3 supra.
-
[8]
Alors même que des données solides attestent leur persistance aujourd’hui (pour une synthèse, voir Quillian, 2006).
Bibliographie
- Alba, R. et Nee, V. (2003). Remaking the American Mainstream : Assimilation and Contemporary Immigration. Harvard University Press.
- Arthur, J. et Shapiro, A. (1995). Campus Wars : Multiculturalism and the Politics of Difference. Westview Press.
- Berrey, E. C. (2011). Why Diversity Became Orthodox in Higher Education, and How It Changed the Meaning of Race on Campus. Critical Sociology, 37(5), 573-596. https://doi.org/10.1177/0896920510380069
- Binder, A. et Wood, K. (2013). Becoming Right : How Campuses Shape Young Conservatives. Princeton University Press.
- Bobo, L. D. et Charles, C. Z. (2009). Race in the American Mind : From the Moynihan Report to the Obama Candidacy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 621(1), 243-259. https://doi.org/10.1177/0002716208324759
- Bonilla-Silva, E. (2003). Racism without Racists : Color-blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. Rowman & Littlefield.
- Brown University Office of Institutional Research. (2012). Fall Census Enrollment. Repéré le 20 juin 2013. http://brown.edu/about/administration/institutional-research/sites/brown.edu.about.administration.institutional-research/files/uploads/Enrollment2012.pdf
- Bryson, B. (2005). Making Multiculturalism : Boundaries and Meaning in U.S. English Departments. Stanford University Press.
- Chang, M. J., Astin, A. W. et Kim., D. (2004). Cross-Racial Interaction Among Undergraduates : Some Consequences, Causes, and Patterns. Research in Higher Education, 45(5), 529-553. https://doi.org/10.1023/B : RIHE.0000032327.45961.33
- Chen, S. (2000). Debates Over Third World Centers at Princeton, Brown and Harvard : Minority Student Activism and Institutional Responses in the 1960s and 1970s. Harvard University.
- Eliasoph, N. (1999). Everyday Racism in a Culture of Political Avoidance : Civil Society, Speech, and Taboo. Social Problems, 46(4), 479-502. https://doi.org/10.2307/3097072
- Espenshade, T., Radford, A. et Chung, C. (2009). No Longer Separate, Not Yet Equal : Race and Class in Elite College Admission and Campus Life. Princeton University Press.
- Feagin, J. (2006). Systemic Racism : A Theory of Oppression. Routledge.
- Gallagher, C. (2003). White Reconstruction in the University. Dans M. Kimmel et A. Ferber (dir.), Privilege : A Reader (p. 299-318). Westview Press.
- Goffman, E. (1974). Frame Analysis : An Essay on the Organization of Experience. Harvard University Press.
- Goldman, S. K. (2012). Effects of the 2008 Obama Presidential Campaign on White Racial Prejudice. Public Opinion Quarterly, 76(4), 663-687. https://doi.org/10.1093/poq/nfs056
- Gross, N. et Fosse, E. (2012). Why are Professors Liberal ? Theory and Society, 41(2), 127-168. https://doi.org/10.1007/s11186-012-9163-y
- Gurin, P., Dey, E., Hurtado, S. et Gurin, G. (2002). Diversity and Higher Education : Theory and Impact on Educational Outcomes. Harvard Educational Review, 72(3), 330.
- Hartmann, D. et Gerteis, J. (2005). Dealing with Diversity : Mapping Multiculturalism in Sociological Terms. Sociological Theory, 23(2), 218-240. https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2005.00251.x
- Harvard University Office of Institutional Research (2009). Degree Student Enrollment.
- Hochschild, J., Weaver, V. et Burch, T. (2012). Creating a New Racial Order : How Immigration, Multiracialism, Genomics, and the Young Can Remake Race in America. Princeton University Press.
- Huntington, S. (2004). Who Are We ? The Challenges to America’s National Identity. Simon & Schuster.
- Kalev, A., Dobbin, F. et Kelly, E. (2006). Best Practices or Best Guesses ? Assessing the Efficacy of Corporate Affirmative Action and Diversity Policies. American Sociological Review, 71(4), 589-617. https://doi.org/10.1177/000312240607100404
- Kasinitz, P., Mollenkopf, J., Waters, M. et Holdaway, J. (2008). Inheriting the City : The Children of Immigrants Come of Age. Harvard University Press.
- Lawrence, G. H. etKane, T.D. (1995). Military Service and Racial Attitudes of White Veterans. Armed Forces & Society, 22(2), 235-255. https://doi.org/10.1177/0095327X9502200205
- Lewis, A. (2003). Race in the Schoolyard : Negotiating the Color Line in Classrooms and Communities. Rutgers University Press.
- Moore, W. (2008). Reproducing Racism : Whtie Space, Elite Law Schools, and Racial Inequality. Rowman and Littlefield.
- Moore, W. et Bell, J. (2011). Maneuvers of Whiteness : ‘Diversity’ as a Mechanism of Retrenchment in the Affirmative Action Discourse. Critical Sociology, 37(5), 597-613. https://doi.org/10.1177/0896920510380066
- Morning, A. (2011). The Nature of Race : How Scientists Think and Teach About Human Difference. University of California Press.
- Munson, Z. (2010). Mobilizing on Campus : Conservative Movements and Today’s College Students. Sociological Forum, 25(4), 769-786. https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2010.01211.x
- Omi, M. et Winant, H. (1986). Racial Formation in the United States : From the 1960s to the 1980s. Routledge.
- Orfield, G., Kucsera, J. et Siegel-Hawley, G. (2012). E Pluribus…Separation : Deepening Double Segregation for More Students. The Civil Rights Project. https://escholarship.org/uc/item/8g58m2v9
- Perry, P. (2002). Shades of White : White Kids and Racial Identities in High School. Duke University Press.
- Picca, L. et Feagin, J. (2007). Two-faced Racism : Whites in the Backstage and Frontstage. Routledge.
- Pollock, M. (2004). Colormute : Race Talk Dilemmas in an American School. Princeton University Press.
- Quillian, L. (2006). New Approaches to Understanding Racial Prejudice and Discrimination. Annual Review of Sociology, 32(1), 299-328. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123132
- Rojas, F. (2007). From Black Power to Black Studies : How a Radical Social Movement Became an Academic Discipline. Johns Hopkins University Press.
- Roth, W. (2012). Race Migrations : Latinos and the Cultural Transformation of Race. Stanford University Press.
- Schuman, H., Steeh, C. et Bobo, L. (1997). Racial Attitudes in America : Trends and Interpretations. Harvard University Press.
- Sears, D. O. et Henry, P. J. (2005). Over Thirty Years Later : A Contemporary Look at Symbolic Racism. Advances in Experimental Social Psychology, 37, 95-150. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(05)37002-X
- Sidanius, J., Levin, S., van Laar, C. et Sears, D. (2008). The Diversity Challenge : Social Identity and Intergroup Relations on the College Campus. Russell Sage Foundation.
- Skrentny, J. D. (2008). Culture and Race/Ethnicity : Bolder, Deeper, and Broader. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 619(1), 59-77. https://doi.org/10.1177/0002716208319761
- Small, M. L. (1999). Departmental Conditions and the Emergence of New Disciplines : Two Cases in the Legitimation of African-American Studies. Theory and Society, 28(5), 659-707. https://doi.org/10.1023/A : 1007034317576
- Small, M. L. (2004). Villa Victoria : The Transformation of Social Capital in a Boston Barrio. University of Chicago Press.
- Small, M. L., Harding, D. J. et Lamont, M. (2010). Reconsidering Culture and Poverty. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 629(1), 6-27. https://doi.org/10.1177/0002716210362077
- Sniderman, P. et Carmines, E. (1997). Reaching Beyond Race. Harvard University Press.
- Stulberg, L. M. et Chen, A.S. (2014). The Origins of Race-Conscious Affirmative Action in Undergraduate Admissions : A Comparative Analysis of Institutional Change in Higher Education. Sociology of Education, 87(1), 36-52. https://doi.org/10.1177/0038040713514063
- Swidler, A. (1986). Culture in Action : Symbols and Strategies. American Sociological Review, 51(2), 273-286. https://doi.org/10.2307/2095521
- Thernstrom, S. et Thernstrom, A. (1997). America in Black and White : One Nation, Indivisible. Simon & Schuster.
- Valenzuela, A. (1999). Subtractive Schooling : Issues of Caring in Education of U.S.-Mexican youth. State University of New York Press.
- Voyer, A. (2011). Disciplined to Diversity : Learning the Language of Multiculturalism. Ethnic & Racial Studies, 34(11), 1874-1893. https://doi.org/10.1080/01419870.2011.552620
- Warikoo, N. (2016). The diversity bargain : And other dilemmas of race, admissions, and meritocracy at elite universities. University of Chicago press.
- Yosso, T. J., Parker, L., Solorzano, D. G. et Lynn, M. (2004). From Jim Crow to Affirmative Action and Back Again : A Critical Race Discussion of Racialized Rationales and Access to Higher Education. Review of Research in Education, 28(1), 1-25. https://doi.org/10.3102/0091732X028001001