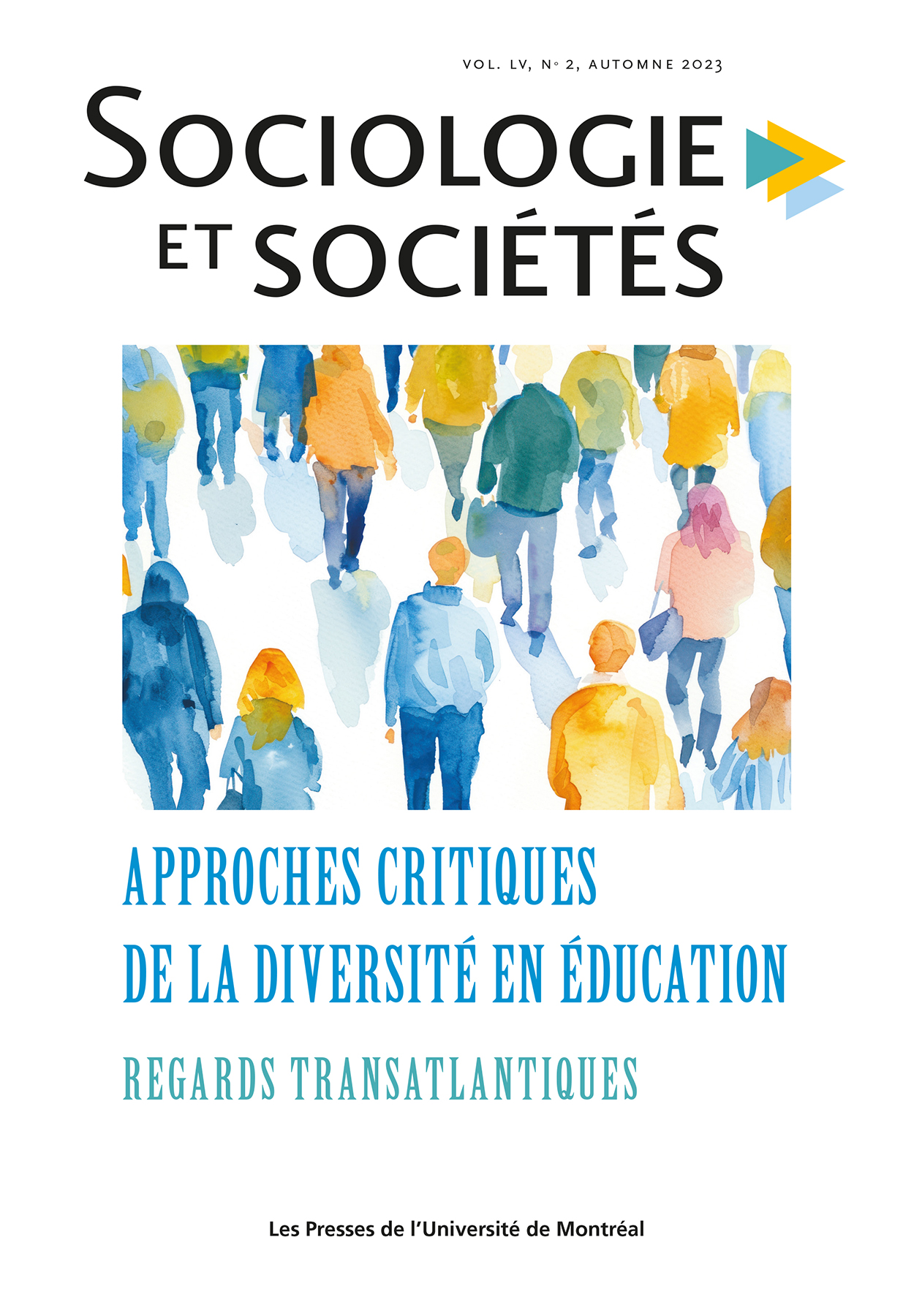Abstracts
Résumé
Au Québec, les initiatives en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) en éducation sont mises en place dans les institutions d’enseignement pour lutter contre les discriminations et les barrières systémiques. Cependant, le climat dit post-racial en vigueur, qui laisse entendre que la discrimination fondée sur la race n’est plus un facteur pertinent pour expliquer les disparités socio-scolaires, complique ces efforts. Cet article présente les résultats d’une étude qualitative intersectionnelle relative au classement en éducation spécialisée d’élèves noir·e·s. Prenant appui sur les cadres théoriques critiques de la blackness et du handicap et utilisant la méthode du contre-récit, des entretiens ont été menés avec 21 membres du personnel scolaire et 20 élèves noir·e·s.. Les résultats révèlent un écart entre la perception du personnel scolaire et les expériences des élèves, mettant en lumière les défis liés à la prise en compte des « besoins particuliers » et des vulnérabilités des élèves noir·e·s. au sein de cette ère dite post-raciale.
Mots-clés :
- éducation spécialisée et inclusive,
- élèves noir·e·s,
- post-racial,
- racisme anti-Noir·e·s,
- équité diversité et inclusion (EDI)
Abstract
In Quebec, equity, diversity, and inclusion (EDI) initiatives in learning institutions serve to address discrimination and systemic barriers in education. However, our supposedly post-racial climate complicates these efforts by suggesting that race-based discrimination is no longer a relevant factor to explain socio-academic disparities. This article presents the results of an intersectional qualitative study on the placement of Black students in special education. Drawing on critical theoretical frameworks of Blackness and disability, and using a counter-narrative methodoloy, interviews were conducted with 21 school staff members and 20 Black students. The analysis of our results reveals a striking gap between the perceptions of school staff and students’ experiences, highlighting challenges related to considering the needs and vulnerabilities of Black students in the context of a supposedly post-racial era.
Keywords:
- Special and inclusive education,
- black students,
- post-racialism,
- anti-Black racism,
- equity diversity and inclusion (EDI)
Resumen
En Quebec, las instituciones educativas llevan adelante iniciativas de equidad, diversidad e inclusión (EDI) en la educación para combatir la discriminación y las barreras sistémicas. Sin embargo, el clima posracial actual, que sugiere que la discriminación racial ya no es un factor relevante para explicar las disparidades socioescolares, socava estos esfuerzos. El presente artículo revela los resultados de un estudio cualitativo interseccional sobre la clasificación de los/as alumnos/as negros/as en la educación especial. Con fundamento en los marcos teóricos críticos de negritud (blackness) y discapacidad, y utilizando el contraargumento como método, se realizaron entrevistas a 21 miembros del personal escolar y a 20 alumnos/as negros/as. Los resultados revelaron una brecha entre la percepción del personal escolar y las experiencias de los/as estudiantes. Esto pone de manifiesto los retos que supone abordar las “necesidades especiales” y las vulnerabilidades de los/as alumnos/as negros/as en esta presunta era posracial.
Palabras clave:
- educación especial y inclusiva,
- estudiantes negros/as,
- posracial,
- inclusión,
- diversidad,
- equidad
Article body
introduction
Au Québec, les initiatives en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) sont désormais enracinées dans le paysage institutionnel, se multipliant de manière intersectorielle, dans le but d’atténuer les barrières systémiques et diverses formes de discrimination qui touchent certains groupes historiquement minorisés. Parallèlement, un éventail substantiel de critiques sont avancées à l’égard de ces initiatives, notamment en ce qui concerne leurs fondements anhistoriques, leurs dimensions symboliques, ainsi que leur inefficacité (Ahmed, 2012). Les institutions éducatives ne sont pas épargnées par ces critiques. Alors que des approches interculturelles et inclusives en éducation ont été mobilisées comme moyen de « gérer » la diversité croissante des publics scolaires, et de promouvoir le vivre-ensemble, le bien-être et le sentiment d’appartenance (Potvin, 2018), les élèves issu·e·s de divers groupes minorisés continuent d’être victimes de discrimination et d’exclusion, tout en faisant face à des expériences traumatiques en milieu scolaire (CDPDJ, 2011 ; Collectif les Béliers solidaires, 2020).
De façon concomitante, au cours des 50 dernières années, une approche culturaliste visant à comprendre les expériences socioscolaires des élèves « issu·e·s de la diversité » a dominé la recherche en éducation au Québec. Dans cette perspective, la priorité est accordée aux facteurs culturels pour comprendre les expériences et performances éducatives des élèves racialisé·e·s. Cette approche s’est souvent concentrée sur l’intégration linguistique des communautés immigrantes, tout en occultant les expériences et processus inéquitables et racialisants qui persistent dans les établissements éducatifs (Collins et al., 2022). Ce cadre de référence s’explique en grande partie par l’ère dite post-raciale en vigueur au Québec, qui sous-entend que la discrimination fondée sur la race n’est plus un facteur pertinent pour expliquer les interactions sociales, les chances de réussite ou les résultats (Goldberg, 2015 ; Howard, 2023).
Par conséquent, les chercheur·se·s continuent à s’affranchir des concepts de race et de racisme, malgré leur importance dans les contextes éducatifs (Thésée, 2021). De surcroît, si le recours à ces concepts est un défi en soi, discuter de la spécificité du racisme anti-Noir·e·s apparaît comme une gageure. Comme l’explique Thésée (2022),
on peut remarquer qu’il existe un trou noir conceptuel qui conduit à invisibiliser la couleur de peau et à étouffer toute tentative de penser, d’écrire, de s’exprimer, d’agir contre le racisme ou de lutter pour l’émancipation et l’affirmation de la spécificité de l’expérience d’être noir·e […]. Il y a une confiscation des mots pour exprimer cette réalité, en raison du caractère colonial de la langue française.
p. 90, traduction
En effet, ce musellement épistémique pose des défis dans la rédaction de cet article. Comme stratégie de contournement, le terme anglais « blackness » est employé. La blackness ne se réduit pas simplement à la couleur de peau. Elle représente une identité et une expérience façonnées par des histoires communes, parfois contestées ou changeantes, et enracinées dans des contextes géographiques spécifiques (Dei, 2018). Elle englobe la conscience historique et politique des Noir.e.s, ainsi que des valeurs d’affirmation de soi, d’autonomie, d’amour et de résistance (Dumas et ross, 2016). De nombreux chercheur·se·s s’inscrivant dans le champ des études critiques relatives à la blackness travaillent sans relâche pour combler ce « trou noir ». Cependant, au moment de la rédaction de cet article, cette option se manifeste comme étant la plus appropriée pour transmettre l’expérience et l’identité d’être noir·e dans un contexte francophone à l’ère de l’idéologie dite post-raciale.
Cet article présente les résultats d’une étude portant sur l’expérience intersectionnelle de la blackness et du handicap. L’enquête prend ainsi appui sur deux cadres théoriques : les études critiques relatives au handicap (critical disability studies) et celles relatives à la blackness (critical black theory), abordant l’interrelation entre le capacitisme et le racisme anti-Noir·e·s, notamment la manière dont ces deux dimensions fonctionnent en tandem afin de maintenir un ensemble d’iniquités de nature systémique (Bailey et Mobley, 2019). À l’aide de la méthode du contre-récit (Solorzano et Yosso, 2002), approche méthodologique qualitative critique, des entrevues ont été réalisées auprès de 21 membres du personnel scolaire et de 20 élèves du secondaire, parallèlement à l’analyse de leurs dossiers scolaires. Les principaux résultats mettent en évidence un important décalage entre la perception du classement en éducation spécialisée exprimée par le personnel et les expériences relatées par les élèves. L’étude illustre ainsi à quel point la finalité et les objectifs-cadres des politiques d’inclusion se situent aux antipodes de la problématique du racisme anti-Noir·e·s.
l’intersection du handicap et de la blackness, à l’ère de l’idéologie dite post-raciale
Pour appréhender la spécificité de l’expérience de la blackness dans le cadre des politiques EDI, du point de vue du classement en éducation spécialisée, il faut d’abord comprendre le cadre organisationnel et sociopolitique dans lequel ce classement s’opère. L’éducation spécialisée au Québec, bien qu’animée par des objectifs d’équité et d’inclusion, révèle des dynamiques complexes et parfois paradoxales. D’une part, elle propose un cadre destiné à répondre aux « besoins particuliers » des élèves, mais d’autre part, elle arbore des disparités raciales marquées, comme le montre notamment la surreprésentation des jeunes noir·e·s dans ce secteur (Mc Andrew et Ledent, 2008). Ce phénomène amène à fortement remettre en question le bien-fondé de l’idéologie post-raciale. Les sections suivantes explorent ces réalités en examinant l’impact du classement des élèves à « besoins particuliers » ; la marginalisation des jeunes Noir·e·s ; et le paradoxe entre l’idéologie post-raciale et les disparités raciales persistantes.
L’intégration scolaire et le classement des élèves à « besoins particuliers »
L’éducation spécialisée est conçue comme un moyen de promouvoir et de garantir une égalité des chances d’accès aux ressources et aux services éducatifs pour tous et toutes les élèves, y compris les élèves handicapé·e·s. Cet objectif est mis en oeuvre par le biais d’une politique d’intégration (MEQ, 1999) qui repose sur une approche psycho-médicale, laquelle préconise la mise en place d’environnements d’apprentissage éducatifs adaptés aux élèves ayant des « besoins particuliers ». Ces environnements d’apprentissage peuvent être intégrés ou non aux établissements scolaires ordinaires. Lorsque ces élèves sont scolarisé·e·s dans les écoles et les classes ordinaires tout en bénéficiant d’accommodements et d’adaptations précises, les environnements d’apprentissage sont dits « intégrés ». Les environnements d’apprentissage dits « non intégrés » comprennent : la scolarisation des élèves au sein d’établissements médicaux ou à domicile ; les classes spécialisées au sein d’écoles ordinaires ainsi que les écoles spécialisées accueillant exclusivement des élèves ayant des « besoins particuliers ». Les écoles spécialisées ont tendance à avoir des ratios personnel-élèves beaucoup plus faibles, l’accès à davantage de ressources spécialisées (psychoéducateur·rice·s, orthophonistes, technicien·ne·s en comportement, etc.) et un environnement généralement plus intime et mieux contrôlé.
Inégalités raciales et trajectoires éducatives : le cas des élèves noir·e·s en éducation spécialisée
La surreprésentation des élèves racialement minorisé·e·s, en particulier des jeunes Noir·e·s, dans les programmes d’éducation spécialisée suscite des préoccupations croissantes quant à l’atteinte des objectifs d’équité et d’inclusion (Cooc et Kiru, 2018). Bien que ces programmes aient été conçus pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, leur mise en oeuvre semble souvent renforcer des dynamiques discriminatoires. Une telle préoccupation prend tout son sens dans le contexte québécois, comme l’illustre la représentation disproportionnée des jeunes Noir·e·s dans le secteur de l’éducation spécialisée.
À cet égard, la seule étude menée jusqu’à présent à ce sujet a mis en évidence une sur-représentation d’élèves noir·e·s en adaptation scolaire, originaires des Caraïbes et/ou d’Afrique subsaharienne (Mc Andrew et Ledent, 2008). Dans le secteur francophone, ces élèves étaient représenté·e·s à un taux de 17,8 %, comparativement à 12,6 % pour l’ensemble de la population. Ils étaient également le groupe le plus nombreux à être classé dans des milieux d’apprentissage non intégrés (14,8 %), comparativement à la population générale (8,9 %) et aux autres groupes d’immigrant·e·s (considéré·e·s comme non-noir·e·s) (6,4 %). Dans le secteur anglophone, cette surreprésentation était plus importante, s’élevant à 19,8 %, comparativement au taux de 16,3 % pour la population totale et de 10,8 % pour la population immigrante combinée (Mc Andrew et Ledent, 2008).
En raison de cette représentation disproportionnée, les jeunes Noir·e·s forment le groupe le plus à risque de ne pas obtenir un diplôme d’études secondaires (Mc Andrew et al., 2015). Leur parcours éducatif est également davantage associé à des trajectoires non linéaires menant au secteur de l’enseignement professionnel (Rousseau et al., 2016), à une surreprésentation dans le secteur de formation des adultes (Potvin et Leclercq, 2014) et à une sous-représentation dans l’accès à l’enseignement supérieur et l’achèvement des études universitaires (Kamanzi, 2023) — autant de facteurs qui peuvent contribuer à accroître leur vulnérabilité au chômage, à la pauvreté et à l’exclusion socioéconomique (CDPDJ, 2011 ; Torczyner et al., 2010).
L’éducation spécialisée au prisme de l’idéologie post-raciale : entre illusion d’inclusion et réalités invisibles
La revue de littérature montre ainsi les effets inéquitables, non inclusifs et durables de l’éducation spécialisée sur les jeunes Noir·e·s. Au Québec, les élèves noir·e·s catégorisé·e·s comme ayant des « besoins particuliers » occupent donc une position charnière particulièrement critique dans le cadre des politiques d’EDI. D’une part, alors que ces politiques se veulent universelles, le marqueur social de la race continue d’être contesté, marginalisé et sous-analysé (Garneau et Giraudo-Baujeu, 2018). Par exemple, dans la plus récente politique de réussite éducative (MELS, 2017), l’approche inclusive mise sur la réussite pour « toutes et tous », prenant en compte des aspects tels que : les capacités intellectuelles, psychologiques, sociales, affectives et physiques ; le statut socioéconomique au regard des élèves venant de milieux défavorisés ; les trajectoires migratoires ; les situations de retard scolaire ; les particularités linguistiques, culturelles ou religieuses du milieu d’origine ; les identités de sexe, de genre et liées à l’orientation sexuelle. Cependant, on constate que, malgré la vaste diversité des critères énoncés, la question raciale demeure absente.
De manière similaire, une publication ministérielle de suivi encourage les écoles à mettre en place des initiatives visant à « soutenir la réussite éducative et la persévérance scolaire des élèves issus de l’immigration à risque en matière d’exclusion » (MEQ, 2023, p. 19) illustrant la non-reconnaissance persistante de la race comme facteur d’exclusion. Son omission répétée laisse entendre que la question raciale n’aurait pas de place dans les discussions sur l’inclusion et la réussite éducative — au diapason de l’idéologie dite post-raciale dominante qui considère le racisme soit comme une réalité appartenant au passé, soit comme un problème extraterritorial. Selon celle-ci,
rien de ce que nous faisons aujourd’hui ne peut être raciste. Parce que nous abordons les notions de culture et d’ethnicité sous un seul angle considéré comme légitime, celui de la différence humaine […], il est « acceptable » de considérer certaines personnes comme étant culturellement incompatibles
Lentin et Karakayali, 2016, p. 142, traduction
Cette approche se reflète également dans les travaux sur les disparités éducatives, qui se sont souvent focalisés sur les enjeux de culture, de langue, de classe sociale et d’intégration, en lien avec la réussite socioscolaire et la participation sociale (Bissonnette et al., 2019 ; Gilbert-Blanchard et al., 2022 ; Mc Andrew et al., 2008 ; 2015). Ces variables sont aussi mobilisées pour expliquer l’échec scolaire (Caldas et al., 2009 ; Tardif-Grenier et al., 2017) et la surreprésentation de certains profils d’élèves dans l’éducation spécialisée (Mc Andrew et Ledent, 2008). Il en résulte que les causes et les effets systémiques de la surreprésentation des élèves noir·e·s dans l’éducation spécialisée, ainsi que les expériences de racisme spécifiquement anti-Noir·e·s vécues par ces derniers·ère·s, demeurent, à tout le moins, insuffisamment expliqués.
théories critiques du racisme anti-noir·e·s et du capacitisme : pour une approche alternative des disparités éducatives
Face aux limites des analyses culturalisantes, la théorie critique de la blackness (critical Black theory) (Dumas et ross, 2016) et les théories critiques sur le handicap (critical disability studies) (Meekosha et Shuttleworth, 2009) offrent une voie féconde pour approfondir la compréhension des mécanismes structurels du racisme anti-Noir·e·s et du capacitisme. La théorie critique de la blackness est un sous-champ des théories critiques de la race (critical race theory [CRT]). La CRT développe un cadre d’analyse qui met l’accent sur le racisme institutionnel, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques, politiques et structures au sein des institutions qui, de manière directe ou indirecte, perpétuent les inégalités raciales en marginalisant systématiquement les groupes racialement minorisés, même en l’absence d’intentions « explicitement racistes » (Collins, 2022). Elle repose sur six principes fondamentaux : 1) la persistance et l’invisibilisation du racisme ; 2) le privilège conféré par la blanchité ; 3) l’importance des récits et des contre-récits comme formes de résistance ; 4) la convergence des intérêts des groupes dominants ; 5) la critique du libéralisme ; et 6) l’importance de l’intersectionnalité (Delgado et Stefancic, 2023).
Toutefois, si la théorie critique de la race propose une critique du racisme sans distinguer les spécificités vécues par les différents groupes racialisés, la théorie critique de la blackness fournit des outils plus précis pour analyser le vécu distinct des personnes noires. Elle met en lumière les dynamiques spécifiques du racisme anti-Noir.e.s, qui désigne la forme la plus virulente et systématique du racisme, caractérisée par la déshumanisation, la marginalisation et la criminalisation constante des personnes noires (Fanon, 1958 ; Wynter, 2003). De manière similaire, le racisme anti-Noir·e·s ne se réduit pas de façon simpliste à une discrimination en lien avec la couleur de peau ou à l’appartenance ethnique ou culturelle. Elle représente une construction sociale et politique à travers laquelle la blackness est perçue comme intrinsèquement inférieure et menaçante, renforçant ainsi la hiérarchie raciale (Dumas, 2018) et perpétuant des stéréotypes racistes historiques enracinés, tels que l’hypersexualisation des femmes noires et l’hyper-agressivité ou criminalité des hommes noirs (Alexander, 2011 ; Collins, 2022). Ainsi, le racisme anti-Noir·e·s
depuis l’époque coloniale, comprend une idéologie, des préjugés, des stéréotypes, des représentations, des lois, des normes et des pratiques qui visent à subordonner spécifiquement les Noires et les Noirs [… en tant que] composante d’une hiérarchie de rapports sociaux de pouvoir [qui] persiste aujourd’hui de manières subtile et diverse dans plusieurs sphères de la vie sociale
Jean-Pierre et Collins, 2022, p. 16
Un concept associé à la théorie critique de la blackness est celui de l’adultisation (adultification) des enfants noir·e·s. Cette adultisation se manifeste par la tendance à les percevoir et à les traiter comme étant plus âgé·e·s et moins innocent·e·s que leurs pair·e·s d’autres groupes raciaux, ce qui les expose, dès le plus jeune âge, à des attentes démesurées et à des traitements injustes, notamment en matière de discipline scolaire (Epstein et al., 2017). Epstein et collègues (2017) ont mis en évidence le biais d’adultisation des filles noires, perçues comme plus indépendantes, responsables et moins innocentes que leurs paires blanches. Selon ces auteures, ce biais alimente des sanctions disciplinaires disproportionnées, les filles noires étant souvent considérées comme ne nécessitant pas de soutien, de protection et de réconfort. De manière similaire, les garçons noirs tendent à être perçus comme plus âgés et plus menaçants qu’ils ne le sont réellement. Cette perception accentue leur criminalisation dans les écoles, où leurs comportements sont souvent interprétés comme malveillants et punis de manière disproportionnée (Gilmore et Bettis, 2021).
Quant aux études critiques du handicap, elles construisent également celui-ci en tant que système social, politique, culturel et historique, interrelié à d’autres marqueurs sociaux tels que la race, le sexe, le statut socioéconomique, le statut migratoire, l’orientation sexuelle, etc. (Meekosha et Shuttleworth, 2009). Schalk (2017) décrit les approches critiques du handicap non pas comme l’étude exclusive des personnes handicapées, mais plutôt comme celle du pouvoir et des privilèges, à la lumière des perspectives, des pratiques et des préoccupations relatives au capacitisme. Conjugué à la théorie critique de la blackness, ce cadre d’analyse permet d’examiner comment le racisme anti-Noir·e·s, l’adultisation et le capacitisme se croisent pour marginaliser davantage les personnes noires en situation de handicap. Selon Schalk (2017), l’expérience du handicap et de la racialisation diffère pour les élèves noir·e·s, mettant en lumière l’invisibilisation qu’ils ou elles subissent ; la spécificité de la blackness dans les dynamiques raciales ; l’importance d’un cadre théorique critique pour remettre en question les postulats dominants et offrir des analyses alternatives.
méthodologie
En cohérence avec ce cadre théorique, une approche qualitative critique a été utilisée pour explorer le classement en éducation spécialisée des élèves noir·e·s. En effet, les chercheur·se·s critiques doivent entreprendre un processus continu d’autoréflexion sur leurs croyances, leurs expériences et leur positionnalité, afin de mener un travail de recherche approfondi et rigoureux, même lorsqu’ils et elles appartiennent à la communauté concernée par la recherche. En ma qualité de chercheuse afro-descendante ayant une formation en éducation spécialisée, je suis consciente du fait que ma position d’autorité s’accompagne de privilèges et de ressources qui peuvent être inaccessibles à d’autres membres des communautés noires et handicapées. Afin de remédier aux risques de biais et d’exploitation inhérents à cette situation, les décisions prises à toutes les étapes du processus de recherche ont été guidées par un impératif de transparence et de réciprocité. Le recours à la méthode du contre-récit s’inscrit dans cette démarche.
La méthode du contre-récit, issue de la CRT, vise à contrer les discours dominants ayant historiquement sous-représenté, mal représenté ou invalidé les expériences des personnes minorisées (Solórzano et Yosso, 2002). Plus précisément, les contre-récits relatent les expériences des individus et des groupes racialement minorisés (Miller et al., 2020). Ils restaurent les traditions narratives au sein de ces derniers (Bell, 2004) et revalorisent des formes de savoir « autres », souvent reléguées au rang de folklore ou de savoir non scientifique (Dei, 2013). Ils facilitent le questionnement des hypothèses dominantes susceptibles de soutenir et/ou légitimiser l’injustice raciale et recentrent l’analyse sur les systèmes et structures, plutôt que sur les individus (Solórzano et Yosso, 2002). Dans le cadre de cette recherche, la méthode du contre-récit a permis de : 1) reconstituer le récit institutionnel dominant en interrogeant les hypothèses implicites qui soutiennent les inégalités raciales ; 2) documenter les expériences vécues du classement en éducation spécialisée du point de vue des élèves noir·e·s en mettant en lumière les dynamiques de racialisation ; 3) contraster les points de vue pour mieux comprendre les écarts entre les discours institutionnels et les réalités vécues par les élèves. Pour ce faire, l’étude a été menée au sein de quatre écoles ordinaires et sept écoles spécialisées. Les participant·e·s, soit des membres du personnel scolaire et des élèves, ont été recruté·e·s au moyen d’un appel à participation envoyé par courriel par l’intermédiaire des directeur·rice·s d’école et à l’aide de la méthode boule de neige. Le personnel scolaire devait remplir deux critères pour participer à l’étude, à savoir : 1) être employé par une commission scolaire anglophone au sein d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire du secteur des jeunes ; 2) participer au processus de classement des élèves en éducation spécialisée. Les critères de sélection des élèves étaient les suivants : 1) l’auto-identification comme noir·e[1] ; et 2) l’inscription dans une école spécialisée à un moment donné au cours de l’année scolaire[2]. Au total, les groupes de participant·e·s étaient composés de 21 membres du personnel et de 20 élèves, comme l’indiquent les tableaux 1 et 2. Cependant, il convient de noter que même si les participant·e·s ont été recruté·e·s dans des commissions scolaires anglophones, cette étude ne se limite pas aux expériences d’élèves dans ce système. Plusieurs d’entre eux et elles ont évoqué des segments de leur parcours socioscolaire liés à leur inscription préalable dans le système francophone.
Tableau 1
Caractéristiques des membres du personnel participant
Tableau 2
Caractéristiques des élèves participant·e·s
Les aspects éthiques de la recherche ont été approuvés par le Comité plurifacultaire d’éthique en recherche de l’Université de Montréal. La majorité des données ont été recueillies au moyen d’entrevues semi-structurées avec les participant·e·s. Dans certains cas, des groupes de discussion ont été organisés avec le personnel en raison de contraintes personnelles et professionnelles. Au total, six groupes de discussion ont été organisés (tableau 1). Les entretiens, d’une durée de 45 à 90 minutes, ont principalement été menés dans des salles privées au sein des établissements scolaires de rattachement des participant·e·s.
Les données générées par le personnel et les élèves ont d’abord fait l’objet d’analyses thématiques distinctes. Toutes les entrevues ont été codées à l’aide du logiciel QDA Miner. Les données relatives au personnel scolaire ont été codées de façon déductive en prenant appui sur les différentes phases du processus de classement en éducation spécialisée documentées dans les revues de la littérature : références, évaluations, identification, classement et prestation de services. Étant donné que les différents groupes de professionnel·le·s avaient des rôles distincts à des moments particuliers du processus de classement, cette analyse a permis une reconstitution et une description détaillées du processus. Les entrevues avec les élèves ont fait l’objet d’un codage inductif. Différents thèmes ont émergé des témoignages des élèves, permettant de décrire chaque phase de leur parcours éducatif (primaire, secondaire, transition et classement dans des écoles spécialisées) afin de produire un contre-récit. Enfin, les récits du personnel scolaire et des élèves ont été contrastés.
derrière le paravent de la bienveillance : un défaut de prise en compte des vulnérabilités des élèves noir·e·s
D’après les témoignages du personnel scolaire et des élèves, le classement en éducation spécialisée peut être décrit comme un processus complexe déclenché, au sein des écoles ordinaires, par les « difficultés » comportementales et/ou d’apprentissage des élèves, telles que perçues par le personnel. Les élèves sont principalement dirigé·e·s par le personnel de l’école ordinaire vers un comité de classement mis en place pour faciliter le transfert de l’élève, que celui ou celle-ci ait été formellement évalué·e ou non, processus aboutissant au classement dans une école spécialisée. La présente étude met en évidence des divergences majeures entre les perceptions institutionnelles telles qu’exprimées par le personnel d’une part, et par les élèves d’autre part, montrant ainsi comment le capacitisme et le racisme anti-Noir·e·s se manifestent insidieusement, dissimulés sous la forme de pratiques nécessaires et bienveillantes.
L’analyse des résultats révèle que les comportements des élèves participant·e·s étaient généralement interprétés par les intervenant·e·s sans prendre en compte leur stade de développement cognitif — l’enfance ou l’adolescence — caractérisé par la formation identitaire, des changements socioaffectifs et d’importantes remises en question. Pour Nelson (2016),
l’enfance n’est pas une catégorie universelle, ni un avantage automatique lié à l’âge, mais plutôt le produit d’une construction discursive qui peut à la fois accorder de la reconnaissance ou marginaliser, sur la base d’une identité assignée […]. Nos idéaux actuels relatifs à l’enfance ont été construits en tenant compte de l’aliénation répétée de sujets non blancs n’appartenant pas à la classe supérieure
p. 73, traduction[3]
Dans les sections suivantes, cette « aliénation répétée » et les façons dont elle se manifeste comme composante de l’adultisation des enfants noir.e.s seront illustrées par une analyse des pratiques disciplinaires, des (non-)réponses aux problèmes de santé mentale des élèves, et du rôle du personnel dans l’exacerbation des problèmes de comportement étiquetés par l’institution.
Pratiques disciplinaires démesurées
L’un des principaux effets de l’adultisation est l’imposition de punitions excessives, notamment dans les contextes scolaires (Epstein et al., 2017). Les intervenant·e·s scolaires se perçoivent souvent comme créant des environnements bienveillants, où les élèves bénéficieraient de mesures disciplinaires non punitives et du soutien adapté à leurs besoins : « Il n’y a pas de punitions, il n’y a rien de punitif, du moins, je ne le perçois pas comme étant punitif » (David, directeur, école spécialisée). Ils et elles mettent en avant des approches alternatives, telles que des programmes de gestion des émotions, la justice réparatrice et le service communautaire :
[Les élèves] font du service communautaire […] comme faire la vaisselle, essuyer les pupitres, s’occuper du recyclage. Je leur demande aussi parfois de m’aider à ranger les espaces communs, ce genre de choses. Le service communautaire, c’est la conséquence principale pour les problèmes de retards et d’absences, et parfois même pour des petits écarts de comportement.
Maria, directrice, école spécialisée
Cependant, les élèves ont tendance à percevoir ces pratiques d’une manière opposée :
On était carrément comme des esclaves dans cette classe… parce qu’on était forcés de faire le ménage. Je me souviens d’une fois, où on avait des cours de natation, et là, moi et mes amis, on voulait pas y retourner parce que la piscine était sale. Alors, on a été comme forcés de nettoyer tout le gymnase, de laver les bancs, de nettoyer le sous-sol, ce genre de choses.
Kenny, 4e sec.
Ce contraste met en lumière un décalage évident entre les intentions des intervenant·e·s et les expériences des élèves. En aucun cas les élèves participant·e·s n’ont rapporté de résultats positifs ou réparateurs liés à cette pratique. En fait, ils ont exprimé un sentiment d’injustice, établi des analogies avec l’esclavage, et manifesté de la résistance et du refus, ce qui a exacerbé leurs « problèmes de comportement », comme l’atteste l’affirmation suivante de Richard (5e sec.) :
Je sais que lancer des boules de neige c’est pas top, mais bof, je suis un gars qui lance des boules de neige, c’est marrant, quoi ! Bref, ma punition, c’était de faire la vaisselle. Mais là, je fais même pas ma propre vaisselle, alors celle des autres, hors de question. Et là, [l’enseignante] me sort, genre : « Tu dois faire un truc pour la communauté. » Alors je me suis dit « ok, fine ». J’ai lavé la vaisselle. Mais le lendemain… on avait un dîner pizza avec un tas d’assiettes, et [l’enseignante] vient me voir et fait : « Oh Richard, tu dois laver la vaisselle. » Là, j’ai juste dit : « Non ! » Et là, boom, elle me colle une semaine de suspension juste parce que je voulais pas laver la vaisselle des autres. Sérieux ? !
Cette situation, partie d’une tâche de service communautaire clairement définie, a dégénéré en une suspension d’une semaine, le refus de l’élève étant perçu comme de l’insubordination. Cependant, la réitération de l’injonction de faire la vaisselle après que l’élève a rempli sa tâche initiale soulève la question des limites et des attentes raisonnables dans une telle intervention. Une suspension aussi sévère, dans ce contexte, semble démesurée et témoigne d’un décalage entre l’objectif réparateur de la punition initiale et l’escalade inutile des sanctions. Alors que les approches dites réparatrices devraient viser à encourager la réflexion et la responsabilité, cet exemple montre comment des pratiques punitives excessives peuvent alimenter un sentiment d’injustice chez les élèves.
Dans de rares cas, certain·e·s intervenant·e·s questionnent ces approches. Par exemple, il est intéressant de noter qu’un directeur a exprimé des préoccupations concernant le traitement différentiel réservé aux élèves noir·e·s, notamment en lien avec lesdites perturbations comportementales :
Nous avons beaucoup d’élèves qui ont des difficultés… des élèves noirs qui ont du mal à respecter le code de conduite […]. Mais, comme, y a des élèves qui sont envoyés à mon bureau pour avoir fait des « slam dunk » [un geste populaire au basketball]. Ben, aucun élève blanc n’est capable de dunker, mais on a beaucoup d’élèves noirs qui sont capables… et ils sont envoyés à mon bureau. Je me demande, est-ce juste ? Ben moi, si j’étais capable de faire un « slam », je le ferais tous les jours, vous me suivez ?
Justin, directeur, école ordinaire
Le basketball, l’un des sports les plus populaires au monde, est largement dominé par des joueurs noirs (Lapchick et Zimmerman, 2020). Le « slam dunk », un geste spectaculaire et impressionnant, est souvent une source d’admiration et d’enthousiasme pour les spectateur·rice·s et les fans. Cependant, selon ce directeur, plutôt que de célébrer leurs prouesses athlétiques, certains élèves noirs seraient dévalorisés et punis pour ces actions. Ce traitement peut être interprété comme une forme d’adultisation, où des comportements enfantins ou adolescents, tels qu’un jeu dynamique ou expressif, sont perçus comme excessifs, perturbateurs ou même menaçants lorsqu’ils proviennent d’élèves noirs. Étant donné que le « slam dunk » n’est pas illégal selon les règles officielles du jeu, il est légitime de se demander pourquoi il est considéré comme non seulement inacceptable, mais punissable dans un contexte scolaire, et comment cette perception est influencée par des biais raciaux et des stéréotypes associés aux Noirs.
Une autre forme de punition excessive, en lien avec l’adultisation, se manifeste à travers la pratique des suspensions dans ou hors des écoles. Selon Léo (directeur, école ordinaire) :
… les suspensions sur place sont davantage un processus d’apprentissage : les élèves ne sont pas laissés seuls à faire des travaux scolaires, ils sont toujours accompagnés par un adulte qui aborde leur comportement de manière individuelle, soit en tête-à-tête, soit en petits groupes […]. Souvent, nous nous asseyons avec eux pour élaborer un emploi du temps adapté qui les aide à progresser sur le plan académique […]. L’idée est d’essayer de motiver les élèves.
Pourtant, le regard porté par les élèves sur les suspensions internes contraste avec celui des intervenant·e·s. Chris (4e sec,) décrit cette expérience comme :
[…] une salle où tu restes enfermé toute la journée, sans aller dîner. On te donne ton travail, ils envoient un élève de ta classe pour te l’apporter, mais t’apprends rien, y a pas de cours, tu fais juste travailler tout seul. En gros, tu restes là toute la journée. C’est un peu comme une cellule d’attente.
Kevin (5e sec.), quant à lui, explique l’impact de ces suspensions sur ses études :
J’ai pris beaucoup de retard scolaire parce que je faisais pas mon travail pendant la suspension, surtout qu’il n’y avait pas de surveillants ou quoi que ce soit. Je faisais rien.
En fait, 17 des 20 élèves participant·e·s ont été soumis·es à des suspensions. Ces pratiques, présentées par les intervenant·e·s comme un processus éducatif et bienveillant, se transforment, selon les contre-récits des élèves, en expériences punitives et d’isolement. Les élèves évoquent un manque d’encadrement et décrivent une situation qui les prive à la fois d’un apprentissage significatif et d’un soutien émotionnel. Dans le cas de Savannah (2e sec.), on constate une dynamique plus insidieuse, où les émotions de l’adulte sont implicitement priorisées, reflétant un déséquilibre qui passe inaperçu sous couvert de bienveillance :
J’étais dans… t’sais, l’endroit où ils t’envoient quand t’es en retenue ou en suspension, ou quand ils pensent que t’es « un problème », genre. J’ai dû rester là deux semaines, à rien faire, rien du tout, juste attendre […]. Ils m’ont fait venir à une réunion avec mes parents, et y’avait ma directrice préférée, genre la seule que j’aimais bien, et elle s’est mise à pleurer, t’sais. Qu’est-ce que j’étais censée faire ? Rester là, assise, et faire semblant que j’avais envie de pleurer aussi ? Bon, ok, j’étais touchée, mais bref, ils m’ont juste dit que j’allais être renvoyée de l’école… Et que si cette [nouvelle école spécialisée] voyait que j’avais changé, je pourrais revenir, mais franchement — jamais de la vie !
Savannah a été laissée sans supervision pendant une période prolongée au cours de cette suspension et ses besoins émotionnels semblent de plus avoir été négligés au profit de ceux de la directrice. Bien que Savannah entretînt une relation positive avec sa « directrice préférée », cette dernière n’a pas pleinement pris en compte l’importance de la préparer, de l’accompagner ou de la soutenir face à la rupture des liens qu’elle avait établis et au transfert vers un environnement inconnu. Au contraire, les émotions de la directrice ont pris le dessus. Epstein et collègues (2017) soulignent que les biais liés à l’adultisation privent les filles noires des libertés propres à l’enfance, rendant leur expérience interchangeable avec celle des femmes noires. Dans ce contexte, les rôles adulte-enfant semblaient inversés. Alors que la directrice pleurait, Savannah, déconcertée, se demandait comment réagir, tandis que ses propres sentiments — notamment une éventuelle culpabilité d’avoir déçu une adulte qu’elle admirait — semblaient relégués au second plan. Cette dynamique s’inscrit dans l’un des principes fondamentaux de la théorie critique de la blackness, qui met en lumière comment des pratiques apparemment neutres ou bienveillantes peuvent avoir des effets néfastes.
Si les pratiques disciplinaires précédemment évoquées ont un caractère insidieux, la forme la plus extrême de discipline, la contention physique, se distingue par son caractère flagrant et direct. Bien que n’étant réglementée par aucun cadre officiel, cette pratique est tolérée au sein de plusieurs établissements scolaires spécialisés au Québec (Bernheim et al., 2019). Les contre-récits des élèves en témoignent :
Ça [la contention physique] m’est arrivé plusieurs fois, genre beaucoup de fois. J’ai eu un genou sur la tête, à l’arrière de la tête, tout ça. C’était grave, c’était une tellement mauvaise école, wow !
Marcus, 4e sec.
Les profs dans cette école, ils te plaquaient carrément ! Genre, ils te prennent, te jettent par terre et te maintiennent jusqu’à ce que tu sois « calme » […]. Ils ont tenté de le faire avec moi une fois […]. T’sais, [les profs] essayaient de les plaquer et [les élèves] se défendaient, et ça tournait au chaos, y’avait genre 3 profs sur un enfant de 8 ans… ou de 10 ans. Genre, 3 profs sur un gars de 10 ans pour essayer de le calmer ! Et le gars hurlait : « Lâchez-moi ! » Et eux : « Plaque-le, balance-le dans la [salle], barrez la porte ! »
Elijah, 5e sec.
Ces pratiques évoquent de manière troublante la posture inhumaine et impuissante dans laquelle George Floyd, un homme noir dont le meurtre par un policier a déclenché un mouvement mondial contre le racisme anti-Noir·e·s, a été contraint avant de perdre tragiquement la vie le 25 mai 2020, à Minneapolis, Minnesota. En effet, Elijah insiste à plusieurs reprises avec intensité sur les actions des enseignants, ce qui souligne sa perception de ces pratiques comme étant excessives. Cette répétition met en avant l’aspect choquant et chaotique de ces interventions, traduisant son indignation face à des comportements qu’il juge nettement inacceptables de la part d’adultes en position d’autorité.
Les expériences décrites dans ces contre-récits illustrent une tension profonde entre les pratiques disciplinaires en milieu scolaire et leur effet sur les élèves, particulièrement dans le contexte de l’école primaire, où il est essentiel de voir aux besoins développementaux des enfants.
Selon les théories critiques du handicap et de la blackness, ces pratiques, documentées comme étant appliquées de manière excessive aux élèves en situation de handicap et aux élèves noir·e·s (Katsiyannis et al., 2020), reflètent l’influence d’idéologies racistes et capacitistes qui sous-tendent le système éducatif. Ce système a historiquement renforcé l’idée de l’infériorité de celles et ceux perçu·e·s comme « autres » et justifié la nécessité de les contrôler par la force (Ellis, 2014).
Des études ont en effet documenté des décès liés à l’usage de contraintes physiques dans les écoles (Nunno et al., 2006). Bien que ces cas restent rares, leur simple existence est une source de préoccupation majeure et devrait suffire à justifier l’élimination de ces pratiques. Il est particulièrement paradoxal que les contraintes physiques soient présentées comme des mesures de sécurité, alors même qu’elles exposent l’enfant à des risques physiques et psychologiques considérables. Les participant·e·s à cette étude présentent des signes évidents de traumatismes, tels que l’anxiété, le repli sur soi et une aggravation de « problèmes de comportement », aussi bien en tant que victimes directes qu’en qualité de témoins de ces pratiques.
L’analyse des pratiques disciplinaires met en lumière leur inadéquation face aux besoins spécifiques des élèves. Cette question devient particulièrement préoccupante lorsque ces interventions ne tiennent pas compte non plus de leurs besoins en santé mentale.
Interventions inappropriées aux besoins de santé mentale
Les écoles spécialisées sont censées être des lieux sécuritaires, nécessaires au soutien des élèves ayant des « besoins particuliers », notamment en matière de santé mentale. Leur mission repose sur la mise en oeuvre d’interventions individualisées, adaptées aux besoins propres à chaque élève, et s’appuie sur la mobilisation de ressources supplémentaires, telles que des professionnel·le·s de la santé mentale, des technicien·ne·s en éducation spécialisée et des programmes axés sur le bien-être émotionnel et social comme décrit par une directrice :
Nous consacrons beaucoup de temps à faire de l’école un lieu accueillant et attrayant, un espace où les élèves souhaitent revenir et s’épanouir, en mettant l’accent sur l’importance de leur sécurité, notamment sur le plan émotionnel.
Maria, directrice, école spécialisée
Effectivement, les élèves mentionnent plusieurs aspects positifs des écoles spécialisées, tels qu’un environnement plus calme et intime, des classes de taille réduite, un soutien à l’apprentissage accru et l’occasion de développer des relations plus significatives avec les enseignant·e·s et les intervenant·e·s :
Il y a moins d’élèves, donc c’est plus facile pour les enseignants de t’aider, et peut-être aussi plus facile de se concentrer, je suppose […]. Ils t’aident, je pense qu’ils savent que tu as des difficultés, alors ils font tout leur possible pour s’assurer que tu progresses.
Isaac, 4e sec.
Les profs… je les aimais vraiment beaucoup. Y a un intervenant noir, il était vraiment super sympa. Il discutait avec moi […], il disait des choses qui me touchaient. Il voyait que je n’allais pas bien, que je n’étais pas heureuse, qu’il s’était passé quelque chose, et il m’en a parlé… il a vraiment montré qu’on lui tient à coeur.
Laura, 4e sec.
Les témoignages des élèves participant·e·s mettent en évidence des dynamiques complexes concernant la prise en charge de leur santé mentale dans les écoles spécialisées. D’un côté, ils et elles valorisent les efforts pour créer un environnement plus calme et sécurisant, ainsi que les interactions positives avec certain·e·s enseignant·e·s et intervenant·e·s qui montrent une réelle empathie et reconnaissance de leurs difficultés. D’autre part, la tendance générale exprimée dans les contre-récits révèle des lacunes importantes dans la réponse aux besoins de santé mentale. Les élèves décrivent des interventions souvent superficielles, inadaptées ou incohérentes, laissant leurs besoins émotionnels et psychologiques largement insatisfaits. Evelyne (5e sec.) explique :
J’essaie de parler de [mon anxiété] à [la technicienne en éducation spécialisée], mais j’ai l’impression que son type d’aide n’est pas le type d’aide dont j’ai besoin, t’sais ? Comme lui parler, c’est plus comme tout exposer, mais ne pas recevoir de conseils en retour sur ce qu’il faut faire […]. Il devrait y avoir des ressources adaptées à tout le monde parce qu’en fin de compte, je suis allée voir [le directeur] à ce sujet, il m’a dit de discuter avec [la technicienne en éducation spécialisée], mais j’ai l’impression que ce n’est pas suffisant. Puis maintenant, il y a aussi [quelqu’un] à qui on peut parler — la conseillère en toxicomanie —, ce que je trouve vraiment bizarre parce que je n’ai jamais eu de problème de toxicomanie.
L’expérience d’Evelyne reflète les obstacles communs rencontrés tout particulièrement par les filles et les femmes noires dont les besoins en matière de santé mentale ont été historiquement négligés et minimisés (Byrd et al., 2022). Bien qu’il semble y avoir plusieurs services spécialisés disponibles dans l’école spécialisée, aucun d’entre eux ne répond aux besoins propres à Evelyn, malgré sa tentative de les verbaliser. Comme les services proposés ne se traduisent pas par des stratégies ou des solutions tangibles, Evelyn se retrouve prise dans une boucle d’échanges verbaux sans fin. En outre, Evelyn se demande pourquoi elle a été orientée vers une conseillère en toxicomanie alors qu’elle n’a pas de problème de drogue. Ce phénomène ne peut être dissocié des préjugés historiques envers les Noir·e·s et des idées fausses selon lesquelles les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent avoir tendance à développer une dépendance aux substances psychotropes (Bignall et al., 2019).
Dans le même ordre d’idées, Karina, qui souffrait d’un trouble d’anxiété grave, s’est vu proposer un programme de soutien scolaire après l’école, en groupe, dans une école ordinaire, ce qui a aggravé son anxiété. Lorsqu’elle s’est retirée, afin de se protéger de cet environnement qu’elle percevait comme chaotique, on lui a demandé :
« Pourquoi n’es-tu pas dans le groupe d’étude après l’école ? Pourquoi n’es-tu pas dans la salle d’étude ? » J’ai répondu : « Parce que je peux pas supporter tout ce monde, je n’y arrive pas. » Ils m’ont dit : « Pourquoi ne peux-tu pas faire ci ? Pourquoi ne peux-tu pas faire ça ? » [j’ai répondu] : « Je viens de vous le dire, pouvez-vous trouver une autre solution pour moi parce que je n’y arrive pas ! » Je pense qu’après ça, ils m’ont transférée dans une école spécialisée.
Karina, 4e sec.
Lorsqu’on lui a demandé si le personnel était au courant de son état, Karina (4e sec.) a répondu : « J’ai l’impression que certains d’entre eux étaient au courant, mais ils s’en foutaient carrément. » Le témoignage de Karina indique qu’elle s’attendait à ce que les adultes fassent preuve de compréhension et de soutien, mais à la place, elle a été conduite vers une école spécialisée.
Le personnel décrit les transferts vers des écoles spécialisées comme un dernier recours parfois malheureux :
Nous faisons vraiment de notre mieux pour donner [aux élèves] ce dont ils ont besoin avant de leur demander de quitter, mais nous levons le pied si nous ne pouvons pas répondre à leurs besoins et nous leur disons que ce n’est pas parce qu’on les veut pas parmi nous, c’est juste qu’ils ont besoin d’un meilleur soutien que celui que nous pouvons leur apporter dans notre école […]. Il est parfois très difficile de voir un élève partir, surtout quand nous savons qu’il a du potentiel.
Shayna, enseignante, école ordinaire
Cependant, dans le cas de Karina, on peut se demander si toutes les mesures ont été épuisées avant son renvoi, il en a été de même pour de nombreux·ses participant·e·s, notamment ceux et celles qui devaient affronter des problèmes de santé mentale. Ces agissements des membres du personnel scolaire ont eu tendance à créer, chez les élèves participant·e·s, un sentiment de méfiance. Face à diverses situations de vulnérabilité, les élèves n’ont pas l’impression de pouvoir compter sur le soutien du personnel scolaire, soit parce qu’il n’est pas digne de confiance, soit parce qu’il est inaccessible.
Exacerbation des « problèmes de comportement »
Selon le personnel et les élèves participant·e·s, les « problèmes de comportement » sont l’une des principales raisons du transfert des élèves des écoles ordinaires vers des écoles spécialisées. Les membres du personnel des écoles spécialisées ont indiqué qu’ils et elles reconnaissaient l’importance de comprendre ces problèmes et d’y répondre en conséquence :
Ce qui se passe, c’est que les élèves ne cessent pas d’avoir des crises lorsqu’ils intègrent les écoles spécialisées, mais le prix de ces crises devient presque nul […] ce qui va les aider, autant que possible, à se concentrer à nouveau sur leurs études, à aimer s’adonner aux études et à être de moins en moins définis par leurs comportements négatifs mais de plus en plus par ce qu’ils sont en tant qu’êtres humains.
Denis, directeur, école spécialisée
De même, les élèves participant·e·s ont reconnu ces comportements et se sont montré·e·s déterminé·e·s à les améliorer. Cependant, bien qu’ils et elles soient dans des environnements spécialisés, ils et elles ne se sentent pas soutenu·e·s par le personnel pour faire face à ces défis. Tout se passe comme si les attitudes froides et directes du personnel et les régimes rigides aggravaient la situation des élèves en accentuant « les comportements négatifs » pour lesquels ils et elles ont été, à l’origine, dirigé·e·s vers une école spécialisée. Par exemple, Laura (5e sec.), qui a eu des problèmes de comportement et des difficultés en mathématiques, tout au long de son parcours scolaire, doit affronter l’attitude dédaigneuse d’une enseignante, ce qui déclenche sa colère :
Une fois, j’étais tellement fâchée, parce que — j’ai trouvé ça vraiment bête… Je suis arrivée en retard au cours de mon prof de maths. Puis, je lui ai demandé ce que j’avais manqué, quels étaient les travaux à compléter. Elle m’a dit : « T’aurais dû être en classe pour ça. T’es arrivée en retard, donc je ne sais pas quoi te dire. » Je lui ai répondu : « Tu pourrais me dire ce que nous avons fait en classe, c’est ce que tu pourrais me dire… » et elle est partie. Ouais, parfois les profs peuvent être vraiment bêtes… c’est pourquoi je veux plus aller à son cours. Honnêtement, je suis toujours en retard à son cours.
Khamiah (4e sec.) a insisté sur la nécessité de garder le contrôle de ses émotions relativement à ce qu’elle percevait comme des comportements déraisonnables de la part des enseignants : « Les profs m’ont écoeuré, mais j’ai gardé mon calme. Si tu fais la moindre des choses, comme te lever sans demander la permission, ils te crient dessus et te disent d’aller t’asseoir dehors. » Ce témoignage met en évidence un environnement où les élèves se sentent constamment surveillé·e·s et jugé·e·s, ce qui peut exacerber leur stress et leur frustration. Par ailleurs, certain·e·s intervenant·e·s ont laissé entendre que les élèves noir·e·s pouvaient être amené·e·s à utiliser l’agressivité comme mécanisme de défense lorsqu’ils et elles ressentaient un sentiment d’exclusion ou d’insécurité. Comme l’explique Leila, enseignante en école spécialisée : « Ça déclenche quelque chose, et bien souvent, ils mettent en place un mécanisme de défense et adoptent un mauvais comportement. Un comportement agressif est très souvent un mécanisme de défense très efficace. » Cette observation est soutenue par Wun (2018), qui explique que les filles noires, en particulier celles issues de milieux socioéconomiques défavorisés, sont fréquemment exposées à des formes de violence interpersonnelle et utilisent souvent la colère comme une stratégie d’adaptation face à leur environnement. Cependant, ce mécanisme de défense peut être interprété comme de la défiance ou de l’insubordination, entraînant des sanctions disciplinaires sévères qui aggravent leur sentiment d’injustice et d’exclusion.
Ces expériences témoignent du fonctionnement intersectionnel des pratiques d’adultisation, qui ciblent spécifiquement les filles noires et les exposent à des formes sévères de discipline. Si certain·e·s élèves, comme Khamiah, parviennent à contenir leurs frustrations, d’autres, comme Elijah (5e sec.), finissent par craquer sous la pression. Elijah, qui se décrit comme « ayant des problèmes de comportement depuis l’enfance », explique qu’il a atteint un point de rupture après avoir été verbalement agressé par une enseignante :
Je lui ai dit : « Si tu n’étais pas prof et que tu me parlais comme ça dans la rue, je t’aurais déjà défoncée. » Parce qu’il est impossible que quelqu’un me parle comme ça sans que je réagisse. Même si mes problèmes de colère se sont calmés depuis des années, si quelqu’un me parle d’une certaine manière, il va voir mon côté mauvais, parce que vraiment je m’occupe de mes propres affaires. Alors oui, elle a dit que c’était une menace. J’ai dit « non, ce n’est pas une menace ».
Elijah, identifié comme étant sur le spectre de l’autisme, une condition neurodéveloppementale, a dû faire face à des attentes et des normes sociales qui ne prenaient pas pleinement en compte ses besoins spécifiques. Selon Koning et Magill-Evans (2001), cette condition se caractérise par
des comportements socialement et émotionnellement inappropriés, un manque d’appréciation des signaux sociaux […], des difficultés à comprendre les expressions faciales des autres et les règles régissant les interactions sociales, à ressentir les sentiments des autres et à s’adapter à différents contextes sociaux ou aux besoins de différents auditeurs
p. 23, traduction
Malgré ce diagnostic et les provocations dont il a été la cible, Elijah a été expulsé d’une école spécialisée, pourtant censée être mieux équipée pour répondre à ses besoins.
Dans une perspective inspirée des études critiques sur le handicap et la race, cette situation illustre comment des pratiques institutionnelles peuvent négliger l’intersection entre capacitisme et racisme anti-Noir·e·s. Les attentes institutionnelles, reposant sur des normes sociales rigides et déconnectées des réalités vécues par les élèves, privilégient leur subordination au détriment de la reconnaissance de leurs besoins propres, renforçant ainsi des perceptions péjoratives. Dans ce cadre, le racisme anti-Noir·e·s joue un rôle central, en alimentant une vision des enfants noir·e·s comme plus menaçant·e·s ou plus âgé·e·s qu’ils et elles ne le sont réellement. Leurs réactions émotionnelles ou résistances sont dès lors souvent perçues comme des comportements dangereux à réprimer, plutôt que comme des manifestations valables de leurs besoins sociaux et émotionnels.
Qu’ils et elles expriment leur colère, comme Elijah, ou qu’elles et ils la répriment, comme Khamiah, ces élèves subissent un processus d’adultisation qui les conduit à intérioriser des étiquettes stigmatisantes de « troubleurs » et de « troubleuses ». Cette dynamique alimente une aliénation profonde, où ils et elles finissent par se percevoir à travers un prisme hétéronome de stéréotypes et attentes négatives, plutôt que comme des individus avec des besoins propres et des expériences légitimes. Ces mécanismes institutionnels illustrent les effets néfastes d’un système qui, en favorisant la conformité aux normes dominantes, perpétue des inégalités structurelles et entrave le développement personnel et social des élèves noir·e·s.
Vers un dépassement de l’idéologie dite post-raciale
Une prise de conscience de ces mécanismes est essentielle pour repenser les pratiques éducatives et disciplinaires, dans le but de créer des environnements véritablement équitables. Cela suppose de prendre en compte les spécificités liées au handicap et les biais raciaux, afin de répondre de manière respectueuse et adaptée aux besoins de chaque élève. Les propos d’une directrice indiquent qu’il reste encore du chemin à parcourir pour concilier volonté d’équité et idéologie post-raciale, qui, bien que non intentionnelle, perpétue des inégalités systémiques :
En tant que femme caucasienne, je me sens mal à l’aise de mettre une étiquette sur la race ou l’ethnicité de quelqu’un, donc… je me sens pas à l’aise de dire « bon, c’est un enfant noir, donc cet enfant noir a besoin d’aide supplémentaire parce qu’il est noir ». Je me sens pas à l’aise de dire ça, vous voyez ? Ça me met très mal à l’aise, parce que je suis qui pour mettre, étiqueter, l’ethnicité de quelqu’un ? Ce serait un problème pour moi. Et en tant qu’enseignante et directrice, j’ai toujours travaillé très dur tout au long de ma carrière pour traiter mes élèves équitablement, en comprenant qu’ils sont des individus, et que s’ils ont besoin de quelque chose de différent de ce que je donne à quelqu’un d’autre, ils me l’expliqueront. Mais je suis très hésitante à mettre des étiquettes ou des contraintes sur un élève en fonction de son apparence physique extérieure.
Linda, directrice, école spécialisée
Cette réticence à reconnaître explicitement la race tout en s’auto-identifiant comme « caucasienne » illustre une tension propre aux idéologies dites post-raciales. Ces idéologies cherchent à minimiser l’importance de la race sous prétexte d’équité, mais révèlent paradoxalement comment les groupes dominants continuent de se percevoir comme la norme incontestée. Ce positionnement efface les différences raciales vécues par les élèves racialisé·e·s tout en maintenant l’invisibilité des privilèges associés à l’identité dominante. En conséquence, les réalités du racisme anti-Noir·e·s et du capacitisme — biais implicites, attentes différenciées, pratiques disciplinaires disproportionnées — restent ignorées, renforçant ainsi les inégalités existantes.
De plus, attendre que les élèves expriment eux et elles-mêmes leurs besoins revient à ignorer les multiples barrières sociales et émotionnelles auxquelles ils et elles font face. Ils et elles peuvent éprouver un manque de confiance envers les adultes et craindre des réprimandes ou des jugements si elles et ils expriment leurs besoins ou leur vulnérabilité. Cette dynamique, renforcée par des stéréotypes liés à leur comportement ou à leur identité, les pousse parfois à se taire pour éviter d’être stigmatisé·e·s, mal compris·e·s ou puni·e·s. Une approche véritablement inclusive, équitable et socialement juste nécessite de dépasser les idéologies dites post-raciales pour reconnaître ces barrières et de créer des espaces où les élèves se sentent suffisamment en sécurité pour s’exprimer. Cela implique de déconstruire les attentes irréalistes liées à l’adultisation et de développer des pratiques basées sur l’écoute et la compréhension, en offrant un soutien proactif et adapté aux besoins réels de chaque élève.
conclusion
Cette étude met en lumière les dynamiques complexes entre le racisme anti-Noir·e·s, le capacitisme et les pratiques éducatives dans le contexte de l’éducation spécialisée. Bien que les discours éducatifs dominants se réclament de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, les pratiques observées révèlent des contradictions évidentes. Les établissements scolaires jouent un rôle clé dans le maintien des structures discriminatoires en reproduisant une normativité blanche et capacitiste qui soutient, de manière implicite, des hiérarchies sociales. Au Québec, la négation ou la minimisation des inégalités raciales tend à renforcer ces dynamiques. À l’ère de l’idéologie du post-racialisme, ce déni contribue à perpétuer le silence épistémique concernant la race et le racisme (Thésée, 2021). Il fonctionne comme un mécanisme de délégitimation des discussions, permettant ainsi d’échapper à la responsabilité de remédier au racisme systémique. Ce processus est résumé avec éloquence par Howard (2023), qui affirme que le fait de taire la race alors que les structures raciales perdurent est une tactique conçue pour rejeter le racisme comme étant sans conséquence, ce qui, en fin de compte, dispense les individus et les institutions de s’engager dans la lutte contre ses effets omniprésents.
Ces dynamiques sociales sont visibles dans les différences de perception entre les récits du personnel et ceux des élèves. Les contre-récits des élèves révèlent comment les systèmes enracinés du capacitisme et du racisme se croisent au sein des institutions éducatives, façonnant les expériences et le vécu de ceux et celles qui se trouvent à l’intersection de la blackness et du handicap. Les écoles apparaissent comme des entités institutionnelles au sein desquelles être blanc·he et apte est la norme ; où l’absence de responsabilité en matière de justice éducative et les points de vue capacitistes sont dissimulés et/ou légitimés par un discours de bienveillance servant principalement les besoins institutionnels. Qu’il s’agisse de préoccupations pour la réussite scolaire, l’estime de soi ou le bien-être socioémotionnel des élèves, ce discours de bienveillance apparaît comme dépourvu de toute responsabilité envers les élèves. Dès lors, il fournit les conditions qui rendent possible et logique le fait de ne pas « voir la race ».
De manière corollaire, le discours de bienveillance fonctionne comme un argument d’exclusion clandestin qui produit, dans les faits, des résultats opposés aux intentions affichées. Cette situation oblige les élèves noir·e·s à activer des mesures d’autoprotection et à porter le poids des conséquences psychologiques associées, telles que les sentiments d’incertitude, d’anxiété, de colère, de panique, d’insécurité, de désespoir, de dépression et de peur. Au-delà de la déresponsabilisation institutionnelle en matière de racisme anti-Noir·e·s, le mépris et les traumatismes associés au classement des enfants noir·e·s en éducation spécialisée sont également banalisés. La non-perception par les intervenant·e·s scolaires du caractère traumatique des expériences institutionnelles vécues par les élèves noir·e·s témoigne, plus largement, de l’adultisation de ces dernier·ère·s.
Dans ce contexte, il devient essentiel d’examiner comment les notions de bienveillance et d’attention sont définies ou comprises par ceux et celles à qui elles sont réellement destinées, et comment elles peuvent être utilisées pour permettre au capacitisme et au racisme anti-Noir.e.s de passer pour des pratiques quotidiennes bien intentionnées. Censées être des lieux de plein déploiement des initiatives en matière d’EDI, les écoles doivent reconnaître que ces dynamiques, de nature systémique, sont profondément enracinées dans les structures et les pratiques institutionnelles, s’inscrivant bien au-delà des actions individuelles des intervenant·e·s.
Appendices
Notes
-
[1]
L’auto-identification a permis d’éviter d’attribuer une étiquette socialement construite aux individus.
-
[2]
L’inscription dans une école spécialisée permettait de déduire que l’élève était passé·e par un processus de classement en éducation spécialisée, toujours en évitant d’attribuer une étiquette socialement construite.
-
[3]
“childhood is not a universal category, not an automatic benefit of one’s age, but rather it is the product of a discursive structure that both empowers and marginalizes on the basis of identity […] our current ideals about childhood were forged through the repeated alienation of subjects who were not white and upper class.”
Bibliographie
- Ahmed, S. (2012). On being included : Racism and diversity in institutional life. Duke University Press.
- Bailey, M. et Mobley, I. A. (2019). Work in the intersections : A black feminist disability framework. Gender & Society, 33(1), 19-40.
- Bell, B. W. (2004). The contemporary African American novel : its folk roots and modern literary branches. University of Massachusetts Press.
- Bernheim, Emmanuelle, Flores Echaiz, L. et Gauthier-Boiteau, D. (2019). La santé mentale des jeunes. Mesures de contrôle et médication en milieu scolaire. L’Avant-garde en santé mentale et le Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal.
- Bignall, T., Jeraj, S., Helsby, E. et Butt, J. (2019). Racial disparities in mental health : Literature and Evidence Review. Race Equality Foundation. https://raceequalityfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2022/10/mental-health-report-v5-2.pdf
- Bissonnette, M., Toussaint, P., Martiny, C., Fortier, G. et Ouellet, F. (2019). Perception de membres de la communauté éducative des facteurs de réussite et d’échec des élèves issus de l’immigration d’écoles secondaires défavorisées et pluriethniques montréalaises. McGill Journal of Education, 54(1). https://doi.org/10.7202/1060861ar
- Byrd, J., Porter, C., Mayes, R. et Ahmadi, A. (2022). (In)Visibility Across Educational Spaces : Centering Mental Health & Wellness for Black Girls & Women. Journal of African American Women and Girls in Education, 2(2), 1-8.
- Caldas, S. J., Bernier, S. et Marceau, R. (2009). Explanatory Factors of the Black Achievement Gap in Montréal’s Public and Private Schools : A Multivariate Analysis. Education and Urban Society, 41(2), 197-215. https://doi.org/10.1177/0013124508325547
- Collectif les Béliers solidaires. (2020, 17 novembre). Ce que tu nous as appris. Histoire engagée. http://histoireengagee.ca/ce-que-tu-nous-as-appris/
- Collins, P. H. (2022). Black feminist thought : Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Routledge.
- Collins, T., Borri-Anadon, C. et Magnan, M.-O. (2022). Shedding Light on Race and Disability in a North American Linguistic Minority Context : A DisCrit Analysis of Special Education in Quebec. Dans C. O’Brien, W. Black et A. Danzig (dir), Who Decides ? Power, Disability and Education Administration (p. 123-148). Information Age.
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (CDPDJ). (2011). Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés. Montréal : CDPDJ. https://www.cdpdj.qc.ca/publications/Profilage_rapport_FR.pdf
- Cooc, N. et Kiru, E. W. (2018). Disproportionality in Special Education : A Synthesis of International Research and Trends. The Journal of Special Education, 52(3), 163-173. https://doi.org/10.1177/0022466918772300
- Dei, G. J. S. (2013). Reframing Critical Anti-Racist Theory (CART) for contemporary times. Counterpoints, (445), 1-14.
- Dei, G. J. S. (2018). “Black Like Me” : Reframing Blackness for Decolonial Politics. Educational Studies, 54(2), 117-142. https://doi.org/10.1080/00131946.2018.142758
- Dumas, M. J. et ross, k. m. (2016). “Be Real Black for Me” Imagining BlackCrit in Education. Urban Education, 51(4), 415-442.
- Ellis, J. (2014). Special education. Eugenic Archive. Canada. https://eugenicsarchive.ca/discover/encyclopedia/535eee5c7095aa000000025d
- Epstein, R., Blake, J. J. et González, T. (2017). Girlhood Interrupted. The Erasure of Black Girls’ Childhood. Georgetown Law Center on Poverty and Inequality. https://genderjusticeandopportunity.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/06/girlhood-interrupted.pdf
- Fanon, F. (1952). Peau noire, masques blancs. Éditions du Seuil.
- Garneau, S. et Giraudo-Baujeu, G. (2018). Présentation : pour une sociologie du racisme. Sociologie et sociétés, 50(2), 5-25. https://doi.org/10.7202/1066811a
- Gilbert-Blanchard, O., Archambault, I., Tardif-Grenier, K. et Audet, G. (2022). La perception des élèves des relations et des attitudes des enseignants à leur égard : contribution du statut générationnel et de la région d’origine. Comparative and International Education / Éducation comparée et internationale, 50(2), 85-103. https://doi.org/10.5206/cieeci.v50i2.14344
- Gilmore, A. A. et Bettis, P. J. (dir.) (2021). Antiblackness and the adultification of BlackChildren in a U.S. Prison Nation. Dans Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press.
- Goldberg, D. (2015). Are We All Postracial yet ? Polity Press.
- Howard, P.S.S. (2023). Performing Postracialism : Reflections on Antiblackness, Nation, and Education through Contemporary Blackface in Canada. University of Toronto Press.
- Jean-Pierre, J. et Collins, T. (2022). Penser une démarche épistémologique afroémancipatrice en recherche qualitative par, pour et avec les communautés noires. Recherches qualitatives, 41(1), 13-34.
- Kamanzi, P. C. (2023). Pathways of Black immigrant youth in Québec from secondary school to university : Cumulative racial disadvantage and compensatory advantage of resilience. Canadian Review of Sociology, 60(3), 409-437.
- Katsiyannis, A., Gage, N. A., Rapa, L. J. et MacSuga-Gage, A. S. (2020). Exploring the Disproportionate Use of Restraint and Seclusion Among Students with Disabilities, Boys, and Students of Color. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 4(3), 271-278. https://doi.org/10.1007/s41252-020-00160-z
- Koning, C. et Magill-Evans, J. (2001). Social and language skills in adolescent boys with Asperger syndrome. Autism, 5(1), 23-36.
- Lapchick, R. et Zimmerman, D. (2020). The 2020 Racial and Gender Report Card : National Basketball Association. The Institute for Diversity and Ethics in Sports. https://www.tidesport.org/_files/ugd/7d86e5_9ed7a1185cc8499196117ce9a2c0d050.pdf
- Lentin, A. et Karakayali, J. (2016). Bringing Race Back in : Racism in ‘Post-Racial’ Times. Movements : Journal for Critical Migration and Border Regime Studies, 2(1), 141-147.
- Mc Andrew, M., et Ledent, J. (2008). La réussite scolaire des jeunes des communautés noires au secondaire. Chaire en relations ethniques, Université de Montréal.
- Mc Andrew, M., Balde, A., Bakhshaei, M., Tardif-Grenier, K., Audet, G., Armand, F., Guyon, S., Ledent, J., Lemieux, G., Potvin, M., Rahm, J., Vatz Laaroussi, M., Carpentier, A. et Rousseau, C. (2015). La réussite éducative des élèves issus de l’immigration : Dix ans de recherche et d’intervention au Québec. Les Presses de l’Université de Montréal.
- Mc Andrew, M., Garnett, B., Ledent, J., Ungerleider, C., Adumati-Trache, M. et Ait-Said, R. (2008). La réussite scolaire des élèves issus de l’immigration : une question de classe sociale, de langue ou de culture ? Éducation et francophonie, 36(1), 177-196. https://doi.org/10.7202/018096ar
- Meekosha, H. et Shuttleworth, R. (2009). What’s so ‘critical’ about critical disability studies ? Australian Journal of Human Rights, 15(1), 47-75. https://doi.org/10.1080/1323238X.2009.11910861
- Miller, R., Liu, K. et Ball, A. F. (2020). Critical Counter-Narrative as Transformative Methodology for Educational Equity. Review of Research in Education, 44(1), 269-300. https://doi.org/10.3102/0091732X20908501
- Ministère de l’éducation (MEQ), Gouvernement du Québec. (1999). Une école adaptée à tous ses élèves : prendre le virage du succès. Politique de l’adaptation scolaire. Gouvernement du Québec.
- Ministère de l’Éducation (MEQ), Gouvernement du Québec. (2023). Soutien au milieu scolaire 2023-2024. Intégration et réussite des élèves issus de l’immigration et éducation interculturelle. Gouvernement du Québec.
- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES), Gouvernement du Québec. (2017). Politique de la réussite éducative : le plaisir d’apprendre, la chance de réussir. Gouvernement du Québec.
- Nelson, C. A. (2016). Slavery, childhood, and the racialized “education” of Black girls. Dans A. Ibrahim et A. Abdi (dir), Education of African Canadian children : Critical perspectives (p. 73-90). McGill-Queen’s University Press.
- Nunno, M., Holden, M. et Tollar, A. (2006). Learning from tragedy : A survey of child and adolescent restraint fatalities. Child Abuse & Neglect. The International Journal, 30, 1333-1342.
- Potvin, M. (2018). Bref portrait historique des courants et débats dans le champ des études ethniques en éducation au Québec. Cahiers de recherche sociologique, (64), 97-127. https://doi.org/10.7202/1064722ar
- Potvin, M. et Leclercq, J.-B. (2014). Facteurs affectant la trajectoire scolaire des jeunes de 16-24 ans issus de l’immigration en formation générale des adultes. Revue des sciences de l’éducation, 40(2), 309-349.
- Rousseau, N., Marion, C., Fournier, H., Tétreault, K. et Paquin, S. (2016). Trajectoires d’élèves québécois inscrits au Parcours de formation axée sur l’emploi. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 19(1), 127-150.
- Schalk, S. (2017). Critical Disability Studies as Methodology, Lateral, 6(1). https://doi.org/10.25158/L6.1.13
- Solórzano, D. G. et Yosso, T. J. (2002). Critical Race Methodology : Counter-Storytelling as an Analytical Framework for Education Research. Qualitative Inquiry, 8(1), 23-44.
- Tardif-Grenier, K., Archambault, I., et Gervais, C. (2017). Portrait des élèves issus de l’immigration en milieu scolaire primaire défavorisé. Comparative and International Education, 46(1). https://doi.org/10.5206/cie-eci.v46i1.9309
- Thésée, G. (2021). Déconstruire la recherche en éducation en contextes de racialisation : Débusquer le racisme épistémologique. Canadian Journal of Education, 44(1), CI1-CI31.
- Thésée, G. (2022). Dancing with the Invisibility/Inaudibility : Nuances of Blackness in a Francophone Context. Dans A. Ibrahim, T. Kitossa, M.S. Smith et H.K. Wright (dir.), Nuances of Blackness in the Canadian Academy : Teaching, learning, and researching while Black (p. 88-107). University of Toronto Press.
- Torczyner, J. L. et Springer, S. (2010). Demographic challenges facing the black community of Montreal in the 21st century. McGill School of Social Work, Montreal Consortium for Human Rights Advocacy Training (MCHRAT).
- Wynter, S. (2003). Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom : Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation — An Argument. CR : The New Centennial Review, 3(3), 257-337. https://doi.org/10.1353/ncr.2004.0015
List of tables
Tableau 1
Caractéristiques des membres du personnel participant
Tableau 2
Caractéristiques des élèves participant·e·s