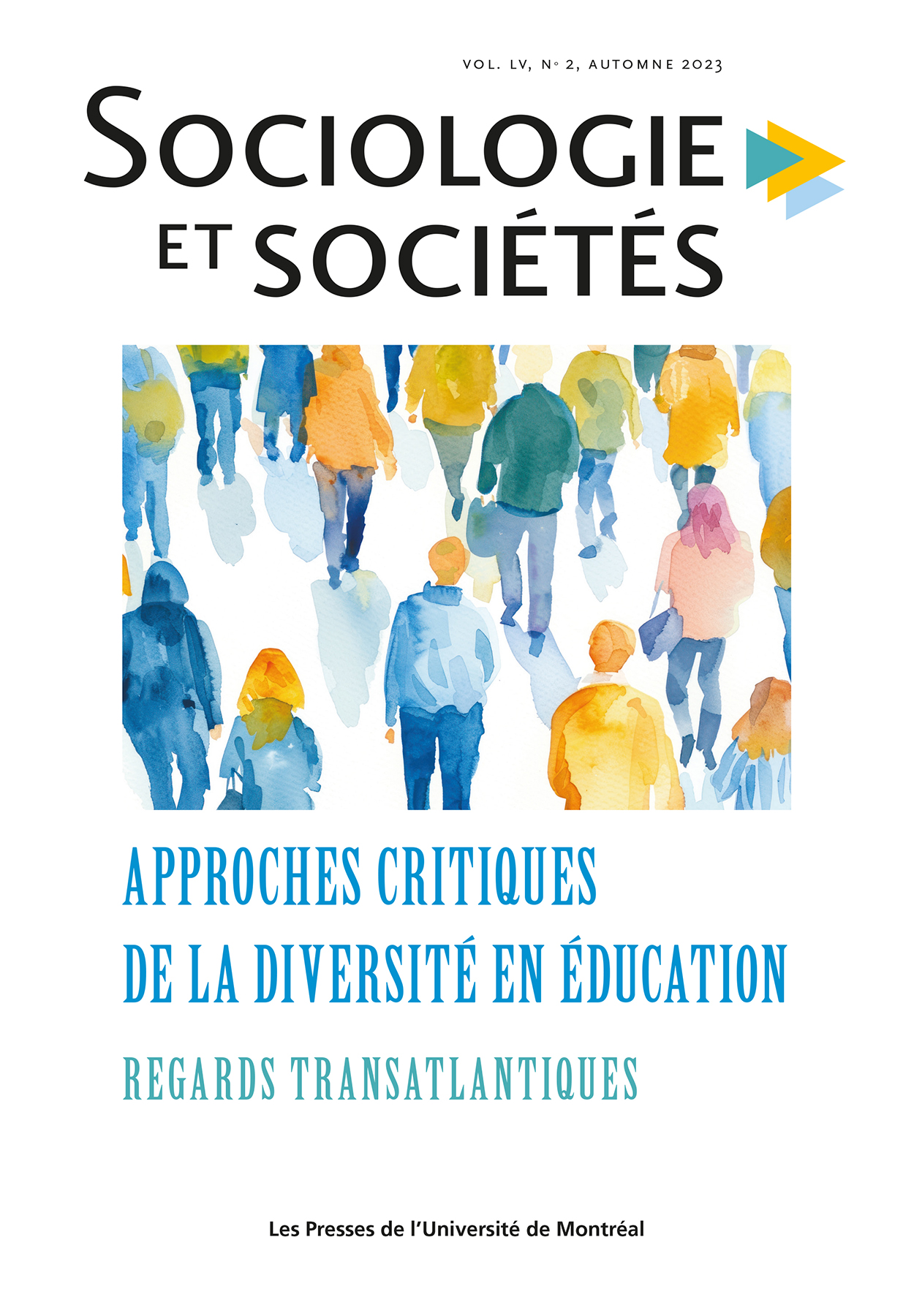Abstracts
Résumé
Cet article examine les tactiques de résistance de femmes universitaires en début de carrière (UDC), au prisme de la race, du genre et de l’espace, en nous appuyant sur 50 entretiens approfondis avec des femmes UDC de cinq universités belges néerlandophones. Croisant le travail de Scott sur la résistance ordinaire avec celui de Puwar sur les space invaders, nous identifions trois répertoires de tactiques de résistance visant à renégocier au quotidien les frontières de l’institution : 1) les tactiques de l’en-dedans qui transgressent et brouillent les définitions de l’occupant légitime ; 2) les tactiques de l’en-dehors qui fournissent des supports à l’universitaire « désincarné » jouant le jeu du mérite ; 3) les tactiques mixtes qui créent des contre-espaces à l’intérieur de l’espace de travail dominant. Nous concluons en étendant le concept d’envahisseuses de l’espace de Puwar à interprètes de l’espace pour souligner le travail de frontière très actif des femmes UDC dans le développement d’une organisation académique antiraciste et antisexiste.
Mots-clés :
- envahisseurs de l’espace,
- résistance,
- intersectionnalité,
- travail de frontière,
- université
Abstract
This paper examines the resistance tactics of early career academics (ECA) with a particular focus on the role of race, gender, and the use of space in navigating academia. Drawing on 50 in-depth interviews with ECAs from five Belgian Dutch-speaking universities, we merge James Scott’s work on everyday resistance with the work of post-colonial scholar Nirmal Puwar on white and racialized women as ‘space invaders’ disrupting normative space. We identify three manifestations of everyday resistance-tactics: 1) innerspace-tactics occur inside the work-space breaking and blurring the symbolic boundaries of who the legitimate occupant can be; 2) outerspace-tactics develop spaces outside the workspace aiming to become the ‘unencumbered’ academic crossing boundaries by playing the game of merit; and 3) inner-outerspace blend tactics establish counter-spaces inside the dominant work-space developing new exclusionary boundaries on their own terms to simulate a space of academic support. We conclude by extending Puwar’s concept of space invaders to space interpreters, highlighting women ECAs’ active boundary work in developing an anti-racist-sexist academic organization.
Keywords:
- Space invaders,
- resistance,
- intersectionality,
- boundary work,
- university
Resumen
El presente artículo examina, a través del prisma de la raza, el género y el espacio, las estrategias de resistencia de las mujeres universitarias que inician su carrera (UIC). Se basa en 50 entrevistas exhaustivas a mujeres UIC de cinco universidades belgas de habla neerlandesa. Combinando la obra de Scott sobre la resistencia ordinaria con la de Puwar sobre los space invaders (invasores del espacio), identificamos tres series de estrategias de resistencia destinadas a renegociar diariamente los límites de la institución : 1) estrategias interiores que transgreden y desdibujan las definiciones del ocupante legítimo ; 2) estrategias exteriores que brindan apoyo al universitario “desencarnado” que juega al juego del mérito ; 3) estrategias mixtas que crean espacios alternativos dentro del espacio de trabajo dominante. Finalizamos ampliando el concepto de invasoras del espacio de Puwar a intérpretes del espacio a fin de destacar el trabajo de frontera activo de las mujeres UIC en el desarrollo de una organización académica antirracista y antisexista.
Palabras clave:
- invasores del espacio,
- resistencia,
- interseccionalidad,
- trabajo de frontera,
- universidad
Article body
Le sexisme, le racisme et d’autres formes d’inégalité ont été largement théorisées et documentées dans le contexte universitaire (Bourabain, 2020 ; Acker et Armenti, 2004 ; Clavero et Galligan, 2021 ; Strauβ et Boncori, 2020 ; Morley, 1994 ; Salmon, 2022). À maintes reprises, les chercheurs ont dénoncé la « mystique de l’égalité » qui sous-tend le monde académique, (ab)usant de la méritocratie pour exclure les femmes et les minoritaires. En remettant en cause la neutralité supposée de l’organisation universitaire, ces travaux ont révélé la nature sexuée et racialisée du « chercheur idéal », à la base de la culture et de la structure universitaires. Dans cet article, l’université est au contraire considérée comme un « régime d’inégalité » (J. Acker, 2009) et une « organisation racialisée/genrée » (Ray, 2019) qui produit de manière intrinsèque des frontières excluantes entre ceux qui incarnent la norme somatique et disposent du « droit d’occuper l’espace » qu’elle leur confère et les subalternes, maintenus à l’écart (Puwar, 2004a ; Ahmed, 2007 ; 2000).
Si la (re)production de frontières genrées-racialisées par la norme somatique au sein de l’université est devenue un champ d’études largement établi, l’accent mis sur la pression, la courbure et la rupture de ces frontières par les subalternes reçoit également de plus en plus d’attention (par exemple, Sharp et Messuri, 2023 ; Sobande et Wells, 2023 ; Gurrieri et al., 2022 ; Lima, Casa Nova et Vendramin, 2023). Le mouvement #MeToo a amplifié la prise de conscience du harcèlement sexuel auquel sont confrontées les femmes universitaires. Sur les plateformes en ligne, dans les médias, elles ont dénoncé le climat sexiste dans les universités du Nord, ont lancé des pétitions et se sont mises en grève (Salmonsson, 2021 ; Young et Wiley, 2022 ; Anitha, Marine et Lewis, 2020). Les chercheurs en études critiques des organisations ont appelé à une action collective contre le sexisme et le racisme (par exemple Contu, 2020 ; Prichard et Benschop, 2018 ; E. Bell et al., 2019 ; M. P. Bell et al., 2021). Cette mobilisation à grande échelle a sans doute favorisé des changements organisationnels et a permis à de nombreuses universités d’installer ou d’affiner leurs politiques en matière d’égalité des genres. La lutte est cependant loin d’être terminée. Plus encore, il a été démontré que les politiques nouvellement mises en place ne servent bien souvent que d’écran de fumée, tout en renforçant une culture de culpabilisation des victimes et de déni. D’autant que ces politiques d’égalité continuent à considérer les employés comme des récepteurs passifs du changement, négligeant leur capacité d’action (Bourabain, 2020 ; Essanhaji et Van Reekum, 2022).
Bien que le mouvement #MeToo ait produit des changements, les femmes universitaires doivent encore remettre en question l’espace blanc et masculin du monde universitaire et y résister. En nous appuyant sur les travaux de James Scott (1989, p. 33), à l’origine du concept de « résistance ordinaire », nous partons de l’observation selon laquelle « l’action politique ouverte domine les récits de conflits politiques »[1], ce qui est de nature à produire une vision « particulièrement étroite » de la résistance des groupes subalternes. Au contraire, les formes ordinaires de résistance sont les « moyens les plus vitaux » dont disposent les groupes subalternes pour faire valoir leurs objectifs politiques. Cet article étudie la résistance ordinaire de femmes universitaires en début de carrière (UDC), constamment confrontées au sexisme et au racisme de l’institution. En nous appuyant sur les données recueillies dans le cadre d’entretiens approfondis avec des femmes blanches et racisées[2], chercheuses doctorales et postdoctorales au sein d’universités belges néerlandophones (n = 50), nous proposons d’éclairer ces formes de résistance ordinaire en tant que pratique quotidienne.
Initialement introduit en études des organisations pour rendre compte de la résistance d’un travailleur sans sexe et sans race ou, plutôt, d’un travailleur masculin et blanc, le cadre d’analyse développé par Scott (1989) n’est pas moins influencé par W. E. B. DuBois et son analyse des subalternes. Dans cet article, nous combinons donc le travail fondateur de Scott avec la théorie féministe postcoloniale pour comprendre comment différentes positionnalités conduisent à l’élaboration de répertoires distincts de résistance[3]. Dans un deuxième temps, nous cherchons à démontrer le lien inextricable entre frontières symboliques, frontières spatiales et possibilités de résistance. L’accent mis sur l’espace constitue en effet une caractéristique majeure de la compréhension de la résistance depuis une perspective féministe postcoloniale. Si l’objectif initial fut d’étudier les formes de solidarité féministe qui traversent les frontières (géographiques), cette perspective s’est révélée tout aussi pertinente pour comprendre les actes de résistance qui permettent de renégocier les frontières — à la fois symboliques et matérielles — des organisations. En nous appuyant sur le travail de Nirmal Puwar (2004a) sur les femmes en tant qu’« envahisseuses de l’espace », nous nous focalisons sur les espaces élitistes du monde universitaire. L’idée d’envahisseurs de l’espace met en évidence l’interaction entre limites symboliques et spatiales des organisations et la manière dont cela peut contraindre les femmes UDC à résister ou à utiliser potentiellement l’espace organisationnel comme moyen d’émancipation. En reliant le travail classique de Scott (1985 ; 1989) sur la résistance ordinaire à la perspective féministe postcoloniale de Puwar (2004a ; 2004b), cet article vise à répondre aux questions suivantes : 1) Quelles tactiques les femmes UDC blanches et racisées adoptent-elles pour renégocier les frontières de l’institution ? 2) Comment ces répertoires de tactiques informent-ils leur investissement de l’espace organisationnel ?
comprendre la résistance ordinaire : cadre théorique et hypothèses
Dans l’étude des organisations, les formes ouvertes de résistance collective sur le lieu de travail ont longtemps dominé le champ. Avec la prise en compte croissante du caractère diffus du pouvoir (Foucault, 1977 ; Raffnsøe, Mennicken et Miller, 2019), l’attention portée à la résistance au travail s’est déplacée cependant vers des pratiques ordinaires et plus discrètes (Fleming et Spicer, 2008 ; Johansson et Vinthagen, 2016). Ces pratiques ordinaires s’expriment dans des actes et des propos de tous les jours — l’humour, le cynisme, les ragots — qui sont souvent décrits comme une résistance « quotidienne » ou « routinière ». Toutefois, le concept de résistance ordinaire est défini de diverses manières et « sans grande précision » (Johansson et Vinthagen, 2016, p. 418). C’est pourquoi nous revenons au travail fondateur de James Scott (1989), à l’origine du concept, qui, principalement à travers l’étude des relations de classe, montre que la résistance ordinaire ne relève pas d’un acte isolé, mais est au contraire pratiquée de manière répétitive et routinière, en utilisant des « armes ordinaires » de manière informelle plutôt qu’organisée. Au lieu d’opter pour une résistance qui s’affiche au grand jour (frontstage) ou de jure, à savoir des actions de contestation ouvertes qui revendiquent le droit à et la reconnaissance de ressources et d’avantages spécifiques, la résistance ordinaire prend souvent la forme d’une résistance en coulisses (backstage) ou de facto. Elle vise à obtenir des avantages sans toutefois demander directement le droit de les posséder (Scott, 1989). Les travaux de Scott ont été cependant critiqués pour avoir trop analysé les comportements quotidiens en termes de résistance (Vallas et Courpasson, 2016). Comme ces pratiques à petite échelle sont censées avoir peu ou pas d’effets, d’autres les qualifient au contraire de « pseudo-oppositions » (Ybema et Horvers, 2017 ; Contu, 2008). Pour Scott (1985), en revanche, lorsque ces pratiques en apparence modestes sont mises en oeuvre par de larges parts des groupes subalternes de manière répétitive, elles produisent un effet réel sur les relations de pouvoir.
La résistance ordinaire doit être ainsi toujours replacée à l’intérieur des rapports de pouvoir propres à un contexte, une situation ou un espace donné. Qu’il s’agisse de l’exercice d’un pouvoir ou d’un contre-pouvoir, celui-ci implique l’utilisation de stratégies aussi bien que de tactiques. En suivant Michel de Certeau, les stratégies sont des pratiques utilisées par le groupe dominant pour maintenir les frontières existantes, tandis que les tactiques sont des moyens pour les groupes dominés de faire usage « des failles que les conjonctures particulières ouvrent dans la surveillance du pouvoir propriétaire » (1990, p. 60-61). Ce dernier point signifie également que le manque de ressources pour les groupes dominés souvent ne leur permet pas de disposer de leurs propres espaces. Ils se doivent, en conséquence, d’utiliser soigneusement les espaces dominants à leur propre avantage. Scott (1989) affirme en particulier que les groupes subalternes sont en mesure d’anticiper les risques liés à la résistance, en se basant sur leur « sagesse tactique » qui influence en retour les objectifs, les gains et le rythme d’actions.
Si Scott part d’une dichotomie relativement simple entre pouvoir et contre-pouvoir, les approches postcoloniales posent au contraire le principe que pouvoir et contre-pouvoir ne sont pas deux entités séparées et exclusives, mais interconnectées et co-constitutives (parmi d’autres, Hibou, 2011 ; Mbembe, 2001). Le pouvoir n’est pas une chose fixe détenue exclusivement par le groupe dominant, tout comme la résistance n’est pas une qualité inhérente aux groupes subalternes. Au contraire, la résistance est un processus négocié dans lequel, en raison de sa propre position interstitielle, un individu peut exercer un pouvoir dans certaines localités et un contre-pouvoir dans d’autres. Par conséquent, pour comprendre la résistance au quotidien, nous devons examiner a) la manière dont les résistances se logent à l’intersection du racisme, du sexisme, ainsi que d’autres régimes d’oppression et b) l’espace dans lequel la résistance prend forme.
La construction de l’espace : frontières et « envahisseurs »
La recherche féministe et postcoloniale a mis en évidence la manière dont les espaces (académiques) genrés et racialisés perpétuent des formes variées de pouvoir et de contre-pouvoir (Essed, 2002 ; Bannerji et al., 1991 ; Crimmins, 2019 ; Bhopal, 2015). Les travaux de Puwar (2004a), en particulier, explorent la manière dont les espaces institutionnels sont historiquement construits autour de « frontières corporelles ». Ces frontières garantissent que les espaces institutionnels soient conformes à certains corps — la norme somatique — afin d’exclure d’autres corps, à savoir les envahisseurs de l’espace. La norme somatique donne ainsi corps aux « occupants naturels » qui naviguent confortablement et discrètement dans l’espace. Alors que la norme somatique est généralement appréhendée comme celle d’un sujet désincarné, Puwar démontre que n’importe quel corps n’est pas également pertinent pour construire l’espace ; les caractéristiques de l’espace des organisations du Nord global sont intrinsèquement liées à la blanchité et à la masculinité.
La présence croissante de groupes subalternes tels que les femmes et les minorités racisées dans les organisations du Nord global a permis de dévoiler les frontières matérielles, sociales et symboliques qui les traversent. Leur intrusion dans l’espace réservé aux hommes blancs a mis en évidence « la fragilité de la revendication masculine [et blanche] de l’espace public » (Puwar, 2004, p. 14) en même temps qu’elle a remis en question la norme somatique. Cette intrusion entraîne une anxiété ontologique liée à la perte de repères ou de limites chez les occupants naturels, à mesure que les envahisseurs de l’espace transgressent les frontières symboliques de l’identité ; autrement dit, celles qui définissent qui est autorisé à pénétrer et qui ne l’est pas. Lorsque les envahisseurs de l’espace entrent dans l’institution, leurs corps se heurtent au regard désorientant des hommes blancs qui perçoivent les subalternes comme « déplacés » (Puwar, 2004, p. 8). Les frontières symboliques entre occupants naturels et envahisseurs de l’espace, entre « nous » et « eux », et qui légitiment la revendication de cet espace, se matérialisent constamment en frontières spatiales, entre « notre espace » et « leur espace » (Yazdiha, 2022, p. 470). Aussi, les envahisseurs de l’espace qui veulent revendiquer l’espace et rester « dedans » sont à des degrés variables contraints de se conformer à un scénario normatif et normé. Ceux qui restent dedans sans se conformer risquent de devenir une nuisance pour les occupants naturels. Les frontières symboliques reproduites par les occupants naturels définissent ainsi les possibilités d’(inter)action. La blanchité et la masculinité forment une orientation, au sens de Ahmed (2007), qui influe sur la manière dont les individus peuvent faire des choses ou pas, se déplacer et interagir dans un espace donné. Si cela peut donner l’impression que les occupants naturels ont beaucoup plus de latitude pour faire des stratégies et maintenir les frontières excluantes — tandis que les envahisseurs sont contraints par ce même espace —, Puwar considère au contraire que la simple arrivée de l’envahisseur de l’espace dans une organisation formée par et pour d’autres corps crée une possibilité en soi de remodelage de l’espace.
La position des résistant·e·s à l’intersection des oppressions de genre et de race rend essentielle une perspective intersectionnelle, en particulier dans les organisations d’élite du Nord global, dont les universités[4]. Si le plafond de verre s’y fissure pour les femmes blanches, le plafond en béton pour les femmes racisées demeure bien en place. Considérer les tactiques de résistance comme des pratiques genrées-racialisées montre comment les femmes blanches et non-blanches expérimentent des formes différentes en fonction de leurs vulnérabilités. D’une part, les tactiques de résistance subalterne s’inspirent d’une « marginalité réussie » où la connaissance de l’oppression est convertie en diverses ressources de résistance, à la recherche d’un équilibre entre conformité et subversion (Rydzik et Anitha, 2020). D’autre part, leur résistance est marquée par ce que Puwar appelle à la suite de Pierre Bourdieu (1994) la complicité ontologique (entre habitus et champ). Puwar emprunte le concept de complicité ontologique pour désigner la proximité que les résistantes éprouvent par rapport aux conditionnements de l’espace, produisant une « inclusion différenciée » dans celui-ci. Elle souligne l’ambivalence et la fluidité des positions d’initiées et d’exclues qui dépendent de leur « sens pratique » ou « sens du jeu ». Si Puwar (2004a, p. 120) ne considère pas les envahisseuses de l’espace comme des « stratèges conscientes », nous soutenons que leurs dispositions permettent à certaines d’ouvrir des brèches dans celui-ci, en utilisant les outils institutionnels à leur portée.
Si nous sommes bien conscients de la manière dont les frontières symboliques se transforment en frontières spatiales, c’est-à-dire les frontières matérielles qui divisent l’espace de travail, il nous faut explorer plus loin ce que nous appelons le travail de démarcation spatiale ou le travail de frontière qui incombe aux envahisseurs. Puwar (2004a, p. 138), par exemple, n’examine pas explicitement cette question du point de vue des envahisseurs de l’espace et se contente de mentionner brièvement des « actes renégats » (renagade acts), c’est-à-dire des actes de prise de position contre le sexisme et le racisme, qui se produisent à l’intérieur de l’espace de l’institution dans le but d’en remodeler les frontières. D’autres recherches féministes postcoloniales se sont toutefois penchées sur l’usage de la marginalité subalterne afin de développer des espaces alternatifs où une résistance radicale est possible. Comme l’affirme hooks (1989, p. 15), ce dont il s’agit est de pousser « contre les frontières oppressives tracées par la domination de race, de sexe et de classe ». Cependant, au lieu de faire tomber complètement ces frontières, hooks plaide pour la création d’« espaces d’ouverture radicale », à l’intérieur même de la culture dominante, afin d’éviter que la résistance des corps subalternes ne soit cooptée ou réduite au silence. Contrairement à l’idée courante d’espaces alternatifs, ces espaces ne sont pas des espaces « sûrs », mais des espaces « risqués », car ils révèlent les frontières que les occupants naturels de l’espace aimeraient garder secrètes. Les envahisseurs de l’espace participent de la sorte de fait à la construction des frontières en créant des « espaces de refus » qui opposent une résistance à la culture dominante. Alors que les espaces marginaux proposés par hooks peuvent être considérés comme l’extrémité d’un continuum d’espaces de résistance, la notion mise en avant par Bhabha (1994) de « tiers-lieu » (third place) ou « espace hybride » examine la construction d’espaces par les subalternes dans lesquels ceux-ci ne rejettent pas complètement la culture dominante, mais créent plutôt une zone interstitielle entre culture dominante et culture subalterne, dans laquelle de nouvelles significations et de nouvelles identités sont élaborées. En ce sens, la résistance subalterne s’organise en brouillant les frontières, en réimaginant et en renégociant les appartenances et le droit à l’espace.
Les recherches antérieures sur les espaces alternatifs dans les organisations ont aussi montré la difficulté pour les subalternes d’une résistance radicale, difficulté qui les conduit souvent à devenir des « radicaux tempérés » (tempered radicals). Les radicaux tempérés développent ainsi la plupart du temps une résistance en coulisses où, tout en affichant une conformité extérieure, ils « persistent tranquillement » en essayant de changer l’institution de l’intérieur (Meyerson, 2008, p. 51 ; Meyerson et Scully, 1995 ; Parsons et Priola, 2013). Par conséquent, la création d’espaces hybrides est souvent considérée comme la possibilité de résistance la plus radicale. Dans cet article, nous prolongeons cette perspective, en appliquant les concepts de Puwar du trouble causé par les envahisseurs de l’espace, afin de rendre compte des tactiques délibérées que les femmes UDC emploient pour bousculer les frontières genrées-racialisées de l’espace académique.
le monde universitaire belge : contexte et méthodologie
Dans le contexte de l’institution académique, souvent présentée comme l’incarnation par excellence de la norme méritocratique, les femmes universitaires blanches et racisées ne cessent de subir des dynamiques d’exclusion. Par le prisme d’une approche critique, le monde universitaire peut être analysé en termes de « régime d’inégalité » (J. Acker, 2009) ou d’une « organisation racialisée » (Ray, 2019) qui s’articule autour de l’idéal d’un universitaire « sans encombre ». Cet universitaire idéal n’est toutefois pas un travailleur abstrait et désincarné, mais davantage le produit d’une norme masculine et blanche qui catégorise les femmes universitaires, en particulier racisées, comme « Autres ». La construction sexuée et racialisée de l’universitaire idéal contribue ainsi aux barrières structurelles et individuelles qui entraînent le phénomène de tuyaux percés, soit la disparition progressive des minorités dans la hiérarchie académique au sein des universités du Nord global. La Belgique en particulier est un contexte d’étude pertinent puisqu’elle est l’avant-dernier pays de l’UE-28 en termes d’égalité des sexes pour ce qui est du professorat (Commission européenne, 2021). Bien qu’aucune statistique ne soit disponible pour étudier le fossé racial dans le monde universitaire, il convient de mentionner que la Belgique, et en particulier la région flamande, est « championne » de l’inégalité éducative entre populations blanches et non blanches parmi les pays de l’OCDE (Bureau de recherche de l’Unicef, 2018).
Depuis 2020, les universités néerlandophones ont été sous le feu des critiques à la suite de plusieurs affaires rendues publiques de harcèlement sexuel et de racisme. Le mouvement #MeToo y a particulièrement influencé la question des inégalités de genre, avec des révélations importantes, en 2021, lorsque plusieurs femmes universitaires découvrent que leur collègue professeur qui les harcelle sexuellement fait déjà l’objet de plus de 20 plaintes auprès des instances de l’université, sans qu’aucune enquête interne n’ait été diligentée (Dapaah, 2022 ; Struys, 2022 ; Vandekerckhove et Bergmans, 2022). Devenues lanceuses d’alerte, elles livrent leurs expériences aux journaux, déclenchant une vague sans précédent d’indignation nationale qui pousse de nombreuses autres étudiantes et enseignantes à partager leur propre histoire de violence sexuelle à l’université en exigeant un changement institutionnel. Ces affaires ont mis en évidence la structure verticale du monde universitaire belge, avec des femmes UDC tout en bas de la hiérarchie professionnelle, travaillant dans des conditions précaires et ambiguës. Elles ont également révélé la relation de très forte dépendance entre superviseurs et supervisé·e·s, terreau d’abus de pouvoir, d’exploitation et de harcèlement sexiste, dans un contexte où les étudiant·e·s en doctorat sont majoritairement embauché·e·s pour des contrats d’un an, renouvelés uniquement à l’issue d’une évaluation positive de leur direction (Bourabain, 2020).
Contrairement au mouvement #MeToo, le mouvement Black Lives Matter a suscité dans ce contexte beaucoup moins de discussions. La préséance de l’égalité des sexes sur l’égalité raciale et leur réinterprétation en termes d’« inégalités rivales » est donc de mise dans le contexte belge, à l’instar d’autres pays européens (Bhopal et Henderson, 2021). Plus généralement, les politiques d’égalité demeurent centrées sur un « travail institutionnel défensif » (Roos et al., 2020). Les dirigeants et administrateurs puissants rechignent l’introduction de mesures d’efficacité réelle par crainte de bouleverser le statu quo et de perdre de leurs privilèges (Bourabain, 2024).
Comme dans la plupart des cultures universitaires masculines et blanches, celles et ceux qui nomment le problème « deviennent le problème » (Ahmed, 2021). En Belgique aussi, les préoccupations et expériences des universitaires subalternes en matière de racisme et de sexisme sont marginalisées ou rendues invisibles. Elles sont intégrées dans une culture du déni, reproduite au quotidien dans les interactions avec les pairs, les superviseurs et les étudiants (Bourabain, 2022). Comme le montrent des travaux récents, la référence incantatoire aux principes méritocratiques en constitue un ressort majeur (Bourabain, 2024 ; Myers et Bhopal dans ce numéro). La culture du déni forme ainsi l’arrière-plan des (im)possibilités pour les femmes UDC de nommer l’inégalité et influence leurs manières d’agir.
Construction et analyse des données
Cette étude s’inscrit dans un projet d’ensemble qui porte sur le sexisme et le racisme dans le monde universitaire belge (Bourabain, 2020 ; 2022). Dans cet article, nous nous appuyons sur un corpus de 50 entretiens semi-structurés approfondis, réalisés avec des femmes blanches et racisées, travaillant comme UDC dans cinq universités néerlandophones en Belgique. 26 femmes blanches et 24 femmes racisées ont été interrogées (voir tableau en annexe). Bien que les personnes racisées appartiennent à différentes minorités, nous ne précisons pas leur origine pour des raisons de confidentialité. En accord avec elles, nous distinguons uniquement entre groupes racialisés comme blancs et non blancs, car la présence marginale de ces derniers dans le monde universitaire belge permettrait de très facilement les identifier.
D’une durée d’une heure à deux heures et demie, les entretiens ont permis de guider nos interlocutrices à l’aide de quatre thèmes en lien avec la question des inégalités et discriminations au travail. Nous avons commencé par planter le décor autour de leur position, les modalités d’embauche, le type de contrat et leur trajectoire (post) doctorale. Nous leur avons ensuite demandé de décrire leur lieu de travail en termes de climat et de relations avec les pairs et la direction, ce qui a généralement conduit à une discussion de leurs expériences d’inégalité à l’université. Lorsqu’elles ont donné des exemples de pratiques racistes-sexistes, nous les avons invitées à approfondir ces souvenirs, en demandant leur ressenti lors de ces événements et leur manière de réagir. Nous avons ensuite exploré les tactiques adoptées par les UDC pour s’opposer et résister à l’environnement professionnel. Dans ce cas, les personnes interrogées ont souvent expliqué spontanément comment leurs actions étaient perçues par leurs collègues.
Nous avons analysé ce corpus avec une stratégie inductive de codage des entretiens. Étant donné que nos interlocutrices se situent au croisement de systèmes d’oppression de genre et de race, nous avons considéré leurs récits comme intrinsèquement intersectionnels. Notre tâche interprétative a dès lors consisté à « rendre explicites les expériences souvent implicites de l’intersectionnalité, même lorsque les participantes n’expriment pas les liens » (Bowleg, 2008, p. 322). Elle a permis de rendre compte des similitudes et différences en termes de tactiques de résistance entre femmes blanches et racisées. De plus, les perspectives féministes noire et postcoloniale de l’intersectionnalité dans lesquelles nous nous inscrivons ici identifient l’analyse intersectionnelle comme intrinsèquement spatiale. Collins et Bilge (2016) démontrent ainsi la manière dont les relations de pouvoir se matérialisent à travers l’espace, rendant la construction analytique des tactiques de résistance à l’intérieur de l’espace organisationnel de l’université indispensable.
Pour identifier les types de pratiques en lien avec nos questions de recherche, nous avons procédé par une analyse thématique inductive (Braun et Clarke, 2006). Les thèmes principaux ont été identifiés par le biais d’un codage ouvert qui cible les sujets les plus saillants. Ces thèmes sont souvent descriptifs dans la mesure où ils reflètent étroitement le langage ordinaire des personnes interrogées. Nous avons ensuite combiné ces thèmes principaux à partir de leurs points communs pour obtenir des thèmes de « deuxième niveau ». Cette étape nous a notamment permis de développer de nouveaux concepts que nous avons mis en regard avec la littérature. Dans une approche informée par la perspective féministe postcoloniale de Puwar, nous avons développé d’autres concepts étroitement liés à la notion d’« envahisseurs de l’espace ». En suivant l’idée de « vocabulaire spatial » de Wasserman et Frenkel (2015), nous ne nous contentons pas d’identifier celui-ci dans les entretiens, mais l’utilisons pour nommer différentes tactiques de résistance. En d’autres termes, si les personnes interrogées ont discuté de leurs expériences en des termes plus larges, notre objectif d’interprétation s’est concentré sur leur spatialité. Nous avons ainsi construit de manière idéal-typique trois types de tactiques mobilisées par les femmes UDC dans leur relation spécifique avec l’espace de travail et ses limites : 1) les tactiques de l’en-dedans ; 2) les tactiques de l’en-dehors ; et 3) les tactiques mixtes.
tactiques de l’en-dedans
Tout d’abord, la majorité des participantes à l’enquête nous ont fait part de l’acquisition progressive d’une sagesse tactique qui leur confère des compétences pour « lire la pièce » et naviguer les rapports de pouvoir. R13 se remémore ainsi sa première expérience professionnelle dans un environnement hostile, où on lui a implicitement enjoint de laisser son identité ethnique « à la maison ». Faisant face à une désapprobation constante de la part de ses pairs et supérieurs, elle évoque sa difficulté initiale à gérer ces situations :
Je pense que je n’avais pas les mots pour identifier ce qui était en train de se passer : je recevais des remarques, elles faisaient mal, mais à ce moment-là, je suis restée silencieuse. C’est une relation de pouvoir, c’est votre supérieur et vous ne le voyez qu’une fois tous les trois mois ; vous devriez être heureuse qu’il veuille vous voir… et puis vous recevez des remarques comme ça… j’ai essayé de me retenir, mais j’ai beaucoup pleuré après.
Le désarmement initial laisse cependant progressivement place à une capacité à faire face aux situations racistes et sexistes plus efficacement. R16, chercheuse post-doctorale, l’exprime ainsi : « Nous sommes allés dîner avec des collègues et ils faisaient toutes sortes de blagues sexistes. Maintenant, cela n’arrive plus parce que j’ai été très claire : ‘‘Hello, nous sommes en 2019 ! ’’ Avant, par contre, je n’osais pas trop… maintenant, je pense être armée. » Cette connaissance expérientielle est non seulement le fruit d’une expérience personnelle, mais également d’un engagement collectif. Comme le font valoir les perspectives intersectionnelles et critiques du racisme, l’expérience vécue est non seulement un mécanisme essentiel pour forger une compréhension globale des rapports de domination, mais détient également les clés pour devenir la matière même de leur transformation.
C’est dans ce contexte qu’il convient de situer l’élaboration d’un ensemble de tactiques de résistance ordinaire. Un premier répertoire prend forme dans l’espace de travail, utilisant ses caractéristiques socio-matérielles pour faire valoir une existence et revendiquer un droit à l’espace. Ici, les femmes enquêtées travaillent de l’intérieur car leur objectif principal est de déconstruire l’invasion en révélant les frontières symboliques et matérielles censées les maintenir à l’écart. L’un des tout premiers enjeux de spatialité qui nous fut signalé a été ainsi la ségrégation des bureaux en termes de rang universitaire. Comme le soulignent les enquêtées R19, R5 et R45 les chercheur·se·s doctorant·e·s sont généralement réuni·e·s dans les mêmes bureaux, tandis que les professeur·e·s se trouvent à « un autre étage » ou « de l’autre côté du couloir ». Wasserman et Frenkel (2015) ont analysé cette stratégie d’emplacement (emplacement strategy), consistant à séparer les employé·e·s de rang inférieur, souvent des femmes, des employé·e·s de rang supérieur, plutôt des hommes, comme une manière de limiter le travail des femmes, placées dans des rôles d’exécution.
Bien que ce soit une manière de faire relativement courante dans le monde professionnel, l’histoire de R46 reflète une dynamique de ségrégation différente, fondée en l’occurrence sur sa position de femme UDC racisée. Son témoignage évoque ainsi les termes de son exil subi dans le « couloir des minorités » :
Lorsque vous allez à notre étage, à gauche, vous avez les doctorants et les professeurs et, à droite, vous avez un couloir où sont réunis principalement des personnels internationaux et temporaires. Comme il n’y avait pas de place pour nous [plusieurs femmes racisées], ils nous ont mis avec les internationaux… Mais nous nous sommes senties isolées. On avait l’impression de ne pas être à notre place. Par exemple, lorsqu’il y a une réception, ils viennent parfois à notre porte pour nous demander de les accompagner. Mais la plupart du temps, ils nous oublient.
Son expérience montre ainsi une ségrégation spécifiques des femmes racisées qui n’est pas liée au statut professionnel, mais est intrinsèquement sexuée et racialisée, puisqu’elles sont séparées de leurs pairs ayant un statut professionnel identique. Perçus comme étant « de passage » et ayant vocation à retourner dans leur pays, « les internationaux » ne sont généralement pas intégrés de la même manière dans le département où ils occupent des bureaux « flexibles » (c’est-à-dire non attribués, mais utilisés en fonction des besoins). Le fait pour les femmes UDC racisées d’occuper le même bureau que les chercheur·se·s internationaux·ales signale ainsi leur droit limité à l’espace et son caractère temporaire, alors même qu’elles sont de statut professionnel, langue et responsabilités identiques à ceux de leurs pairs blancs. Après de nombreuses occurrences d’« oubli » et d’invisibilisation, R46 finit par exiger d’être déplacée dans le couloir principal, obtenant le soutien de son superviseur, lui aussi universitaire racisé :
J’ai envoyé un courrier à mon supérieur pour lui demander une réunion. Je lui ai dit que nous nous sentions comme des exilées, que nous n’étions pas considérées comme faisant partie du groupe et que cela générait beaucoup d’autres manifestations de racisme de la part des collègues. Il m’a répondu que la première chose à faire était de déménager au rez-de-chaussée. La semaine dernière, nous avons déménagé dans un autre bureau. Cela change tellement les choses ; désormais, on passe devant d’autres bureaux et on peut avoir des petites discussions dans les couloirs.
En revendiquant explicitement le droit d’occuper un espace formel, cette personne s’est rapprochée physiquement de l’espace alloué à ses pairs blancs. Elle a utilisé cette tactique de revendication de l’espace et de redéfinition des frontières à d’autres moments, notamment après avoir constaté avec une collègue que d’autres collègues, ainsi que des étudiant·e·s, prononçaient mal leur nom. Il s’agit là d’une pratique d’effacement courante pour les femmes racisées dans des environnements professionnels du Nord global (Kohli et Solórzano, 2012). Après avoir tenté à plusieurs reprises de corriger ses collègues, R46 a opté à nouveau pour signaler le problème à son supérieur. Ce dernier a fini par lui conseiller d’aborder la question lors de la prochaine réunion de département :
C’était un point à l’ordre du jour et nous avons soigneusement expliqué que cela pouvait être inconscient, mais que mal prononcer les noms était source de frustration. Deux personnes avaient agi de la sorte et savaient qu’il s’agissait d’elles. Après la réunion, l’une d’entre elles ne m’a même pas regardée et l’autre, une professeure, était en colère contre moi. Elle m’a dit : « Mais c’est à vous de me le faire remarquer, je ne peux pas le savoir. » J’ai dit : « Je l’ai fait, mais au bout d’un moment, c’est fatigant de voir que vous ne vous corrigiez pas. » « Oui, mais vous n’auriez pas dû le faire comme ça. » Et j’ai dit : « Je suis désolée, mais c’était la meilleure façon de le faire, j’espère qu’à présent vous ne l’oublierez pas. » Elle était furieuse de la manière dont on l’avait interpellée.
L’utilisation d’espaces formels comme les réunions de département est tout à fait exceptionnelle et R46 n’a choisi cette voie que parce que son superviseur hiérarchique le lui a suggéré. Cela prouve que le soutien des supérieurs dans l’identification et la lutte contre le racisme et le sexisme est nécessaire pour provoquer un véritable changement (Scarborough, Lambouths et Holbrook, 2019). Cette histoire montre aussi que les occupants naturels sont conscients des frontières implicites qu’ils reproduisent dans l’espace de travail. La professeure a été prise par surprise lorsque R46 a exposé ses préoccupations. Selon sa remarque, « vous n’auriez pas dû le faire comme ça », les espaces formels ne sont pas conçus pour que des corps subalternes décident de ce qui est à l’ordre du jour. En prenant la parole de la sorte, R46 a brouillé les frontières entre les occupants légitimes de ces espaces et ceux qui n’en sont pas.
Toutefois, les chercheuses rencontrées choisissent le plus souvent les espaces sociaux informels comme lieu de confrontation. Elles indiquent que ces cadres informels dans lesquels elles déjeunent ou prennent un café brouillent les frontières hiérarchiques professionnelles et offrent plus de place pour prendre le contrôle. R23 indique, par exemple, que personne ne peut passer devant la salle de réunion sans entendre « quelque chose en rapport avec le féminisme, les droits de l’homme et la discrimination ». Le fait de parler de son expérience et de celle de ses collègues femmes met d’autres mal à l’aise, mais aussi « convertit les gens ». Dans le même temps, cependant, les frontières professionnelles floues permettent également aux occupants naturels de se sentir plus à l’aise dans ces espaces pour poser des questions « personnelles » ou faire de « petites blagues ».
Tous les jours, durant la pause-café, j’étais au centre de l’attention. Pendant longtemps, j’ai ressenti de la curiosité. Je ne sais pas comment l’expliquer… Je n’étais pas une des leurs. Ils avaient tellement de questions sur la façon dont je vivais ma vie que je me suis dit : « Tu sais quoi, utilise ça pour changer le récit, pour changer la façon dont ils pensent à toi. »
R29
Des blagues [sur les Noirs] ont été faites dans le groupe, je me suis sentie forte sur le coup, mais après je me suis dit que je n’aurais pas dû faire ça. J’ai commencé à dire que la Belgique a détruit le Congo, j’ai parlé du colonialisme… nous en avons parlé pendant une minute, puis la conversation s’est arrêtée.
R40
Les occupants naturels utilisent le « discours ordinaire » (ordinary talk) pour activer une notion d’entre-soi qui légitime le sexisme-racisme (van Dijk, 1995). Parler des subalternes en termes déshumanisants et objectivants est un moyen de renforcer les frontières symboliques de l’identité collective. Dans les deux cas, les femmes UDC utilisent ces espaces pour perturber les stratégies des occupants naturels. Alors que R29 remodèle le récit en abordant des questions exotisantes, R40 expose le racisme implicite, ce qui met fin à la conversation. Alors que certaines refusent de se soumettre à ce type de « conversation ordinaire », d’autres considèrent au contraire qu’elles peuvent ainsi « faire partie de la famille ».
Les femmes UDC ont été également confrontées à un espace de travail genré par le biais de communications explicites diffusées sur le campus. Plusieurs femmes partagent ainsi avoir été confrontées à des visuels lors de leurs déplacements vers et dans le bureau, des affiches de soirées étudiantes, par exemple, où les femmes sont représentées comme objets sexuels. Un exemple nous est donné par R23 qui a remarqué une affiche dans son département incitant le personnel à maintenir un mode de vie sain. R23 et ses collègues ont réagi en collant des post-it pour revendiquer visuellement cet espace :
Ils ont fait cette affiche qui a été accrochée à côté de l’ascenseur pour encourager les gens à prendre les escaliers. On y voit un type qui tend ses muscles en disant : « Ne sois pas une mauviette, prends les escaliers » (Don’t be such a pussy, take the stairs). Et on s’est dit : « Mais qu’est-ce qu’on peut faire ? » Nous avons laissé des post-it partout pour dire que la mention péjorative des organes génitaux féminins n’était pas acceptable. Beaucoup de gens ont dit : « Ils ne voulaient pas dire vagin, ils voulaient dire chatte. » Il y a eu beaucoup de réactions négatives, beaucoup de gens ont été méchants à ce sujet. Mais tout de suite, on s’est dit : « Non, cela ne va pas se passer comme ça. Pas sous notre regard. »
Pris ensemble, ces extraits montrent que les tactiques de l’en-dedans ne sont pas construites en fonction de ce qui est jugé une manière acceptable, pour les envahisseuses de l’espace, de s’y déplacer. Les femmes UDC brisent et remodèlent activement les frontières au sein de l’espace de travail avec des stratégies plutôt explicites de prise de parole dans des espaces formels aussi bien qu’informels. Elles confrontent les discours, les images, les messages et la ségrégation soi-disant « ordinaires ». Ces pratiques ne sont pas seulement mises en oeuvre pour conquérir l’appartenance, mais plutôt pour que celle-ci soit reconnue par le biais d’une revendication d’espace. Alors que Scott affirme que les pratiques de jure sont beaucoup moins courantes et moins « ordinaires », nous pouvons soutenir que ces tactiques sont plus « faciles » à mettre en oeuvre dans une institution qui est encore en crise, avec l’esprit #MeToo qui rôde dans les couloirs. Cela provoque ce que Puwar appelle, une désorientation parmi les occupants naturels opposés à la revendication d’espace par les femmes UDC. Leur résistance n’est pas seulement vécue comme une perte de frontière, mais aussi comme une perte d’identité, car le fonctionnement habituel de l’espace est perturbé par le potentiel redouté d’un environnement « qui mue » (Puwar, 2004a, p. 29).
tactiques de l’en-dehors
Dans ce deuxième ensemble de tactiques, les UDC résistent en sortant des frontières physiques de leur espace de travail. Leur démarche consiste à se retirer, à s’isoler ou même à fuir — comme elles le décrivent — un espace de travail « toxique », « malsain » et « épuisant » ; tout en se conformant par ailleurs aux exigences « objectives » pour devenir une universitaire idéale. Cette attitude est à contraster avec celle de la résignation, qui est une forme de résistance quotidienne couramment évoquée (Coleman et Tucker, 2011). Si elles évitent ou fuient les interactions avec leurs collègues et espace de travail, elles le font principalement de manière silencieuse, rarement franche et avouée.
La tactique la moins courante consiste ici à se retirer des interactions racistes-sexistes sur le lieu de travail. R14, par exemple, a littéralement quitté la pièce lors d’une activité de team building avec ses collègues, car la remarque raciste d’un collègue à son égard a fait rire tout le monde. Dans ce cas particulier, le déni du racisme est clairement réaffirmé par des micro-interactions, renforçant ainsi les barrières excluantes à l’égard des femmes UDC. Après plusieurs tentatives infructueuses pour souligner le caractère inapproprié du commentaire, la seule façon de faire comprendre son point de vue fut de quitter l’espace :
Je lui ai dit sur-le-champ que je n’appréciais pas son commentaire. Il n’a rien dit, il a ri nerveusement, puis j’ai dit : « Quelle façon de casser l’ambiance ! », et personne n’a réagi. Tout le monde a fait comme si de rien n’était… Mon coeur battait la chamade, je me disais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je lui ai donc répété que cela me mettait très mal à l’aise, que c’était raciste. Personne n’a fait de commentaire. Je me suis alors dit que j’avais deux possibilités : soit rester et faire semblant d’aller bien, soit… et puis je me suis dit qu’ils étaient OK pour me voir comme ça, alors pourquoi est-ce que je considérerais ce que cela leur ferait à eux ? La meilleure solution était donc de partir et de faire une déclaration. Sinon, ça allait passer pour une petite blague qui avait mal tourné. J’ai donc dit : « Ça ne ressemble pas à du team building, je rentre chez moi », et je suis partie.
R14
Les tactiques spatiales les plus courantes étaient toutefois silencieuses et en général le fait des UDC racisées. Celles-ci utilisent leur « ex-centricité » pour quitter l’espace de travail et se concentrer sur leur carrière, car le fait d’être dedans entrave plutôt leurs opportunités. Le travail à distance, devenu relativement habituel pour les universitaires, a donné aux femmes racisées une flexibilité en silence, permettant de jouer le jeu du mérite tout en gardant à distance le sexisme racialisé qu’elles subissent sur le lieu de travail. Selon R28, doctorante en sciences humaines et sociales :
Je n’ai pas vraiment de liens avec mes collègues, en tout cas moins que ceux qu’ils ont entre eux, parce que l’année dernière, j’étais tellement frustrée que j’ai beaucoup travaillé depuis chez moi. Jusqu’à présent, chaque expérience professionnelle a été traumatisante, alors je prends consciemment mes distances pour leur donner moins de chances de me blesser et pour me concentrer sur mon travail.
Cependant, l’extérieur, l’en-dehors peut également devenir un nouvel espace dans lequel les UDC racisées « se serrent les coudes » (R13), à la recherche d’un soutien académique qui leur fait défaut dans l’espace de travail. R13, également doctorante en sciences humaines et sociales, rencontre ainsi souvent une collègue racisée d’un autre département avec qui elle se sent à l’aise pour travailler :
Au début, j’étais la seule personne avec des origines migratoires… c’est pas que ce n’était pas drôle… mais vous vous sentez toujours un peu comme l’intrus là-dedans… Souvent, je ne travaillais pas au bureau… alors je retrouvais quelqu’un que je connaissais. J’ai pris l’habitude de travailler ailleurs, dans un café… J’allais très souvent travailler avec elle plutôt qu’avec mes collègues. C’est plus facile.
Les espaces de l’en-dehors permettent généralement de se réunir plus facilement, évitant ainsi les effets d’ « amplification » dont usent les occupants naturels, à savoir : bien que ces femmes soient minoritaires dans le monde universitaire, leur présence est sans cesse exagérée du fait du trouble perçu qu’elle provoque dans un « paysage institutionnel normal » (Puwar, 2004a, p. 48). L’amplification se trouve exacerbée lorsque les envahisseuses de l’espace interagissent les unes avec les autres : elles sont alors vues comme « faisant alliance » et menaçant l’environnement normatif. Aussi, si se rassembler « en-dedans » est perçu comme une menace des frontières spatiales et symboliques, les tactiques silencieuses de l’en-dehors offrent un plan B, lorsque par exemple nos interlocutrices sont explicitement réprimandées sur le fait que leur résistance dans l’espace intérieur met en péril leur carrière universitaire. Celles qui résistent sur le devant de la scène deviennent des fautrices de trouble pour leurs supérieurs, qui les font passer au second plan pour éviter les répercussions. Comme l’indique R28 :
Je parlais à un professeur qui, je pensais, avait une certaine compréhension des enjeux de pouvoir. J’ai dit que les hommes ont plus de facilité à faire avancer leur carrière parce qu’ils font de l’autopromotion sans scrupules. Je pensais que c’était du bon sens que les hommes se vendent plus facilement ? Quelques semaines plus tard, ma responsable demande une réunion parce qu’elle a entendu dire que je ne pouvais pas travailler avec des hommes blancs d’âge moyen. Si, en tant que minoritaire, vous critiquez le monde universitaire, cela signifie apparemment que vous critiquez les Blancs. C’est à ce moment-là que je me suis dit que je n’avais plus rien à faire ici. Il faut toujours faire attention à ce que l’on dit, car je n’ai même pas parlé de Blancs !
Cependant, alors qu’elles prennent discrètement leurs distances par rapport à l’espace hostile, elles risquent encore d’en subir les conséquences. De la même manière que leur présence dans l’espace universitaire conduit à « l’amplification », leur absence peut également devenir hyper-visible. Comme elles sont souvent les seules racisées dans leur département, elles ont également du mal à disparaître ou de s’effacer en arrière-plan. Travailler sous le regard de l’homme blanc est ainsi une constante dans le vécu de ces femmes et, en particulier, des femmes racisées, fréquemment confrontées aux techniques de micromanagement, à savoir une surveillance accrue et des interventions particulièrement intrusives de la part de leurs supérieurs (Bourabain, 2020). Ceux-ci s’attendent en effet à ce qu’elles soient constamment disponibles et ne veulent en aucune circonstance les perdre de vue. Aussi, bien que le travail à distance soit devenu une pratique courante, les femmes UDC y ont recours expressément pour éviter de devenir encore plus régulées. Comme en témoigne R6, doctorante en SHS :
Disons qu’au début, je ne me sentais pas la bienvenue, je ne me sentais vraiment pas à l’aise du tout. J’ai alors essayé de travailler plus souvent à domicile. Mais cela a vite été mal vu par mes supérieurs… Ils m’ont alors « proposé » de travailler à domicile un jour par semaine ! Alors que tout le monde peut travailler à domicile.
Les tactiques de l’en-dehors offrent le meilleur exemple de résistance en coulisses (backstage resistance). Outre la technique consistant à « quitter la pièce », la plupart des femmes UDC ont eu recours au fait de quitter physiquement l’espace de travail, tout en maintenant leur qualité de membre par l’accent mis sur leur carrière, qui leur permet de continuer à jouer le jeu du mérite et espérer franchir les frontières de l’exclusion. Ce que ces fragments tendent aussi à montrer est que les femmes UDC veulent jouer le jeu universitaire, mais qu’elles ne sont pas autorisées à être aussi « détachées » que l’universitaire idéal est censé pouvoir l’être. En se retirant de l’espace de travail au sein duquel elles doivent accomplir un travail émotionnel constant pour faire face à l’inégalité, elles se libèrent (en partie) du fardeau d’être femme racisée à l’université. Tandis que Puwar envisage la complicité ontologique comme de la capacité à se conformer aux codes et conditions du terrain de jeu en fonction de sa propre positionnalité, les femmes UDC choisissent stratégiquement la résistance en coulisses pour ne pas être mises hors-jeu. Elles font ainsi en sorte d’éviter que la complicité ontologique ne devienne un déni ontologique.
tactiques mixtes de l’en-dedans et de l’en-dehors
Le troisième répertoire de tactiques présente une combinaison des démarches susmentionnées, étant donné que l’objectif des tactiques de résistance mixtes est de construire des espaces à l’intérieur de l’organisation, mais distincts de l’espace dominant. Ces contre-espaces sont construits avec un objectif similaire à celui des tactiques de l’en-dehors, puisqu’ils visent à stimuler un soutien personnel et professionnel qui leur est refusé au sein de l’espace dominant. En occupant des bureaux et des salles de réunion, nos interlocutrices créent une extériorité dans l’en-dedans qui leur permet de développer une communauté et un réseau de soutien. Comme l’explique R18, doctorante en SHS non racisée :
Mes deux collègues et moi, nous avons décidé de nous soutenir mutuellement. Tous les deux mois, nous nous réunissons pour parler de nos problèmes de doctorat et de nos contacts avec [nom du superviseur blanc]. Nous l’avons formalisé parce que nous avions l’habitude d’en parler souvent pendant le déjeuner ou entre les heures de travail, mais nous nous sommes dit que nous devrions vraiment prendre le temps de le faire.
Ces contre-espaces brisent les prérequis établis dans l’espace masculin blanc qui les rend « déplacées ». Ils introduisent des valeurs de solidarité, d’attention et de compréhension qui leur font défaut en tant qu’envahisseuses de l’espace dominant. En construisant de tels espaces, elles contrent leur « sans-abrisme symbolique » (Irigaray, 1991) et développent leur appartenance en des termes qui leur sont propres, et sans « se faire attaquer » ; où leurs « expériences ne sont pas minimisées » : « Je n’ai pas à tout expliquer… on se sent chez soi », — souligne R3, autre doctorante racialisée comme blanche.
Se soutenir mutuellement dans les épreuves est l’une des raisons d’être de ces contre-espaces (Bayfield et al., 2020 ; Lewis et al., 2015), car le fait de parler de luttes similaires aide à surmonter la fatigue causée par le simple fait d’exister dans l’espace académique. Selon R14 : « nous pouvons ainsi partager ces situations et nous défouler sur le moment, puis juste passer à autre chose ». La plupart du temps, elles construisent ces espaces pour devenir plus performantes, en s’appuyant sur les relations évolutives entretenues avec leur direction de recherche. R6 se remémore en ces termes la création d’un groupe de soutien non-mixte, réservé aux femmes :
Au début, tout le monde avait une façade, faisant comme si tout allait bien, personne n’osait demander des conseils. Au bout d’un moment, je me suis rendu compte qu’on était dans la même situation. J’ai donc entamé la conversation en demandant si tout allait bien. C’est ainsi que le projet a vu le jour… Nous avons créé un groupe de soutien pour toutes les femmes. Nous avons créé un groupe de soutien pour toutes les femmes et nous nous sommes vraiment rapprochées les unes des autres. Nous nous consultons mutuellement pour obtenir des conseils, que ce soit à propos d’un programme, d’une méthode… Mais aussi, si nous ne nous sentons pas bien pour exprimer nos frustrations. Et cela a vraiment beaucoup aidé.
En outre, ces espaces leur permettent de revendiquer une identité académique conforme aux aspirations néolibérales de réussite. De son côté, R3 a créé un groupe d’écriture réservé aux femmes, simplement en louant une salle de réunion au département sur un créneau fixe. Le groupe a vu le jour lorsque les femmes UDC ont remarqué que « les femmes ont beaucoup de tâches administratives à accomplir. Nous devons donc prendre le temps d’écrire et éviter les autres tâches. » Cependant, elles ont aussi rapidement constaté que leur initiative était entravée par leurs pairs :
Nous avons reçu tellement de critiques… tout le monde n’a pas trouvé normal que le projet soit réservé aux femmes. Ils ont vraiment réagi… de manière très agressive. Ils nous ont demandé pourquoi nous faisions cela et si c’était autorisé : parce que pas mal de femmes voulaient participer. À un moment donné, ils se sont dit qu’ils ne devraient pas autoriser cela. Et nous avons dû inviter des hommes, et c’est là que ça s’est dilué, parce que pas un seul homme ne s’est présenté. Cela a un peu prouvé mon point de vue. Ce n’est pas parce qu’ils voulaient vraiment participer, mais parce qu’ils se sentaient exclus.
R3
R6 a vécu une expérience similaire dans laquelle le contre-espace qu’elles avaient récemment fabriqué a été délibérément déconstruit par ceux qui s’en sont sentis exclus. Les UDC hommes en particulier ont réagi en attirant l’attention de l’encadrement sur la situation :
Ils ont vraiment essayé de l’arrêter. Puis les professeurs ont dit qu’un espace sûr était important, mais qu’il ne devait pas créer deux groupes, qu’il ne devait pas être destiné à colporter des ragots sur les collègues. Mais il ne s’agit pas de ragots, il s’agit de se soutenir les unes les autres… Maintenant, nous le gardons secret, ce qui est en fait horrible.
R6
Comme le montrent ces récits, les femmes UDC utilisent leur position marginale pour développer de nouveaux espaces de résistance, à l’intérieur de leur espace de travail. Il est intéressant de noter que ces tactiques diffèrent de la notion d’espaces d’ouverture radicale de hooks (1989), ainsi que de celle de tiers-espace ou espace hybride de Bhabha (1994) que nous avons exposés. Les contre-espaces investis par nos interlocutrices développent de nouvelles frontières, mais dans des termes qui leur sont propres. Ces frontières ne sont pas poreuses comme le seraient celles d’un tiers-espace, même si elles n’utilisent pas nécessairement ces espaces pour « refuser » la culture dominante, dans la logique par exemple des espaces d’ouverture radicale.
En conséquence, la construction de tels contre-espaces vient encore « amplifier » les effets d’amplification, c’est-à-dire de perception exacerbée du nombre d’envahisseurs et de la menace qu’ils constituent, que traduit la crainte de perte de frontières chez les corps à la maison. C’est, au contraire, nous l’avons vu, une situation délibérément évitée dans les tactiques de l’en-dehors. Aussi, de manière attendue, c’est cette tactique qui suscite les résistances les plus importantes de la part des occupants naturels — voyant dans l’assemblée de femmes UDC une menace à l’ordre établi et à l’institution. Les occupants naturels cherchent donc à réprimer ces tactiques en intensifiant ou en développant de nouvelles formes de violence symbolique, mais aussi, nous pouvons l’imaginer, physique. En renversant la table, ils se constituent en victimes pour mieux nier de la sorte le sexisme-racisme de l’institution (Essed, 1991).
discussion : envahisseuses ou interprètes de l’espace ?
L’objectif de cet article fut d’éclairer les tactiques de résistance des femmes UDC, blanches et racisées, dans le monde universitaire. Pour éclairer les réponses des femmes universitaires, blanches et racisées, face aux frontières excluantes de l’institution et la manière dont celles-ci engagent l’utilisation de l’espace organisationnel, nous avons mis en évidence trois répertoires de tactiques en ce qu’elles utilisent différemment les limites spatiales de l’institution. Si les tactiques de l’en-dedans utilisent des espaces formels aussi bien qu’informels pour interroger de l’intérieur les frontières de l’institution et revendiquer un droit à l’espace ; les tactiques de l’en-dehors investissent l’espace « hors » organisation, souvent en tant que plan B, permettant de la sorte de se retirer de l’espace de travail masculin et blanc, tout en continuant à aspirer à la figure de l’universitaire idéal. Les tactiques mixtes dès lors combinent ces deux répertoires pour aboutir à la construction de contre-espaces « de l’intérieur » qui esquissent la possibilité d’un changement normatif au sein de l’environnement professionnel à la faveur duquel les UDC ne sont plus dépourvues de soutien. En conséquence, ce sont ces tactiques mixtes, qui engagent un changement institutionnel, qui suscitent, comme le montre l’enquête, la plus forte opposition chez les corps à la maison, dont elles traduisent la crainte ontologique que l’espace qu’ils sont « en droit de posséder » ne soit occupé par celles qui n’appartiennent pas.
L’analyse des récits montre aussi comment le déploiement de ces tactiques dépend des positionnalités au sein de l’espace académique. En particulier, le prisme intersectionnel permet de mettre en évidence l’utilisation différentielle des trois répertoires par les femmes racialisées comme blanches et non-blanches. À partir de la distinction établie par Scott (1989), il apparaît notamment que si les femmes UDC blanches ont tendance à opter pour des pratiques de jure, les femmes racisées penchent davantage pour celles de facto. Cette différence fut particulièrement saillante dans la mobilisation tactique de l’en-dehors, qui fut essentiellement le fait de femmes racisées. Inversement, il est significatif que les femmes blanches soient davantage présentes dans les tactiques mixtes qui, à la différence des tactiques de l’en-dehors, ne sont pas des tactiques « silencieuses ». Comme leurs collègues hommes, les femmes blanches incarnent en partie la norme somatique qui leur confère une complicité ontologique supérieure en raison de leur capital de blanchité (Bourdieu, 1977 ; Puwar, 2004a ; Myers et Bhopal dans ce numéro). Cette capacité à circuler plus « librement » et à occuper plus d’espace en fait des « radicales tempérées » en soi, c’est-à-dire à qui on autorise de faire bouger « tranquillement » les choses (Meyerson, 2001, p. 51). Par contraste, leurs paires racisées sont poussées à devenir des radicales tempérées, compte tenu des coûts matériels, professionnels et psychologiques inhérents à leur travail de résistance au quotidien.
L’enquête a permis d’éclairer en effet la double contrainte que fait peser sur elles l’exigence d’exceller dans l’université néolibérale et de faire face à la violence sexiste-raciste au quotidien. Parler entraîne potentiellement pour les femmes racisées des conséquences négatives graves qui les transforment en cible d’attaques et les condamnent à l’isolement. Nombreuses furent ainsi nos participantes à relever la manière dont le travail émotionnel constant pour exister dans un environnement masculin et blanc est synonyme de problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété, le stress, un sentiment profond d’isolement. Leurs réalisations font l’objet d’un examen minutieux, cependant que les efforts déployés pour remettre en question l’ordre masculin et blanc les détournent de leurs objectifs immédiats de progression de carrière. Placées face à des injonctions paradoxales, d’aucunes pensent arrêter — raison de plus, si besoin était, de rappeler que les femmes universitaires en début de carrière ne devraient pas être seules responsables de démanteler le sexisme et le racisme à l’université.
Malgré ces différences de position et de posture, l’enquête a néanmoins montré leur capacité réelle à faire un travail de frontière, selon l’expression proposée, qui renégocie les limites de l’institution. Aussi, notre contribution sur le plan théorique consiste à étendre la notion d’envahisseuses de l’espace de Puwar à celle d’interprètes de l’espace pour rendre compte de la manière dont les corps subalternes naviguent aujourd’hui les espaces professionnels masculins et blancs. Pour cela, nous avons fait dialoguer la théorie sociologique classique de la résistance ordinaire avec une approche féministe postcoloniale de l’espace. Dans ce contexte, la perspective empruntée à Scott permet notamment de souligner comment, dans un environnement qui contraint et exclut les femmes, celles-ci sont capables de « désorienter » l’organisation en débusquant soigneusement ses « failles » et sans avoir à renoncer à leurs propres objectifs de carrière pour autant.
À travers le concept d’envahisseuses de l’espace, Puwar a montré comment la simple présence des corps subalternes a un effet sur le fonctionnement de l’espace masculin blanc, permettant à certains corps de se déplacer librement, tout en en contraignant d’autres. Son travail souligne la fluidité et la complexité des positions sur le continuum de l’en-dedans et l’en-dehors, par le prisme d’une approche bourdieusienne qui construit l’espace comme un terrain de jeu. S’inspirant de Bourdieu, Puwar (2004a, p. 120) considère la qualité de membre ou d’établi (insider) comme quelque chose qui s’acquiert plutôt inconsciemment et qui ne fait pas des insiders des « stratèges conscients ». Cependant, elle ne néglige pas non plus la question de l’agentivité en discutant brièvement la notion d’actes renégats. L’utilisation du terme renégat connote en particulier le fait que les subalternes pourraient se montrer plus réticentes à résister si cela peut compromettre leur qualité de membre.
Considérer les envahisseuses de l’espace comme des interprètes de l’espace permet en revanche, selon notre hypothèse, d’étudier la manière dont les corps subalternes s’engagent activement dans le fonctionnement quotidien de l’espace masculin blanc. Comme le montrent nos résultats, la résistance n’est pas seulement une réponse réactive à l’oppression qui fait peser le risque de perdre sa qualité de membre. Elle est aussi une résistance productive, au sens où elle façonne de nouvelles subjectivités et de nouveaux espaces d’expression. Par la revendication de l’espace, les tactiques de résistance permettent de reconfigurer sa signification initiale et, partant, de redéfinir qui en est l’occupant légitime. Si Puwar à la suite de Bourdieu considère que les subalternes utilisent une « sagesse pratique » qui leur permet de se déplacer silencieusement dans l’espace et en devenir des initiés peu à peu, nous observons leur usage d’une « sagesse tactique », au sens de Scott, qui découle d’une marginalité réussie au sein de l’espace universitaire et délibérément utilisée pour remettre en question ses frontières. Cela montre notamment que les femmes UDC ne sont pas seulement « perturbatrices », car présentes, mais que la résistance fait partie de leur pratique quotidienne. Leur travail d’interprétation rend visible et permet de penser un processus de conscientisation spatiale qui, loin d’être l’apanage des seuls occupants naturels, émerge aussi parmi les corps subalternes apprenant à reconnaître la relation intrinsèque entre espace occupé et position sociale. Plus de vingt ans après la publication du travail fondateur de Puwar et à la faveur des mouvements récents de justice sociale comme #MeToo et Black Lives Matter qui ont eu une résonance particulière dans le monde universitaire, nous mettons donc ainsi en avant l’hypothèse d’une évolution de ses pratiques quotidiennes.
Appendices
Annexe
Liste des personnes enquêtées
Notes
-
[1]
Nos traductions.
-
[2]
Dans cet article, nous suivons l’usage de Colette Guillaumin (1972) du terme « racisées » pour parler des chercheuses minoritaires. Nous utilisons le terme plus large de racialisation pour parler des processus et des organisations sociales (voir sur ces distinctions Doytcheva et Gastaut, 2022).
-
[3]
Nous faisons ici le choix de privilégier les travaux fondateurs de Scott dans la mesure où nous souhaitons prêter attention à l’acte quotidien de résistance tel qu’il se donne à voir en particulier dans les espaces organisationnels de la vie académique. D’autres cadres conceptuels de la résistance élaborés dans une perspective postcoloniale mériteraient toutefois d’être rappelés, dont ceux proposés par Stuart Hall (2006), Frantz Fanon (1961) ou Homi Bhabha (1994).
-
[4]
Notre conception de l’intersectionnalité suit celle du féminisme noir et postcolonial, à savoir un cadre d’analyse qui cible la manière dont de multiples identités (de race, de classe, de genre, de sexualité, de capacité) interagissent pour créer des systèmes complexes et uniques de privilège et d’oppression (Crenshaw, 1991 ; Bilge, 2010 ; Collins, 2015). L’intersectionnalité souligne que ces identités ne sont pas séparées ou seulement additives, mais au contraire s’imbriquent pour façonner les expériences vécues et les réalités sociales, tant sur le plan micro que macrosociologique.
Bibliographie
- Acker, J. (2009). From Glass Ceiling to Inequality Regimes. Sociologie du travail, 51(2), 199-217. https://doi.org/10.1016/j.soctra.2009.03.004
- Acker, S. et Armenti, C. (2004). Sleepless in Academia. Gender and Education, 16(1), 3-24. https://doi.org/10.1080/0954025032000170309
- Ahmed, S. (2000). Strange Encounters. Embodies Others in Post-Coloniality. Routledge.
- Ahmed, S. (2007). A Phenomenology of Whiteness. Feminist Theory, 8(2), 149-168. https://doi.org/10.1177/1464700107078139
- Ahmed, S. (2021). Complaint ! Duke University Press.
- Anitha, S., Susan M. et Lewis, R. (2020). Feminist Responses to Sexual Harassment in Academia : Voice, solidarity and resistance through online activism. Journal of Gender-Based Violence, 4(1), 9-23. https://doi.org/10.1332/239868019X15764492460286
- Bannerji, H., Carty, L., Dehli, K., Heald, S. et McKenna, K. (1991). Unsettling Relations. The University as a Site of Feminist Struggles. South End Press.
- Bayfield, H., Colebrooke, L., Pitt, H., Pugh, R. et Stutter N. (2020). Awesome Women and Bad Feminists : The Role of Online Social Networks and Peer Support for Feminist Practice in Academia. Cultural Geographies, 27(3), 415-435. https://doi.org/10.1177/1474474019890321
- Bell, E., Meriläinen, S., Taylor, S. et Tienari, J. (2019). Time’s up ! Feminist Theory and Activism Meets Organization Studies. Human Relations, 72(1), 4-22. https://doi.org/10.1177/0018726718790067
- Bell, M. P., Berry, D., Leopold, J. et Nkomo, S. (2021). Making Black Lives Matter in Academia : A Black feminist call for collective action against anti‐blackness in the academy. Gender, Work & Organization, 28(S1) : 39-57. https://doi.org/10.1111/gwao.12555
- Benschop, Y. et Verloo, M. (2012). Gender Change, Organizational Change, and Gender Equality Strategy. Dans D. Knights, E. Jeanes et P. Yancey-Martin (dir.), Handbook of Gender, Work & Organization (p. 277-290). John Wiley.
- Bhabha, H. (1994). The Location of Culture. Routledge.
- Bhopal, K. (2015). The Experiences of Black and Minority Ethnic Academics : A Comparative Study of the Unequal Academy. Routledge.
- Bourabain, D. (2020). Everyday Sexism and Racism in the Ivory Tower : The Experiences of Early Career Researchers on the Intersection of Gender and Ethnicity in the Academic Workplace. Gender, Work & Organization, 28(1), 248-267. https://doi.org/10.1111/gwao.12549
- Bourabain, D. (2022). Everyday Sexism and Racism in the Ivory Tower. The Struggles and Resistance of Women Early Career Researchers in Belgium. VUBPRESS.
- Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press.
- Bowleg, L. (2008). When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman : The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersectionality Research. Sex Roles, 59(5-6), 312-325. https://doi.org/10.1007/s11199-008-9400-z
- Braun, V. et Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
- Certeau, M. de (1990). L’invention du quotidien. I. Arts de faire. Gallimard.
- Clavero, S. et Galligan, Y. (2021). Delivering Gender Justice in Academia through Gender Equality Plans ? Normative and Practical Challenges. Gender, Work & Organization, 28(3), 1115-1132. https://doi.org/10.1111/gwao.12658
- Coleman, L. et Tucker, K. (2011). Between Discipline and Dissent : Situated Resistance and Global Order. Globalization, 8(4), 397-410. https://doi.org/10.1080/14747731.2011.585823
- Collins, P. et Sirma, B. (2016). Intersectionality. Polity Press.
- Contu, A. (2008). Decaf Resistance : On Misbehavior, Cynicism, and Desire in Liberal Workplaces. Management Communication Quarterly, 21(3), 364-379. https://doi.org/10.1177/0893318907310941
- Contu, A. (2020). Answering the Crisis with Intellectual Activism : Making a difference as business schools scholars. Human Relations, 73(5), 737-757. https://doi.org/10.1177/0018726719827366
- Crimmins, G. (2019). A Structural Account of Inequality in the International Academy : Why Resistance to Sexism Remains Urgent. Dans G. Crimmins (dir.), Strategies for Resisting Sexism in the Academy. Higher Education, Gender and Intersectionality (p. 3-16). Palgrave Macmillan.
- Dijk, A. van (1995). Communicating Racism : Ethnic Prejudice in Thought and Talk. 6. print. Sage Publications.
- Doytcheva, M. et Gastaut, Y. (2022). Race, Racismes, Racialisations : enjeux conceptuels et méthodologiques, perspectives critiques. Émulations. Revue de sciences sociales, (42), 7-30.
- Essanhaji, Z. et Van Reekum, R. (2022). Following Diversity through the University : On Knowing and Embodying a Problem. The Sociological Review, 70(5), 882-900. https://doi.org/10.1177/00380261221083452
- Essed, P. (1991). Understanding Everyday Racism : An Interdisciplinary Theory. Sage Publications.
- Essed, P. (2002). Everyday Racism : A New Approach to the Study of Racism. Dans D. Goldberg et P. Essed (dir.), Race Critical Theories. Text and Context, 176-194. Blackwell Publishers.
- European Commission (2021). She Figures 2021 : Gender in Research and Innovation : Statistics and Indicators. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2777/06090.
- Fanon, F. (1961). Les damnés de la terre. Maspero.
- Fleming, P. et Spicer, A. (2008). Beyond Power and Resistance : New Approaches to Organizational Politics. Management Communication Quarterly, 21(3), 301-309. https://doi.org/10.1177/0893318907309928
- Foucault, M. (1977). Discipline and Punish : The Birth of the Prison. Penguin.
- Guillaumin, C. (1972). L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel. Mouton.
- Gurrieri, L., Prothero, A., Bettany, S., Dobscha, S., Drenten, J., Ferguson, S., Finkelstein, S., McVey, L., Ouarahmoune, N., Steinfield, L. et Tuncay Zayer, L. (2022). Feminist Academic Organizations : Challenging Sexism through Collective Mobilizing across Research, Support, and Advocacy. Gender, Work & Organization, 31(5), 2158-2179. https://doi.org/10.1111/gwao.12912
- Hall, S. (2006). Cultural studies and its theoretical legacies. Routledge.
- Hibou, B. (2011). Anatomie politique de la domination. La Découverte.
- hooks, b. (1989). Choosing the Margin as a Space of Radical Openness. The Journal of Cinema and Media, (36), 15-23.
- Irigaray, L. (1991). The Poverty of Psychoanalysis. Dans M. Whitford (dir.), The Irigaray Reader (p. 79-104). Basil Blackwell.
- Johansson, A. et Vinthagen, S. (2016). Dimensions of Everyday Resistance : An Analytical Framework. Critical Sociology, 42(3), 417-435. https://doi.org/10.1177/0896920514524604
- Kohli, R. et Solórzano, D. (2012). Teachers, Please Learn Our Names ! : Racial Microagressions and the K-12 Classroom. Race Ethnicity and Education, 15(4), 441-462. https://doi.org/10.1080/13613324.2012.674026
- Lewis, R., Sharp, E., Remnant, J. et Redpath, R. (2015). ‘Safe Spaces’ : Experiences of Feminist Women-Only Space. Sociological Research Online, 20(4), 105-118. https://doi.org/10.5153/sro.3781
- Lima, J., Casa Nova, S. et De Oliveira Vendramin, E. (2023). Sexist Academic Socialization and Feminist Resistance : (De)Constructing Women’s (Dis)Placement in Brazilian Accounting Academia. Critical Perspectives on Accounting, 99, Article 102600. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2023.102600
- Mbembe, A. (2001). On the Postcolony. University of California Press.
- Meyerson, D. et Scully, A. (1995). Crossroads Tempered Radicalism and the Politics of Ambivalence and Change. Organization Science, 6(5), 585-600. https://doi.org/10.1287/orsc.6.5.585
- Morley, L. (1994). Glass Ceiling or Iron Cage : Women in UK Academia. Gender, Work & Organization, 1(4), 194-204. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.1994.tb00018.x
- Parsons, E. et Priola, V. (2013). Agents for Change and Changed Agents : The Micro-Politics of Change and Feminism in the Academy. Gender, Work & Organization, 20(5), 580-598. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2012.00605.x
- Prichard, C. et Benschop, Y. (2018). It’s Time for Acting Up ! Organization, 25(1), 98-105. https://doi.org/10.1177/1350508417741501
- Puwar, N. (2004a). Space Invaders : Race, Gender, and Bodies Out of Place. Berg Publishers.
- Puwar, N. (2004b). Thinking About Making a Difference. The British Journal of Politics and International Relations, 6(1), 65-80. https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2004.00127.x
- Raffnsøe, S., Mennicken, A. et Miller, P. (2019). The Foucault Effect in Organization Studies. Organization Studies, 40(2), 155-182. https://doi.org/10.1177/0170840617745110.
- Ray, V. (2019). A Theory of Racialized Organizations. American Sociological Review, 84(1), 26-53. https://doi.org/10.1177/0003122418822335
- Rydzik, A. et Sundari, A. (2020). Conceptualising the Agency of Migrant Women Workers : Resilience, Reworking and Resistance. Work, Employment and Society, 34(5), 883-899. https://doi.org/10.1177/0950017019881939
- Salmon, U. (2022). ‘It’s Wicked Hard to Fight Covert Racism’ : The Case of Microaggressions in Science Research Organizations. Gender, Work & Organization, 31(3), 727-748. https://doi.org/10.1111/gwao.12934
- Salmonsson, L. (2021). Social Media as a Tool for Shaping a Counter-Public Space in Swedish Academia. Dans Chandra, G. et Erlingsdottir, I. (dir.), Routledge Handbook of the Politics of the #MeToo Movement. Routledge.
- Scarborough, W., Lambouths, D. et Holbrook, A. (2019). Support of Workplace Diversity Policies : The Role of Race, Gender, and Beliefs about Inequality. Social Science Research, 79, 194-210. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.01.002
- Scott, J. (1985). Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press.
- Scott, J. (1989). Everyday Forms of Resistance. The Copenhagen Journal of Asian Studies, 4, 33-62. https://doi.org/10.22439/cjas.v4i1.1765
- Sharp, E. et Messuri, K. (2023). A Reprieve from Academia’s Chilly Climate and Misogyny : The Power of Feminist, Women‐centered Faculty Writing Program. Gender, Work & Organization, 30(4), 1236-1253. https://doi.org/10.1111/gwao.12967
- Sobande, F. et Wells, J. (2023). The Poetic Identity Work and Sisterhood of Black Women Becoming Academics. Gender, Work & Organization, 30(2), 469-484. https://doi.org/10.1111/gwao.12747
- Strauβ, A. et Boncori, I. (2020). Foreign Women in Academia : Double‐strangers between Productivity, Marginalization and Resistance. Gender, Work & Organization, 27(6), 1004-1019. https://doi.org/10.1111/gwao.12432
- Unicef Office of Research (2018). An Unfair Start. Inequality in Children’s Education in Rich Countries. Innocenti Report Card 15. Unicef Office of Research.
- Vallas, S. et Courpasson, D. (2016). Resistance Studies : An Introduction. In The SAGE Handbook of Resistance, 1-28. SAGE Publications Ltd.
- Wasserman, V. et Frenkel, M. (2015). Spatial Work in Between Glass Ceilings and Glass Walls : Gender-Class Intersectionality and Organizational Aesthetics. Organization Studies, 36(11), 1485-1505. https://doi.org/10.1177/0170840615593583
- Ybema, S. et Horvers, M. (2017). Resistance Through Compliance : The Strategic and Subversive Potential of Frontstage and Backstage Resistance. Organization Studies, 38(9), 1233-1251. https://doi.org/10.1177/0170840617709305
- Young, S. et Wiley, K. (2022). Erased : Ending Faculty Sexual Misconduct in Academia an Open Letter from Women of Public Affairs Education. Public Policy and Administration, 37(3), 255-260. https://doi.org/10.1177/09520767211015408