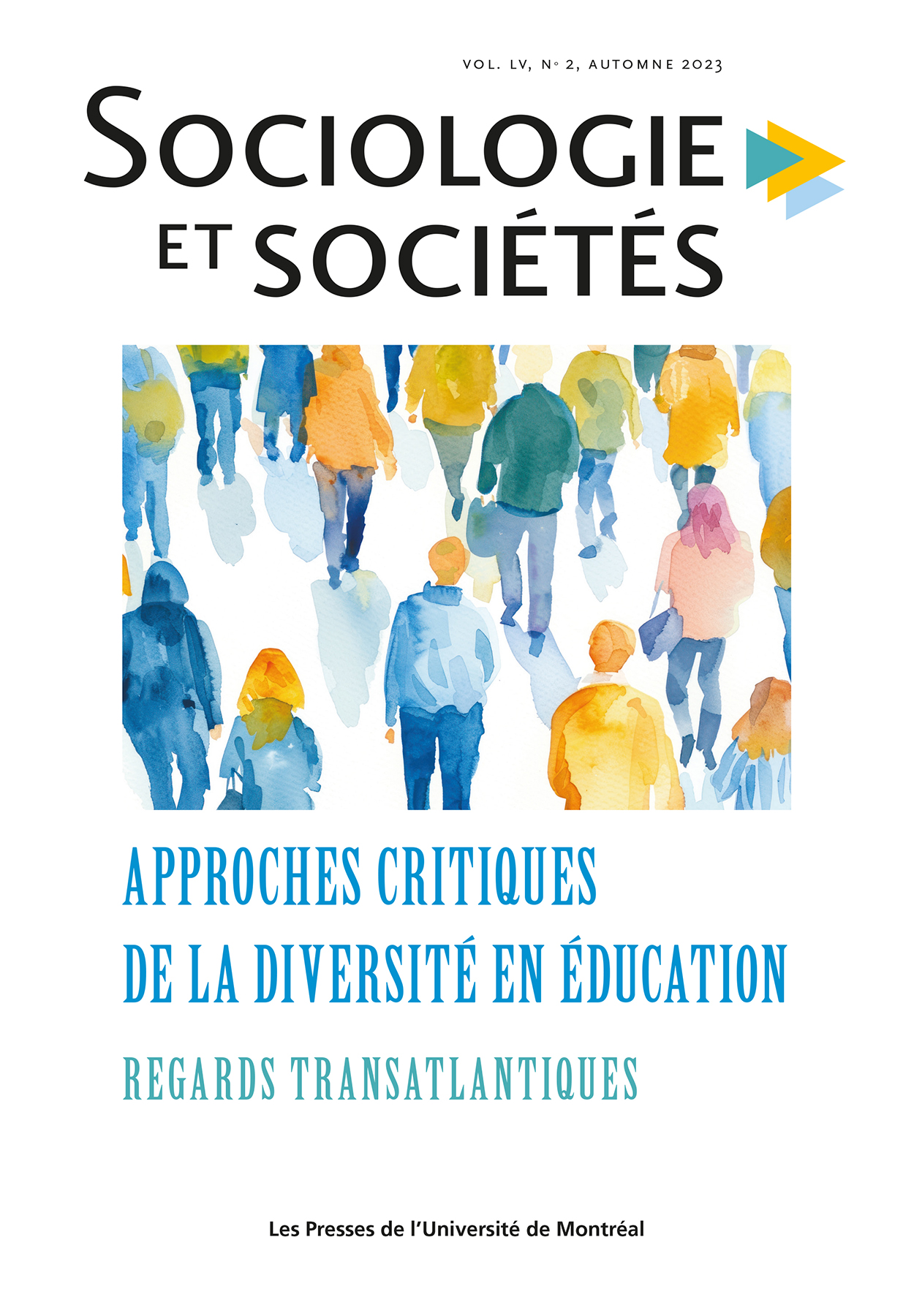Abstracts
Résumé
Faisant fond sur les perspectives singulières de femmes noires, de couleur ou autochtones, ainsi que sur les recherches de personnes queers de couleur, ce chapitre examine la manière dont les champs des savoirs minoritaires et les personnes qui en sont à l’origine réagissent aux interpellations néolibérales du monde universitaire occidental, notamment à cette nouvelle appétence pour la différence — réduite à une forme de diversité anodine, porteuse de phénomènes toxiques. Cette réflexion s’appuie sur une vision du néolibéralisme comme un vaste projet éducatif ou une pédagogie sociale visant à remodeler la société, y compris nos subjectivités, à l’image de ses propres principes de rationalité et de relationnalité marchandes, une entreprise qui s’étend en absorbant et en neutralisant, dans une certaine mesure, ses propres critiques, notamment celles émanant des projets de savoirs minoritaires et des personnes qui les ont créés. Son intention : participer à l’essor d’une littérature savante consacrée à la définition collective d’autres possibles, d’autres formes de relationnalité et de contre-institutionnalité dans l’université blanche néolibérale.
Mots-clés :
- université,
- néolibéralisme,
- interpellation,
- savoirs/subjectivités minorisé·e·s,
- politiques de diversité (ÉDI)
Abstract
Following the unique insights from Black, women of colour and Indigenous feminist writings, along with queer of colour scholarship, this chapter interrogates the ways in which minority knowledge fields and producers respond to the neoliberal interpellations of the western university, particularly to its newfound fondness for difference reduced to benign diversity that opens up toxic opportunities for them. Building on an understanding of neoliberalism as a vast educational project or social pedagogy that strives to remodel society, including our subjectivities, to its own image of market rationality and relationality — a project expanding itself by successfully absorbing and neutralising, to some extent, its own critiques, among them minority knowledge projects and producers — this intervention hopes to contribute to the growing literature on envisioning collectively other possibilities, alternative forms of relationality and counter-institutionality within the neoliberal white settler university.
Keywords:
- University,
- neoliberalism,
- interpellation,
- minorized knowledge/subjectivities,
- diversity policies (EDI)
Resumen
A partir de las perspectivas únicas de los escritos feministas de mujeres negras, de color e indígenas, junto con los estudios académicos de personas queer de color, el presente capítulo cuestiona las formas en que los campos de conocimiento minoritarios y quienes los generan responden a las interpelaciones neoliberales de las universidades occidentales, en particular a su nueva afición por la diferencia, que se ve reducida a una diversidad inofensiva que genera oportunidades tóxicas para ellos. Con base en la idea de que el neoliberalismo es un vasto proyecto educativo o de pedagogía social que pretende remodelar la sociedad, incluidas nuestras subjetividades, a su propia imagen de racionalidad y relacionalidad de mercado —un proyecto que se expande absorbiendo y neutralizando satisfactoriamente, hasta cierto punto, sus propias críticas, entre ellas los proyectos de conocimiento minoritarios y quienes los generan—, el trabajo busca contribuir a la literatura, cada vez más abundante, sobre la concepción colectiva de otras posibilidades, es decir, formas alternativas de relacionalidad y contrainstitucionalidad dentro de la universidad neoliberal de colonos blancos.
Palabras clave:
- universidad,
- neoliberalismo,
- cuestionamiento,
- saberes/subjetividades minorizadas,
- políticas de diversidad (EDI)
Article body
avant-propos
L’assaut virulent de l’administration Trump à l’encontre des programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) va-t-il rendre toute critique de leur cooptation néolibérale et de leur capture par les élites — ainsi que, plus globalement, des politiques d’identité (identity politics) — obsolète ou malvenue ? Assiste-t-on à l’émergence d’un quasi-consensus progressiste selon lequel l’heure ne serait plus à la critique, mais à la défense inconditionnelle de ces programmes ? Les premiers signaux semblent aller dans ce sens : ceux qui, hier encore, en pointaient les limites, se muent aujourd’hui en leurs défenseurs.
Je m’inscris en faux avec cette perspective et soutiens au contraire que le contexte actuel rend plus urgentes que jamais des critiques constructives à visée radicale — au sens d’un retour aux racines des problèmes — qui ne sauraient être confondues avec le démantèlement[2] et la chasse aux sorcières[3] orchestrés par le nouveau gouvernement républicain. Plus que jamais, il est essentiel de démasquer le jeu du « good cop, bad cop » auquel se livrent depuis plusieurs décennies les Démocrates et les Républicains, les deux piliers du duopole politique étatsunien. Ce spectacle des soi-disant « guerres culturelles » constitue un rouage clé du consentement et de l’hégémonie, dissimulant habilement le fait que ces deux camps sont en réalité les deux faces d’une même médaille.
Les effets de cette croisade anti-DEI ne manqueront pas de renforcer des tendances similaires déjà présentes au Canada. Le 2 janvier, University of Alberta est devenue la première institution canadienne à annoncer publiquement sa transition de l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) vers un nouveau cadre baptisé « l’accès, la communauté et l’appartenance » (ACB)[4]. Si la direction de l’université présente ce virage comme une vision plus authentique et moins polarisante, ses détracteurs y voient une tentative de complaire à un gouvernement provincial hostile aux initiatives EDI dans le secteur public. Plus problématique encore, l’administration universitaire cherche à masquer les véritables raisons de ce changement en s’appuyant sur des critiques légitimes de l’EDI, notamment sa dérive vers un exercice symbolique dénué de portée réelle ou réduit à une simple conformité bureaucratique. Dans cette province dirigée par le Parti conservateur uni (UCP), où le climat politique autour de l’EDI est déjà tendu, la situation risque de s’envenimer sous l’effet des récents décrets exécutifs de Trump. Les craintes de voir le gouvernement albertain suivre une trajectoire similaire sont fondées : il a proposé un projet de loi qui lui donnerait le pouvoir de veto sur le financement fédéral de la recherche, un financement qui, selon la première ministre albertaine, favoriserait des projets idéologiquement orientés à gauche. De plus, lors de son congrès général en novembre 2024, le UCP a adopté à l’unanimité une motion visant à éliminer les programmes EDI dans la fonction publique et à mettre fin à l’utilisation de fonds publics pour soutenir la formation à l’EDI[5].
* * *
Le titre original en anglais[6] de mon intervention renvoie à une maxime contemporaine : « si on n’est pas à table, on est au menu[7] ». Ce mantra libéral inclusif affirme qu’un siège à la table des négociations assurerait l’autoreprésentation, menant aux jours meilleurs ou du moins à ne pas se faire dévorer tout cru. Permettez-moi de ne pas être d’accord avec ces promesses et de postuler au contraire que si nous siégeons désormais à la table des négo, nous n’avons jamais cessé de figurer au menu — ce qui revient à dire que nous (enseignat·e·s-chercheur·se·s racisé·es oeuvrant en un milieu universitaire occidental) sommes en train de nous manger nous-mêmes. Je développe, dans cet article, la question de « qui/qu’est-ce qui est mangé par qui, et dans quel but » sous le terme de « diversité comme appât » qui a double sens : l’université contemporaine se sert de la diversité tant pour appâter des chercheur·euses dont la tâche consistera à incarner ce modèle au sein de son projet hégémonique que pour utiliser ces « universitaires de la diversité » comme « appât » afin d’attirer de nouvelles « clientèles » (populations étudiantes) qui, à leur tour, deviendront les nouvelles générations d’expert·es chargé·es de gouverner la différence pour l’État et le capital. Étant donné qu’un appât est normalement destiné à être mangé par autrui, on pourrait se demander pourquoi j’ai fait allusion à l’idée de nous manger nous-mêmes, ou d’auto-cannibalisme. Poursuivons.
Au milieu des années 1990, période d’ascension du multiculturalisme (néo)libéral en enseignement supérieur au Canada, Himani Bannerji, universitaire bengalo-canadienne féministe, marxiste et antiraciste, livre un témoignage poignant sur la violence d’être inclus·e dans une institution blanche. Elle commence par se définir comme « sans doute l’une des plus anciennes enseignantes non blanches du monde universitaire ontarien », qui par ailleurs enseigne dans un champ (genre, race et classe) tant idolâtré que marginalisé, et dont le nom est même associé à une doctrine dans le champ des théories féministes (Bannerji, 1995, p. 97), avant d’avancer que « [l]es relations sociales qui régissent l’enseignement et l’apprentissage relèvent de la violence pour nous qui ne sommes pas blanches et qui donnons des cours sur “le genre, la race et la classe” à une population étudiante “blanche”, au sein d’une université “blanche” » (Bannerji, 1995, p. 102). Face au regard blanc qui impose un sens à son corps menu de femme de couleur, elle interpelle son auditoire pour occuper l’espace d’autorité que lui confère son titre de professeure vis-à-vis d’une population étudiante à majorité blanche et pour enseigner des sujets controversés, à savoir le colonialisme, le racisme, le patriarcat et le capitalisme. Pour supporter cette violence, elle se dissocie de sa propre corporéité tout en la mettant en scène comme outil d’enseignement à partir de ce que j’appelle une « pédagogie auto-cannibalisante ».
[L]orsque, dans mes cours, je parle de la place des « corps » dans l’histoire, dans l’organisation sociale des relations et des espaces, de la manière dont le regard du pouvoir les construit, c’est mon propre corps que je projette sur le devant de la scène à travers mes mots. Je l’écris et l’inscris, au lieu de l’effacer. Il faut d’abord que j’attire leur attention sur mon corps, que je les fasse me fixer le regard avant de devenir une construction mentale. Je m’empare ensuite de cette construction de femme « sud-asiatique » et la démolis petit à petit. Dans tous les sens du terme, mon corps leur sert de support pédagogique. Je suis l’enseignante, je leur offre mon corps comme outil pédagogique ; la salle se fait arène, scène, amphithéâtre, je suis actrice dans un théâtre de cruauté…
Bannerji, 1995, p. 101-102
En se servant de son corps pour appâter son public, Bannerji défie le regard racialisant ; son corps se transforme en réceptacle vide, porteur d’une construction infligée, d’un stéréotype. Pour faire se retourner les stéréotypes et les regards contre eux-mêmes, elle utilise alors son corps comme principal site de représentation. Il s’agit d’un exercice violent, qui implique un démembrement.
Je me dissocie de ma propre présence dans la salle. Mais je signifie, je symbolise, j’incarne une construction qui me sert d’outil pédagogique. […] c’est ce corps ainsi que des siècles de « conscience » du racisme existentiel et historique, qui constituent ma présence et mes outils « pédagogiques ». […] J’offre, petit à petit, mon expérience, mon corps, mon intellect en pâture au profit des apprenant·es. Pour ne pas succomber à la violence des relations sociales qui régissent le quotidien d’une femme sud-asiatique non blanche dans une salle de cours blanche, en Ontario, au Canada, il faut que je me dissocie.
Bannerji, 1995, p. 102-103
Cependant, soumettre violemment le soi à la gouvernementalité racialisée du monde universitaire blanc est également un processus de subjectivation. La manière dont Bannerji raconte la lente sublimation de sa colère, qu’elle transforme en objet de recherche et d’enseignement par et à travers des actions institutionnelles (notamment endiguement et officialisation), convoque la relation entre assujettissement et subjectivation établie par Foucault, autrement dit le lien constitutif entre le processus de subordination par le pouvoir et celui de production du sujet. La pédagogie auto-cannibalisante de Bannerji représente sa manière à elle de construire, à partir d’un statut d’objet, le sujet, un sujet subversif et contestataire. Il s’agit d’un « choix » posé à partir de circonstances non choisies, pour reprendre la pensée de Marx, mais qui n’en contribue pas moins à ses aspirations à la liberté.
On peut cependant appréhender ma détresse et ma dissociation d’une autre manière. Il ne s’agit pas seulement de la peur du regard, de ma présence dans ce théâtre de cruauté, du sacrifice de mon corps sur l’autel d’un dieu de la pédagogie blanc. Je suis un objet. Mais je suis également un sujet. Ma dissociation tient beaucoup de ce fait. Rien que le choix pédagogique d’enseigner, dans ce pays, des matières que je tiens absolument à enseigner participe de ma propre décolonisation et de celle d’autrui, de mon besoin viscéral de lutter contre le racisme impérialiste et patriarcal.
Bannerji, 1995, p. 104
En choisissant ce parcours pédagogique, j’ai conscience de me faire violence. […] Et pourtant, je choisis de m’imposer cette violence. Parce que j’ai fait le choix de décoloniser, d’enseigner l’antiracisme, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Cette colère lente, longue, prolongée qui prend la forme d’une méthode, d’une approche, de théories, de situations, d’économie politique et d’histoire ; toutes ces heures de cours magistraux, d’examens et de travaux universitaires représentent ma spontanéité, ma colère, officialisée, élargie et contenue, occasionnée et entravée par les règlements d’une université blanche. Une subversion, une protestation, pas encore révolutionnaires, ou qui ne le seront peut-être jamais. Mais c’est un courant qui suit son cours, un petit affluent qui viendra alimenter mon rêve — une véritable révolution socialiste, féministe, antiraciste, marxiste et anti-impérialiste. […] La médiation de ma colère me coupe en deux. Mais ici, dans mon travail concret et immédiat d’enseignante, je ne suis pas silencieuse. C’est déjà ça.
Bannerji, 1995, p. 105-106
L’auto-analyse incarnée de Bannerji offre un ancrage précieux à mon argumentation. En effet, je fais valoir que les personnes racisées sont interpellées de manière différente dans l’université néolibérale blanche, en particulier lorsqu’elles sont embauchées pour travailler sur la race et qu’elles ont pour mission d’incarner la diversité. Représenter la « diversité » peut être épuisant, souligne Sara Ahmed (2009) ; notre arrivée fait office de preuve selon laquelle l’université est arrivée à se défaire de la blanchité. Dans une certaine mesure, notre présence au sein de l’institution vient saper ce que nous enseignons, puisque nous problématisons « toujours » la suprématie blanche et le racisme institutionnel. Nous sommes donc prisonnier·ères d’une posture intenable : enseigner le racisme à des personnes et dans des établissements qui considèrent que notre simple présence constitue la preuve que le problème a été résolu. Ahmed (2009, p. 41) fait notamment valoir que :
Le tournant vers la diversité repose souvent sur une logique comptable, sur le fait d’être plus nombreux, d’intégrer davantage de personnes racisées pour ajouter de la couleur aux visages blancs des organisations. […] Nous symbolisons l’espoir ou la promesse que la blanchité est en train d’être déconstruite. Notre arrivée est perçue comme une preuve d’engagement, de changement, de progrès. […] Je parle de blanchité dans un séminaire, et quelqu’un dans l’auditoire dit : « mais vous êtes professeure », comme pour dire que si des femmes noires deviennent professeures, alors la blanchité du monde recule. Si seulement nous avions le pouvoir qu’on nous imagine, si seulement notre simple présence pouvait avoir une telle force. […] J’ai été recrutée pour enseigner « le cours sur la race », je réponds. Je suis la seule personne racisée employée à temps plein dans le département. J’hésite. Cela devient trop personnel. L’argument devient trop lourd à porter lorsque votre corps est si exposé, lorsque vous vous sentez si visible. Je m’arrête, et ne termine pas ma réponse à la question. [L’italique est de moi]
Le corps destiné à incarner la diversité est à nouveau surexposé et objectivé. Professeure racisée dans un milieu universitaire blanc, elle se retrouve à nouveau dans la posture intenable de sujet-objet, autrement dit d’être assise à la table des négociations tout en figurant au menu — une posture fabriquée et entretenue par l’appétence du monde universitaire pour la diversité. Cette appétence vient recycler les projets de savoirs minoritaires et les personnes qui les ont créés, afin de renforcer l’hégémonie au sein du néolibéralisme, lequel constitue, selon Ferguson (2008, p. 162), « la toute dernière expression du mouvement de globalisation contemporaine visant à cannibaliser la différence et son potentiel de dissension » [l’italique est de moi].
Ce genre de « cannibalisme » atteint son paroxysme dans la gestion académique du féminisme noir et des chercheuses universitaires féministes noires. Tandis que le monde universitaire néolibéral blanc, à travers ses dispositifs institutionnels, transforme toutes sortes de projets de savoirs minoritaires en ressources extractibles alléchantes pour se donner une image de diversité et de progrès multiculturel, il continue à les marginaliser (Crawley, 2018, p. 10) ; le sort réservé au féminisme noir et aux chercheuses universitaires noires nécessite d’ailleurs une attention toute particulière. Ayant très tôt pris conscience de cette fatale attraction, les chercheuses féministes noires se sont livrées à des interventions critiques. Il y a un quart de siècle, Ann duCille avait dénoncé l’appétence du monde universitaire pour une différence noire exempte de corps noirs — un monde avide « de disposer de cette “différence noire signifiante”, mais sans la différence liée à un nombre significatif de personnes noires » (1994, p. 600). La même année, Barbara Christian émettait la mise en garde suivante : « Si la question du féminisme noir venait à exister dans le monde universitaire sans que les chercheuses noires y jouent un rôle primordial, ce serait une perte incommensurable, une ironie peu banale » (1994, p. 173). Avec le recul, on ne peut qu’admirer la clairvoyance dont ces chercheuses féministes noires ont fait preuve en saisissant les enjeux de la question de l’institutionnalisation des champs des savoirs minoritaires et des personnes qui les ont créés, en particulier la recherche féministe noire. Lors de déclarations prémonitoires, elles ont dressé, comme Grace Hong le souligne, « un portrait saisissant d’un futur sombre et ironique, au sein duquel le monde universitaire s’adonne à la fétichisation du féminisme noir comme domaine de recherche tout en tolérant voire facilitant la violence systémique faite aux femmes noires » (Hong, 2008, p. 96). Cette « double manoeuvre, qui consiste à encenser ces personnes tout en les faisant échouer » (Bilge, 2013) fait partie des interpellations contradictoires et toxiques du monde universitaire néolibéral que Bannerji avait dénoncées dès le départ. Elle avait notamment fait valoir que “son” champ de recherche avait été banalisé et, en même temps, sanctifié comme un mantra ou, peut-être, comme un dispositif hégémonique utilisé pour enseigner une certaine forme de théorie féministe à l’université, à savoir “genre, race et classe”. (Bannerji, 1995, p. 97) [l’italique est de moi]
Si le « féminisme noir a alimenté la théorie culturelle afro-américaine tout en permettant aux études noires de se faire une place dans l’institution universitaire au cours des dernières décennies » (Weheliye, 2014, p. 5), ironiquement, c’est un champ qui continue à subir ce cruel phénomène d’encensement et de mise en échec, à défaut d’être carrément désavoué. Cette mise en échec peut être carrément meurtrière, si l’on en croit la longue liste établie par Grace Hong, qui recense les chercheuses féministes noires ayant connu une fin prématurée dans un milieu universitaire extractiviste marqué par « une haine pathologique des femmes noires » (Walcott, 2018, p. 96). Rinaldo Walcott apporte des preuves accablantes de la discrimination que subissent les femmes noires dans le milieu universitaire canadien :
Dans tous les postes universitaires que j’ai occupés, et ce depuis plus de vingt ans, j’ai été témoin de la manière dont mes collègues réagissaient à la présence des femmes noires. Presque à chaque fois qu’une femme noire était mentionnée, on essayait de passer à autre chose, de la délégitimer ou de carrément l’ignorer. Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher sur la réception de la politique féministe noire par l’État et l’institution universitaire. En effet, de toutes les politiques féministes contemporaines, c’est celle qui a subi les critiques les plus sévères. Cet acharnement met au jour ce que masque le mouvement de diversité et d’inclusion, c’est-à-dire une forme de violence permanente destinée à intégrer quelques personnes au détriment du groupe.
Walcott, 2018, p. 96
En m’appuyant sur les perspectives singulières de femmes noires, de couleur ou autochtones, ainsi que sur les recherches de personnes queers de couleur, je cherche à comprendre dans quelle mesure les champs des savoirs minoritaires et les personnes qui en sont à l’origine réagissent aux interpellations néolibérales du monde universitaire occidental, notamment à cette nouvelle appétence pour la différence — porteuse de phénomènes toxiques. Cet article vise à participer à l’essor d’une littérature savante consacrée à la définition collective d’autres possibles, d’autres formes de relationnalité et de contre-institutionnalité dans l’université blanche néolibérale. Je commencerai par situer ma prise de parole.
En mettant au jour les mécanismes du pouvoir relatifs à l’incorporation des savoirs minoritaires et des personnes qui en sont à l’origine, notamment nos multiples implications dans ces processus (en tant que chercheur·se·s du domaine qui extraient continuellement des connaissances de groupes minorisés), j’ancre ma démarche dans le féminisme noir qui, en tant que processus intellectuel, nous rappelle l’importance de toujours situer le lieu social à partir duquel nous formulons questions et critiques (Cooper, 2017). Cette démarche exige une prise de conscience de ma propre participation aux phénomènes que je critique et de ma propre posture vis-à-vis des rouages du pouvoir de l’université néolibérale, ainsi que de mon positionnement sous-jacent, forgé par et à travers ces postures structurelles. Je suis une immigrante de couleur, une chercheuse de première génération qui bénéficie des privilèges structurels liés au titre de professeure titulaire, qui passe presque pour blanche et qui travaille dans l’une des cinq premières universités de recherche au Canada. Je travaille sur les savoirs minoritaires, lesquels sont organisés en sous-champs au sein de la structure disciplinaire d’un département de sociologie d’une université francophone — département dont j’ai été pendant 14 ans (jusqu’en juin 2019) la seule professeure à temps plein d’origine non européenne, la seule personne non blanche. Toutefois, il est important de faire remarquer que, dans ma société d’origine, la Turquie, je n’ai pas grandi en tant qu’autre ethnique ou racisée. Aux États-Unis, souligne Frankenberg lors de son échange avec Lata Mani, il convient de prendre en compte « la différence fondamentale, en matière de parcours, entre celles d’entre nous qui sont issues du tiers monde géographique et celles qui sont devenues adultes en tant que personnes de couleur en Occident » (1993), et ce, afin d’éviter les amalgames problématiques entre groupes
dont les relations vis-à-vis de la structure de pouvoir du pays sont extrêmement différentes. Nous devons être sur nos gardes, dans la mesure où les programmes d’affirmation positive ou de diversité peuvent éventuellement se traduire par des embauches de personnes formées ailleurs, à l’instar de ce que l’on voit dans le monde des affaires.
Frankenberg et Mani, 1993, p. 297
Par ailleurs, en donnant des cours aux premier et second cycles sur la race et les relations ethniques, le genre et les sexualités, l’intersectionnalité ainsi que les approches postcoloniales et décoloniales, je suis incontestablement une agente de l’incorporation universitaire de ces champs de savoirs minoritaires, doublement au service de l’institution : d’une part comme personne incarnant la diversité — une personne « de la diversité » comme on nous appelle ici, au Québec — et d’autre part qui enseigne et fait des recherches sur ces sujets-« objets ».
politique des savoirs minoritaires
Le mot minorité sous-entendu dans savoirs minoritaires ne doit pas être interprété au sens statistique du terme (autrement dit au sens de « moins nombreux »), mais dans son acception sociologique, c’est-à-dire disposant de moins de pouvoir, minorisé. Les champs des savoirs minoritaires sont des domaines de recherche issus des mouvements d’émancipation sociale des années 1950 et 1960. Ils ont fait leur apparition dans l’université occidentale à la suite de discussions et de compromis institutionnels qui sous-entendent des mesures d’encadrement et de gouvernance de la dissidence. Comme le rappelle Ferguson (2008, p. 163), le début de ce mouvement, « qui remonte à la fin des années 1960, marque l’avènement de transformations profondes au sein des institutions modernes en Occident. Le pouvoir administratif avait dû limiter les objectifs collectifs, oppositionnels et redistributifs de la différence », tout en faisant valoir cette différence comme gage de progrès institutionnel. Selon Ferguson, cette validation constitue non seulement une incitation, mais également une forme d’assujettissement qui masque certaines formes de différence tout en en faisant valoir d’autres. L’intégration de ces différences sous-entend une évaluation toute mathématique de leur potentiel de transformation et de rupture. Ferguson, en appelant « cette incorporation des modes de différences et ce calcul destiné à évaluer leurs propriétés et leurs fonctions » volonté d’institutionnalisation, souligne dans quelle mesure ce phénomène n’équivaut pas seulement à l’absorption des institutions et des sujets modernes, mais représente également un mode d’assujettissement en soi (Ferguson, 2008).
Dès le départ, il y a tension entre déstabilisation et stabilisation, entre le désir de démanteler les structures dominantes de la production de savoir au sein de l’université, lesquelles réduisent les minorités à des « objets d’étude » tout en les subjuguant et les dominant, et l’incitation à se conformer à des conventions et des normes établies au sein d’une discipline, à « prendre sa place » pour devenir une science à part entière — ce qui sous-entend de tourner le dos à toute dimension politique. Ce phénomène a engendré un problème de taille, car ces initiatives de savoirs oppositionnels n’ont jamais cherché à « simplement proposer une vérité supérieure », mais ont toujours comporté « une critique immanente du savoir-pouvoir et de la disciplinarisation » qui vise à déstabiliser « la machine du savoir au sein même des institutions du savoir » (Ferguson, 2015, p. 45). La déstabilisation interne est tout sauf facile. Plusieurs dizaines d’années après l’apparition de projets de savoirs minoritaires et l’arrivée de professeur·es racisé·es à l’université, ces objectifs n’ont toujours pas été atteints. Ces projets font souvent face à un dilemme : d’une part,
se conformer aux missions néolibérales de l’institution universitaire, qui sous-entend notamment la prolifération de « différences » marchandisées et domestiquées, lesquelles mettent en scène le labeur matériel et idéologique alimentant les préceptes du capitalisme tardif, tels que « la diversité et l’excellence » et « citoyen·nes du monde » ; d’autre part, être vulnérabilisés et, à intervalles réguliers, menacés d’éradication au sein d’une structure universitaire qui cède à la pression d’une gestion capitaliste tout en éprouvant des difficultés financières
Elia et al., 2016, p. 2-3
Si, sur le plan institutionnel, « les études minoritaires ont forcément été constituées par tout ce qui avait été exclu du canon et des champs classiques des disciplines, comme s’il s’était agi d’une arrière-pensée, si tant est qu’il y ait eu pensée », comme le soutiennent Alcoff et Mohanty, leur réception au sein de l’université a été tout aussi discréditée : « ces savoirs sont doublement dévalorisés ou minorisés. Ils sont associés à des chercheur·euse·s qui subissent une discrimination intellectuelle […] et on les attaque sous prétexte qu’ils ne répondent pas au modèle de désintéressement prôné par l’université » (Alcoff et Mohanty, 2006, p. 7-8). On peut établir un parallèle entre savoirs minoritaires et la notion foucaldienne de « savoirs assujettis », que Foucault entend comme « toute une série de savoirs qui se trouvaient disqualifiés comme savoirs non conceptuels, comme savoirs insuffisamment élaborés : savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement inférieurs, savoirs en dessous du niveau de la connaissance ou de la scientificité requises » (1976/2003, p. 7). N’oublions pas que, pour Foucault, la généalogie constituait une entreprise chargée de « désassujettir les savoirs historiques […] pour les rendre capables d’opposition et de lutte contre la coercition d’un discours théorique unitaire, formel et scientifique » (1976/2003, p. 11), ce qui montre bien à quel point il est illusoire de penser que l’on peut désassujettir ces savoirs au moyen de paradigmes dominants. En effet, l’un des principaux enjeux de leur apparition à l’université tournait autour de questions du « savoir collectif de personnes marginales et de la réhabilitation de versions différentes, discordantes, de l’histoire des dominations et des luttes » (Mohanty, 1990, p. 184). Le pouvoir de l’autodéfinition figurait au coeur des débats sur la production et la légitimation des savoirs, en particulier « de projets pédagogiques dans des domaines tels que les études des femmes, les études noires et les études ethniques » (Mohanty, 1990, p. 184). Les questions d’autoreprésentation et d’autodéfinition et celle de leur mise en oeuvre figuraient donc au premier plan des luttes menées pour faire entrer les cursus de savoirs minoritaires à l’université, comme en témoigne la fréquence de termes tels que « appropriation du récit », « agentivité » et « voix ». Toutefois, la politique du savoir qui caractérise ces nouveaux domaines essentiels ne se limite pas à l’autoreprésentation ou l’autodéfinition, puisque celles-ci sous-entendent aussi (idéalement) une critique radicale du savoir à proprement parler, notamment de celui produit au sein de ces nouveaux domaines — c’est-à-dire ce que Cornel West appelle l’auto-inventaire radical de nos propres pratiques universitaires (1987). Celles-ci sont constituées par (et constitutives de) rationalités, techniques et affects gouvernementaux sur lesquels l’université néolibérale est fondée et dont elle dépend. Pour modifier nos comportements et envisager d’autres formes de relations, il convient de bien évaluer notre propre participation au maintien de ces mécanismes hégémoniques. Il s’agit d’un enjeu de taille, rarement atteint dans les formations de savoirs minoritaires, aujourd’hui transformées en disciplines. Ce n’est pourtant pas par manque de connaissance, puisque bon nombre de ces enjeux avaient été clairement définis à la fin des années 1980. Chandra Mohanty a bien saisi le double enjeu critique dont ces nouveaux savoirs « souvent hérétiques » devraient être assortis :
Ce n’est qu’à la fin du vingtième siècle, à la suite d’importants mouvements politiques d’opposition à l’échelle tant locale qu’internationale, que […] de nouveaux espaces d’analyse sont apparus dans les universités et ont permis de penser le savoir comme une praxis, comme le point de départ de la transformation et du changement. L’appropriation de ces espaces et le défi que représente la pratique d’une éducation radicale exigent donc l’élaboration de savoirs critiques (ce à quoi tendent les études féministes, les études noires et les études ethniques) et, parallèlement, la critique du savoir en tant que tel.
Mohanty, 1990, p. 184-185
Mais la politique du savoir associée à ces nouvelles initiatives, notamment les revendications d’autoreprésentation et d’autodéfinition qu’elles comportent, s’est violemment heurtée aux revendications d’objectivité, de distance et de neutralité axiologique qui dominent la plupart des sciences — conflit toujours d’actualité si l’on en croit l’ampleur des mouvements étudiants qui réclament la décolonisation de l’université et de ses programmes à travers le monde, et la manière dont leurs revendications sont balayées, et ce, au nom de la scientificité. Par conséquent, à défaut de transformation radicale, l’inclusivité libérale qui consiste à ajouter des matières à des cadres disciplinaires existants, sans mettre en oeuvre d’épistémologies et de méthodologies transformatrices, est devenue la principale approche en matière d’intégration des savoirs minoritaires. La pression en faveur du « clonage scientifique » ne vient pas seulement de l’université, mais également de l’extérieur. Les attaques constantes, tant de la droite que de la gauche, qui consistent à qualifier de politique identitaire les luttes des minorités et les formations de savoir, ont forcé les chercheur·se·s à s’éloigner de leurs bases « naturelles ». Ces projets ont, dans une large mesure, perdu de leur pertinence vis-à-vis des groupes et des mouvements qu’ils étaient censés représenter ou servir au départ. Partant, leur mission secondaire, à savoir la critique du savoir en tant que tel — le savoir qu’ils et elles produisent — a également été négligée. Qui plus est, suite aux pressions exercées pour forcer ces projets à se conformer à des méthodes scientifiques et à des conventions disciplinaires étroitement définies, beaucoup ont abandonné la coproduction de savoirs en partenariat avec leur communauté ou bien les ont transformés en objets d’étude. Chercher à accroître sa valeur sur le marché universitaire ou à être considéré·e comme un·e scientifique « digne de ce nom » coûte cher aux universitaires minoritaires qui ont gardé des liens avec leur communauté ; en effet, ces personnes courent le risque, bien réel, d’exploiter leur communauté ou de se transformer en courtier·ères ou en commissaires d’affaires ethniques.
Toutefois, il est toujours possible d’opter pour le refus, de refuser institutionnalisation, pouvoir et reconnaissance — autant de vertus associées aux domaines scientifiques. Au lieu de chercher à transformer les savoirs insurgés en disciplines, ne devrions-nous pas plutôt, à l’instar de Foucault ([1976] 2003, p. 10), nous interroger sur « l’ambition de pouvoir qu’emporte avec soi la prétention à être une science » ? Certains champs de savoirs minorisés résistent mieux que d’autres aux chants des sirènes et à la dépolitisation qui en découle ; il nous faut analyser de manière beaucoup plus fine les conditions particulières entourant ceux qui ont réussi. Parfois, la tradition sur laquelle s’appuie (ou est censé s’appuyer) un champ particulier vient renforcer ou alors affaiblir sa capacité de résistance à l’éviscération néolibérale. Par exemple, l’histoire du champ des études ethniques et racial[8] est essentiellement associée à l’establishment sociologique, notamment à l’École de Chicago et aux travaux de Robert Park, plutôt qu’aux mouvements des droits civiques et de libération raciale des années 1950 et 1960. Définir une telle origine, c’est concevoir les études raciales et ethniques comme un sous-champ de la sociologie ou de l’anthropologie, et non comme un projet de savoir contre-hégémonique visant à transformer les conditions et structures de ce qui est considéré comme science. Il en résulte la perpétuation, masquée sous la nouvelle étiquette de champ « progressiste », du regard scientifique classique qui transforme en objet d’étude les groupes altérisés en raison de leur appartenance à un groupe racisé ou ethnique. Cette approche diffère de celle qui sous-tend le mouvement post-insurrectionnel, lequel considère ces groupes comme des sujets connaissants, qui produisent des connaissances valables sur leurs propres communautés, et qui fait valoir la nécessité impérative d’embaucher des universitaires minoritaires dont les liens avec les communautés dont ils et elles sont issu·e·s les habilitent à enseigner et à faire de la recherche. En revanche, l’origine des études noires remonte à la tradition radicale noire et aux mouvements de contestation des personnes noires. Si cette filiation ne les met pas à l’abri d’une assimilation à la diversité néolibérale, elle représente néanmoins la mémoire collective d’une théorie radicale et militante dont se nourrissent les pratiques contemporaines. Comme l’affirme Kelley (2016) :
Les études noires ont non seulement été conçues en dehors du cadre universitaire, mais également en opposition à une culture universitaire eurocentrique liée au monde des affaires et au pouvoir militaire. Les chercheur·se·s contestataires en études noires sont issu·e·s d’un mouvement d’insurrection de masse. Les modèles institutionnels qu’ils et elles ont établis ne dépendaient pas de l’université, même s’ils en faisaient partie. Dans les décennies qui ont suivi, suite aux pressions exercées en faveur du multiculturalisme, ces institutions ont été intégrées — avec plus ou moins d’empressement — à l’université à proprement parler.
Le problème ne tient pas seulement au fait que ces champs, dont la vocation était d’apporter des transformations radicales, ont été vidés de leur substance, mais également au fait que leur intégration confère désormais aux pratiques universitaires courantes et routinières un ton « politiquement engagé ». On en veut pour preuve l’omniprésence persistante du scientisme dans toutes les activités universitaires prétendant remettre en question les hiérarchies du savoir. En voici quelques exemples. Lors d’un récent colloque international sur l’intersectionnalité, une conférencière plénière s’est adressé au public, notamment à bon nombre d’étudiant·e·s du second cycle, en ces termes : « Allez sur le terrain, amusez-vous ! », tandis que l’infâme photo en noir et blanc de Malinowski, celle où il est entièrement vêtu de blanc et se tient debout aux côtés de personnes noires accroupies, à moitié nues, était projetée sur le mur derrière lui. Personne n’a remis en cause son injonction ni le regard colonial déshumanisant dont elle était assortie. Autre lieu, autre colloque international. Lors d’un colloque de sociologie et d’anthropologie sur la remise en question des disciplines et des savoirs, qui s’est tenu en Amérique du Nord en 2017, un conférencier plénier a affirmé que travailler sur sa propre communauté ne relevait pas de l’anthropologie, avant de poursuivre avec le discours éculé de la mise à distance et de l’objectivité. Il s’est ensuite vanté d’avoir refusé de superviser une étudiante de cycle supérieur, d’origine arménienne, qui voulait travailler sur le traumatisme du génocide vécu par sa famille, et de lui avoir conseillé d’aller plutôt faire une thérapie ! Encore une fois, personne n’a rien dit. Les « incidents » de ce type sont trop nombreux pour être tous énumérés ici ; toutefois, la régularité à laquelle ils se produisent et la quasi-absence de remise en question met en lumière l’inertie de nos communautés universitaires — comme si « collectivement, nous (chercheur·se·s de l’université libérale) étions tous et toutes frappé·e·s d’une paralysie de la volonté, et que le système n’avait pas seulement été érigé autour de nous, mais avait fait de nous son propre mur d’enceinte » (Thompson, 1970, p. 303).
Mais comment en arrive-t-on donc à être partie intégrante du mur d’enceinte du système ? On pourrait également se référer non seulement au commentaire incisif de Thompson, mais également à Derrida, qui faisait valoir que notre propre travail intellectuel participe intégralement de l’immuabilité institutionnelle. « L’institution, ce ne sont pas seulement des murs et des murs et des structures extérieures qui entourent, protègent, garantissent ou contraignent la liberté de notre travail, c’est aussi et déjà la structure de notre interprétation » (Derrida, 2004, p. 102). À l’université, nos pratiques, valeurs et relations avec l’institutionnalité — qui ne figurent pas suffisamment dans les questionnements, par ailleurs critiques, de nos champs critiques — s’avèrent en fait résider au coeur du problème. Si les travaux qui dénoncent les effets nocifs de l’institutionnalisation sur les champs de savoirs minorisés ne manquent pas, on manque en revanche de recherches qui examineraient les conditions et structures qui ont permis cette institutionnalisation et en décriraient les conséquences. On a également négligé de décrire les conditions matérielles et symboliques qui forgent et structurent la formation de sens au sein de « nos » champs. Négliger ces questions nous empêche de bien saisir à quel point les paramètres propres à nos champs (notamment la manière dont les connaissances sont produites et dont l’équité et la justice — entre autres — sont interprétées) sont modelés par les techniques, ententes et rationalités qui régissent l’institutionnalisation de nos propres champs et de nos propres personnes — au départ issu·es de mouvements contestataires. Comme le fait valoir Chandan Reddy, « les conditions et structures qui permettent l’institutionnalité [des études ethniques] en viennent à modeler tant le sens donné à l’égalité raciale que son illusion » (2011, p. 30). En fin de compte, ne pas tenir compte de ces éléments équivaut à, comme l’avait souligné Derrida, éclipser le fait que l’institution est aussi et déjà la structure de notre interprétation, que les voies et mécanismes de l’institutionnalisation orientent également la formation de sens au sein des communautés épistémiques porteuses de cette différence minorisée.
la diversité — piège à clics
Il serait à peine exagéré d’affirmer que la façon dont l’université néolibérale s’est emparée de la différence minoritaire, aujourd’hui rebaptisée « diversité » — « notre différence est devenue leur diversité » (Ahmed, 2009, p. 43) —, est sous-tendue par un mobile entrepreneurial ; ce phénomène n’est « ni antiraciste ni redistributif, mais vise à générer une plus-value de la diversité ou à créer un désir pour la plus-value produite par la diversité » (Roediger, 2017). Par ailleurs, comme le font valoir des chercheur·se·s et mouvements étudiants divers, l’intégration limitée d’élites racisées dissimule très bien la domination des masses qui s’opère au nom du multiculturalisme néolibéral et de la suprématie blanche comme système politique sur lequel il repose (Reddy, 2019). En vertu du régime administratif de l’université néolibérale, la « diversité, l’inclusion et le multiculturalisme constituent autant d’éléments plus ou moins manipulés pour ne pas toucher aux logiques raciales » (Crawley, 2018, p. 10) — logiques dont l’agencement disciplinaire est partie intégrante. Bien souvent, nous, chercheur·se·s autochtones, noir·e·s et de couleur, qui travaillons sur les champs de savoirs minoritaires, en venons à représenter la diversité en devenant la paroi corporelle (l’enceinte) de l’université occidentale. Emmuré·es dans la diversité, nous permettons aux murs de l’université d’afficher un visage heureux, aux couleurs de la diversité (Ahmed, 2009). Toutefois, ce processus n’exclut pas la possibilité de répondre à ces interpellations néolibérales de manière déstabilisante au lieu de continuer à renforcer ce projet hégémonique ; en effet, l’hégémonie n’est jamais totale et ses contradictions rendent possible sa propre remise en question. Comme le postule Ferguson,
[é]tant donné que l’université a joué et continue à jouer un rôle déterminant dans l’essentiel de la production de différence minoritaire et de tous ces phénomènes de multiculturalisme libéral et néolibéral, elle devient également un site de lutte et de contestation, un site où la différence minoritaire peut être manipulée à des fins de remise en question des pratiques sociales libérales et néolibérales.
Ferguson, 2015, p. 48
Si la récupération de la diversité par l’université néolibérale se traduit par toutes sortes d’actions — création de programmes de savoirs minoritaires au sein des études ethniques ou des études des femmes et de genre, création de commissions pour mettre en place et suivre les plans d’action institutionnels d’équité, diversité et inclusion (ÉDI), embauche (d’un nombre ridiculement faible) de producteur·trice·s de savoirs minoritaires —, ces actions ne permettent que rarement de transformer réellement la structure de pouvoir de l’université. Là n’est pas leur objectif. Loin de là ! Certain·e·s chercheur·se·s ont abordé ce phénomène sous l’angle de la « marchandisation de la différence ». Cette approche a donné naissance à des prises de position radicales, associant la marchandisation au fait de déposséder radicalement les savoirs insurgés des projets émancipateurs dont ils sont issus. J’ai une posture ambivalente par rapport au concept de marchandisation lorsque celui-ci est utilisé comme principal angle d’analyse, et ce, pour trois raisons : premièrement, la lecture de cooptation (dépossession) hégémonique qui en découle occulte le fait que les redéfinitions hégémoniques constituent des processus instables, assortis de failles et de contradictions, et qui comptent des acteur·rice·s contestataires et subversif·ve·s. Deuxièmement, ce concept véhicule une vision idéalisée des champs de savoirs minoritaires. Ils sont présentés comme des savoirs systématiquement insurgés et même comme des espaces de « parole libre », dénués de rapports de pouvoir. Partant, il vient atténuer l’impératif d’autocritique et brider l’éventail interprétatif de la « coïncidence historique » entre l’essor de ces projets de savoirs et la reconfiguration néolibérale de rapports de pouvoir entre l’État, le capital et le monde universitaire (Hall, 1991 ; Ferguson, 2012). Troisièmement, le concept de marchandisation ne figure plus au coeur du monde capitaliste d’aujourd’hui ; la complexité de la raison néolibérale et les relations ambiguës qu’elle entretient avec la différence ne sauraient être cristallisées ni dans ce seul concept, qui ne rend pas compte de l’ensemble des relations sociales, ni dans l’assimilation du néolibéralisme à la marchandisation impitoyable de la société dans son ensemble (Dardot et Laval, 2013). Bon nombre d’analystes s’accordent à dire que la marchandisation a été remplacée par un autre concept ; pour beaucoup, son successeur serait d’ailleurs le crédit (ou la dette). Ces évolutions et les conséquences qu’elles comportent doivent être prises en compte. Tout d’abord, il y a une différence de taille entre le marché libéral classique et le nouveau marché néolibéral financier. Dans la première optique, les individus sont tous considérés comme ayant potentiellement quelque chose à vendre. Dans la seconde, nous sommes tous et toutes des projets en quête d’investissements (Feher, 2017). On nous incite donc constamment à nous interroger sur notre « valeur de crédit » et à accroître la valeur de notre « capital humain ». Il s’agit là d’un questionnement intéressant, qui invite à réfléchir de manière globale aux subjectivités du monde universitaire néolibéral, notamment aux instances où les personnes de couleur sont interpellé·e·s à titre de diversité. En fin de compte, la manière dont nous sommes interpellé·es comme sujets dans le monde capitaliste néolibéral n’est pas la même que dans le monde capitaliste classique ; cette différence infléchit l’évolution de notre rapport à nos travaux de recherche, aux autres et à nous-mêmes.
À ce titre, la perspective de Dardot et Laval est plus intéressante et plus riche que le paradigme de la marchandisation de la différence. À partir des travaux de Foucault, ils postulent que le néolibéralisme n’est pas seulement une idéologie ou une politique économique, mais constitue avant tout une nouvelle rationalité — une rationalité de gouvernance. Celle-ci utilise la logique de marché en tant que « logique normative généralisée, qui s’applique à l’État tout comme à nos subjectivités les plus intimes » (Dardot et Laval, 2013). Le néolibéralisme, loin de « constituer l’élargissement naturel de la sphère de marchandisation et du champ de l’accumulation » (188), « a tendance à structurer et à organiser non seulement les actions des dirigeant·es, mais également le comportement des dirigé·e·s » (110). Pour ce faire, il fait appel à « des méthodes inédites de contrôle des comportements et subjectivités » (188) et évolue en intégrant ses propres critiques. En fin de compte, ces lectures s’avèrent plus pertinentes pour examiner les ambiguïtés et les contradictions d’un phénomène dont la marchandisation de la différence ne rend que partiellement compte. Les travaux de Stuart Hall en la matière n’ont d’ailleurs pas d’égaux. Hall fait valoir, à propos de l’intérêt récent du capital pour la différence, que pour maintenir son emprise, le néolibéralisme mondialisé a dû apprendre à vivre avec et grâce à la différence — ce qui sous-entendait toutefois de lui attribuer un nouveau sens, de l’incorporer et de la gouverner :
Pour continuer à dominer le marché international, le capital a dû négocier […], incorporer et refléter en partie les différences qu’il tentait de surmonter. Il a donc dû essayer de s’emparer de ces différences et, dans une certaine mesure, de les neutraliser. Partant, il essaye de créer un monde composé d’éléments différents, […] sans toutefois accorder d’importance à ces différences.
Hall, 1991, p. 32-33
Selon Hall, cette nouvelle forme de pouvoir économique « vit culturellement de la différence et […] joue constamment avec le feu de l’Autre transgressif » (1991, p. 31), tout en absorbant et en neutralisant partiellement les différences déstabilisantes, transformées en différences inoffensives et gouvernables. Il faut dire que la différence perturbatrice qui a accompagné les mouvements d’émancipation sociale n’a pas seulement constitué un défi pour le pouvoir en place, mais a également permis, grâce à l’institutionnalisation de la différence, de donner un nouveau souffle à l’hégémonie. Pour Ferguson (2012, p. 42), ce phénomène engendre une nouvelle contradiction sociétale, en ce sens que l’auto-affirmation des minorités, même si celle-ci suppose une critique radicale de l’hégémonie, devient, en raison de son institutionnalisation, également un site permettant au pouvoir de réaffirmer son hégémonie comme jamais auparavant. Ces différences, bien qu’ayant au départ critiqué la « soi-disant bienveillance des institutions politiques et économiques », ont été absorbées « au sein d’un éthos administratif qui [les] a fait valoir comme preuves de l’évolution de l’université et de la résurrection d’une culture nationale commune » (Ferguson, 2008, p. 162-163). Qui plus est, les conditions et structures de leur institutionnalisation se sont étendues aux structures théoriques, cadres interprétatifs et outils de pensée de ces champs, et en ont modifié le sens. Ceci illustre bien l’argument de Hall quand il montre comment le néolibéralisme incorpore les différences qu’il tente de surmonter, c’est-à-dire en reflétant partiellement ces dernières, en leur donnant un nouveau sens et en les transformant en différences qui n’en sont plus, en diversité, c’est-à-dire en différence dénuée d’adversité. Comme l’affirme Reddy :
Avec le recul historique, on constate que l’institutionnalisation libérale de la race au sein des études ethniques a souvent été contextualisée de manière forcée — voire même purement limitée à son contexte — notamment lorsque ces programmes ont fait leur apparition dans les campus universitaires. […] [O]n se rend compte que ce que l’institutionnalisation libérale attendait des études ethniques n’était pas une généalogie critique de l’université moderne au sein du capitalisme racial, mais l’émergence d’une classe interraciale au sein de l’institution éducative dont la présence et la marge de manoeuvre restreinte vident de sens le concept d’égalité raciale.
Reddy, 2011, p. 30
Toutefois, les (re)définitions de l’hégémonie ne sont jamais absolues. En effet, l’instabilité et les contradictions qu’elles comportent lui confèrent un potentiel de déstabilisation, de redéfinition contre-hégémonique ou de coexistence de courants subversifs sous-jacents. Le phénomène d’absorption de la différence minorisée par l’État, le capital et l’université ne constitue pas seulement « l’occasion de redistribuer les cartes au sein de l’ordre blanc » (Crawley, 2018, p. 11) et de contribuer au renouveau de l’hégémonie, mais comporte également d’imprévisibles zones de brèche et de faille, sources potentielles de déstabilisation. La pédagogie autophagique de Bannerji illustre bien ce mode de subversion — il s’agit d’une action susceptible de venir alimenter des courants d’opposition plus importants à même d’éroder l’université néolibérale, blanche et allochtone.
apprendre des refus noirs et autochtones
Envisager le néolibéralisme comme « discours postpolitique qu’habitent également les universitaires progressistes » (Blalock, 2015, p. 73), et pas uniquement comme idéologie conservatrice, permet d’adopter une perspective plus large et de comprendre dans quelle mesure l’université néolibérale nous interpelle tous et toutes. Toutefois, la manière dont nous sommes interpellé·e·s est fonction de l’intersection de différents axes de pouvoir — axes tant irréductibles (principe de non-équivalence) qu’inséparables les uns des autres (Bilge, 2015). Par ailleurs, nos réactions vis-à-vis des interpellations néolibérales sont très différentes, même parmi les universitaires autochtones, noir·e·s et autres racisé·e·s (dit·e·s en anglais « de couleur »). Comme je l’ai souligné précédemment, lorsque Bannerji est interpellée par l’université blanche à titre de « femme sud-asiatique » donnant des cours sur la race, elle riposte en faisant appel à une pédagogie auto-cannibale qui lui permet de survivre et de résister. Elle collectivise sa colère et sa lutte, ancre celles-ci dans une lignée multigénérationnelle qui part des actrices des luttes d’aujourd’hui et se poursuit avec celles des luttes de demain. « Se défaire de l’histoire nous salit, nous démembre. Nous sommes en première ligne. D’autres viennent nous rejoindre, avec et derrière nous. Un jour, nous formerons un tout » (Bannerji, 1995, p. 106).
D’autres réagissent en se transformant en intermédiaires ethniques et choisissent de mettre leurs savoirs et leurs compétences culturelles d’initié·e·s à disposition de l’institution. Leurs motifs peuvent être plus ou moins nobles — depuis la défense de l’équité raciale jusqu’à l’intérêt personnel. Le choix qui consiste à s’investir dans l’institution et à lui faire confiance est sévèrement critiqué par les universitaires autochtones, noir·es et de couleur, et ce, depuis un certain temps. Cornel West s’est notamment insurgé contre la « formation de canons minoritaires » qui, selon lui, « ne fait que reproduire et renforcer les formes dominantes de l’autorité culturelle » (1987, p. 198). Pour répondre à ses questions incisives, notamment :
que signifie le fait de s’engager dans la formation d’un canon à ce moment historique précis ? […] quel est le rôle joué par la classe et les intérêts professionnels des canonisateur·rice·s dans le processus d’élargissement d’un canon donné ou celui de création de canons multiples et contradictoires ?
1987, p. 193
West se livre à un auto-inventaire critique de ses propres activités intellectuelles à titre de critique culturel afro-américain. En décodant les débats relatifs à la formation du canon afro-américain à partir de l’essor du multiculturalisme libéral dans le milieu universitaire états-unien des années 1980, West s’attaque non seulement aux intérêts de classe des universitaires noir·e·s alors « devenu·e·s les commissaires régissant une partie d’un canon élargi ou un canon distinct », mais souligne également que leur inclusion « témoignait du succès des idéologies dominantes du pluralisme » (1987, p. 197) — argument qui, à la lumière des derniers débats, semble toujours d’actualité. Ainsi, 30 ans plus tard, Kelley affirme que le multiculturalisme libéral n’a jamais eu pour but de remédier aux « séquelles laissées par des siècles de racisme, de dépossession et d’injustice », mais plutôt « d’accueillir certaines personnes dans les rangs d’une “société qui n’est plus considérée comme racialement injuste” » (2016). De même, Walcott (2018) nous invite à rejeter la solution de l’inclusivité libérale qui consiste à intégrer quelques élites racisées au détriment des masses tout en perpétuant le modèle d’oppression structurelle. Ce faisant, il souligne notre responsabilité à nous, universitaires, car c’est à nous qu’il incombe de résister à de telles tentations à l’échelle individuelle. Ce type de mesures incitatives fait partie intégrante de ce que j’appelle le piège à clics de la diversité. Cette expression est à double sens dans la mesure où l’institution embauche des universitaires « de la diversité » en usant de ce concept comme d’un piège à clics pour alimenter son projet hégémonique et se servir d’eux comme appâts pour attirer de nouvelles « clientèles » (étudiantes), lesquelles constitueront à leur tour les futures générations d’expert·e·s chargé·e·s de gouverner la différence pour l’État et le capital. Walcott refuse de se réjouir de ces « réussites » individuelles comme s’il s’agissait de réussites collectives. Il fait valoir que « l’individualisme compensatoire qui caractérise notre époque doit être rejeté systématiquement », avant de poursuivre :
Il ne faut pas s’y tromper. Les logiques actuelles de l’antiracisme, de l’équité et même de la justice sociale ont pour autre le sujet noir. Nous n’avons jamais bénéficié de manière collective de leur performativité institutionnelle. Les personnes qui en bénéficient sont celles qui se rapprochent de la blanchité, pas seulement d’un point de vue phénotypique, mais également au sens d’anti-noirceur instituée, et qui s’inscrit par conséquent dans la logique de la suprématie blanche.
Walcott, 2018, p. 93
Il s’agit d’un appel à prendre conscience de la performativité d’inclusion que l’on voit aujourd’hui à l’oeuvre dans l’université, c’est-à-dire un réformisme de surface qui fraternise avec les forces de l’oppression. Cependant, ce débat-là (s’investir dans l’université ou lui tourner le dos) ne répond pas entièrement à la question. Certaines personnes refusent même d’y participer au motif qu’elles en refusent les propos et l’alternative proposée (pour ou contre). À la place, elles ne proposent rien de moins que la sédition et le marronnage, puisqu’il n’est possible d’échapper aux interpellations néolibérales que dans des espaces fugitifs. Fred Moten et Stefano Harney qualifient cette voie de « sous-communs » :
[l]a seule relation possible à l’université aujourd’hui est une relation criminelle. […] on ne peut pas nier que l’université est un lieu de refuge et on ne peut pas accepter que l’université soit un lieu de raison éclairée. Dans de telles conditions, on ne peut que se faufiler dans l’université et y voler tout ce qu’on peut. Abuser de son hospitalité, contrarier sa mission, rejoindre sa colonie de réfugié·e·s, […] être dans, mais pas de — voilà le chemin de l’intellectuel·le subversif·ve au sein de l’université moderne. […] Après tout, l’intellectuel·le subversif·ve est venu·e sous de faux prétextes, avec les mauvais papiers, par amour. Son travail est aussi nécessaire qu’indésiré. L’université a besoin de ce qu’iel porte, mais ne peut supporter ce qu’iel apporte. Et en plus de tout ça, iel disparaît. Iel disparaît dans les souterrains […] dans les sous-communs de la raison éclairée, là où le travail est accompli, là où le travail est subverti, là où la révolution est toujours noire, toujours forte.
Harney et Moten, 2013, p. 26
Le travail d’Harney et Moten avait touché une corde sensible dans le milieu universitaire et s’était « répandu comme une traînée de poudre parmi les doctorant·e·s précaires et les étudiant·e·s de cycle supérieur d’obédience radicale. Aux yeux de beaucoup de ces jeunes chercheur·se·s qui tentaient tant bien que mal de gagner leur vie avec des charges de cours, la critique d’[Harney et Moten] avait valeur de vérité criante » (Kelley, 2016). Ce refus de considérer l’université comme un lieu de raison éclairée était, pour beaucoup, tout à fait logique, surtout pour les personnes confrontées aux structures de race, de classe, de genre, de capacitisme et d’hétérosexisme de l’institution. Les sous-communs proposés par Harney et Moten, ajoute Kelley (2016),
« est un réseau de fugitif·ves, dont l’engagement pour l’abolition et la collectivité a priorité par rapport à une culture universitaire qui vise à créer des individus socialement isolés, et dont le scepticisme intellectuel et les prétentions d’objectivité ne viennent pas remettre en cause l’ordre du monde. »
Au-delà des enseignements que représente le refus radical de ces intellectuels noirs, il faut également mentionner les travaux de chercheuses autochtones qui ont élaboré une autre praxis de refus notable (Simpson, 2007 ; Grande, 2018). Ancré dans les pédagogies autochtones inspirées de la terre et dans la résistance au colonialisme de peuplement, ce refus aborde également la question de l’extractivisme, notamment celui pratiqué à l’université, qui faisait partie et continue à faire partie de toute une série de relations extractivistes plus larges visant à assujettir les peuples autochtones (Smith, 2012). Comme le fait valoir l’écrivaine, musicienne et « ex‑universitaire » Leanne Betasamosake Simpson de la nation Michi Saagiig Nishnaabeg :
[L]’état d’esprit extractiviste ne cherche pas à engager la conversation, à entamer un dialogue ou à intégrer les savoirs autochtones dans les conditions fixées par les peuples autochtones. Non, il s’agit essentiellement d’extraire des idées que des scientifiques ou des écologistes ont jugées pertinentes et de les assimiler… de les imprimer sur du papier toilette avant de les vendre aux gens. Il s’agit d’extraction tant intellectuelle que cognitive et physique. […] Il incombe à la couche dominante […] de la société de trouver une manière de vivre plus durablement et de s’extraire de la pensée extractiviste.
Simpson, citée dans Klein, 2013
Il faut faire preuve de prudence à l’égard de la critique autochtone de l’extractivisme universitaire, d’une part parce qu’elle s’attaque à une question essentielle et d’autre part parce qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une appropriation indue. Même si le lien entre savoir et pouvoir et le manque d’actions concrètes pour « décoloniser les savoirs » dans les champs de savoirs minoritaires sont dénoncés régulièrement, la responsabilité de la communauté universitaire reste mal définie. Dans les champs qui nous préoccupent, l’auto-inventaire radical qui permettrait de baliser nos propres pratiques extractivistes (recherche et enseignement) n’a toujours pas eu lieu. On continue à extraire des savoirs de communautés et d’étudiant·e·s minorisé·e·s dans des conditions dont ils et elles ne tirent aucun bénéfice. Puisque nos programmes ne comprennent pas de cours obligatoires sur les épistémologies décoloniales et les pratiques de recherche non extractivistes (et n’en comprendront jamais), il nous faut introduire clandestinement ces contre-méthodes et ces savoirs dans les cours obligatoires et facultatifs. Faute de quoi, nous aurons contribué à former la future génération de chercheur·se·s extractivistes. Dans de nombreux milieux institutionnels, nous, enseignant·e·s, avons encore cette latitude. Nous pouvons nous inspirer de pratiques autres, notamment du principe de « recherche conviviale[9] » de l’Universidad de la Tierra, une université mexicaine non conventionnelle, multisite, qui s’inspire de savoirs « vernaculaires ». La recherche conviviale ne se cantonne pas à l’étude d’une communauté minorisée ; il s’agit d’une « recherche ancrée dans la communauté et dont le but est la préservation et la survie de celle-ci », « fondée sur le principe voulant que la communauté possède déjà des savoirs et qu’il s’agit dès lors de trouver une manière adéquate pour comprendre ce savoir et lui rendre hommage » (Moten dans Cooper et al., 2018, p. 167-168). À ce propos, on peut s’inspirer du cadre proposé par la chercheuse Quéchua Sandy Grande, à savoir une éthique du refus alliant théories radicales noires et théories autochtones dans une corésistance à l’université allochtone blanche afin de construire collectivement un futur libérateur. Ce cadre, qui s’appuie sur trois grands principes (collectivité, réciprocité et mutualité), constitue une invitation à rejeter tentations individuelles et désir de branding personnel pour mettre l’accent sur la production collective de savoir ; il encourage également la pratique d’une responsabilité collective et l’établissement de relations de réciprocité profonde qui nous rendent « redevables envers les communautés dont nous nous réclamons et que nous affirmons servir », tout en « nous montrant responsables les un·e·s des autres et en assumant la responsabilité de nos travaux » (Grande, 2018, p. 61). Enfin, si l’engagement en faveur du principe de mutualité touche à la réciprocité, il ne s’arrête toutefois pas là. La mutualité englobe les liens particuliers avec la terre et la communauté intergénérationnelle, car il faut encourager « le développement de relations sociales qui ne dépendent pas des impératifs du capital et qui rejettent l’exploitation » (Grande, 2018, p. 61).
coda
Est-il possible d’échapper à la situation paradoxale d’être interpellé·e·s en tant que complices d’un système universitaire qui usurpe les luttes de libération radicale et les projets de savoirs qui les accompagnent pour réorganiser et redéfinir les ententes néo/libérales qui gouvernent la différence, qui nous gouvernent et profitent de nous, de cette différence ? Y a-t-il moyen d’échapper au système universitaire qui manipule le piège à clics de la diversité et nous incite à nous appâter nous-mêmes en tant que diversité — ce qui revient à dire que nous nous livrons à l’autophagie ? Si
l’on ne parvient pas à transformer radicalement l’architecture sociale et épistémologique — complètement racialisée — sur laquelle repose l’université moderne « tout simplement » en ajoutant des visages plus foncés, des espaces de parole encore plus libérée, de meilleures formations et un programme d’étude qui souligne les oppressions tant passées que contemporaines
Kelley, 2016
alors que faut-il faire ? On sait pertinemment, preuves à l’appui, que lorsque la critique de l’université émane de ses propres rangs, elle ne remet pas en question le projet néolibéral et peut même servir ses fins hégémoniques, à tel point que la criticité même, c’est-à-dire l’universitaire critique professionnalisé·e, devient l’une des pierres angulaires permettant d’étayer l’édifice (Harney et Moten, 2013, p. 31). Ces contradictions, propres à notre époque, constituent des enjeux sur lesquels il faut travailler. En l’absence d’approche unique, il convient toutefois d’examiner ces contradictions et d’élargir les crevasses institutionnelles pour y installer nos espaces fugitifs. L’université « nous fait croire que les politiques de lobbying constituent notre seul salut pour accéder à ces institutions ou les contrôler » (Kelley, 2016). Loin de constituer notre salut, cette approche s’avère plutôt notre damnation. La violence que représente le fait de siéger à la table des négociations tout en figurant au menu est bien réelle. Il existe d’autres moyens, des itinéraires moins balisés qui se rejoignent à l’abri des regards, là où le travail ingouvernable, inutile aux yeux du pouvoir administratif, continue à être accompli[10].
Appendices
Notes
-
[1]
Version remaniée d’un chapitre publié en 2020, cet article s’inscrit dans une recherche financée par le CRSH portant sur les savoirs minoritaires au sein de l’université néolibérale. Certain·es trouveront peut-être déplacée ou intempestive sa critique des inclusions hégémoniques à une heure où les forces exclusionnistes frappent. L’avant-propos vise à éclairer un tant soit peu pourquoi nous ne pouvons pas abdiquer la critique constructive.
-
[2]
Trump a fait de l’élimination des programmes de DEI – une promesse électorale – une cible clé dès ses premiers jours au pouvoir. À son investiture, il a signé un décret exécutif ordonnant « la suppression de tous les programmes discriminatoires, y compris les programmes DEI illégaux et les mandats, politiques, programmes, préférences et activités relatifs à la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité (DEIA) dans le gouvernement fédéral, sous quelque nom qu’ils apparaissent » et obligeant les agences fédérales à fermer l’ensemble de leurs bureaux chargés de promouvoir DEI, DEIA et la justice environnementale et à en licencier le personnel sous soixante jours (White House, 20 janvier 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/ending-radical-and-wasteful-government-dei-programs-and-preferencing/). Un autre décret émis le lendemain ciblait le secteur privé afin d’inciter les entreprises à abandonner ces initiatives jugées « illégales et immorales ». (White House, 21 janvier 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/ending-illegal-discrimination-and-restoring-merit-based-opportunity/) Depuis, plusieurs compagnies telles que Meta, Amazon, Walmart, Target, McDonalds, ont annoncé l’abandon de leurs programmes DEI. Ce décret gèle aussi les subventions et prêts fédéraux liés aux initiatives DEI, ce qui a un impact significatif sur les universités et les organisations qui en dépendent. Trump a par ailleurs demandé aux institutions fédérales d’enquêter sur les universités ayant une dotation de plus d’un milliard de dollars qui maintiennent des programmes DEI. Une circulaire invite à signaler toute tentative de dissimulation de ces programmes sous d’autres noms.
-
[3]
Le terme n’est pas hyperbolique, comme en témoignent les moyens de délation mis en place. Des lettres encourageant la dénonciation ont été envoyées aux employés des départements de la Sécurité intérieure et des Anciens combattants, à la NASA et dans d’autres agences. Celles-ci leur informaient qu’ils avaient dix jours pour signaler toute personne continuant à travailler sur des projets DEI qui pouvaient être déguisés sous d’autres rubriques (Britanny Gibson, Marc Caputo, Axios, 22 janvier 2025, https://www.axios.com/2025/01/23/trump-dei-snitches-government). Aussi, le Bureau de la gestion du personnel a annoncé la création d’une ligne de signalement électronique pour que les employés fédéraux puissent dénoncer anonymement leurs collègues montrant un intérêt pour les programmes DEI. (Ed Kilgore, Intelligencer, 30 janvier 2025, https://nymag.com/intelligencer/article/trumps-dei-witch-hunt-reaches-new-low-after-plane-crash.html)
-
[4]
Depuis son émergence en Floride en 2021, la vague anti-DEI (EDI au Canada) n’a cessé de prendre de l’ampleur, devenant un cheval de bataille majeur pour les conservateurs et l’extrême droite (voir l’introduction de ce numéro). Le virage pris par University of Alberta s’inscrit dans cette dynamique plus large, où plusieurs universités américaines — notamment dans les États du Sud, comme University of Southern Mississippi — ont déjà adopté des variantes du langage « accès, appartenance et communauté ». En Alberta, d’autres universités emboîtent le pas à UofA : University of Calgary a récemment annoncé l’intégration de son bureau de l’EDI et de l’accessibilité dans un nouveau « bureau des engagements institutionnels », tandis que University of Lethbridge a remplacé son site web sur l’EDI par un site consacré à l’accessibilité, l’appartenance et la communauté. Hannah Liddle, « Inside the University of Alberta’s move away from equity, diversity and inclusion », University Affairs, 28 janvier 2025. https://universityaffairs.ca/news/inside-the-university-of-albertas- move-away-from-equity-diversity-and-inclusion/.
-
[5]
Voir Liddle (2025) susmentionné.
-
[6]
“‘We’ve joined the table but we are still on the menu’ : Clickbaiting diversity in today’s university”. Plutôt qu’une traduction littérale, j’ai préféré un nouveau titre résonnant avec un public francophone.
-
[7]
L’origine de ce dicton n’est pas claire ; beaucoup sont d’avis qu’il aurait vu le jour à Washington (DC) dans les années 2000. Carol Bush, « If You’re Not at the Table, You’re on the Menu », www.oncnursingnews.com/nurse-blogs/carol_bush/1213/if-youre-not-at-the-table-youre-on-the-menu, 30 décembre 2013.
-
[8]
La manière dont ce « champ » est structuré dépend de son environnement, notamment de l’université ou de la région où il est implanté. Aux États-Unis, le terme « études ethniques » fonctionne souvent comme une appellation générique englobant les projets de savoirs minoritaires distincts et explicitement nommés dont les Études Noires, Africaines Américaines, Asiatiques Américaines, Latin@, Autochtones, Arabes Américaines, Portoricain·e·s, etc. Au Canada, l’histoire des programmes et diplômes en études noires est beaucoup plus récente et leur distribution plus limitée sur le plan géographique — par exemple, il n’y a aucun programme d’études noires dans les universités francophones ; un tel projet suit actuellement son cours institutionnel à l’Université de Montréal. Par ailleurs, les études noires et autochtones ne sont pas incluses dans les études ethniques—cette dernière figurant souvent comme un sous-champ dans les départements de sociologie et d’anthropologie. L’inclusion, en tant que sous-champ de la sociologie, discipline bien établie, mais qui n’a pas vraiment décentré son habitus racial, rend sans doute les études ethniques et raciales plus vulnérables au risque de clonage et de domestication disciplinaires.
-
[9]
Rappelons ici le sens étymologique de « convivial », qui vient du latin convivere, vivre ensemble.
-
[10]
J’ai mis du temps à me rendre compte de cela, ayant trop longtemps mis ma confiance dans le modèle voulant que les initiatives réformistes soient complémentaires, et non oppositionnelles, à celles insurrectionnelles. À l’instar des récentes converti·e·s pouvant pécher par un excès de zèle, mes arguments sont susceptibles de refléter des excès similaires que j’assume entièrement, comme ils témoignent de mon cheminement toujours en cours vis-à-vis de la question de l’institutionnalité.
Bibliographie
- Ahmed, S. (2009). Embodying diversity. Race Ethnicity and Education, 12(1), 41-52.
- Alcoff, L. et Mohanty, S. (2006). Reconsidering identity politics. Dans L. Alcoff et al. (dir.), Identity politics reconsidered (p. 1-9). Palgrave-Macmillan.
- Bannerji, H. (1995). Thinking Through. Women’s Press.
- Bilge, S. (2013). Intersectionality undone. DuBois Review, 10(2), 405-424.
- Bilge, S. (2015). Le blanchiment de l’intersectionnalité. Recherches féministes, 28(2), 9-32.
- Blalock, C. (2015). Neoliberalism and the crisis of legal theory. Law and contemporary problems, 77(4), 71-103.
- Christian, B. (1994). Diminishing returns. Can Black feminism(s) survive the academy ? Dans D.T. Goldberg (dir.), Multiculturalism : A Critical Reader (p. 168-179). Blackwell.
- Cooper, A., Walcott, R. et Hughes, L. (2018). Robin DG Kelley and Fred Moten in conversation. Critical Ethnic Studies, 4(1), 154-172.
- Cooper, B. (2017). Beyond Respectability. University of Illinois Press.
- Crawley, A. (2018). Introduction to the academy and what can be done ? Critical Ethnic Studies, 4(1), 4-19.
- Dardot, C. et Laval, P. (2013). The New Way of the World. Verso.
- Derrida, J. (2004). Eyes of the University. Stanford University Press.
- duCille, A. (1994). The occult of true Black womanhood. Signs, 19(3), 591-629.
- Elia, N., Hernandez, D., Kim, J., Redmond, S.L., Rodriguez, D. et Echavez See, S. (2016). Introduction : a sightline. Dans Critical Ethnic Studies : A Reader (p. 2-15). Duke UP.
- Feher, M. (2017). Le temps des investis. Découverte.
- Ferguson, R. (2008). The will to institutionality. Radical History Review, (100), 158-169.
- Ferguson, R. (2012). The reorder of things. University of Minnesota Press.
- Ferguson, R. (2015). University. Critical Ethnic Studies, 1(1), 43-55.
- Foucault, M. (2003). Society must be defended. Picador. (Ouvrage original publié en 1976)
- Frankenberg, R. et Mani, L. (1993). Race, “postcoloniality” and the politics of location. Cultural Studies, 7(2), 292-310.
- Grande, S. (2018). Refusing university. Dans E. Tuck et K.W. Yang (dir.), Toward What Justice ? (p. 47-65). Routledge.
- Hall, S. (1991). The local and the global. Dans A.D. King (dir.), Culture, Globalization and the World-System, (p. 19-39). University of Minnesota Press.
- Hall, S. (1997). The spectacle of the “other”. Dans S. Hall (dir.), Representation (p. 223-279), Sage.
- Harney, S. et Moten, F. (2013). The Undercommons. Autonomedia.
- Hong, G. (2008). “The future of our worlds” : Black feminism and the politics of knowledge. Meridians, 8(2), 95-115.
- Kelley, R.D.G. (2016, 1er mars). Black study, black struggle. Boston Review. https://www.bostonreview.net/forum/robin-kelley-black-struggle-campus-protest/
- Klein, N. (2013, 6 mars). Dancing the world into being : a conversation with Idle No More’s Leanne Simpson. Yes Magazine. https://www.yesmagazine.org/social-justice/2013/03/06/dancing-the-world-into-being-a-conversation-with-idle-no-more-leanne-simpson
- Mohanty, C. (1990). On race and voice. Cultural Critique, (14), 179-208.
- Morris, A. (2015). The Scholar Denied. University of California Press.
- Reddy, C. (2011). Freedom from Violence. Duke UP. Press.
- Reddy, C. (2019). Neoliberalism then and now : Race, sexuality, and the black radical tradition. GLQ, 25(1), 150-155.
- Roediger, D. (2017). Class, Race, and Marxism. Verso.
- Simpson, A. (2007). On ethnographic refusal : Indigeneity, “voice” and colonial citizenship. Junctures, (9), 67-80.
- Smith, L.T. (2012). Decolonizing Methodologies. Zed Books.
- Thompson, E.P. (1970). The business university. New Society, (386), 301-304.
- Walcott, R. (2018). Against social justice. Dans E. Tuck et K.W. Yang (dir.), Toward what justice ? (p. 85-99). Routledge.
- Weheliye, A. (2014). Habeas Viscus. Duke UP.
- West, C. (1987). Minority discourse and the pitfalls of canon formation. Yale Journal of Criticism, 1(1), 193-202.