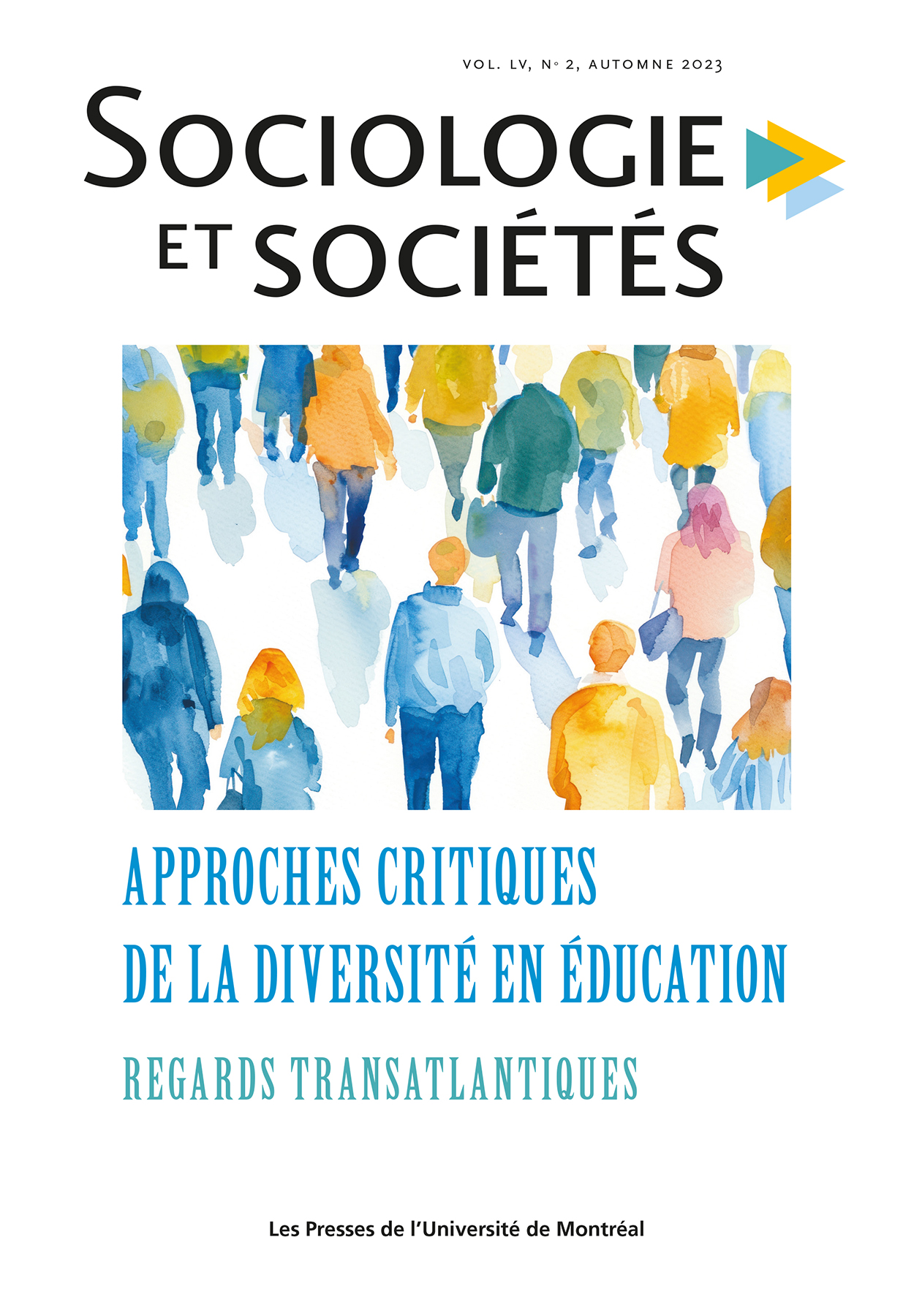Article body
À la fin de l’année 2022, un groupe d’activistes conservateurs, rejoint par des universitaires, s’est fixé comme objectif d’abolir l’ensemble des programmes de Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) dans les universités publiques du Texas aux États-Unis. S’associant à des collaborateurs proches du gouverneur qui, pour certains, avaient fait de la disparition de ces programmes une priorité politique de longue date (Confessore, 2024), ils dressent un inventaire au vitriol de la « révolution DEI » en cours sur les campus américains. Repris par le Sénat, envoyé aux présidences d’université, leur rapport porte rapidement ses fruits : dès mars 2023, emboîtant le pas à la Floride, l’État du Texas légifère pour interdire toute dépense de création de services spécifiques en matière de diversité, le recrutement de personnel dédié, ainsi que toute exigence de formation, à l’exception des activités de recherche et d’enseignement. Prenant la parole à l’occasion de l’adoption du Florida Educational Equity Act quelques mois plus tôt, le gouverneur de la Floride en résume l’essence ainsi : « Si l’on regarde comment ces politiques ont été mises en place dans notre pays, on comprend alors que discrimination, exclusion, [i]ndoctrinement serait plus approprié pour les définir. Elles n’ont pas de place dans nos institutions » (Diaz, 2023).
Bien avant que la Cour suprême n’infirme de manière définitive la jurisprudence Bakke, considérée comme acte fondateur des politiques de diversité dans les universités américaines[1], la croisade anti-DEI, portée par un réseau de militants, de fondations et d’instituts de la droite américaine, était sur les rails. Dans le sillage de la réception globale de Black Lives Matter et de la convergence sans précédent des luttes antiracistes que le meurtre de Georges Floyd a provoquée (Crenshaw, 2021 ; Wallace-Wells, 2021), la réaction conservatrice fut initiée par le président Trump lui-même. Dès le mois de septembre 2020, il interdit par décret toute formation à la diversité et à l’inclusion dans l’administration fédérale qui engagerait les thèmes du racisme systémique, du biais implicite ou inconscient ; ou qui provoquerait des sentiments d’« inconfort, responsabilité, angoisse, ou stress psychologique », sur la base de considérations liées au sexe ou à la race (Executive Order 13950, 2020).
Bien que des divergences existent sur la manière de nommer l’adversaire — political correctness, identity politics et multiculturalisme dans les années 1980-1990, plus récemment critical race theory, critical social justice, mais aussi cancel culture, wokeness et wokism, voire même woke communism — la rhétorique anti-DEI imprègne la droite républicaine dont elle est devenue à la fois la cause et le cri de ralliement. D’abord focalisée avec succès sur la théorie critique de la race ou CRT, leur offensive donne lieu à un effort législatif sans précédent : plus de 20 États américains introduisent des projets de loi, durant la seule année 2021 (Ray et Gibbons, 2021 ; Doytcheva, 2022), interdisant l’enseignement de la CRT dans le secondaire (où celle-ci, selon toute vraisemblance, n’était pas enseignée). Au fondement de ses textes, la notion de divisive concepts dévoile la résistance opposée à la reconnaissance du racisme systémique, ainsi que des régimes historiques d’oppression fondés sur la blanchité.
À l’avant-garde du mouvement conservateur et de son bras nationaliste chrétien, des États tels que la Floride et le Texas, suivis de l’Oklahoma ou du Tennessee, sont à l’origine d’initiatives qui aboutissent, dès 2023, à prolonger la séquence anti-CRT en la transposant à l’université. Si le Stop W.O.K.E. Act, adopté en 2022 par la Floride[2] (que désavoue y compris une partie de la droite au nom de la liberté d’expression), a vu ses dispositions en matière de travail et à l’université suspendues ; ce sont les initiatives anti-DEI qui ont pris le relais dans l’espace académique. Au coeur de leurs préoccupations, les diversity statements exigés par un nombre croissant d’universités des candidat·e·s au recrutement (notamment enseignant·e·s), mais aussi tout centre, service, personnel spécifique, dédié à ces politiques — accusées d’engloutir une manne financière considérable pour « endoctriner » l’université. Bien que les législateurs aient relevé la contradiction de cette démarche avec la volonté de créer des universités d’excellence et « compétitives » — par exemple, les restrictions à la tenure en Floride ont dissuadé les candidatures prospectives, alors que les diversity statements sont exigés dans beaucoup de programmes fédéraux — la revendication d’une université authentiquement méritocratique, aveugle au genre et à la race, constitue l’épine dorsale de ces lois. En arrière-plan, un réseau d’activistes, think tanks, fondations et instituts de toute sorte alimente leurs rhétoriques réactionnaires (Hirschman, 1991) tout en rêvant de « contre-révolution »[3].
Il serait erroné de ne voir dans cette séquence politique qu’un phénomène étatsunien, venant prolonger les cultural wars dont sont le théâtre depuis toujours les meilleurs campus de la nation (Fassin, 1993). D’ores et déjà résonnent en Europe les hantises du wokisme, de la cancel culture et de la « logique intersectionnelle qui fracture tout »[4], à quoi s’ajoutent des productions idéologiques propres autour du « décolonialisme » et de l’« islamogauchisme », qui sont l’objet ici d’un consensus transpartisan. À l’heure d’un antiracisme global et multiracial, les conservatismes et nationalismes blancs se globalisent aussi, jusqu’à exporter outre-Atlantique les théories du « grand remplacement ». Quant au Canada, il est généralement considéré dans cette littérature comme l’endroit où le « régime woke » est le plus avancé et se nomme multiculturalisme.
diversité et crt : une convergence problématique à repenser
Pour autant, les offensives législatives contre la CRT dans l’enseignement secondaire, puis contre les politiques DEI, à l’université, reposent sur une méconnaissance ou plutôt une déformation systématique de ces problématiques. À tel point que cette posture fut récemment analysée en termes de racelighting, par analogie au gaslighting — technique manipulatoire qui consiste à faire douter la cible de son expérience et de sa capacité de discernement (Wood et Harris, 2021 ; Smith et Parker, 2024). Activiste conservateur et membre du Manhattan Institute, à l’origine de la campagne anti-CRT, Christopher Rufo en exhorte la logique de désinformation ainsi : « Nous avons réussi à figer leur marque — la critical race theory — avec succès dans la discussion publique et on ne cesse de faire monter les perceptions négatives. Nous finirons par la rendre toxique, en plaçant toutes les insanités culturelles sous cette étiquette. Le but est, dès que le public lit quelque chose de fou dans les journaux, qu’il pense aussitôt critical race theory[5]. »
Le racelighting dont sont l’objet les politiques de diversité et la CRT et, surtout, leurs relations réciproques opère ainsi par déplacement et resignification. Il est d’autant plus surprenant que, d’une part, c’est à un juge conservateur, dévoué à combattre « les attaques contre les institutions américaines » (Powell, 1970), que l’on doit l’invention de la doctrine juridique de la diversité, il y a bientôt de cela cinquante ans[6].
À force d’amalgames assumés, le racelighting masque le fait, d’autre part, que les approches critiques du racisme (Doytcheva et Gastaut, 2022) invitent à une analyse circonspecte des politiques libérales de la diversité. Celle-ci s’enracine dans le « pessimisme » fondateur des théoricien·ne·s critiques de la race quant aux capacités du réformisme libéral et d’une réforme juridique incrémentale à faire advenir la justice raciale (Bell, 1980 ; Mills, 1997). Dans la vision fondatrice de Derrick Bell (1980), la justice raciale relève en effet de conditions rares et spécifiques qui requirent pour aboutir une convergence stratégique avec les intérêts blancs du moment. Si la CRT se voit aujourd’hui discréditée en éducation comme propagande idéologique, sa critique fondatrice du droit antidiscriminatoire se révèle au contraire précurseure. Enracinée dans le courant plus large des critical legal studies, elle invite à déconstruire le rôle de la loi et du juridique dans la légitimation du statu quo social.
Dès la fin des années 1970, cette posture d’abord incomprise par de nombreux contemporains — dont beaucoup de libéraux qui célèbrent avec enthousiasme les victoires historiques de la déségrégation — souligne les contradictions et angles morts de l’édifice juridico-politique qui institutionnalise la révolution des droits civiques et la lutte contre les discriminations. En fait partie la critique d’une conception restrictive de la discrimination, qui renvoie celle-ci à l’idée d’acte individuel malintentionné (Freeman, 1977), plutôt qu’à une vision structurelle et politique du racisme (Carmichael et Hamilton, 1967 ; Bonilla-Silva, 1997 ; Feagin, 2006 ; Ray, 2023). Cette vision limitée à la fois du tort subi et des remèdes à apporter (Crenchaw, 1989) va de pair avec une approche exclusive et segmentée qui filtre les expériences vécues des discriminé·e·s par le prisme des « catégories protégées ». En lieu et place d’intersectionnalité, elle se révèle porteuse d’une inflation catégorielle et de tensions normatives qui confortent en définitive l’ascendant de la blanchité (Bhopal, 2018 ; Doytcheva, 2020).
Font partie également des hypothèses fondatrices de la CRT : la critique d’une préséance idéologique et politique des idéaux de la déségrégation qui pousse les avocats à opérer dans le processus judiciaire au détriment des désirs et intérêts immédiats de leurs clients (Bell, 1976)[7] ; la réversibilité des catégories antidiscriminatoires, aisément détournées par les majoritaires — pères en quête d’égalité, victimes du racisme antiblanc et de la discrimination « inversée », masculinistes, fumeurs, chasseurs, bouchers (Cooper, 2004) — dans un mouvement de pluralisation extrême, sans fondement juridique ni lien avec la question des inégalités.
Pour Davina Cooper (2004), la notion de diversité ne repose pas sur un concept ou une théorie intégrée, mais recouvre davantage un champ discursif, analytique et normatif large. Celui-ci émerge à partir des années 1980, au croisement de théories et d’idéologies multiples, dont la chute du soviétisme, la montée du néolibéralisme, la remise en cause du féminisme radical, l’expansion des politiques gay et lesbiennes, la naissance du mouvement queer, les luttes qui entourent l’antiracisme et le multiculturalisme. Intellectuellement, l’espace des diversity politics se situe donc à la confluence de plusieurs courants tels que le libéralisme, la pensée communautarienne, le poststructuralisme, le post-marxisme, le féminisme, le postcolonialisme, la théorie queer (Cooper, 2004). Son déploiement fut néanmoins jalonné par trois moments : démocratique, conservateur et axiologique. Le premier reflète l’importance attachée aux politiques majoritaires qui, à partir de la seconde moitié du xxe siècle, forment une source de légitimité importante pour la citoyenneté démocratique libérale. C’est cette tendance qui pousse à la formulation et à l’extension de nouveaux droits (culturels, LGBT, des minorités), ainsi qu’au développement des notions de reconnaissance et d’authenticité (Kymlicka, 1995, 2007 ; Taylor, 1994). Dans ce processus d’universalisation, cependant, les territoires de la diversité en viennent à être colonisés par de « fausses minorités », ou des groupes socialement puissants qui s’auto-interprètent en termes de vulnérabilité. C’est le tournant conservateur dont découle la prévalence de définitions dites axiologiques de la diversité. Ses catégorisations sont de moins en moins liées à une revendication sociale d’égalité (Fraser, 2005), mais s’attachent à la mise en évidence « des formes de vie légitimement différentes » (Cooper 2004, p. 6). Au croisement du post-marxisme et du post-postmodernisme, la « redécouverte de la valeur » (Cooper 2004, p. 6.) a étayé les hypothèses d’hétérogénéité et d’incommensurabilité de toutes formes de différences et d’identités dont la qualité ne réside plus dans l’oppression subie, mais dans les valeurs morales qui leur servent d’ancrage. Porteur d’une différenciation accélérée, ce processus de « diversification de la diversité » fut subséquemment théorisé dans les termes d’une superdiversité (Doytcheva, 2018).
Pour autant, si la plupart des engagements, à la fois théoriques et pratiques, ont emprunté cette optique, tel ne fut pas le cas de la recherche critique sur la race et le racisme. Pour Derrick Bell (2003, p. 1622), « le concept de diversité constitue une distraction (distraction) sérieuse dans les efforts de justice sociale »[8]. Par ces connotations méritocratiques, il avantage les populations aisées, majoritairement blanches ; alors que le décentrement opéré des problèmes de pauvreté et d’inégalités pourrait exclure plus de Noir-américains que ne sauraient admettre les politiques d’affirmative action. Selon Bell, la confirmation de la jurisprudence Bakke en 2003, alors célébrée comme une « victoire », risque de se transformer rétrospectivement en « défaite » — ce dont a récemment attesté le procès de Harvard (SFFA, 2023). Selon Charles R. Laurence III (1997), le fait d’ancrer les politiques de justice raciale dans la notion de libertés académiques, comme le fait la doctrine juridique de la diversité, reflète une institutionnalisation du pouvoir blanc : fût-ce aux élites académiques de définir ce qui est bon pour la communauté, elles pourraient tout aussi bien prendre fait et cause pour la blanchité.
Pour Bell (2003), la raison de la diversité offre ainsi une illustration définitive de sa théorie de la convergence des intérêts, à savoir : une aide significative ne saurait être apportée aux minorisé·e·s que dans la mesure où elle répond à d’autres intérêts et priorités jugées fondamentales. Des travaux empiriques ont prolongé ces critiques normatives. Ils montrent comment, dans la sphère politique, au travail, en éducation, les luttes contre la discrimination ou pour l’émancipation ont été cooptées avec succès par l’institution, au diapason des politiques néolibérales environnantes (Ahmed, 2012 ; Embrick, 2011 ; Bilge, 2013 ; Berrey, 2015 ; Bhopal et Myers, 2023). Le business case, en particulier, ou argument commercial en faveur de la diversité, brandi dans les années 1980 par l’entreprise pour prévenir le démantèlement de ces politiques au temps des Reaganomics, en constitue l’exemple parfait. Mais leur néolibéralisation ne s’arrête pas au seuil de l’université. Dans l’académie aussi, le marché de la diversité (diversity bargain) permet de capitaliser sur les corps racisés au bénéfice de l’institution blanche (Warikoo, 2016 ; Bilge, 2013 ; Leong, 2012). Le marché de la diversité individualise et transforme ces notions en autant de « styles de vie » et de consommation, où la recherche de profitabilité va de pair avec une réinscription du racisme (Ahmed, 2012 ; Bhopal, 2018 ; Thomas, 2020). Dans certains cas, cela peut même servir de prétexte à une légalisation des discriminations au lieu de les combattre (Kirby et al., 2015). En parallèle, l’élargissement et la fragmentation des publics cibles, en particulier dans l’espace européen, façonnent des inégalités rivales (Bhopal, 2022) et confortent le pouvoir de la blanchité (Mayorga-Gallo, 2019 ; Doytcheva, 2018, 2020).
Approches critiques de la diversité
En somme, si l’on ne peut nier l’impact de la pensée et des mobilisations de la diversité au tournant du xxie siècle sur les mouvements politiques progressistes, cette mise en perspective historique nous invite aussi à en interroger les principes — plutôt changeants et hésitants — en matière de différenciation et d’égalité : qui sont les sujets légitimes de ces politiques ? Quel contenu positif et concret leur donner ? Dans un contexte où il est urgent de contrer les attaques idéologiques qui les ciblent, ce dossier fait le pari d’une autonomie réflexive et critique de la recherche sur ces questions. Bien que la recherche scientifique ne puisse se couper en la matière du débat politique, elle n’en est pas une chambre de résonance mécanique, mais doit maintenir au contraire une capacité réflexive et critique afin d’imaginer et faire advenir des horizons post-racistes — en éducation comme ailleurs.
Ainsi s’ébauche l’espace étroit et semé d’obstacles que notre dossier propose d’occuper, à savoir celui d’une critique dialectique de la diversité dans l’espace académique, qui ne cède rien ni à ses attaquants idéologiques au temps de la réaction conservatrice ni, non plus, à la facilité d’une vision irénique — car idéologiquement opposée — de ces politiques qui y verrait l’accomplissement achevé de la justice raciale et de l’équité. Ce sont les angles morts, tensions et contradictions des politiques diversité que ce dossier propose d’interroger, non pas pour les disqualifier en facilitant l’oeuvre de destruction de leurs adversaires politiques. Mais pour bâtir sur ces questions une analyse exigeante et informée qui ne répond pas aux agendas conservateurs. Comme nous y invite Sirma Bilge dans ce numéro, bien qu’il n’y ait pas de voie toute tracée en la matière, il est important de se saisir des contradictions, d’élargir les failles institutionnelles pour y installer des formes alternatives de compréhension de la relationnalité et de la contre-institutionnalité.
À la suite d’autres travaux, nous proposons de qualifier de critique cette approche de la diversité. En référence à Marx, Nancy Fraser (2012, p. 31) retient comme définition de la théorie critique et de la démarche critique, de manière plus générale, l’effort d’une « auto-clarification des luttes et des désirs du temps présent ». Cette définition souligne à la fois le caractère réflexif de la posture critique et son engagement à éclairer les luttes pour l’émancipation. En paraphrasant toujours Fraser (2005, p. 10), il est ainsi possible d’appréhender les approches critiques comme celles qui ne se réclament « que des composantes de la politique de la différence culturelle pouvant être combinées à une revendication sociale d’égalité ». Selon Patrizia Zanoni et al. (2010), malgré une variété de perspectives, ce que les approches critiques de la diversité ont en partage est une opposition commune à la vision instrumentale des différences qui caractérise la plupart des appropriations politiques et organisationnelles de ce paradigme. Au croisement de la CRT et des études critiques de la blanchité, les critical diversity studies forment un champ académique dynamique et en développement depuis la fin des années 1990. Celui-ci porte la focale sur deux questions parallèles mais interreliées que sont, d’une part, la dépolitisation apparente de ces politiques par leur individualisation et déconnexion des luttes sociales et, d’autre part, les effets de leur mise en marché. Les approches critiques de la diversité interrogent les conséquences de ce double mouvement en matière d’antiracisme et de lutte contre les discriminations et examinent ses contributions aux processus de reproduction d’une blanchité hégémonique. La transnationalisation des analyses en constitue un autre trait marquant.
un tournant global de la diversité
Malgré la transnationalisation croissante de la diversité sous influence étasunienne, l’enracinement de ces politiques dans des contextes historiques et politiques particuliers ne conserve pas moins sa prégnance. Les articles réunis dans son dossier en font état : le tournant global de la diversité épouse des trajectoires spécifiques en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse, en France ou au Canada. Au Canada, en particulier, la trajectoire des initiatives en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) relie le passé colonial du pays à son image actuelle sur la scène internationale de société inclusive et multiculturelle. Dans le sillage du multiculturalisme, le développement des politiques EDI est justifié par la nécessité de remédier aux iniquités causées par le colonialisme. En Europe, il est le fruit d’un processus plus récent d’européanisation de la lutte contre les discriminations qui se déploie au tournant des années 2000, à l’initiative d’abord d’acteurs néerlandais et britanniques. Notre dossier fait ainsi le pari d’un regard transatlantique sur ces politiques qui fait ressortir tant leurs dynamiques globales d’emprunt, d’hybridation et de mobilités que leur ancrage dans des contextes historiques.
Du multiculturalisme à la diversité : la trajectoire canadienne
Au Canada, la trajectoire des initiatives EDI relie le passé colonial du pays à son image actuelle sur la scène internationale de société inclusive et ouverte à la diversité. Adoptée en 1867, la Loi sur les Indiens, comme partie intégrante de la Confédération, et l’établissement des pensionnats autochtones, permettent en effet de situer le génocide physique et culturel des peuples autochtones dans l’histoire de la nation. En réduisant leur statut à celui de mineurs, le renforcement de leur dépendance à l’égard du gouvernement vise à empêcher leur autodétermination. Au nom d’une politique assimilationniste que justifie la volonté d’éduquer et d’émanciper, les enfants autochtones sont séparés par la force de leurs parents et placés dans des pensionnats où ils furent victimes de sévices et d’abus physiques, psychiques et sexuels. Par ailleurs, le racisme et la xénophobie ont été des idéologies constitutives des premières politiques d’immigration canadiennes. Après la Seconde Guerre mondiale, celles-ci et les discours qui les encadrent reposent sur l’infériorisation des migrants non blancs. Si l’accueil des immigrants et des réfugiés d’origine européenne fut encouragé, la Loi sur l’immigration chinoise, adoptée en 1885, impose une taxe d’entrée aux travailleurs chinois souhaitant immigrer au Canada. Au milieu du 20e siècle, encore, les réfugiés juifs n’ont pas le droit de s’installer.
C’est seulement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l’État canadien entame un processus de démocratisation progressive de ses institutions par le transfert de pouvoirs, d’abord, de Londres à Ottawa et la création de la citoyenneté canadienne. Accordée en premier lieu aux descendants de colons et d’immigrés blancs, la citoyenneté est étendue aux minorités noires et asiatiques en 1948, puis aux Inuits en 1950 et aux Amérindiens en 1960 (Helly, 2000 ; Doytcheva, 2005). La Déclaration canadienne des droits est adoptée la même année. Mais la consolidation de l’État canadien après-guerre au nom du projet universaliste de la citoyenneté ne parvient pas à enrayer des revendications nationalistes et identitaires. La société canadienne est fortement divisée selon des lignes raciales et culturelles qui placent les individus d’ascendance anglaise et, dans une moindre mesure, française en haut de l’échelle sociale, alors que la majeure partie des descendants de colons français, ainsi que les immigrés, composent la population laborieuse et que les Autochtones sont exclus des scènes économiques et politiques.
Face à cette division extrême, le gouvernement fédéral adopte des programmes de discrimination positive pour faciliter l’accès des francophones à la fonction publique : il déclare l’État canadien bilingue en 1969 et propose la même année l’abolition des réserves amérindiennes. En 1967, il démocratise la politique d’immigration en supprimant les restrictions racistes. Ces actions volontaristes montrent néanmoins une efficacité réduite : en 1969, les instances amérindiennes refusent leur intégration comme citoyens à part entière au nom de l’atteinte qui s’ensuivrait à la reproduction de leur vie communautaire et demandent une autonomie gouvernementale ; un parti souverainiste est fondé au Québec, où un mouvement de lutte armée entre en action en 1970.
C’est dans ce contexte que la politique du multiculturalisme voit le jour en 1971, adoptée par le gouvernement libéral de Pierre Trudeau. Sur le plan international, elle offre au Canada une image unique et distinctive qui lui permet de se singulariser au sein des organisations internationales en se démarquant des États-Unis et de l’Angleterre. Sur le plan national, l’adoption de cette politique, adossée aux idéaux des Nations unies en matière de droits humains, espère parvenir à la neutralisation des mouvements nationalistes au Québec et des activismes antibritanniques (Bloemraad, 2015 ; Triadafilopoulos, 2012) par la promotion des notions plus larges de diversité et d’inclusion. Dérivé du libéralisme politique (Kymlicka, 2010), le multiculturalisme canadien met l’accent sur la reconnaissance de la diversité des identités ethnoculturelles et la protection des droits des individus à manifester publiquement leurs appartenances.
En ce qui concerne la province du Québec, à la recherche d’une identité qui s’écarte du modèle multiculturaliste perçu comme anglo-saxon, celle-ci opte pour l’interculturalisme (Richard, 2009) qui vise le dialogue et le rapprochement des cultures autour d’une identité linguistique commune, matérialisée par la langue française et la promotion de la culture francophone. Bien qu’ayant des logiques distinctes, aussi bien le multiculturalisme canadien que l’interculturalisme québécois construisent idéologiquement la question de l’altérité au prisme de la notion de culture, occultant le fait que « la culture » invoquée dans les discours et les politiques publiques est, largement, normalisée et homogénéisée. De plus, ils encouragent la dichotomie anglophone/francophone comme principale référence identitaire, pouvant ainsi servir à minoriser les appartenances ethnoculturelles de l’immigration (Dhamoon, 2009 ; Dhamoon et AbuLadan, 2009). Dans le contexte sociopolitique et linguistique du Québec, où les enjeux identitaires peuvent intensifier la hiérarchisation des relations sociales entre minoritaires et majoritaires (Darchinian et Kanouté, 2021 ; Darchinian et Magnan, 2020 ; Breton, 2015), la prédominance de cette rhétorique dichotomique a des effets structurants sur les interactions sociales. Dans les milieux éducatifs, les expériences de linguicisme, de racisme et d’intolérance religieuse favorisent un repli identitaire des groupes minorisés et grèvent le vivre-ensemble.
Entre mobilisations locales et circulations globales
L’évolution des politiques EDI en éducation, au Canada, suit une trajectoire marquée par le militantisme et les mobilisations collectives contre le racisme systémique qui régit les institutions publiques, y compris éducatives, du primaire jusqu’à l’université. Le mouvement en faveur des droits des Premières Nations a ainsi contribué à la création, en 2015, de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) chargée de l’investigation sur les pensionnats. Dans la même lignée, le mouvement Land Back souligne la nécessité d’une reconnaissance officielle par les institutions publiques (dont des universités) des terres appartenant traditionnellement aux Premières Nations. En 2020, le mouvement Black Lives Matter, en sensibilisant l’opinion publique à l’histoire de l’esclavage, contraint les initiatives EDI à faire face au racisme systémique anti-Noir·e·s, plus particulièrement en éducation. Le mouvement en faveur des droits des personnes LGBTQ+ influe à son tour sur les initiatives EDI qui ciblent, de plus en plus, les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Quand #MeToo conforte les objectifs d’équité des sexes et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Enfin, le mouvement en faveur des personnes handicapées aboutit à l’adoption, en 2019, de la loi canadienne sur l’accessibilité, marquant également de son empreinte les initiatives institutionnelles en faveur de la diversité (Carastatis et al., 2018 ; Weldon, 2011).
Mais les leviers de ces évolutions sont aussi, et de plus en plus, internationaux et géopolitiques. Dans un contexte où l’impératif EDI, nouvelle base normative des démocraties libérales, revêt une dimension transnationale, au Canada aussi, ces politiques se muent au rythme de circulations globales. La mise en place d’initiatives relatives à la diversité en emploi et à l’éducation inclusive s’est ainsi fortement inspirée des politiques du même nom aux États-Unis. Au regard des similarités entre l’histoire du colonialisme au Canada et en Australie, en lien avec les processus historiques et contemporains de minorisation des peuples autochtones, force est de constater que le plan d’action australien de réconciliation a orienté l’implantation de la Commission de vérité et réconciliation dans le contexte canadien, ainsi que les politiques éducatives respectives et celles en faveur de l’accès des Peuples Premiers à la fonction publique (Regan, 2010 ; Short, 2003). Les politiques du Royaume-Uni ont été également un vecteur d’émulation. En s’inspirant des programmes britanniques d’Athena Swan et Race Equality Charter (Bhopal, 2018), le gouvernement canadien a introduit, en 2019, la charte Dimensions, ayant pour but de remédier à la sous-représentation des groupes historiquement marginalisés dans les programmes contingentés, notamment en science, technologie, ingénierie et médecine (STEM). Les politiques d’équité de genre des pays nordiques ont inspiré aussi les décideurs canadiens (Cardona López et al., 2018). Toutefois, la refonte dans le creuset du multiculturalisme ou de l’interculturalisme canadiens de l’ensemble de ces emprunts et hybridations n’a pas abouti, tant s’en faut, à l’élimination des processus de minorisation (Chicha, 2020 ; Abu-Laban et Gabriel, 2002). Focalisés sur la préservation et la valorisation des spécificités culturelles des groupes racisés ou « le rapprochement des cultures » par le biais de la langue française (Dhamoon, 2009 ; Dewing et Brosseau, 2009), voire sur une rhétorique de la « diversité heureuse » (Cornu, 2013), les efforts entrepris furent critiqués pour avoir dissimulé les rapports de pouvoir dissymétriques.
En parallèle, l’accumulation d’initiatives qui ciblent différents groupes discriminés (les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethnoculturelles, les personnes en situation de handicap), en l’absence de prise en compte réelle des dynamiques intersectionnelles des inégalités (Bilge, 2020), n’a pas permis d’altérer la surreprésentation de certaines populations — notamment autochtones et noires — au sein des positions sociales les plus désavantagées.
L’école face à l’impératif du vivre-ensemble
En éducation, les études consacrées à ces questions convergent autour de deux principaux axes : les processus multiformes de racialisation des élèves minoritaires, d’une part, et l’impératif de formation à la diversité et à l’inclusion des acteur·rice·s clés de la socialisation scolaire, à savoir, les enseignant·e·s, les intervenant·e·s scolaires et les directeur·rice·s d’école, d’autre part. En ce qui concerne les jeunes Autochtones, malgré la mise en place de politiques visant à accroître leur accès à l’éducation et leur réussite scolaire, des écarts importants persistent entre leurs réalités éducatives et celles du reste des Canadiens. Un taux de décrochage élevé au secondaire et un taux d’accès et de rétention faible à l’université montrent que les promesses égalitaires, véhiculées par le multiculturalisme et l’interculturalisme, n’ont pas été honorées. Par leur aveuglement à l’historicité des rapports de pouvoir, ils ont même pu contribuer à renforcer les processus de minorisation (Larochelle, 2021 ; Abawi, 2017 ; Thobani, 2007).
En ce qui concerne d’autres populations racisées, la recherche met en évidence la persistance et l’effet structurant de leur sous-représentation parmi les enseignant·e·s du primaire et du secondaire, et son impact sur le développement d’un sentiment d’exclusion chez les élèves qui en sont issues. L’étude de Darchinian et al. (2021) souligne en particulier la prédominance démographique d’enseignant·e·s blanc·he·s dans un contexte majoritairement composé d’élèves non blanc·he·s, soulignant les processus de racialisation qui en résultent des élèves noir·e·s et latino-américain·e·s. En plus de cette sous-représentation, la carrière d’enseignant·e et de directeur·rice minoritaires dans les écoles à forte diversité ethnique est émaillée de barrières systémiques qui engendrent une charge émotionnelle et une fatigue raciale, partie intégrante de leur quotidien professionnel (Lafortune et Kanouté, 2023 ; Abawi et Eizadirad, 2020 ; Ryan et al., 2009).
Malgré le portrait globalement positif de la réussite scolaire des jeunes issu·e·s de l’immigration au Canada et au Québec, les résultats d’études empiriques mettent en lumière les inégalités systémiques qui touchent plus particulièrement certaines sous-populations. Par exemple, les parcours scolaires des jeunes originaires d’Asie du Sud et des Caraïbes, marqués par le désavantage socioéconomique, sont également ponctués de retards et d’échecs scolaires (Bakhashei et al., 2016 ; Potvin et al., 2015). Les jeunes Haïtiens et Haïtiennes, en particulier, sont surreprésenté·e·s dans les classes destinées aux élèves présentant des difficultés d’apprentissage. Concernant les élèves d’origine asiatique, souvent qualifié·e·s de « minorité modèle », en dépit de performances scolaires remarquables, ils et elles peuvent se sentir exclu·e·s et victimes du racisme au quotidien (Sun, 2014 ; Chu, 2023 ; Doucet, 2022 ; Chu et Darchinian, 2024). L’étude menée par Chu et Darchinian (2024) des expériences scolaires de jeunes Vietnamien·ne·s à Montréal met en lumière en particulier l’internalisation de la blanchité en tant que norme sociale, conduisant ces jeunes à mettre à distance tant leur culture d’origine que celle de la société d’accueil. Ces résultats illustrent la complexité des processus de minorisation à l’oeuvre et ouvrent la voie à une réflexion critique sur la rhétorique de la réussite, souvent présentée comme constitutive de l’identité canadienne en tant que société d’accueil inclusive.
Par le biais des contenus éducatifs et des relations pédagogiques constitutives de la transmission des savoirs, le curriculum scolaire participe de ces processus de racialisation, opérant comme un outil hégémonique de socialisation consciente et inconsciente aux normes et valeurs de la majorité blanche (Jay, 2002 ; Nieto, 2000). Au Québec, les travaux de Larochelle (2021) montrent la continuité historique des pratiques altérisantes propres à l’école québécoise, mettant en évidence, à travers l’étude du matériel scolaire (contenus, devoirs et activités « parascolaires ») aux xixe et xxe siècles, une représentation historique infériorisante de l’Autochtone, de l’Arabe, du Noir et du Chinois. Larochelle souligne du reste la double visée de ce processus d’altérisation, également utilisé comme stratégie pour susciter la motivation scolaire chez les jeunes Québécois blancs. D’autres études ont mis en évidence la prédominance des références culturelles et identitaires francophones/anglophones dans les programmes d’Univers social et de Culture et citoyenneté québécoise ; la place limitée accordée à l’histoire des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des immigrants du Sud (Darchinian, 2023 ; Larochelle, 2021 ; St-Denis, 2011). À titre d’illustration, l’étude de Darchinian (2023) du rapport des jeunes filles musulmanes aux cours d’histoire et d’« éthique et culture religieuse » au secondaire fait ressortir le malaise ressenti par ces jeunes femmes du fait que leurs caractéristiques ethnoreligieuses et culturelles sont soit absentes du programme, soit abordées de façon tronquée et par des stéréotypes.
L’absence d’une formation adéquate des acteur·rice·s important·e·s de la socialisation scolaire dans des milieux hautement diversifiés est un facteur explicatif du rôle de l’école dans la reproduction des préjugés et stéréotypes raciaux (Audet et al., 2020 ; Magnan et al., 2021 ; Archambault et al., 2018 ; Kanouté et Lafortune, 2011). Des notions comme les biais implicites, le racisme inconscient, les microagressions, conséquence d’une vision à la fois déficitaire et homogénéisante des élèves non blanc·he·s, ont été mobilisées pour souligner l’enjeu de formation. Dans le contexte d’une polarisation accrue des rapports éducatifs, la sur-représentation des jeunes Noir·e·s dans les classes spécialisées, leur médicalisation et l’hypersurveillance dont ils et elles sont l’objet (Collins, 2022 et dans ce numéro ; Anadon et Collins, 2023 ; Braa dans ce numéro) peuvent résulter en effet d’un défaut de conscience, en lien avec l’absence de formation.
En somme, telles que promues par l’école au Canada et au Québec, sur la base d’une idéologie politique (la méritocratie) et économique (l’individualisme néolibéral), les initiatives en faveur de la diversité restent indifférentes au privilège blanc. Elles occultent les rapports de pouvoir. Malgré des politiques valorisant la diversité ethnoculturelle et visant à l’inclusion des populations issues de l’immigration, les institutions éducatives québécoises et canadiennes, supposément pluralistes, demeurent des espaces politiques où la construction d’un Autre racialisé s’actualise, contribuant à la reproduction d’un racisme systémique.
La diversité à l’épreuve de l’université néolibérale
La restructuration des universités canadiennes résulte de changements économiques et politiques des années 1970 qui visent à l’adapter au nouveau contexte sociopolitique régi par la libéralisation des marchés et l’exigence de compétitivité. Au tournant de la crise économique des années 1980, la logique marchande pénètre la nouvelle gestion publique, y compris des universités qui, fidèles à cet ancrage néolibéral, ont rapidement assimilé les approches néo-managériales de la diversité, mettant l’accent sur l’excellence, l’innovation et l’efficacité (Bilge, 2020 ; Doytcheva, 2020 ; Oliveira et Avoine, 2017). Dans la continuité des orientations formulées par le gouvernement fédéral, et relayées à l’échelle provinciale, elles se sont dotées de politiques internes de promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (Université d’Ottawa, Beauchamp, 2020 ; Gaudreault-Desbiens et Boutrouille, 2020 ; Université de Montréal, Mc Andrew, 2020). Les travaux de recherche en dressent cependant un bilan mitigé : si certaines études reconnaissent les avancées réalisées en matière d’inclusivité, d’autres soulignent les résultats limités des initiatives EDI, qui opèrent davantage comme des moyens de légitimation institutionnelle que de remise en question des inégalités et normativités dominantes (Pizarro Milian et Wijesingha, 2023 ; Smith, 2018 ; Ahmed, 2012 ; Myers et Bhopal dans ce numéro).
Selon les conclusions de plusieurs travaux empiriques d’envergure (Campell, 2021 ; Henry et al., 2017 ; M. Smith, 2018), malgré l’institutionnalisation de ces préoccupations dans les universités canadiennes, les objectifs d’équité, de diversité et d’inclusion semblent loin d’être atteints. En ce qui concerne par exemple la politique de recrutement et de rétention du corps professoral — un des volets de ces politiques au Canada —, des études portant sur les conditions de travail du personnel enseignant ont révélé la précarisation croissante des métiers de l’enseignement, reflétée par le nombre croissant de professeur·e·s sous contrat à court terme et la baisse subséquente de professeur·e·s permanent·e·s ou occupant des postes menant à la permanence. Outre les conditions précaires d’emploi, ces travaux soulignent le caractère genré et racialisé des iniquités vécues par les enseignant.es contractuel·le·s à l’université (Nichols, 2023 ; Dawson et al., 2019 ; Field et al., 2014 ; Bourabain dans ce numéro).
Dans ce contexte, l’engagement des universités canadiennes en faveur de la diversité contribue à la perpétuation d’une rhétorique symbolique plutôt qu’à l’avènement d’un véritable changement institutionnel. Plutôt que de contribuer à des réformes substantielles en faveur de la justice sociale, l’instrumentalisation des enjeux EDI dans la gouvernance académique semble prendre la forme d’un processus de tokenisation (Cukier et al., 2021 ; Campell, 2021 ; Pidgeon, 2016). Comme le montre Campell à cet égard, la réception des politiques d’EDI par des acteur·rice·s universitaires se traduit par la minoration de la complexité et de l’interdépendance des structures de pouvoir, en amont comme en aval de l’université ; la non prise en compte de leur dynamique intersectionnelle et la résistance à l’introduction de changements structurels (Campell, 2021). De ce point de vue, ces initiatives échouent à remédier aux iniquités systémiques et à l’injustice épistémique qui touche les peuples autochtones, ainsi que les communautés racisées (Stein et de Oliveira Andreotti, 2017). D’un côté, les barrières systémiques qui perdurent dans l’univers académique canadien perpétuent la sous-représentation des personnes racisées, notamment des femmes racisées, parmi les membres du corps professoral. D’un autre côté, l’attribution de rôles et de mandats reliés à leur identité raciale les situe à la marge de l’hégémonie du pouvoir (Hirshfield et Joseph, 2012 ; Kobayashi, 2009). L’omniprésence de formes explicites et implicites de racisme au quotidien et la racialisation insidieuse de l’université qui en résulte renvoie aussi à un phénomène d’infériorisation du savoir et de l’histoire des peuples autochtones, des Afro-descendants et des personnes racisées, participant de leur oppression comme sujets non blancs (Pete et al., 2013). Dans un contexte où la colonialité du pouvoir est maintenue, voire renforcée, par les processus de néolibéralisation de l’université qui structurent les pratiques institutionnelles autour de normes d’excellence et de performance, la célébration d’une « diversité heureuse » et « bienveillante » converge peu, en définitive, avec les impératifs de remédiation.
L’européanisation de la lutte contre les discriminations
Dans le contexte européen, à l’exception de la Grande-Bretagne où ces développements reflètent de près les politiques étatsuniennes, le tournant de la diversité s’opère en lien avec les initiatives de l’Union européenne qui, à la fin des années 1990, s’engage pour construire un cadre juridique et politique contre les discriminations. À l’intersection des préoccupations économiques du marché unique — où marchandises, travailleurs et capitaux doivent circuler librement — et d’un projet plus politique d’intégration et de citoyenneté, la question des discriminations épouse la vision européenne du moment. À la faveur du Traité de Maastricht de 1992 qui, pour la première fois, institue une citoyenneté européenne en la dérivant de celle des États membres, un bouleversement important a lieu au sein des réseaux militants et d’entrepreneurs de cause qui se mobilisent sur ces enjeux dans le giron de la Commission. En lieu et place d’une citoyenneté européenne déterritorialisée, débarrassée des nationalismes d’antan, qui constitue une revendication historique désavouée par Maastricht (Favell, 2000 ; Guiraudon, 2004), une nouvelle expertise s’impose dans le champ de la cause de l’immigration. Emmenée par des acteurs anglo-néerlandais, spécialistes en droits humains et des minorités, elle aboutit à la construction politique du problème des discriminations.
Jusque-là, la plupart des pays européens, à l’exception de la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, des Pays-Bas, ont en effet un dispositif juridique et politique assez modeste, voire inexistant, en matière de lutte contre les discriminations. Dans beaucoup de pays, il se construit à la faveur de la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, 1965). La logique qui prévaut alors dans les législations nationales est celle de la criminalisation du racisme et de la discrimination raciale (Suk, 2008). En France, cette logique trouve ses origines dans l’entre-deux-guerres et la législation naissante contre la propagande antisémite ; cependant que la mémoire de la Shoah marque les processus législatifs qui accompagnent le renouvellement de ces dispositions au cours des années 1970. Bien que des provisions soient progressivement introduites en droit civil — également sous égide européenne — la prévalence de la voie pénale fait que peu d’actions sont introduites en justice : les condamnations pour discrimination raciale se comptent sur les doigts de la main[9].
Dans ce contexte, l’initiative législative européenne vise à remédier aux carences d’un cadre juridique inopérant en le rendant plus attractif pour les plaignants et les professionnels du droit. Par ailleurs, dès les années 1980, la Communauté économique européenne est à l’origine de commissions parlementaires, chargées d’enquêter sur le racisme, en particulier dans les régions à forte immigration. Leurs travaux soulignent la montée de « sentiments diffus de xénophobie » à l’égard des communautés de l’immigration : sans nécessairement se confondre avec une « hostilité agressive et délibérée », ils recouvrent des « attitudes de défiance » et « des comportements discriminatoires au quotidien » (Evrigenis, 1985, p. 60, 92). Alors que l’UE dispose de compétences importantes en matière de contrôle des frontières et de politiques d’immigration, elle n’en a quasiment aucune sur le volet de la citoyenneté et de l’inclusion. C’est donc dans ce contexte que la lutte contre les discriminations est placée à l’ordre du jour, à la faveur d’un effort de politisation du marché commun et l’intérêt porté aux questions de justice sociale.
Malgré la centralité historique de l’antiracisme dans le processus européen de réinvention de la non-discrimination, la voie rapidement choisie sera celle de l’« universalité juridique de la discrimination » (Lanquetin, 2004). Selon cette perspective, portée d’abord par une expertise juridique qui s’avère prépondérante dans le champ de la cause des migrants, les mécanismes de la discrimination, leurs effets, ainsi que les leviers pour les combattre sont identiques, quel que soit le motif sous-jacent[10]. Aussi, le droit européen consacre l’universalisation du principe de non-discrimination en retenant simultanément et de manière indifférenciée plusieurs catégories protégées : au nombre de six dans le Traité d’Amsterdam, en 1997, elles sont dix-sept dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE en 2000 ; douze dans la loi française contre les discriminations en 2001 qui transpose les directives européennes et vingt-six en droit français aujourd’hui.
Parallèlement à cette expansion rapide du régime, à peine né de l’antidiscrimination, une deuxième innovation majeure voit le jour. Dès 2003, la Commission européenne (2003, 2005), dans deux rapports aux titres explicites, embrasse la raison de la diversité et en particulier son business case, dans une logique d’isomorphisme mimétique avec le monde corporate et les grands groupes américains. La promotion de la diversité subsume et requalifie la lutte contre les discriminations avant même que celle-ci n’ait eu le temps d’émerger, une séquence historique que Doytcheva (2020) analyse en termes d’« intégration inversée ». Combinée aux approches dites « horizontales » ou « inclusives » (qui étendent ces préoccupations au-delà des groupes protégés en droit, eux-mêmes en augmentation), les effets délétères de managérialisation de la diversité n’en ont été que davantage accélérés. La dé-racialisation presque complète de ces politiques et le blanchiment d’une diversité supposément « sans race » constituent aujourd’hui une conséquence majeure : bien que la France, avec sa vision républicaine, offre ici un cas paradigmatique, sa situation en Europe est loin d’être atypique.
Discriminations et diversité à l’université : le cas français
Si le monde de l’entreprise et, dans une moindre mesure, la sphère politique furent dans un premier temps en France le cadre par excellence de développement de ces politiques, leurs préoccupations se sont communiquées dans la période récente à l’éducation et à l’université. Dès le début des années 2000, de grandes écoles et d’autres institutions de l’élite, telles que Sciences Po à Paris, s’emparent du souci de diversification de leurs promotions, très majoritairement composées d’étudiant·e·s venant de milieux sociaux (hyper)privilégiés. Alors que le programme emblématique de Sciences Po a perduré, pour des effets toutefois limités (Oberti et al., 2024 ; Van Zanten, 2023 ; Allouch, 2022), tel ne fut pas nécessairement le cas d’autres initiatives, dont les actions furent jugées fragmentées, sans cadre national et perspective d’ensemble, avec peu de continuité (Bonneau et al., 2021 ; Gaide et Kam, 2019).
Aussi, faut-il attendre le milieu de la décennie suivante pour voir ces préoccupations se communiquer à l’université publique, à la faveur d’un contexte marqué par le repli de l’activisme patronal (Alaktiff et Doytcheva, 2018). Après une décennie riche en signatures de chartes et obtention de labels[11], le monde de l’entreprise se dit « fatigué » de ses efforts de conformation, d’autant qu’ils n’ont pour base juridique que sa propre « bonne volonté ». Afin de compenser l’érosion des initiatives qui, malgré leur caractère privé, font seules office de politique contre les discriminations, à partir de 2015, l’État invite l’administration à rejoindre le mouvement de certification. En 2017, #MeToo précipite ses préoccupations, créant en l’espèce des violences sexuelles et sexistes de nouveaux objets et priorités d’intervention.
Malgré l’antériorité des travaux en sciences sociales sur la reproduction des inégalités, les discriminations à l’école constituent en France un objet récent et comparativement peu documenté. La première étude d’envergure à examiner l’écart de résultats entre élèves immigrés et locaux dans le secondaire (Valet et Caille, 1996) conclut d’ailleurs, à rebours d’enquêtes qualitatives (Payet, 1995), à une meilleure performance des élèves issus de l’immigration. Aussi, faut-il attendre les années 2000 et le processus d’européanisation décrit plus haut pour que la discrimination émerge en tant qu’objet dans le champ scolaire. Régulièrement classé dans les enquêtes internationales parmi les systèmes les plus inégalitaires, voire « le plus inégalitaire », parmi les pays à performance scolaire élevée (OCDE, 2023), le système éducatif français peine à faire toute la lumière sur l’étendue des discriminations. Alors que l’incidence massive de la ségrégation scolaire, y compris raciale, est connue et documentée (Felouzis, 2003 ; Van Zanten, 2001), ses effets sont accentués par une « performance en ciseaux » (Cnesco, 2016) qui, depuis les années 2000, accompagne les réformes néolibérales[12]. L’absence de mesure systématique des variables liées à l’origine ethnique rend toutefois possible une forme d’opacité : si des données statistiques signalent que les élèves issus de l’immigration dans leur ensemble obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs dans l’enseignement secondaire (Ichou, 2016 ; Brinbaum et Cebolla-Boado, 2007), d’autres enquêtes soulignent, au contraire, que l’école est un terrain privilégié de prime expérience du racisme, y compris parmi les descendants d’immigrés européens (Primon, 2018 ; 2022).
Si ces inégalités importantes se transmettent de manière attendue de l’enseignement secondaire à l’université, ce n’est que dans la période la plus récente que la question du racisme et des discriminations y fut posée. Lancé en 2018, avec le soutien du Défenseur des droits et autres institutions publiques, le projet ACADISCRI (Hajjat et al., 2022) a permis de lever le voile sur cette réalité : si 20 % des répondant·e·s estiment avoir subi un traitement discriminatoire, ce chiffre est de plus de 50 % en ce qui concerne le personnel[13]. À la demande de ses soutiens institutionnels, toutefois, la conception de l’enquête fut « élargie » pour inclure la mesure d’autres expériences vécues de discrimination, liées au sexe, genre, orientation sexuelle, handicap, mais aussi statut social, santé, et même activité syndicale.
Contrairement au monde de l’entreprise, il n’existe pas d’initiatives en matière de diversité propres à l’espace académique. Cette situation est amenée à évoluer en 2019, à la faveur de la loi pour la transformation de la fonction publique qui renforce les obligations de l’administration. S’appuyant sur un engagement de longue date en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, y compris un texte de 2013 qui installe des « missions égalité » dans les universités, la loi réitère l’obligation pour chaque université de se doter de référent·e·s égalité. Dans le sillage de #MeToo et d’initiatives législatives ciblant le harcèlement, elle rend obligatoire la création de cellules d’écoute, chargées de recueillir les signalements pour « violence sexuelle et sexiste ». Bien que les obligations des missions égalité soient réglementairement circonscrites aux « discriminations liées au sexe, à la grossesse et à la situation de famille, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles », dès 2020, par le truchement d’appels à projets, « programmes pilotes » ministériels et autres circuits d’influence, dont des associations professionnelles, l’invitation à y adjoindre la notion de diversité fait son chemin[14].
Les missions universitaires se nomment désormais « Égalité et Diversité » (ou « Égalité et lutte contre les discriminations »), alors que des bureaux « Égalité, Diversité et Inclusion » sont créés au sein des directions de ressources humaines. Dans un contexte de mise en concurrence généralisée au plan local, comme international, en à peine quelques années, les universités françaises ont été ainsi placées à égalité avec leurs consoeurs britanniques et nord-américaines et désormais dotées d’une vice-présidence, d’un bureau RH et de responsables dédiés. Ce changement fulgurant, ainsi que le leadership, plutôt contre-intuitif, de la France en matière de diversité au sein de l’UE, ne saurait toutefois nous induire en erreur. Si, en théorie, beaucoup de ces engagements se réfèrent à « l’ensemble des discriminations », soit les 26 catégories actuellement retenues par la loi française, dans les faits, ils demeurent assez étroitement liés aux préoccupations historiques en matière d’égalité des sexes, de harcèlement, de VSS.
Dans ces conditions, c’est bien d’une opération de diversity-dropping dont il s’agit qui consiste à s’en approprier le langage au bénéfice des enjeux de genre, élargis le cas échéant à la question de la sexualité et de la transidentité. Également accueillies sous ces missions-ombrelle, les dispositions liées au handicap relèvent, quant à elles, de régulations spécifiques et disposent de leurs propres outils. De ce point de vue, les acteurs de la diversité académique semblent faire preuve d’un défaut de sincérité qui surpasse celui des acteurs économiques : alors que ces derniers avaient progressivement « élargi » leurs politiques pour y inclure toutes sortes de préoccupations, les premiers se contentent de renommer ce qu’ils font déjà sur un autre sujet, à des fins de communication.
Quant à l’antiracisme, bien que l’État ait institué la date du 21 mars en « Journée contre le racisme », devant être marquée dans toutes les universités par des activités spéciales, force est de constater qu’il joue encore et toujours l’arlésienne dans ces politiques. Le registre événementiel prévaut, la « sensibilisation » reste de mise plus de vingt ans après les premières initiatives de la loi contre les discriminations. Le prisme commémoratif l’emporte, faisant la part belle à une violence figée dans le passé (Lentin, 2020), quand ce n’est la réitération d’un récit dominant qui vise à susciter l’adhésion aux valeurs nationales, plus qu’il ne donne des outils aux minoritaires pour se défendre (Cognet et Dhume, 2020). À titre d’exemple, la première « mesure phare » du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme adopté par le gouvernement en 2023 prévoit ainsi l’obligation d’« organiser une visite historique ou mémorielle en lien avec le racisme, l’antisémitisme ou l’antitsiganisme pour chaque élève au cours de son parcours scolaire » ; ou encore, la création « d’une frise républicaine de dates historiques à célébrer autour de la fraternité [pour] en faire des moments positifs pour l’unité de la Nation » (DILCRAH, 2023, p. 10). L’événementialisation — festive ou commémorative de ces problématiques — participe dans ce contexte à renouveler la compréhension du racisme en tant que préjugé individuel, par opposition à désavantage systémique, et, partant, à conforter son emprise institutionnelle et politique. En ce sens, le monde académique français demeure le lieu d’un puissant déni du racisme et le règne prétendu de la norme méritocratique.
regards transatlantiques
Les contributions réunies dans ce dossier ont en commun la proposition d’interroger l’ancrage colonial des universités du Nord global en tant qu’agentes de la blanchité et la manière dont elles en assurent la protection par un ensemble d’instruments discursifs et institutionnels dont participent les initiatives EDI. Si certaines contributions privilégient un regard critique sur les initiatives institutionnelles en faveur de la diversité afin d’analyser leurs angles morts et contradictions, d’autres s’attardent davantage sur les expériences vécues d’étudiant·e·s et agent·e·s, victimes du racisme et des discriminations. Toutes permettent néanmoins de tisser des liens entre les expériences européennes — suisse, belge, britannique — et nord-américaines, étatsunienne et canadienne. Ce regard transatlantique permet de souligner la transnationalisation forte de ces problématiques au diapason des logiques globales de néolibéralisation qui s’étendent désormais non seulement à l’université mais aussi aux enjeux de justice sociale.
Ouvrant le dossier, l’article de Sirma Bilge rappelle à quel point l’université néolibérale est vorace en ressources, temps, énergie venant en particulier de ses membres racisé·e·s. En s’appuyant sur les travaux de Himani Bannerji, elle avance l’hypothèse selon laquelle, convié·e·s à la table des discussions, elles et ils ne restent pas moins « au menu » — illustrant une forme d’« autophagie » qui révèle la violence subtile et systémique de leur implication académique. Sur ces questions, Bilge souligne la difficulté d’imaginer des interventions qui puissent déstabiliser l’institution hégémonique, au lieu de servir ses intérêts, en transformant par exemple l’altérité subversive en « diversité bénigne », mais qui ne fait pas de différence. Elle en entrevoit la possibilité à condition d’investir et d’élargir les failles institutionnelles : plus que par un programme explicite, cela passe par un travail relationnel au quotidien et une inspiration puisée dans des pratiques exogènes à l’espace académique, comme celles promues par des penseur·euse·s autochtones et afro-américain·e·s.
Cette perspective est également explorée par l’article de Dounia Bourabain qui se consacre à l’analyse des tactiques de résistance de femmes chercheures en début de carrière, engagées dans un « travail de frontière » pour faire plier le racisme-sexisme de l’institution. En mobilisant les concepts de résistance ordinaire de James Scott et de space invaders de Nirmal Puwar, Bourabain utilise un prisme spatial pour interroger les exclusions vécues par les femmes blanches et racisées en début de carrière, ainsi que le rôle de la méritocratie dans leur reproduction au quotidien. Les données tirées d’une étude qualitative, fondée sur les expériences de cinquante femmes dans cinq universités flamandes de Belgique, lui permettent d’identifier plusieurs tactiques de résistance que celles-ci mettent en oeuvre pour redéfinir les frontières sexistes et racistes de l’institution, devenant ainsi de véritables « interprètes de l’espace ».
Dans la continuité, l’article de Lafortune et collègues révèle les mécanismes profonds de racialisation, mais aussi de déni du racisme, qui continuent à structurer l’espace académique canadien, malgré de nombreux engagements en faveur de l’inclusion. À l’origine de leur réflexion, les résistances rencontrées lors d’un projet de recherche sur l’expérience des élèves noir·e·s dans le système scolaire québécois. L’article propose de documenter ces différentes formes de résistance auxquelles se heurte la démarche de recherche, dévoilant en creux les épistémologies de l’ignorance au service de l’institution. L’article met ainsi en lumière l’emprise d’une vision post-raciale, associée à la perception d’un Québec inclusif et égalitaire, et la manière dont celle-ci contribue à maintenir les structures de pouvoir en minimisant l’importance du racisme.
Le climat post-racial du système éducatif du Québec est également interrogé dans l’article de Tya Collins. En s’appuyant sur la critical black theory et les critical dissability studies, Collins met en lumière les limites des approches culturalistes et le défaut d’analyse du racisme systémique dont sont victimes les élèves noir·e·s, sur-représenté·e·s en éducation spécialisée. Utilisant la méthode des contre-récits, elle révèle l’écart entre la perception du personnel scolaire et les vécus des élèves noir·e·s, invitant ainsi à déconstruire la notion de « besoins particuliers ». Reprenant le concept d’adultisation, l’article montre comment la construction par le personnel scolaire des élèves noir·e·s comme moins « innocent·e·s » conduit à des punitions démesurées et des pratiques disciplinaires inappropriées, porteuses d’une dynamique d’aliénation profonde des élèves placé·e·s.
Dans la perspective également de la critical race theory, la contribution de Martin Myers et Kalwant Bhopal examine l’appropriation des politiques EDI par les universités américaines et britanniques de l’élite. Théorisant, à la suite de Derrick Bell, une dynamique de « divergence des intérêts » et de « repli blanc », les auteurs montrent comment ces politiques sont détournées pour augmenter le « mérite » et valoriser le travail des étudiant·e·s blanc·he·s sur les campus de l’élite. À partir d’une enquête qualitative par entretien menée aux États-Unis et au Royaume-Uni, auprès d’étudiant·e·s de cycles supérieurs, ils théorisent le « capital blanc » comme mécanisme central de la reproduction du racisme sur les campus de l’élite. Marque d’appartenance et label méritocratique, celui-ci est utilisé comme un véritable avantage stratégique par les étudiant·e·s blanc·he·s et aisé·e·s qui s’appuient sur les mesures de l’affirmative action pour renforcer les frontières de l’institution.
Dans le contexte des États-Unis, la contribution de Natasha Warikoo et Janine de Novais se penche également sur l’expérience des étudiant·e·s blanc·he·s sur les campus de l’élite. À partir d’une enquête par entretien, les autrices montrent comment les cadres raciaux, à savoir les prismes par lesquels les individus interprètent le rôle de la race, évoluent à la faveur de leurs trajectoires scolaires et de leur admission à l’université. Si le cadre de l’aveuglement à la couleur (colorblindness) prévaut dans leurs expériences pré-universitaires, c’est le cadre de la diversité qui semble s’épanouir sur les campus américains. Warikoo et De Novais soulignent néanmoins l’ambivalence de ces socialisations et des cadres raciaux qui en résultent, souvent maniés ensemble par les mêmes individus. Elles interrogent avec le recul la capacité de la raison de la diversité à soutenir un effort ambitieux en matière de justice sociale et soulignent les apports d’une analytique du pouvoir pour faire face au racisme systémique.
Cette question est explorée plus loin dans la contribution de Milena Doytcheva qui revient sur la retentissante affaire SFFA, ayant récemment conduit la Cour suprême étatsunienne à annuler la jurisprudence Bakke, considérée comme acte fondateur des politiques de diversité à l’université. À travers une démarche sociohistorique qui met en perspective cinquante ans de combats judiciaires ayant jalonné la (dés)institutionnalisation de ces politiques aux États-Unis, Doytcheva identifie trois mécanismes qui affaiblissent le récit de la diversité comme fondement des politiques d’égalité : la normativité universalisante de la blanchité et la répudiation de la logique correctrice, l’emprise de l’élitisme qui privilégie les enjeux d’image et de réputation au détriment de ceux de justice sociale. L’article offre enfin un regard comparatif suggérant que, loin d’être propres aux États-Unis, ces mécanismes ont été amplifiés par la réception européenne de ces politiques.
Dans le contexte de la Suisse, cette fois, l’article de Saaz Taher revient sur le déboulonnement des statues de figures historiques associées à l’esclavagisme et au colonialisme, en réponse au mouvement antiraciste de 2020. Adoptant une perspective d’épistémologie critique, Taher s’appuie sur les concepts de colonialité, de post-racialisme, de violence et de résistance épistémiques pour interroger la marginalisation des voix des communautés noires au sein des récits nationaux dominants qui perpétuent l’héritage colonial. Elle met notamment en lumière la manière dont le lien étroit entre identité nationale et mémoire collective permet à la majorité blanche de conserver sa position de pouvoir par le biais de récits alarmistes, inquiets de l’effacement de l’histoire nationale.
La contribution d’Amani Braa qui clôt le dossier revient enfin sur la racialisation des enjeux de (dé)radicalisation en contexte canadien. Prenant appui sur une enquête qualitative par entretiens et récits de vie et une analyse interprétative des expériences socioscolaires, Braa montre ainsi à quel point les politiques en théorie « préventives » ajoutent un fardeau supplémentaire de discrimination pour les jeunes musulman·e·s racisé·e·s dans les cégeps montréalais. Face aux mesures de surveillance agressive qui créent un environnement hostile à leur épanouissement, elle examine comment ils et elles sont partagé·e·s entre postures d’allégeance et de loyauté, d’une part, et de désengagement et de désespoir, d’autre part. En référence aux travaux de Hirschman, Braa interroge l’importance revêtue dans ce contexte par une posture hybride qui est celle de la résilience ou de la résignation, dont la saillance reflète les logiques profondes de racialisation et d’islamophobie qui traversent l’institution.
Appendices
Notes
-
[1]
Students for Fair Admissions v. Harvard, 600 U.S. 181 (2023).
-
[2]
Stop Wrongs to Our Kids and Employees Act, également connu comme Individual Freedom Act.
-
[3]
Parmi les plus actifs : Claremont Institute, Heritage Foundation, Cato Institute, Manhattan Institute, mais aussi Idaho Freedom Foundation, Velocity Convergence, à l’origine de l’initiative anti-DEI dans le Tennessee.
-
[4]
Voir, par exemple, l’entretien accordé par E. Macron à ELLE : https://www.elle.fr/Societe/News/Emmanuel-Macron-son-entretien-exclusif-avec-ELLE-3934484
-
[5]
https://x.com/realchrisrufo/status/1371540368714428416?lang=fr Nos traductions.
-
[6]
Avocat d’affaires et membre du conseil d’administration de Philip Morris jusqu’à sa nomination en 1971 à la Cour suprême par Nixon, Powell déplore les menaces qui pèsent sur le système de la liberté d’entreprise aux États-Unis : composés de « Communistes, New Leftistes et autres révolutionnaires » (Powell, 1971), ses assaillants « extrémistes » se recrutent désormais à l’université, dans les cercles scientifiques et littéraires. Mais le danger vient aussi des syndicats, des mouvements de consommateurs qui s’érigent contre l’irresponsabilité meurtrière de l’industrie automobile et bientôt du tabac. Le mémorandum confidentiel qu’il rédige en 1971 est ainsi crédité d’avoir inspiré la création d’un important réseau d’organisations conservatrices, ironie de l’histoire, à l’origine de la campagne actuelle anti-DEI, dont en premier lieu Heritage Foundation, Cato et Manhattan Institute (voir note supra).
-
[7]
Bell soutient ainsi, qu’en fonction du contexte, la mixité raciale peut être un objectif éducatif « avantageux », non pertinent ou même « désavantageux » : « des remèdes beaucoup plus effectifs à la subordination raciale à l’école pourraient être obtenus si les énergies créatrices des organisations de défense des droits civiques s’alignaient sur les besoins et les désirs de leurs clients » (Bell, 1976, p. 88), au lieu de poursuivre la mixité comme symbole politique.
-
[8]
À noter que le jeu de mots est plus significatif encore en langue française où, dans le contexte d’émergence des politiques européennes de la diversité, au début des années 2000, des travaux soulèvent aussitôt la question d’une « stratégie de diversion » (Guiraudon, 2004 ; voir aussi infra).
-
[9]
Dans le cas de la France, ces chiffres sont de : 3 en 1997, 7 en 1999, 16 en 2000, 12 en 2001, 29 en 2002, 9 en 2012, 7 en 2013, 14 en 2014 et 7 en 2015. Sur ces enjeux, voir Latraverse et Doytcheva (2018).
-
[10]
Selon Virginie Guiraudon, l’extension des bases du principe de non-discrimination est d’abord soutenue par la fédération d’ONG « Ligne de départ », à l’origine de la revendication d’une action législative européenne contre les discriminations, avant d’être reprise à son compte par l’administration : « Le groupe Ligne de départ comprit qu’il pouvait rassembler dans une coalition d’autres lobbies européens tels que le Forum Européen des Personnes Handicapées et détourner l’attention des populations immigrées qui ne bénéficiaient pas toujours de la plus grande sympathie » (Guiraudon, 2004, p. 46).
-
[11]
Parmi les plus importants, on peut citer : la Charte de la diversité (promue par l’IMS en 2004), la Charte de la parentalité (L’Oréal, 2008), la Charte LGBT (l’Autre cercle, 2008), le Label Égalité (AFNOR, 2004), le Label Diversité (AFNOR, 2008), le Label Alliance (AFNOR, 2016).
-
[12]
Dans la dernière édition de l’enquête PISA, cet écart entre élèves natifs et immigrés ou issus de l’immigration est de, respectivement, -60 et -47 points, alors que pour ne donner qu’un exemple, c’est l’inverse qui est vrai au Royaume-Uni, mais aussi en Ontario (OCDE, 2023, p. 34).
-
[13]
Le projet fait notamment suite au colloque « Racisme et discriminations raciales, de l’école à l’université » qui s’est tenu en 2018 à l’Université Paris Diderot : https://www.canal-u.tv/chaines/univcotedazur/colloque-racisme-et-discrimination-raciale-de-l-ecole-a-l-universite
-
[14]
À noter que cette démarche est préfigurée dès 2011 par la Conférence Permanente des Chargées de Mission Égalité et Diversité (CPED) : association nationale qui regroupe des chargé·e·s de mission et des vice-président·e·s en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur université. Bien que leur travail porte à l’époque quasi exclusivement sur les enjeux de l’égalité professionnelle femmes-hommes, élargis le cas échéant et par le truchement d’initiatives personnelles et professionnelles à ceux du genre et de l’orientation sexuelle, l’association choisit néanmoins le terme à la mode de diversité pour qualifier ses missions. Elle participe ainsi à structurer la construction de ces initiatives sur le terrain.
Bibliographie
- Abawi, Z. E. (2017). Marginal voices : Indigenous and racialized dialogue in education. Graduate Student Symposium Selected Papers. Queen’s University.
- Abawi, Z. et Eizadirad, A. (2020). Bias-free or biased hiring ? Racialized teachers’ perspectives on educational hiring practices in Ontario. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, (193), 18-31.
- Abu-Laban, Y. et Gabriel, C. (2002). Selling diversity : Immigration, multiculturalism, employment equity, and globalization. University of Toronto Press.
- Ahmed, S. (2012). On Being Included. Racism and Diversity in Institutional Life. Duke University Press.
- Alaktiff, J. et Doytcheva, M. (2018). Normation de la diversité en entreprise : qu’en est-il des discriminations ethnoraciales ? Dans A. Bender, A. Klarsfeld et C. Naschberger (dir.), Management de la diversité des ressources humaines (p. 145-170). Vuibert.
- Allouch, A. (2022). Les nouvelles portes des grandes écoles. PUF.
- Audet, G., Magnan, M.-O., Doré, E., Potvin, M., St-Vincent, L.-A., Gélinas-Proulx, A. et Abath, A. A. (2020, janvier). Diriger et agir pour l’équité, l’inclusion et la justice sociale : boite à outils pour les directions d’établissement d’enseignement. Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité. https://hdl.handle.net/1866/22946
- Bakhshaei, M., Georgiou, T. et Mc Andrew, M. (2016). Language of instruction and ethnic disparities in school success. McGill Journal of Education, 51(2), 689-713.
- Battiste, M., Bell, L. et Findlay, L. M. (2002). Decolonizing education in Canadian universities : An interdisciplinary, international, indigenous research project. Canadian Journal of Native Education, 26(2).
- Bell, D. (2003). Diversity’s distractions. Columbia Law Review, 103(6), 1622-1633.
- Bell, J. M. et Moore, W. L. (2018). Disfavored Subjects : How Liberalist Diversity Fails Racial Equity in Higher Education. Dans D.G. Embrick, S.M. Collins et M. Dodson (dir.), Challenging the Status Quo (vol. 123, p. 71-88). Brill.
- Berrey, E. C. (2015). The Enigma of Diversity : The Language of Race and the Limits of Racial Justice. University of Chicago Press.
- Bhopal, K. (2018). White privilege : The myth of a post-racial society. Policy Press.
- Bhopal, K. (2023). ‘We can talk the talk, but we’re not allowed to walk the walk’ : the role of equality and diversity staff in higher education institutions in England. Higher Education, 85(2), 325-339.
- Bhopal, K. et Myers, M. (2023). Elite universities and the making of privilege : Exploring race and class in global educational economies. Routledge.
- Bilge S. (2013). Intersectionality Undone : Saving Intersectionality from Feminist Intersectionality Studies. Du Bois Review, 10(2), 405-424. https://doi.org/10.1017/S1742058X13000283
- Bilge, S. (2020). We’ve joined the table but we’re still on the menu : Clickbaiting diversity in today’s university. Dans J. Solomos (dir.), Routledge international handbook of contemporary racisms (p. 317-331). Routledge.
- Bloemraad, I. (2015). Theorizing and Analyzing Citizenship in Multicultural Societies. The Sociological Quarterly, 56(4), 591-606. https://doi.org/10.1111/tsq.12095
- Bonilla-Silva, E. (1997). Rethinking racism : Toward a structural interpretation. American sociological review, 62(3), 465-480. https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2657316
- Bonilla-Silva, E. (2003). Racism without racists : Color-blind racism and the persistence of racial inequality in America. Rowman & Littlefield.
- Bonneau C., Charrousset P., Grenet J. et Thebault G. (2021). Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? IPP. https://shs.hal.science/halshs-03119054/
- Borri-Anadon, C. et Collins, T. (2023). Entre surveillance disproportionnée et inaction à l’égard d’élèves issus de l’immigration considérés à besoins éducatifs particuliers : une recherche ethnographique. La nouvelle revue - Éducation et société inclusives, 95(1), 25-42. https://doi.org/10.3917/nresi.095.0025
- Brinbaum, Y. et Cebolla-Boado, H. (2007). The school careers of ethnic minority youth in France : success or disillusion ?. Ethnicities, 7(3), 445-474.
- Campbell, A. (2021). Equity education initiatives within Canadian universities : Promise and limits. Perspectives : Policy and Practice in Higher Education, 25(2), 51-61.
- Cardona López, J. A., Nordfjell, O. B., Gaini, F. et Heikkinen, M. (2018). Promising Nordic practices in gender equality promotion : Developing teacher education dialogue, practice, and policy cycles on-line. Policy Futures in Education, 16(5), 605-619. https://doi.org/10.1177/1478210317722286
- Carmichael, S. et Hamilton, C.V. (1967). Black Power : The Politics of Liberation in America. Random House.
- Chicha, M.T. (2020). Les programmes d’accès à l’égalité au Québec : du rétrécissement au détournement de l’objectif d’égalité ? Dans P. Jalette (dir.), Les relations industrielles en question (p. 147-162). Presses de l’université de Montréal.
- Chu, A. (2023). « Comme, j’ai jamais été victime de racisme, mais direct. […] C’est comme dans le gris, c’est pas noir ou blanc » : l’expérience socioscolaire des personnes de minorité vietnamienne de deuxième génération au Québec [Mémoire de maitrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/28029
- Chu, A. et Darchinian, F. (2024). Éternels étrangers et étrangères ou minorités modèles ? Les expériences socioscolaires de jeunes adultes d’origine vietnamienne au Québec. Alterstice, 12(2), 77-88.
- Collins, T. (2022). Black student experiences in English Quebec schools : a DisCrit composite counter-story of the special education placement process [Thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/26989
- Collins, T. et Borri-Anadon, C. (2024). Ableism and (Neo)Racism in School Placement Processes in Quebec : School Personnel Interpretations of Immigrant Student Difficulties—A Secondary Publication. Journal of Contemporary Educational Research, 8(3), 148-160. https://doi.org/10.26689/jcer.v8i3.6450
- Confessore, N. (2024, 20 janvier). America is under Attack’ : Inside the Anti-DEI Crusade. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2024/01/20/us/dei-woke-claremont-institute.html
- Cooper, D. (2004). Challenging diversity. Cambridge University Press.
- Cornu, L. (2013). Diversité dans la diversité. Dans S. Villavicencio et G. Navet (dir.), Diversité culturelle et figures de l’hétérogénéité. L’Harmattan.
- Crenshaw, K. W. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex : A blackfeminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum 1, 139-167.
- Crenshaw, K. W. (2021). This Is Not a Drill : The War against Antiracist Teaching in America. UCLA Law Review, 68, 1702-1729.
- Cukier, W., Adamu, P., Wall-Andrews, C. et Elmi, M. (2021). Racialized leaders leading Canadian universities. Educational Management Administration & Leadership, 49(4), 565-583. https://doi.org/10.1177/17411432211001363
- Darchinian, F. (2023). Curriculum caché d’altérisation au secondaire : les récits des élèves musulmanes issues de l’immigration à Montréal. Éducation et francophonie, 51(2). https://doi.org/10.7202/1109675ar
- Darchinian, F. et Kanouté, F. (2020). Parcours postsecondaires et professionnels et rapports de pouvoir au Québec : discours de jeunes adultes issus de l’immigration. Revue des sciences de l’éducation, 46(2), 69-92. https://doi.org/10.7202/1073719ar
- Darchinian, F. et Magnan, M. O. (2020). Boundaries Through the Prism of Post-secondary and Professional Orientation. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 50-67.
- Darchinian, F., Magnan, M. O. et de Oliveira Soares, R. (2021). The construction of the racialized Other in the educational sphere : The stories of students with immigrant backgrounds in Montréal. Journal of Culture and Values in Education, 4(2), 52-64.
- Dawson, D. L., Meadows, K. N., Kustra, E. et Hansen, K. D. (2019). Perceptions of Institutional Teaching Culture by Tenured, Tenure-track, and Sessional Faculty. Canadian Journal of Higher Education, 49(3), 115-128. https://doi.org/10.47678/cjhe.v49i3.188493
- Dewing, M. et Brosseau, L. (2009, 15 septembre). Le multiculturalisme canadien (Publication 2009-20-F), révisée le 3 janvier 2018. Bibliothèque du Parlement. https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2009-20-f.pdf
- Dhume, F. et Cognet, M. (2020). Racisme et discriminations raciales à l’école et à l’université : où en est la recherche ? Le français aujourd’hui, 209, 17-27.
- Diaz, J. (2023, 15 mai). Florida Gov. Ron DeSantis signs a bill banning DEI initiatives in public colleges. NPR. https://www.npr.org/2023/05/15/1176210007/florida-ron-desantis-dei-ban-diversity
- DILCRAH (2023). Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026.
- Doucet, D. (2022). La négociation ambivalente de l’identité et du rapport à la culture d’une « minorité modèle » : les récits des jeunes de minorité coréenne à Montréal. [Mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/26610
- Doytcheva, M. (2005). Le Multiculturalisme. La Découverte.
- Doytcheva, M. (2018). Diversité et « super-diversité » dans les arènes académiques : pour une approche critique. Sociétés plurielles, 2. https://doi.org/10.46298/societes-plurielles.2018.4250
- Doytcheva, M. (2020). “White Diversity” : Paradoxes of Deracializing Antidiscrimination. Social Sciences, 9(4). https://www.mdpi.com/2076-0760/9/4/50
- Doytcheva, M. (2022). Approches critiques du racisme, perspectives franco-américaines. Revue du MAUSS, 2(60), 205-222. https://doi.org/10.3917/rdm1.060.0205
- Doytcheva, M. et Gastaut, Y. (2022). Race, Racismes, Racialisations : enjeux conceptuels et méthodologiques, perspectives critiques. Émulations. Revue de sciences sociales, (42), 7-30. https://doi.org/10.14428/emulations.042.01
- European Commission (2003). The Costs and Benefits of Diversity. Directorate-General for Employment & Social Affairs.
- European Commission (2005). The Business Case for Diversity. Good Practices in theWorkplace. Directorate-General for Employment & Social Affairs.
- Evrigenis, D. (1985). Report on the Findings of the Committee of Inquiry into the Rise of Racism and Fascism in Europe. European Parliament.
- Executive Order N° 13950 (2020, 22 septembre). Combating race and sex stereotyping. https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/28/2020-21534/combating-race-and-sex-stereotyping
- Fassin, É. (1993). La chaire et le canon. Les intellectuels, la politique et l’Université aux États-Unis. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 48(2), 265-301. https://doi.org/10.3406/ahess.1993.279133
- Favell, A. (2000). L’européanisation ou l’émergence d’un nouveau champ politique : le cas de la politique d’immigration. Cultures & Conflits, (38-39). https://doi.org/10.4000/conflits.274
- Feagin, J. (2006). Systemic racism : A theory of oppression. Routledge.
- Felouzis, G. (2003). La ségrégation ethnique au collège et ses conséquences. Revue française de sociologie, 44(3), 413-447.
- Field, C., Jones, G., Karram Stephenson, G. et Khoyetsyan, A. (2014). The “Other” University Teachers : Non-Full-Time Instructors at Ontario Universities. Higher Education Quality Council of Ontario. https://heqco.ca/wp-content/uploads/2020/03/Non-full-time-instructors-ENG.pdf
- Fraser, N. (2005). Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution. La Découverte.
- Fraser, N. (2012). Le féminisme en mouvements : des années 1960 à l’ère néolibérale. La Découverte.
- Freeman, A. D. (1978). Legitimizing racial discrimination through antidiscrimination law : A critical review of Supreme Court doctrine. Minnesota Law Review, 62, 1049-1120.
- Gaide, A. et Kam, E. (2019). Militer avec ou contre la référente égalité femmes-hommes ? Retour collectif sur des mobilisations étudiantes infructueuses. Genre, sexualité & société, (22). https://doi.org/10.4000/gss.5690
- Guiraudon, V. (2004). Construire une politique européenne de lutte contre les discriminations : l’histoire de la directive « race ». Sociétés contemporaines, 1(53), 11-32. https://doi.org/10.3917/soco.053.0011
- Hajjat, A., Dhume, F., Cognet, M., Rodrigues, C., Bozec, G., Blassel, R., Hamel, C., Weiss, P.-O., Bao, T., Karimi, H., Gillet, C. et Longuet, L.. (2022). Enquête nationale sur les discriminations à l’université. Analyses et résultats de l’étude pilote. https://hal.science/hal-03731238/
- Helly, D. (2000). Primauté des droits ou cohésion sociale. Les limites du multiculturalisme canadien 1971-1999. Dans M. Wieviorka et J. Ohana (dir.), La Différence culturelle. Une reformulation des débats (p. 414-427). Balland.
- Henry, F. et Tator, C. (dir.) (2009). Racism in the Canadian university : Demanding social justice, inclusion, and equity. University of Toronto Press.
- Hirshfield, L. E. et Joseph, T. D. (2012). ‘We need a woman, we need a black woman’ : gender, race, and identity taxation in the academy. Gender and Education, 24(2), 213-227. https://doi.org/10.1080/09540253.2011.606208
- Hopson, R. L. (2013). “People Like Me” : Racialized Teachers and the Call for Community [Thèse de doctorat, Université de Toronto]. TSpace. http://hdl.handle.net/1807/43595
- Ichou, M. (2016). Performances scolaires des enfants d’immigrés : quelles évolutions ? Contribution au rapport du CNESCO. https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/ichou_seul1.pdf
- Jay, M. (2003). Critical race theory, multicultural education, and the hidden curriculum of hegemony. Multicultural Perspectives : An Official Journal of the National Association for Multicultural Education, 5(4), 3-9.
- Kirby, T. A., Kaiser, C. R. et Major, B. (2015). Insidious procedures : Diversity awards legitimize unfair organizational practices. Social Justice Research, 28, 169-186.
- Kobayashi, A. (2009). Now you see them, how you see them : Women of colour in Canadian academia. Dans F. Henry et C. Tator (dir.), Racism in the Canadian university : Demanding social justice, inclusion, and equity, (p. 60-75). University of Toronto Press https://doi.org/10.3138/9781442688926-003
- Kreiter, M. et Scarritt, A. (2018). “Boatloads of Money” in the Great Equalizer : How Diversity Furthers Inequality at the Neoliberal University. Dans D.G. Embrick, S. M. Collins et M. S. Dodson (dir.), Challenging the Status Quo (p. 89-116). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004291225_006
- Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship : A liberal theory of minority rights.
- Kymlicka, W. (2010). The rise and fall of multiculturalism ? New debates on inclusion and accommodation in diverse societies. International social science journal, 61(199), 97-112.
- Lafortune, G. et Kanouté, F. (2023). « Être soi-même ou s’ajuster au cadre » : le poids de la fatigue raciale pour des personnes noires enseignantes et directrices d’école à Montréal. Éducation et francophonie, 51(2). https://doi.org/10.7202/1109681ar
- Lanquetin, M.-T. (2004). La double discrimination à raison du sexe et de la race ou de l’origine ethnique, Migrations-Études, (126), 1-16.
- Larochelle, C. (2021). L’école du racisme : La construction de l’altérité à l’école québécoise (1830-1915). Les presses de l’Université de Montréal.
- Larochelle-Audet, J., Borri-Anadon, C. et Potvin, M. (2016). La formation interculturelle et inclusive du personnel enseignant : conceptualisation et opérationnalisation de compétences professionnelles. Éducation et francophonie, 44(2), 172-195.
- Latraverse, S. et Doytcheva, M. (2018). 20 ans de non-discrimination en France : du droit aux pratiques. Cahiers de la LCD, 1(6), 121-137. https://doi.org/10.3917/clcd.006.0121
- Lawrence III, C. R. (1997). Each Other’s Harvest : Diversity’s Deeper Meaning. University of San Francisco Law Review, 31, 757-778. http://hdl.handle.net/10125/65961
- Lentin, A. (2020). Why Race Still Matters. John Wiley & Sons.
- Leong, N. (2012). Racial Capitalism. Harvard Law Review, 126(8), 2151-2226.
- Louis, J. (2020). Être jeune et Noir·e· : Les micro-agressions raciales vécues par de jeunes Noir·e·s de 8 à 30 ans en milieu scolaire au Québec et en Ontario. [Mémoire de maîtrise, Université d’Ottawa]. Travail social - Mémoires // Social Work - Research Papers. https://doi.org/10.20381/ruor-25369
- Magnan, M.-O., Collins, T., Darchinian, F., Kamanzi, P. C. et Valade, V. (2024). Student voices on social relations of race in Québec Universities. Race Ethnicity and Education, 27(2), 156-172.
- Magnan, M.-O., Gosselin-Gagné, J., Audet, G. et Conus, X. (2021). L’éducation inclusive en contexte de diversité ethnoculturelle : comprendre les processus d’exclusion pour agir sur le terrain de l’école. Recherches en éducation, (44). https://doi.org/10.4000/ree.3272
- Mayorga-Gallo, S. (2019). The white-centering logic of diversity ideology. American Behavioral Scientist, 63(13), 1789-1809.
- Mc Andrew, M. (dir.) (2020, avril) Équité, diversité et inclusion à l’Université de Montréal : diagnostic. https://www.umontreal.ca/public/www/images/diversite/documents/EDI-Diagnostic_avril_2020.pdf
- Mills, C. W. (1997). The racial contract. Cornell University Press.
- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2017). Politique de la réussite éducative : Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir. Gouvernement du Québec.
- Mons, N. et Chesné, J.-F. (dir.) (2016, septembre). Inégalités sociales et migratoires : Comment l’école amplifie-t-elle les inégalités ? Cnesco. http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales/
- Nichols, L. (2023). Adjuncting for Life : The Gendered Experience of Adjunct Instructors in Ontario. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 56-73. https://www.proquest.com/scholarly-journals/adjuncting-life-gendered-experience-adjunct/docview/2890018343/se-2
- Nieto, S. (2000). Affirming diversity : The sociopolitical context of multicultural education (3e ed.). Longman.
- Oberti, M., Pavie A. et Rossignol-Brunet, M. (2024). Les enjeux de la réforme des admissions à Sciences Po Paris : Mérite et inégalités en tension dans une grande école. LIEPP. https://sciencespo.hal.science/hal-04822549v1
- OECD (2023). PISA 2022 Results (Volume 1) The state of learning and equity in education. https://doi.org/10.1787/53f23881-en
- Payet, J.P. (1995). Collèges de banlieue. Ethnographie d’un monde scolaire. Méridiens Klincksieck.
- Pete, S., Schneider, B. et O’Reilly, K. (2013). Decolonizing Our Practice : Indigenizing Our Teaching. First Nations Perspectives, 5(1), 99-115.
- Pidgeon, M. (2016). More Than a Checklist : Meaningful Indigenous Inclusion in Higher Education. Social inclusion, 4(1), 77-91.
- Pierre, M. et Bosset, P. (2020). Racisme et discrimination systémiques dans le Québec contemporain : présentation du dossier. Nouvelles pratiques sociales, 31(2), 23-37.
- Pizarro Milian, R. et Wijesingha, R. (2023). Why Do EDI Policies Fail ? An Inhabited Institutions Perspective. Equality, Diversity and Inclusion : An International Journal, 42(3), 449-464. https://doi.org/10.1108/EDI-02-2022-0048
- Potvin, M., Magnan, M.-O., Larochelle-Audet, J. et Ratel, J.-L. (2015). La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : pour une école inclusive et antiraciste (2e édition). Presses de l’Université du Québec.
- Powell, J. (1971). Attack of American Free Enterprise System. Confidential memorandum. http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/personality/sources_document13.html
- Primon, J.-L. (2018). Une violence sociale et institutionnelle à l’école : le racisme vécu par les descendants d’immigrés. Dans E. Dugas (dir.) Les violences scolaires d’aujourd’hui en question. Regards croisés et altérités. L’Hamattan.
- Primon, J.-L. (2022). La construction du fait raciste. Les apports des enquêtes statistiques à la sociologie du racisme. Emulations-Revue de sciences sociales, (42), 149-164.
- Ray, R. et Gibbons, A. (2021). Why are states banning critical race theory ? Brookings. https://www.brookings.edu/articles/why-are-states-banning-critical-race-theory/
- Ray, V. (2023). On critical race theory : Why it matters & why you should care. Random House Trade Paperbacks.
- Regan, P. (2010). Unsettling the settler within Indian residential schools, truth telling, and reconciliation in Canada. UBC Press.
- Ryan, J., Pollock, K. et Antonelli, F. (2009). Teacher diversity in Canada : Leaky pipelines, bottlenecks, and glass ceilings. Canadian Journal of Education, 32(3), 591-617.
- Short, D. (2003). Reconciliation, assimilation, and the indigenous peoples of Australia. International Political Science Review, 24(4), 491-513.
- Smith, M. (2018). Diversity in theory and practice : Dividends, downsides, and dead-ends. Contemporary inequalities and social justice in Canada, 43.
- Smith, W. A. et Parker, L. (2024). Guest editorial : You can’t racelight CRT !. Equality, Diversity and Inclusion : An International Journal, 43(3), 389-399.
- St. Denis, V. (2011). Silencing Aboriginal Curricular Content and Perspectives Through Multiculturalism : “There Are Other Children Here”. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 33(4), 306-317.
- Stein, S. et de Oliveira Andreotti, V. (2017). Higher Education and the Modern/Colonial Global Imaginary. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 17(3), 173-181. https://doi.org/10.1177/1532708616672673
- Suk, J. C. (2008). Procedural Path Dependence : Discrimination and the Civil-Criminal Divide. Washington University Law Review, 85(6), 1315-1371.
- Sun, M. (2014). The Educational Experience of Students of Chinese Origin in a French-Speaking Context : the role of school, family, and community. [Thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://hdl.handle.net/1866/10889
- Taylor, C. (1994). Multiculturalisme : différence et démocratie. Aubier.
- Thomas, J. M. (2020). Diversity Regimes. Why Talk Is Not Enough to Fix Racial Inequality at Universities. Rutgers University Press.
- Triadafilopoulos, T. (2012). Becoming Multicultural : Immigration and the Politics of Membership in Canada and Germany. UBC Press.
- Vallet, L. et Caille, V. (1996). Les élèves étrangers ou issus de l’immigration dans l’école et le collège français. Ministère de l’Éducation nationale. https://sciencespo.hal.science/hal-03393269v1
- Van Zanten, A. (2001). L’école de la périphérie : scolarité et ségrégation en banlieue. PUF.
- Van Zanten, A. (2023). Is ‘diversity’a liability or an asset in elite labour markets ? The case of graduates who have benefited from a French positive discrimination scheme. Journal of Education and Work, 36(1), 65-78.
- Wallace-Wells, B. (2021, 18 juin). How a Conservative Activist Invented the Conflict over Critical Race Theory. The New Yorker. https://www.newyorker.com/news/annals-of-inquiry/how-a-conservative-activist-invented-the-conflict-over-critical-race-theory
- Warikoo, N. (2016). The Diversity Bargain. And other dilemmas of Race, Admissions, and Meritocracy at Elite Universities. University of Chicago press.
- Wood, J.L. et Harris, F. III (2021). Racelighting definitions.https://racelighting.net/definitions/
- Zanoni, P., Janssens, M., Benschop, Y. et Nkomo, S. (2010). Guest editorial : Unpacking diversity, grasping inequality : Rethinking difference through critical perspectives. Organization, 17(1), 9-29.