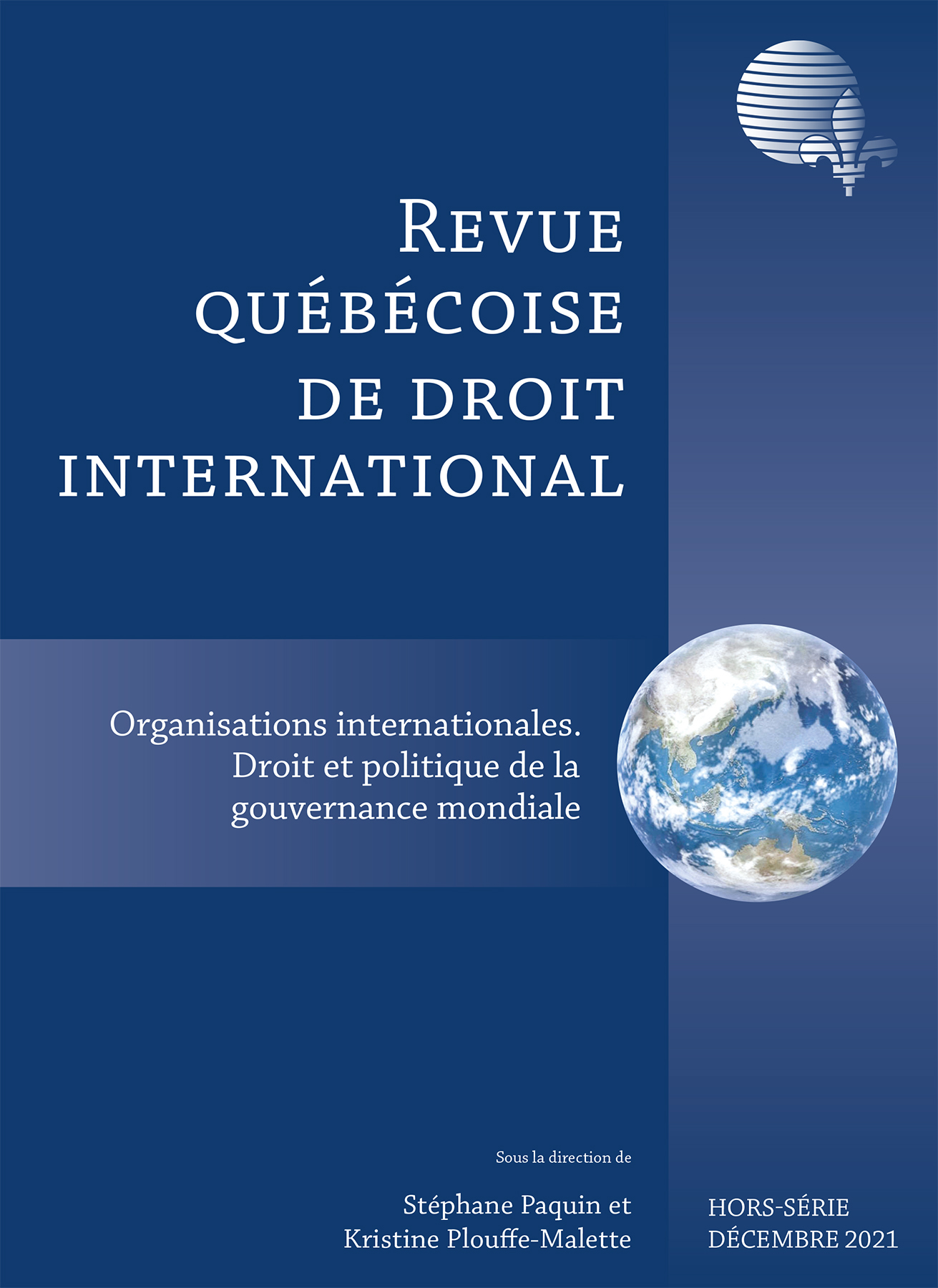Les Accords de Bretton Woods sont souvent présentés comme étant le premier système monétaire et financier mondial. Or, la régulation des questions monétaires avait déjà pris les traits d’un ordre spontané dès le XIXe siècle. En effet, après la guerre opposant la France à la Prusse entre 1870 et 1871, les États exerçant l’essentiel du commerce international avaient adopté de facto l’étalon-or. Ce système spontané avait pour objet de garantir la monnaie nationale et d’éviter les crises de confiance dans le billet de banque, introduit au XIXe siècle par des banques commerciales privées, en lieu et place de l’utilisation presque exclusive des métaux précieux qui avait cours auparavant. Les billets émis par ces dernières n’avaient pas toujours eu d’équivalent en réserves de métaux et des crises de confiance s’en suivaient occasionnellement, générant une instabilité du système. L’apparition des banques centrales ayant le monopole de l’émission de monnaie, et l’adoption de l’étalon-or ont ainsi donné naissance à un ordre international monétaire sui generis. Le système de l’étalon-or du XIXe siècle se fondait sur un principe cardinal : toute émission de monnaie par un État correspondait en principe à un poids fixe en or, stabilisant ainsi les taux de change. En effet, les devises avaient des parités fixes avec l’or qui servait de monnaie internationale. Pour cela, les États devaient donc se conformer à une stricte discipline monétaire afin de conserver le stock d’or correspondant aux billets et pièces qu’ils avaient mis en circulation. En dépit de quelques critiques, ce système demeura en place jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il s’agissait d’un véritable ensemble ordonné, bien qu’il n’ait pas été mis au monde par entente conventionnelle et qu’aucune organisation internationale n’en surveillait la mise en oeuvre. En raison du rôle stratégique des métaux précieux, le commencement de la Première Guerre mondiale marqua l’abandon de l’étalon-or. Tous les belligérants optèrent alors pour l’inconvertibilité. Les monnaies n’avaient ainsi plus d’équivalent et l’or ne servait plus de monnaie internationale. À partir de ce moment, l’instabilité s’est installée, car l’inflation générée par les besoins de la guerre a conduit les États à augmenter leur masse monétaire en circulation. Si diverses tentatives de réinstaurer l’étalon-or ont émergé après la Première Guerre mondiale, soit unilatéralement, soit sous l’égide de la SDN, seules trois monnaies, le franc, la livre et le dollar, sont redevenues directement convertibles. Ce système souffrait d’un problème majeur : celui d’être contrôlé principalement par deux États en concurrence (la GrandeBretagne et les États-Unis). La surévaluation de la livre britannique (sa valeur en or était surestimée et fondée sur la parité de 1913) conduisit certains États, dont l’Allemagne, à échanger leurs livres en or, augmentant ainsi leurs réserves d’or et réduisant par conséquent celles de Londres. Couplés à la politique économique de la couronne britannique, ces comportements ont eu pour conséquence de faire diminuer les réserves en or de Londres à moins de 5 % du stock mondial en 1931. Pendant ce temps, la position dominante américaine était moins attaquée, les réserves d’or de la réserve fédérale baissant seulement de 45 à 35 % du stock mondial. La grande dépression d’octobre 1929 sonna le glas de la tentative de réintroduction de l’étalon-or. Avec la récession, certains États cédèrent à la tentation d’utiliser la monnaie comme un instrument de politique économique internationale. Ils recoururent aux dévaluations monétaires afin de rendre leurs exportations plus profitables, et adoptèrent diverses mesures protectionnistes visant à protéger leurs marchés. Par exemple, en 1930, la loi américaine Smoot-Hawley augmenta les droits de douane de 20 000 produits. En réaction, d’autres États ont procédé à une hausse de leurs taxes …
Le Fonds monétaire international[Record]
Professeur de droit international, titulaire de la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport, École de Gestion, Département de marketing, Université de Sherbrooke.