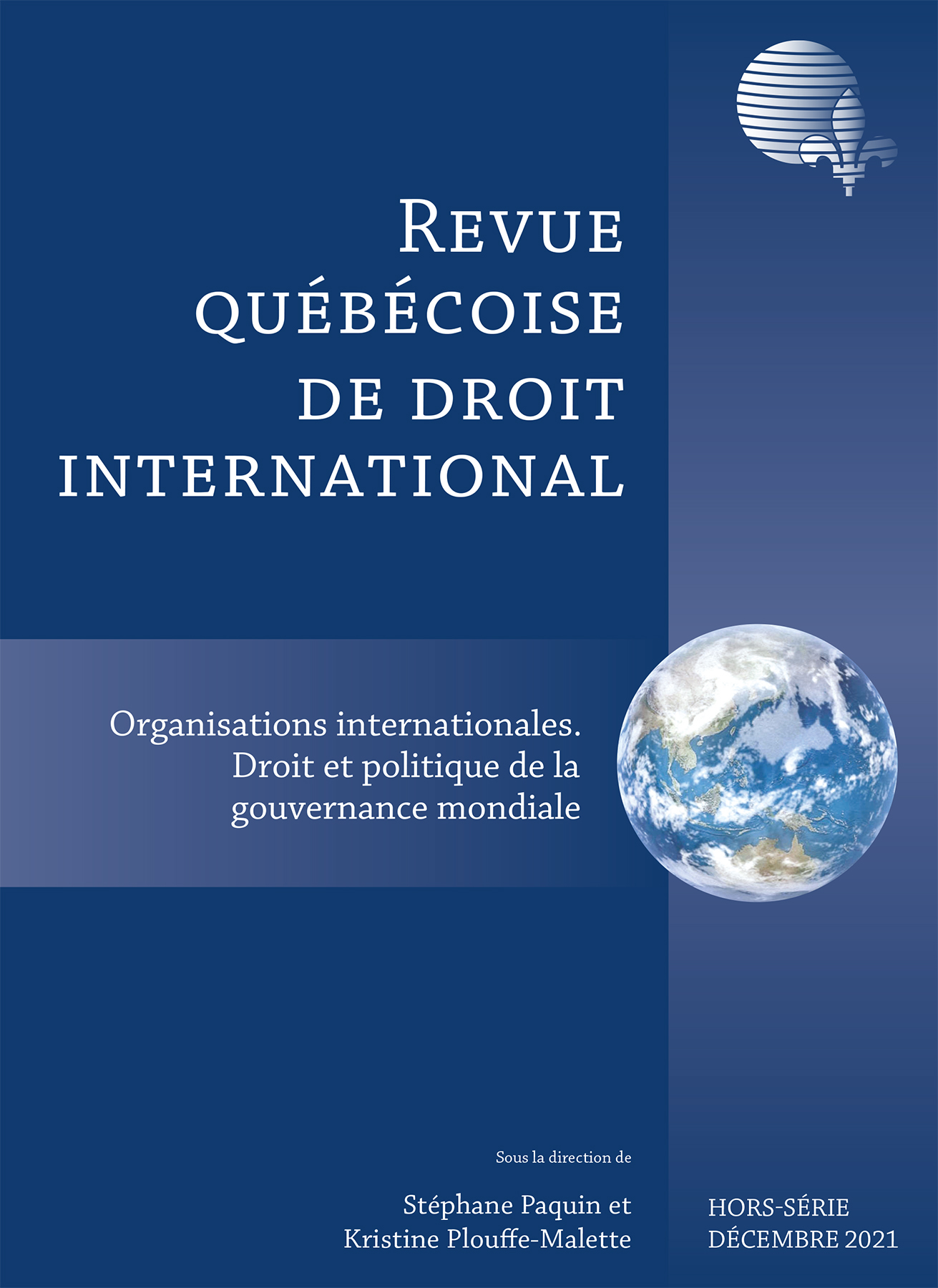L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est une alliance militaire créée le 4 avril 1949 et regroupant aujourd’hui vingt-neuf États. Il s’agit de l’alliance la plus durable de l’histoire moderne, dont la crise est régulièrement diagnostiquée par les observateurs, mais néanmoins surmontée. Récemment, le président états-unien Donald Trump l’a qualifiée « d’obsolète », et le président français Emmanuel Macron la craint en état de « mort cérébrale ». De fait, les tensions suscitées par les agissements de la Turquie ou les dérives autoritaires de certains membres plaident contre elle. Force est toutefois de reconnaître que, depuis sa création, elle a fait preuve d’une grande plasticité, tant dans son fonctionnement que dans ses structures et modes de décision. Elle a conduit des opérations militaires sur trois continents, a institutionnalisé des partenariats avec quelque vingt pays, et noué des relations avec d’importantes démocraties hors Europe : Australie, Nouvelle-Zélande, Japon ou Corée du Sud. Il s’agit donc de revenir brièvement sur l’histoire de l’OTAN et une brève description de ses structures actuelles, avant de nous interroger sur ce qui constitue l’originalité de l’Organisation par rapport aux autres modèles historiques et contemporains d’alliances et d’étudier sa longévité exceptionnelle. L’évolution de l’alliance est marquée par la transformation du système stratégique international, et l’OTAN de 1949 a peu à voir avec celle de 2020. Il est donc important de retracer l’évolution de l’alliance afin d’observer cette interpénétration entre les logiques internationales et la forme institutionnelle prise par l’alliance. L’Alliance est généralement présentée comme le simple résultat d’un mécanisme d’équilibrage de la menace posée par l’Union soviétique (balancing). Cette vision du processus de création de l’OTAN oublie une dimension fondamentale liée au contexte historique. En premier lieu, contrairement aux alliances du 18e et 19e siècles, dans lesquelles les alliés craignaient au moins autant leurs adversaires qu’ils se craignaient mutuellement, l’OTAN trouve son origine dans l’habitude de coopération militaire entre Britanniques et Américains créée durant la Seconde Guerre mondiale. Cette coopération a été bien souvent difficile, mais elle a permis de créer des mécanismes qui se sont prolongés durant l’après-guerre, ce qu’illustre la coopération approfondie entre Washington et Londres sur les problèmes posés par la Grèce et la Turquie, l’occupation de Berlin et la réponse appropriée à apporter à Moscou. Dès l’origine, l’Alliance atlantique a été perçue comme une communauté de valeurs : un télégramme du Foreign Office rappelle ainsi que l’Alliance rassemble « des pays qui ont été nourris aux libertés civiles et aux droits humains fondamentaux ». De ce point de vue, L’Alliance atlantique n’est pas une alliance traditionnelle, puisque ses membres se percevaient mutuellement de manière très différente des alliances pré-1939. On a souvent avancé que la signature d’un traité d’alliance permanente par les États-Unis en 1949 représentait une rupture par rapport à leur isolationnisme. La rupture est réelle, mais elle date des années 1945-1946, la création de l’Alliance n’étant que l’aboutissement d’un processus pluriannuel d’engagement américain pour la sécurité de l’Europe. De 1945 à 1950, la menace d’une invasion soviétique immédiate n’était pas perçue par les États-Unis comme le principal danger pour la sécurité européenne : deux autres thèmes d’inquiétudes dominaient à Washington. En premier lieu, le poids de la guerre et la démoralisation causée par les difficultés vécues par les populations risquaient de plonger les économies européennes dans une période de stagnation durable. En deuxième lieu, la fatigue psychologique liée aux combats et à la reconstruction risquait de rendre les Européens si pessimistes sur leur futur qu’ils auraient succombé à des tentatives de prises du pouvoir par les partis communistes locaux, appuyés par la menace que faisait planer …
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord[Record]
Professeur de relations internationales au Center for War Studies, University of Southern Denmark.