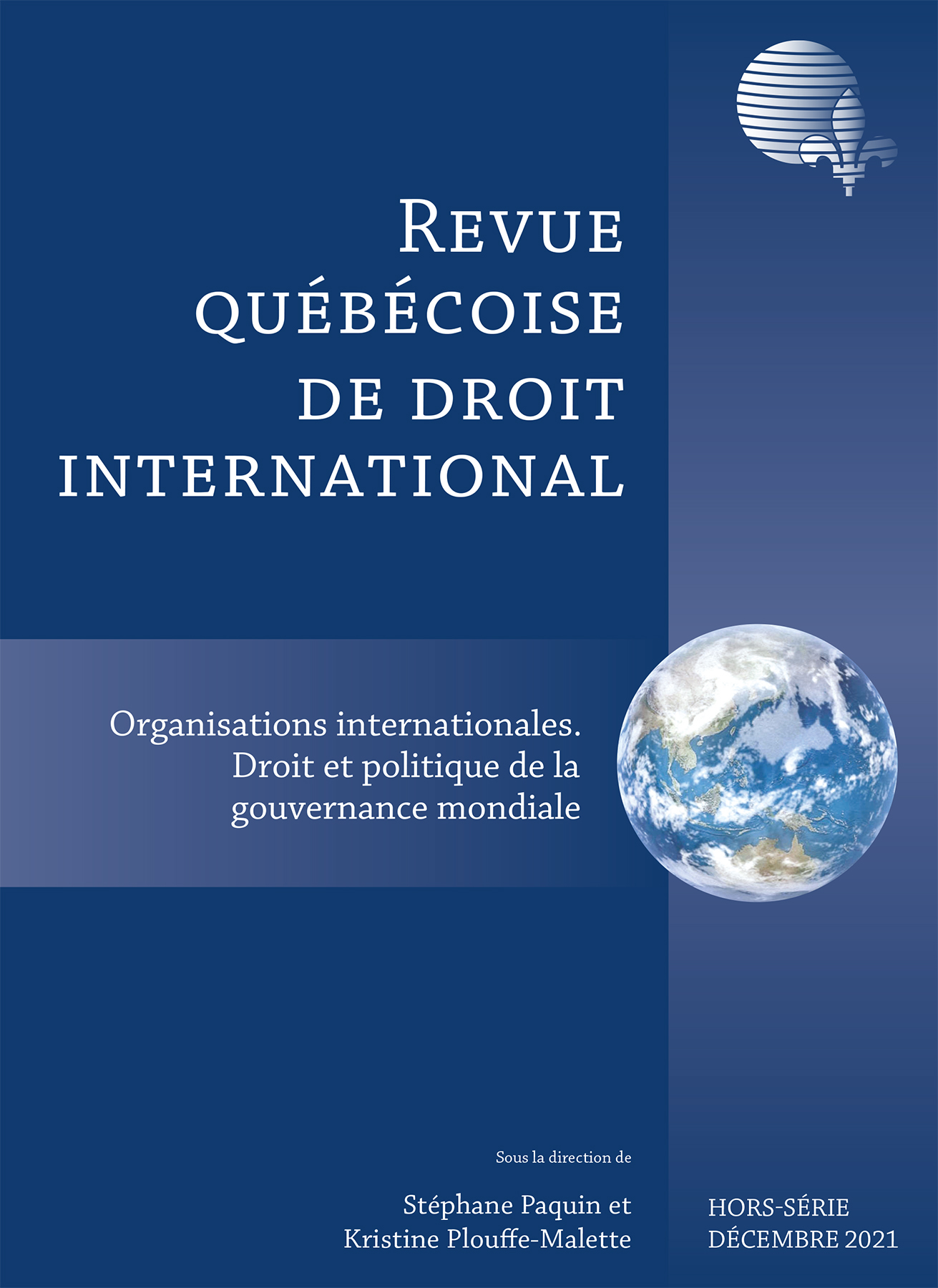Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est un organisme qui oeuvre à la protection des personnes affectées par les conflits armés et qui est le gardien du droit international humanitaire. Dans le panorama des organisations oeuvrant à l’international, il occupe une place à part. En effet, il n’est ni une organisation internationale intergouvernementale, ni une organisation non-gouvernementale (ONG). On a donc coutume de dire qu’il s’agit d’une institution hybride, car c’est une association créée en vertu du droit suisse, mais dont les activités se déploient à l’international, ou encore d’une institution sui generis, au sens où elle n’entre dans aucune des catégories qui relèvent de la terminologie du droit international général. Le CICR a vu le jour à la fin du XIXe siècle après qu’un homme, Henry Dunant, ayant été fortuitement le témoin des conséquences dramatiques de la guerre sur les soldats blessés et malades, décida de proposer la création d’une organisation de secours dont le mandat serait d’alléger les souffrances des personnes affectées par les conflits armés. Au même titre que la physionomie des guerres a considérablement changé depuis 150 ans, les activités du CICR ont sensiblement évolué, de même que son positionnement dans l’ordre international. Après avoir présenté les attributions du CICR en tant qu’organisation humanitaire, cette contribution abordera la place que cette organisation occupe au sein du système international et le rôle qu’elle joue dans le cadre de la gouvernance mondiale. Crée formellement en 1863 par cinq hommes : un citoyen genevois (Henry Dunant), un militaire (le Général Dufour), deux médecins (Louis Appia et Théodore Maunoir) et un juriste (Gustave Moynier), en réponse à l’appel lancé par Henry Dunant dans son livre Un Souvenir de Solférino, le CICR tire aujourd’hui son mandat à la fois des Conventions de Genève (CG) de 1949 et de leurs Protocoles additionnels (PA) de 1977, de ses Statuts et de ceux du Mouvement international de la Croix-Rouge adoptés en Conférence internationale. Il déploie ses activités de prévention, d’assistance, de protection et juridiques dans plus de 80 pays du monde et agit selon des principes bien définis. Le mandat du CICR se trouve aujourd’hui principalement dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. Ceci a de particulier qu’il en résulte qu’il s’agit à la fois d’un mandat confié par les États, qui sont les signataires de ces Conventions, mais également d’un mandat que le CICR s’est lui-même confié en quelque sorte, puisqu’il est l’instigateur des Conventions de Genève. Il n’en demeure pas moins que fixé dans des traités internationaux, son mandat jouit d’une assise particulière et a pour cadre le droit international public. Au terme des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, la mission du CICR s’articule autour de la protection des différentes personnes qui se trouvent hors de combat dans les conflits armés, c’est-à-dire des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, à savoir respectivement les blessés, les malades (CG I), les naufragés (CG II), les prisonniers de guerre (CG III) et les personnes civiles (CG IV). À ce titre, le CICR est notamment invité à agir en tant que substitut des puissances protectrices, fonction qui inclut la possibilité pour lui de proposer ses bons offices pour le règlement de différends. Au coeur de ses prérogatives en matière de protection se trouvent également ses activités liées au rétablissement des liens familiaux, que le CICR mène au travers l’Agence centrale de recherche. De même, ses visites aux personnes privées de liberté, en particulier aux prisonniers de guerre et aux …
Le Comité international de la Croix-Rouge[Record]
Professeure, Faculté de droit, Université Laval; l’auteure aimerait remercier Marine Colomb, étudiante au LL.M. avec mémoire à la faculté de droit de l’Université Laval, pour les recherches auxquelles elle a contribué en lien avec cette contribution. Elle remercie également Simon Dousset (candidat au LL.M. Études internationales, Université Laval) et Jean-René Beauchemin (candidat au LL.M en droit, Université Laval).