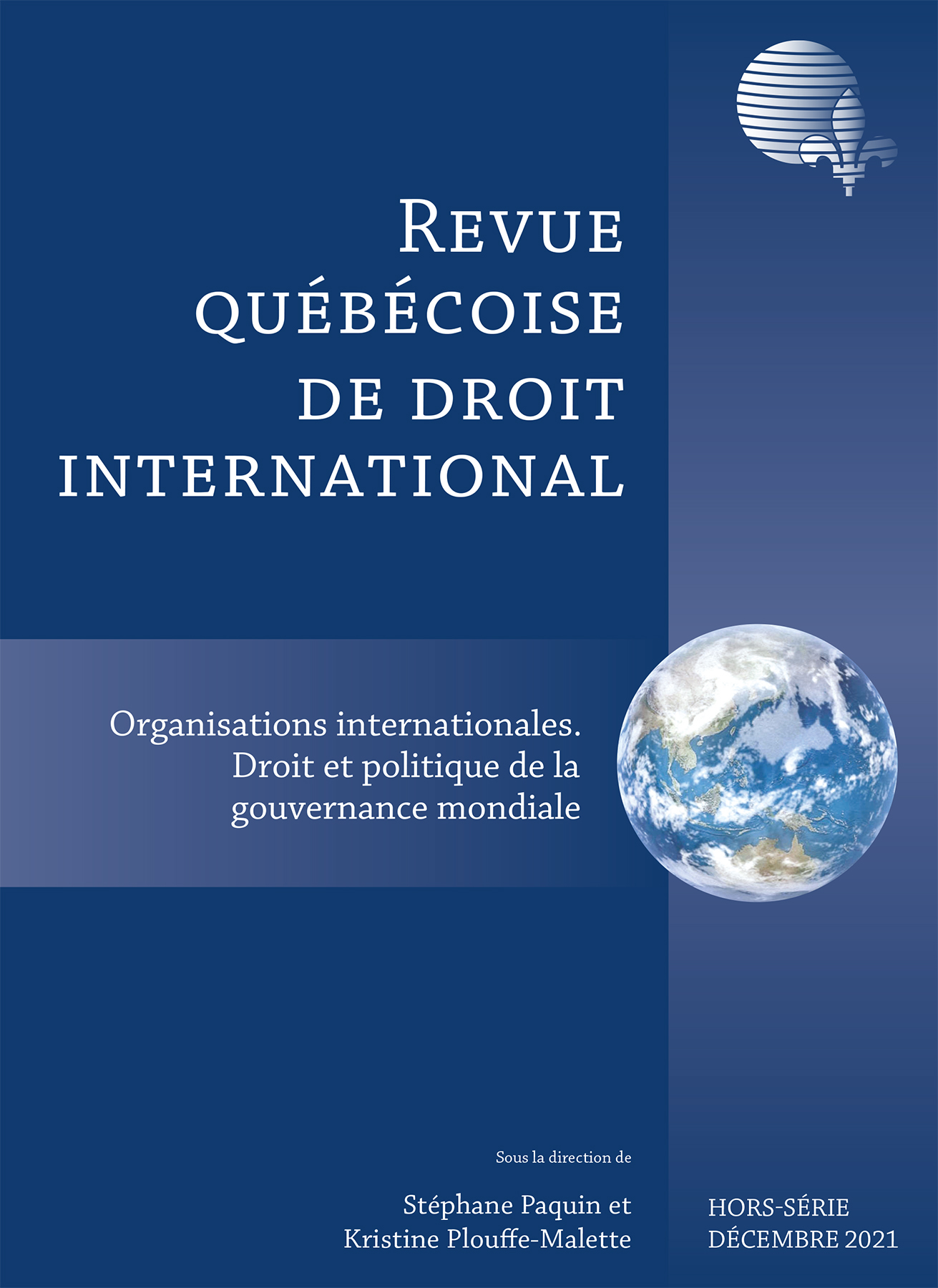L’émergence des enjeux qui nécessitent des réponses allant au-delà des frontières nationales des États - tels que le commerce et les échanges internationaux, les conflits armés, la criminalité internationale, la destruction de l’environnement, les pandémies, etc. - ont conduit ceux-ci à créer des cadres de consultation dépassant la limite de leur souveraineté nationale. L’Organisation des Nations Unies (ONU), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) sont les premières institutions de la gouvernance mondiale après la Seconde Guerre mondiale dont « [le commerce et la coopération] constituent les deux pierres angulaires ». La résurgence et l’expansion de ces enjeux continuent à renforcer et à élargir le cadre de cette gouvernance mondiale. Cette contribution porte sur la gouvernance judiciaire mondiale, un aspect de la gouvernance mondiale qui a connu un développement important ces dernières années. Sans l’aborder dans tous ses aspects, il s’intéresse en particulier au système international pénal. « The international criminal justice (ICJ) system is a combination of international institutions such as the ICC, ad hoc and mixed-model tribunals, international investigating bodies, and national criminal justice systems ». Il comprend l’ensemble des acteurs et mécanismes permettant d’assurer les enquêtes et poursuites, aux niveaux international et national, des auteurs de crimes internationaux graves, ainsi que l’application des peines y afférentes. Ces crimes internationaux, qui touchent par leur nature l’ensemble de la communauté internationale, comprennent notamment les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le crime de génocide et le crime d’agression. Aujourd’hui, le système international pénal ne se présente pas comme un système intégré, mais un ensemble multiforme et multicéphale concourant au même but, celui des enquêtes et poursuites des auteurs de crimes internationaux. Si on essayait d’en présenter un schéma global sous forme pyramidale, on placerait au sommet les juridictions pénales internationales, au milieu les juridictions hybrides et à la base les juridictions nationales. Toutefois, comme nous le verrons, le système international pénal, notamment mis en place par la création de la Cour pénale internationale (CPI), première juridiction pénale internationale permanente, met l’accent sur la responsabilité des États dans la lutte contre l’impunité. Le système international pénal s’éloigne dès lors d’une hiérarchie verticale plaçant les juridictions internationales au sommet de la chaîne de responsabilité ou de celle du pouvoir. Dans le cadre de cette contribution, dans une perspective chronologique et pour simplifier la présentation des différentes composantes de ce « système » visant à lutter contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux, nous choisissons de procéder tour à tour en suivant la classification suivante : les juridictions ad hoc créées pour une période et des circonstances données, la CPI et les juridictions et acteurs nationaux. Les juridictions ad hoc, présentées en premier lieu, comprennent d’une part les tribunaux pénaux internationaux (le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda) créés par le Conseil de sécurité de l’ONU et d’autre part les juridictions hybrides (telles que le Tribunal spécial pour le Liban, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone ou les Chambres africaines extraordinaires) émanant d’un accord entre une organisation internationale et un État. Les caractéristiques de la CPI, seule juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle, sont ensuite abordées dans la deuxième section de la contribution. Sa compétence et quelques aspects de sa procédure pénale sont notamment discutés. En dernier lieu est évoqué le rôle indispensable des acteurs nationaux, autant étatiques que non étatiques, dans la mise oeuvre des enquêtes et poursuites en matière de coopération et de contributions aux procédures pénales. Les juridictions ad hoc sont celles qui sont …
Le système international pénal[Record]
Azé Kerté Amoulgam, Candidat au doctorat en droit, Faculté de droit, Université Laval.
Fannie Lafontaine, Professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval.