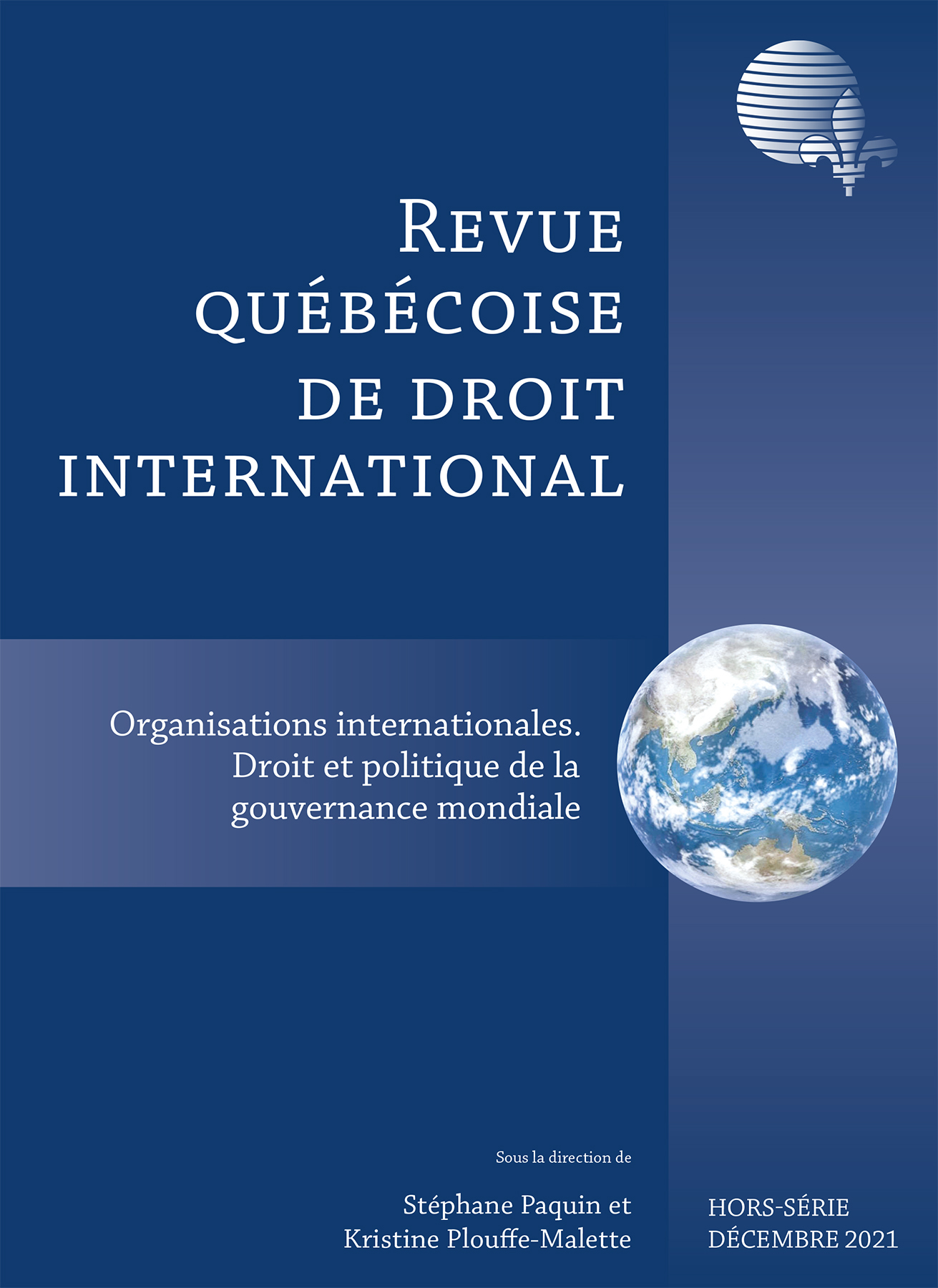Malgré des progrès notables dans la condition des femmes, l’égalité des sexes demeure une priorité au niveau mondial et pour cause ; aucun pays ne rassemble actuellement les conditions d’une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. En quoi le droit international des droits de la personne, système juridique développé par les Nations Unies dans la deuxième moitié du XXe siècle, a-t-il réussi à protéger les droits des femmes et quels sont désormais les défis qu’il reste à relever afin d’atteindre l’égalité genrée au niveau planétaire ? Un regard sur l’élaboration des normes, programmes et procédures consacrés aux droits des femmes au sein des Nations Unies depuis sa création en 1945 s’avère utile pour répondre à ces questions. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs femmes se sont impliquées dans la création d’une nouvelle organisation internationale multilatérale à vocation universelle appelée à devenir les Nations Unies. Certaines oeuvrent en tant que représentantes gouvernementales, d’autres, regroupées au sein d’associations féministes, font du lobbying auprès des délégations étatiques. En 1945, lors des négociations en vue d’adopter la Charte des Nations Unies à San Francisco, alors que les femmes n’avaient le droit de vote que dans 30 des 51 membres fondateurs, seulement 4 des 160 signataires sont des femmes : Minerva Bernardino (République dominicaine), Virginia Gildersleeve (États-Unis), Bertha Lutz (Brésil) et Wu Yi-Fang (Chine). Malgré cette représentation anémique au sein des délégations nationales, les femmes ont joué un rôle central afin que leurs préoccupations soient reconnues dans le traité constitutif des Nations Unies. La norme de non-discrimination, pierre angulaire du futur système onusien des droits humains, interdit les distinctions, notamment celles liées au sexe. Le lobby féministe réussira à inscrire le principe de l’égalité de droits des hommes et des femmes dans le préambule, tandis que l’article 8 garantit un accès égal des hommes et des femmes aux fonctions et organes des Nations Unies. L’inclusion de ces références explicites aux femmes dans la Charte est le fruit du travail de Bertha Lutz et Minerva Bernadino. Elles surent convaincre les délégués masculins, mais aussi féminins étant donné l’opposition de Virginia Gildersleeve qui jugeait l’expression générique « droits de l’Homme » suffisamment englobante. Certaines femmes diplomates du « clan occidental » considéraient d’ailleurs avec hauteur les demandes de leurs consoeurs comme relevant d’un féminisme spectaculaire et inapproprié. Cette division se reproduira lorsque Lutz et Bernardino proposeront la création d’une commission des droits des femmes au sein des Nations Unies. Gildersleeve prétextera que les droits des femmes doivent plutôt relever du cadre universel de la Commission des droits de l’homme qui venait d’être établie en 1946 et non d’un nouvel organe distinct. Finalement, la Commission de la condition de la femme (CCF) sera créée, sous l’impulsion de Bodil Begtrup, diplomate danoise qui en sera d’ailleurs la première présidente de 1946 à 1948. De composition gouvernementale et basée à New York, la CCF est éloignée des autres organes conventionnels de protection des droits de la personne siégeant à Genève. Cette distanciation géographique ne favorisera en rien la construction de liens institutionnels étroits, la solidarité des experts en matière de droits humains et, de ce fait, a contribué à la marginalisation des questions relatives aux femmes au sein des Nations Unies. Malgré ces difficultés, la CCF a joué un rôle colossal dans la promotion de l’égalité entre les sexes et, plus spécifiquement, dans l’élaboration de normes internationales protégeant les droits des femmes. À l’instar de tous les organes onusiens, la CCF n’a pas été immunisée contre l’idéologie bipolaire de la guerre froide. À l’origine, le bloc occidental était appuyé par les États de l’Amérique …
Les droits des femmes et les Nations Unies : d’hier à aujourd’hui[Record]
Professeure titulaire, Faculté de droit, Université de Montréal.