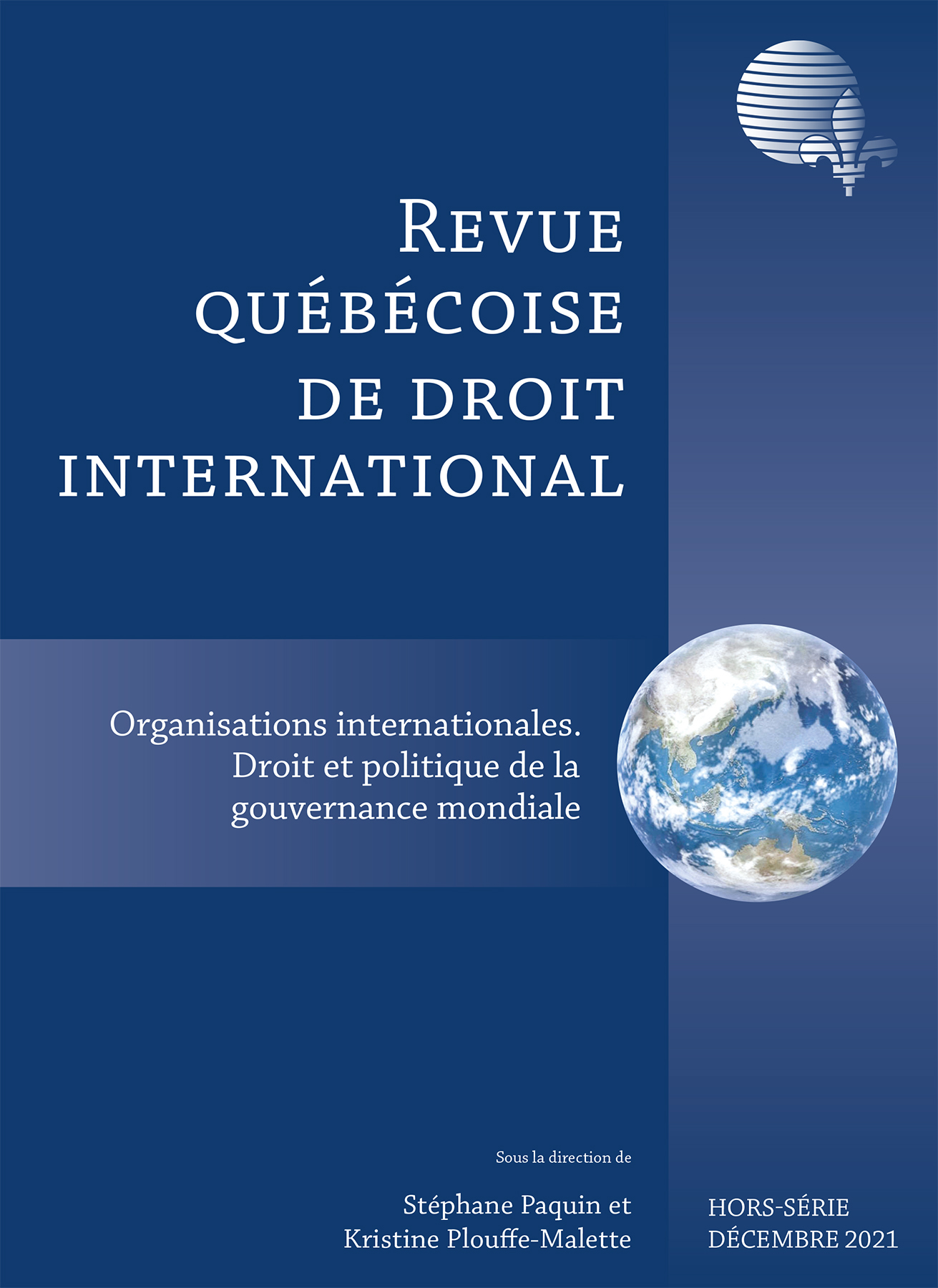L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est une agence spécialisée de l’ONU créée en 1945 qui rassemble 193 membres. Elle déploie son action dans cinq grands domaines, soit l’éducation, les sciences exactes, naturelles et sociales, la culture, la communication et l’information. Érigée sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, l’UNESCO est animée par des buts de paix et de prospérité qu’elle cherche à atteindre en stimulant la coopération entre ses membres dans ses domaines de compétence. Son Acte constitutif, soit la Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, reflète cet idéal en affirmant au premier paragraphe de son préambule que « [l]es guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Dans le secteur de la culture, la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a permis à l’Organisation d’atteindre une extraordinaire notoriété auprès du grand public. Son travail s’étend cependant bien au-delà de ce système de protection des plus beaux sites du patrimoine culturel et naturel de l’humanité. Il vise plus généralement à protéger le patrimoine sous toutes ses formes, en temps de paix et en temps de guerre, ainsi qu’à favoriser la créativité des individus et des groupes. Trente-cinq instruments juridiques contraignants et non contraignants régissent ou influencent le comportement de ses membres dans ces domaines, auxquels s’ajoutent des dizaines de programmes et d’initiatives liés à des enjeux culturels spécifiques. L’UNESCO constitue notamment un élément moteur de la coopération culturelle, en particulier entre pays développés et en développement. L’UNESCO incarne donc incontestablement le pilier culturel de la gouvernance mondiale. Son rôle dans la préservation de la diversité culturelle au sein de la société internationale ne découle toutefois pas uniquement des compétences que lui reconnait son acte constitutif. Il est surtout le fruit de plusieurs décennies d’actions et de réflexions menées par l’Organisation pour promouvoir la contribution de la culture au bien-être des sociétés. Pour en rendre compte, il faut d’abord s’intéresser à l’histoire et à la mission de l’UNESCO, ainsi qu’au travail qu’elle a réalisé en vue de faire reconnaitre le lien étroit unissant la culture aux processus de développement. Son action normative dans le secteur de la culture mérite ensuite d’être présentée à travers un survol des grandes conventions culturelles concluent sous son égide. Enfin, quelques réflexions sur l’avenir de la diversité culturelle face à quelques défis du XXIe siècle permettent d’appréhender l’évolution de la compétence culturelle de l’UNESCO au cours des prochaines décennies. D’un point de vue historique, la mission de l’UNESCO a d’abord été assumée par la Commission internationale de coopération intellectuelle (CICI), un organe de la Société des Nations (SDN) créé en 1922 dont le mandat consistait à coordonner les travaux et relations scientifiques des États membres. D’abord renforcées par la mise en place de l’Institut internationale de coopération intellectuelle (IICI) en 1926, qui devient alors l’organe exécutif de la CICI, les activités de celle-ci sont ensuite freinées par l’éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. L’UNESCO, mise en place dès la fin de ce conflit international, devient ainsi l’héritière des travaux menés précédemment par l’IICI et le CICI. Les origines mêmes de l’UNESCO remontent quant à elles à la création de la Conférence des ministres alliés de l’éducation (CMAE) à Londres en 1942. Les ministres du Royaume-Uni, de la Belgique, de la France, de la Grèce, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie se rassemblent, alors que le conflit bat son plein, pour entreprendre la reconstruction de leurs …
L’unesco et la diversité culturelle[Record]
Professeure à la Faculté de droit et à l’École supérieure d’études internationales de l’Université Laval, titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles.