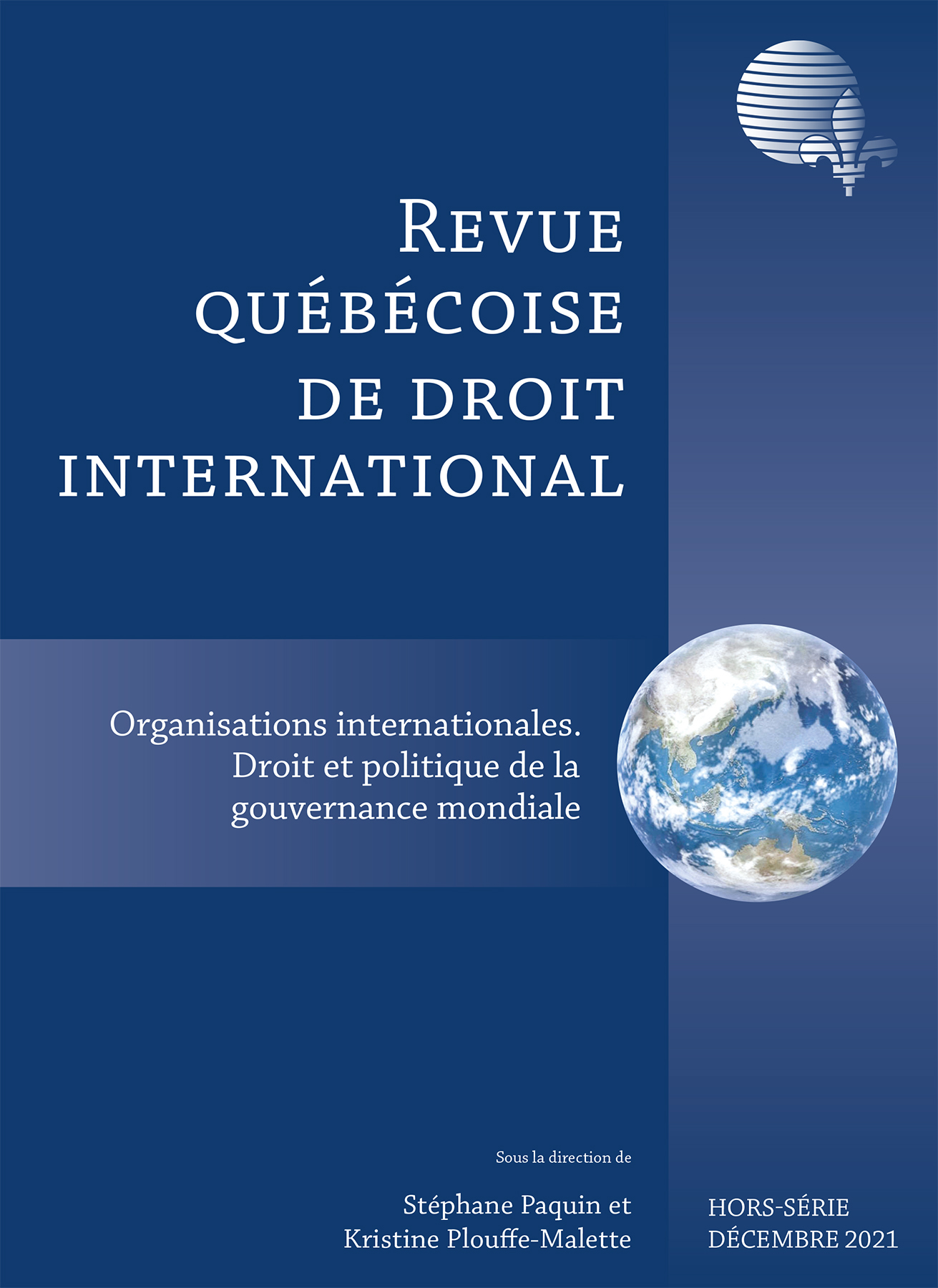En soixante-dix années d’existence, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a à son actif des réalisations significatives en matière de santé internationale audelà des attentes de sécurité sanitaire, de gestion des besoins à l’origine de sa création. L’organisation a aussi essuyé plusieurs critiques autant à l’interne qu’à l’externe en raison notamment de sa lourdeur bureaucratique, son caractère plus normatif qu’opérationnel, son manque de réactivité face aux crises, sa gestion inefficace et inefficiente des ressources et du manque de participation politique, démocratique et citoyenne au sein de ses instances. Dans un contexte de mutations rapides, profondes et transfrontalières, caractérisé par une crise sanitaire qui a aujourd’hui un apogée, l’organisation en constante transition a de nouveau rendez-vous avec l’Histoire. Cette contribution consacrée à ce « colosse aux pieds d’argile » porte un regard à la fois informatif et analytique sur les enjeux auxquels l’Organisation mondiale de la santé est confrontée. Après avoir rappelé les origines de l’OMS dans la première partie, nous présentons sa structure de gouvernance dans une seconde section. La troisième partie analyse le rôle normatif de l’organisation, tout en le replaçant dans le contexte actuel de la pandémie. La section qui suit, fait état du financement de l’OMS. Enfin, dans les deux dernières parties, les grandes réalisations et programmes stratégiques développés au cours des soixante-dix dernières années sont présentés, les défis auxquels l’OMS doit encore faire face sont abordés. En ce sens, si la crise actuelle de la COVID19 a imposé au monde entier l’urgence d’agir du local au global pour contenir la propagation de l’épidémie, elle offre aussi un momentum privilégié pour « repenser la gouvernance mondiale de la santé ». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Conférence des Nations Unies sur les organisations internationales s’est réunie à San Francisco en avril 1945 pour poser les fondations d’« un monde meilleur […] où tous les êtres humains pourront vivre une vie décente d’hommes libres ». Parmi ces bases, la création d’une nouvelle organisation internationale de la santé a été votée. Des experts venant de seize pays et des représentants des institutions existantes (Bureau sanitaire panaméricain, Office International d’Hygiène Publique (OIHP), Organisation d’hygiène de la Société des Nations (OH-SDN), Administration des Nations unies pour le secours et la reconstruction (UNRRA)) ont été mandatés par le Conseil économique et social de l’ONU pour mener des travaux au sein d’une commission technique préparatoire. Cette commission a planché sur les enjeux et préoccupations soulevés par la création de cette nouvelle organisation entre autres, l’impact des nouveaux arrangements sur le bien-fondé des organisations régionales existantes, le choix du siège de l’organisation pour lui garantir une pleine autonomie politique, l’absorption de l’OIHP par l’OMS, la question de la représentation des pays non membres, etc. Un an plus tard au terme de débats juridiques et de négociations, la Conférence internationale sur la santé réunit à New York le 19 juin 1946, approuva la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (Constitution de l’OMS). Ainsi créée, l’OMS, institution internationale spécialisée du système des Nations Unies, s’est donnée pour objectif ambitieux d’amener « tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible ». En effet, le préambule de la Constitution de l’OMS adoptée par la Conférence internationale de la Santé tenue à l’été 1946 et entrée en vigueur le 7 avril 1948 définit la santé comme : « un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » ; reconnaît qu’il s’agit d’un droit humain fondamental. Il précise également que « la santé de tous les peuples …
L’Organisation mondiale de la santé a 70 ans : de la santé internationale à la globalisation[Record]
Professeure, École nationale d’administration publique.