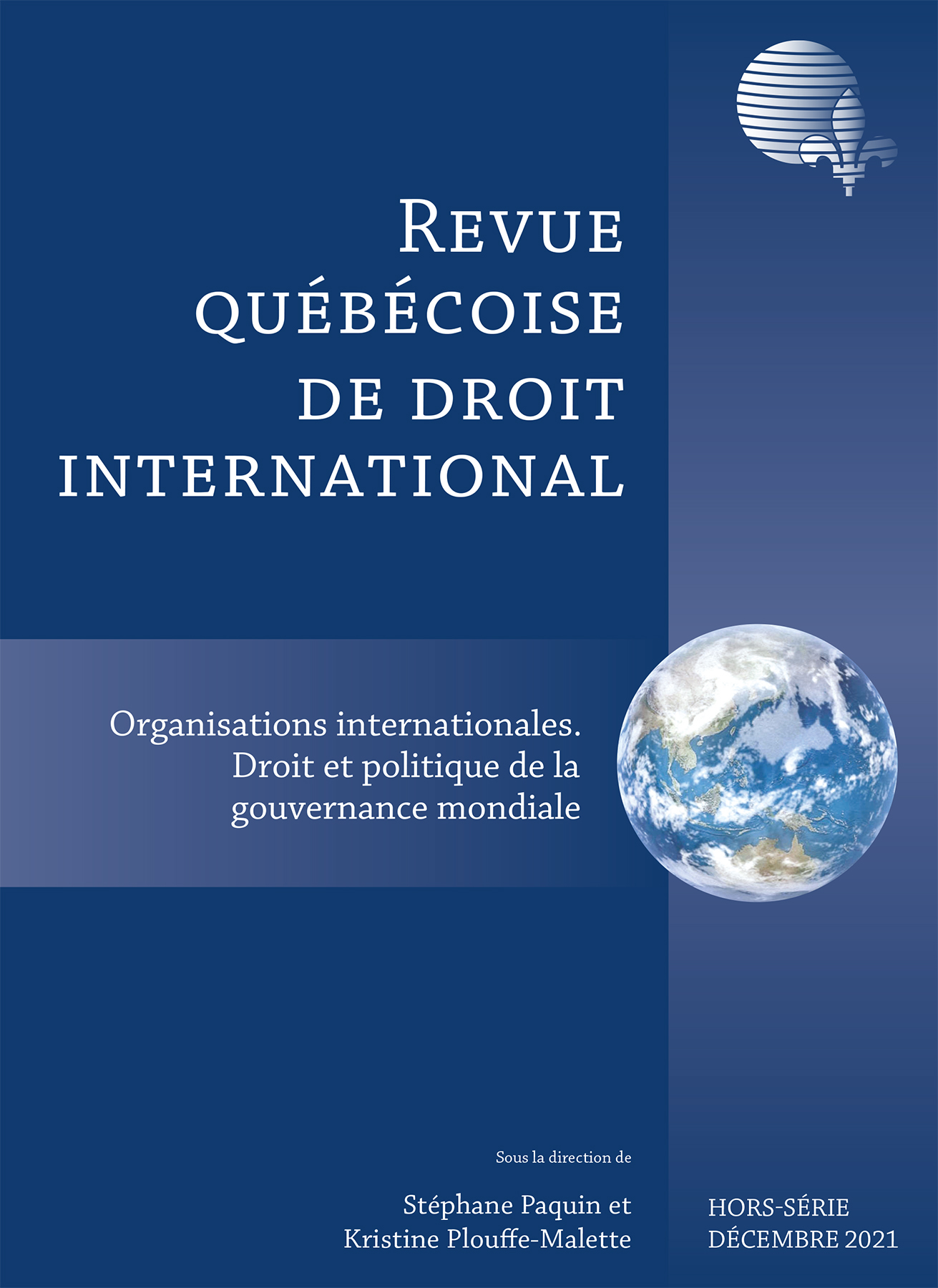Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la promotion et la protection des droits de la personne est devenue un objectif primordial d’un nombre important d’organisations internationales et régionales. Nombre d’entre elles ont adopté des normes en la matière ou se sont penchées sur les violations de ces droits et libertés par les États parties aux traités. Cette contribution analyse d’abord le système institutionnel universel essentiellement issu de la Charte des Nations Unies, puis le système universel conventionnel de promotion et de protection des droits de la personne. Seront ensuite présentés les mécanismes régionaux en la matière, c’est-à-dire les systèmes américain, européen et africain de promotion et de protection des droits de la personne. Finalement, nous nous pencherons sur les développements récents en la matière en Aise et au sein des pays arabes. À la lecture de cette contribution, il faut garder à l’esprit que chacun de ces systèmes a élaboré ses propres textes juridiques, développé ses institutions et ses procédures, à des niveaux plus ou moins similaires pour promouvoir et protéger les droits de la personne. L’enchevêtrement des normes et la prolifération des processus décisionnels en matière de droit de la personne donnent lieu à un important complexe de régimes, lequel entraine parfois une superposition anachronique de ceux-ci, mais également une incohérence normative ou décisionnelle. Bien qu’il ne s’agisse pas ni du premier traité ni de la première organisation internationale à aborder la question des droits de la personne, le système institutionnel universel de promotion et de protection des droits de la personne tel qu’on le connait à ce jour prend naissance dans la Charte des Nations Unies (Charte). C’est à l’article premier de la Charte énonçant les buts des Nations Unies qu’il est mentionné que l’organisation doit veiller à la réalisation de la coopération internationale dans « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ». La Charte ne doit toutefois pas être comprise comme un outil de promotion et de protection des droits de la personne ; si cette philosophie y est bien ancrée, les engagements ferment ne s’y retrouvent pas. Par exemple, les articles 55 et 56 créent de vagues obligations pour les États Membres afin de générer les meilleures conditions qui soient pour le développement économique et social de tous dans le respect universel et effectif des droits et libertés. Malgré cette faiblesse normative, les Nations Unies ont créé au fil du temps un réseau d’organisations qui voient à cet objectif premier. En effet, les organes des Nations Unies ont réussi à donner vie à ces obligations et ont cherché à en assurer le respect en adoptant un ensemble de traités et d’entités. L’un des premiers gestes forts posés par les Nations Unies et ses États Membres sera l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) le 10 décembre 1948. Les États Membres des Nations Unies ont ainsi rapidement reconnu l’importance de la protection des droits de la personne et se sont accordés sur le besoin de mettre en place des instruments de droit international en la matière. Il faut noter que la DUDH consiste en une résolution de l’Assemblée générale adoptée sans objection par 50 des 58 États Membres de l’époque et, par conséquent, n’a pas à proprement parler de force contraignante, car elle ne consiste pas en un traité. De nos jours, les droits inclus à la DUDH ont acquis une valeur de droit coutumier qui s’impose à tous les États. Bien qu’il n’existe pas de définition unique des droits …
Les droits de la personne : organisations internationales et régionales[Record]
Professeure associée, Université du Québec à Montréal (UQAM); Membre du GERIQ (Groupe d’étude et de recherche sur l’international et le Québec) à l’École nationale d’administration publique; Membre du CEIM (Centre en étude sur l’intégration et la mondialisation), UQAM; Codirectrice de la Revue québécoise de droit international.