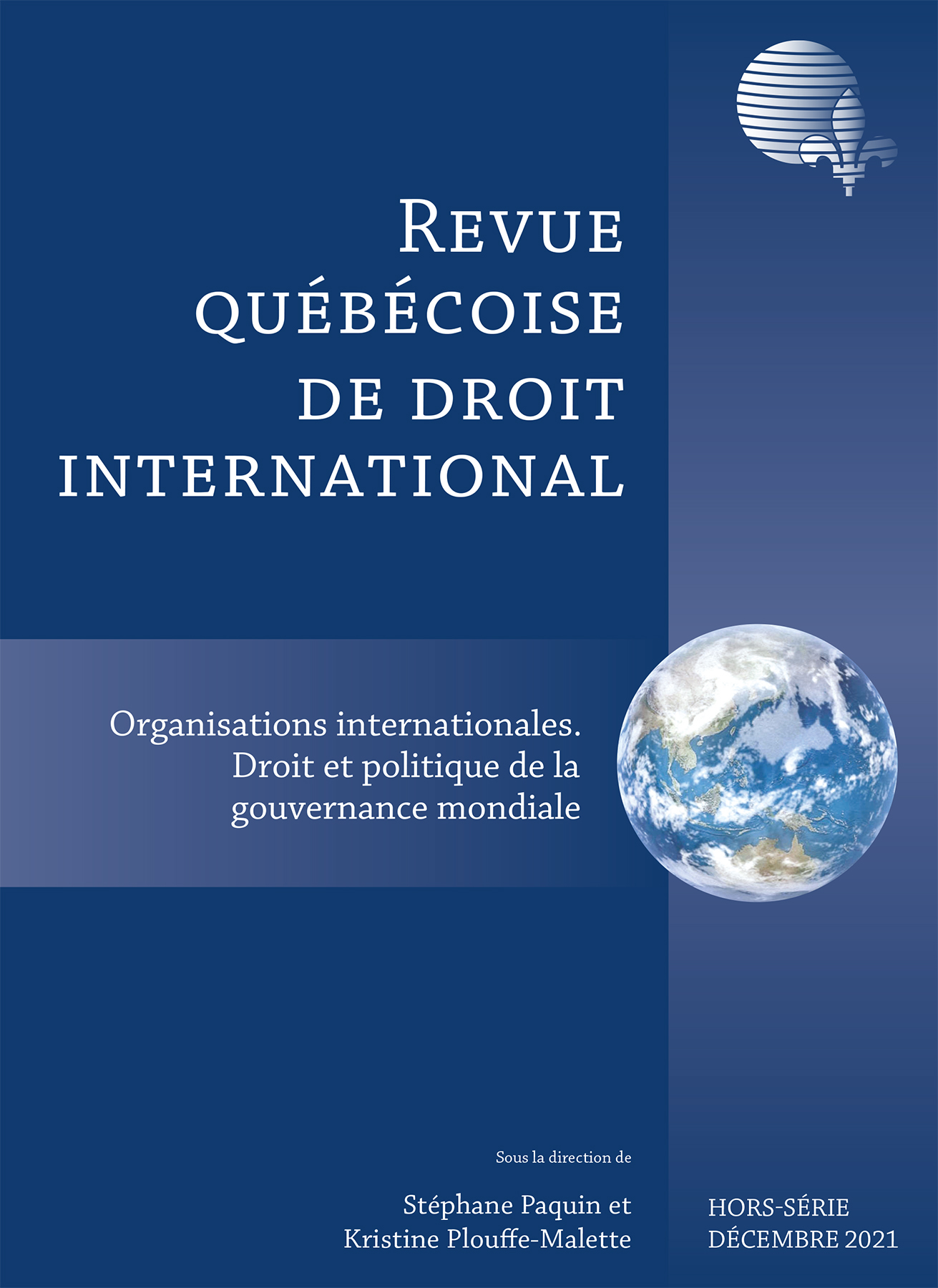L’Organisation des Nations Unies (ONU) est créée en 1945 pour « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances », comme le rappelle le préambule de sa Charte. C’est donc à l’ONU, première organisation multilatérale véritablement universelle et élément central de la gouvernance mondiale, que revient la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationales. C’est entre août et octobre 1944, à Dumbarton Oaks dans les environs de Washington, que les quatre « Grands » (Chine, États-Unis, Grande-Bretagne et Union des Républiques socialistes et soviétiques (URSS)) élaborent les structures et les compétences de l’ONU. Comme leur but est de créer un système de sécurité internationale efficace, ils dotent le Conseil de sécurité de pouvoirs réels en plus d’en faire l’unique garant du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il s’agit ici d’une différence majeure avec la Société des Nations (SDN), l’organisation qui a précédé l’ONU, puisqu’au sein de cette dernière, il n’y avait pas, en principe, de distinction de compétence entre l’Assemblée et le Conseil restreint. C’est donc une exigence d’efficacité et de réalisme qui guide la conception du Conseil de sécurité. Le nouveau Conseil consacre l’inégalité de fait entre les États membres puisque les plus puissants ont un rang et des droits particuliers au sein de l’ONU avec un statut spécial octroyé aux membres permanents, les cinq « Grands » victorieux de la Deuxième Guerre mondiale (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et URSS), sous la forme d’un droit de veto. La création de l’ONU permet de surmonter certaines des lacunes de la SDN. Tout d’abord, pour éviter la politique de la « chaise vide » comme lors du retrait du Japon et de l’Allemagne dans les années 1930, les Nations Unies mettent sur pied un Conseil de sécurité où les membres permanents ont un droit de veto et où les dix membres non permanents sont élus par l’Assemblée générale à tous les deux ans. Ensuite, pour dépasser le manque d’universalité de la SDN, l’ONU instaure une Assemblée générale où tous les États du monde peuvent être membres et qui, en théorie, supervise les travaux du Conseil de sécurité. Enfin, pour éviter l’inactivité de la SDN, l’ONU crée un Secrétariat permanent possédant une expertise technique et diplomatique importante. Cette contribution examine la capacité d’adaptation de l’ONU et plus spécifiquement du Conseil de sécurité dans « le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Malgré ses innovations par rapport à la SDN, l’ONU fait face à de nombreux défis à ses débuts qu’elle réussit à surmonter graduellement grâce à sa flexibilité institutionnelle. C’est d’ailleurs cette flexibilité qui donne naissance au maintien de la paix entre 1948 et 1956. La sécurité collective telle qu’envisagée dans la Charte n’étant pas mise en oeuvre pour cause de tensions entre Américains et Soviétiques, l’ONU (Assemblée générale et Secrétariat) improvise en créant le maintien de la paix. Cette contribution vise à présenter les liens entre le Conseil de sécurité et le maintien de la paix et pour ce faire il est divisé en trois parties qui analysent : La création de l’ONU repose sur une initiative américaine et plus spécifiquement du président Franklin Delano Roosevelt. C’est lui qui souhaite appeler la future organisation « Nations Unies ». Cela explique les similitudes organisationnelles entre le système politique des États-Unis et celui des Nations Unies. Comme dans le système américain, l’ONU est dotée d’un organe exécutif (le Conseil de sécurité), d’un organe législatif (l’Assemblée générale) et d’un organe juridique (la Cour internationale de justice). Le Secrétariat, …
Le Conseil de sécurité et les opérations de maintien de la paix[Record]
Professeur de relations internationales, Sciences po Paris.