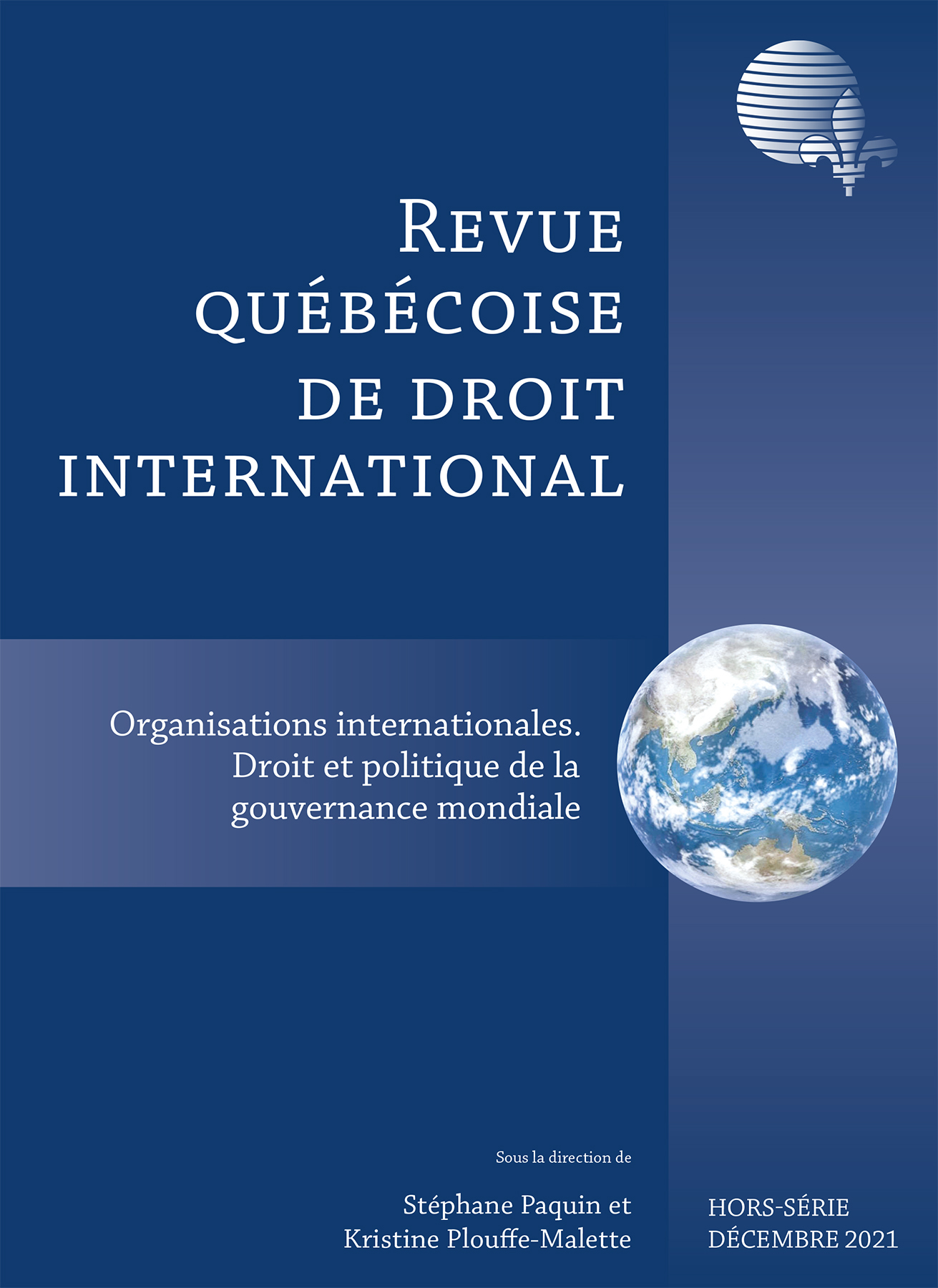Si l’Organisation des Nations Unies (ONU) a d’abord été conçue pour être le centre de la diplomatie multilatérale dans la politique mondiale de l’après-Deuxième Guerre mondiale, il ne faut jamais perdre de vue le fait que cette organisation a été pensée pendant la guerre comme un outil de paix. À ce titre, le tout premier considérant du préambule de la Charte des Nations Unies est éloquent : « Nous, peuples, des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances ». En définitive, avant toute chose, les Nations Unies cherchent à préserver la paix, ce qui inclut le respect des droits fondamentaux, la création de conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect du droit international et le développement du progrès social. L’étude de la pratique onusienne permet dorénavant d’affirmer qu’elle intervient en toute matière dont certes la paix et la sécurité internationales, mais également les changements climatiques, le développement durable, les droits fondamentaux, le désarmement, le terrorisme, les crises humanitaires et sanitaires, l’égalité entre tous, le commerce, la gouvernance, la production alimentaire, etc. Dorénavant aucun thème n’échappe aux Nations Unies ! Ainsi, le système onusien a été créé en 1945 et repose aujourd’hui sur une architecture complexe, qui n’a pas été développée de manière linéaire, mais bien selon les besoins et les problématiques du moment. Cette contribution présente cette construction unique en son genre pour ensuite aborder quelques aspects qui le lient aux normes de droit international. Finalement, les principaux défis que cette organisation internationale à vocation universelle rencontre encore à ce jour, plus de 75 ans après sa création, seront étudiés. La création de l’ONU repose sur la Charte des NationsUnies. Ce traité fondateur prévoit l’ensemble des normes générales sur lesquelles s’appuient les Nations Unies. Pour arriver à ses fins, il est précisé au préambule de la Charte, qu’il importe d’être tolérant, de vivre en paix dans un esprit de bon voisinage, d’unir nos forces pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, d’accepter les principes et les méthodes de règlement des différends sans le recours aux armes, mais plutôt aux institutions internationales, notamment pour favoriser le progrès économique et social de tous. Le libellé des articles 1 et 2 de la Charte énonce les principes fondateurs de la gouvernance mondiale. Ceux-ci s’expriment à travers des principes que les Membres doivent respecter. D’abord, l’ONU est fondée sur l’égalité souveraine des Membres, lesquels doivent remplir leurs obligations de bonne foi. Ceci implique la résolution de différends par des moyens pacifiques, l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force, contre le territoire ou l’indépendance d’un État. Dans la réalisation de ces principes, les Membres se doivent assistance et s’abstiennent d’assister un État contre lequel une action est menée. Finalement, aucune disposition de la Charte ne doit s’interpréter comme une autorisation d’intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États. En résumé, en devenant Membre des Nations Unies, les États doivent s’abstenir de recourir à la force armée et ne doivent en aucun cas intervenir dans les affaires intérieures des uns et des autres, tout en choisissant des moyens pacifiques pour régler leurs conflits. L’ONU est une organisation internationale à vocation universelle, c’est-à-dire à laquelle tous les pays peuvent appartenir. S’ils étaient 51 au moment de sa création, ils sont dorénavant 193 auxquels s’ajoutent deux Membres observateurs, sans droit de vote, le Vatican et la Palestine. Peuvent devenir Membres tous les États qui acceptent le libellé de …
Le système des Nations Unies : au coeur de la gouvernance mondiale[Record]
Professeure associée, Université du Québec à Montréal (UQAM); Membre du GERIQ (Groupe d’étude et de recherche sur l’international et le Québec) à l’École nationale d’administration publique; Membre du CEIM (Centre en étude sur l’intégration et la mondialisation), UQAM; Codirectrice de la Revue québécoise de droit international.