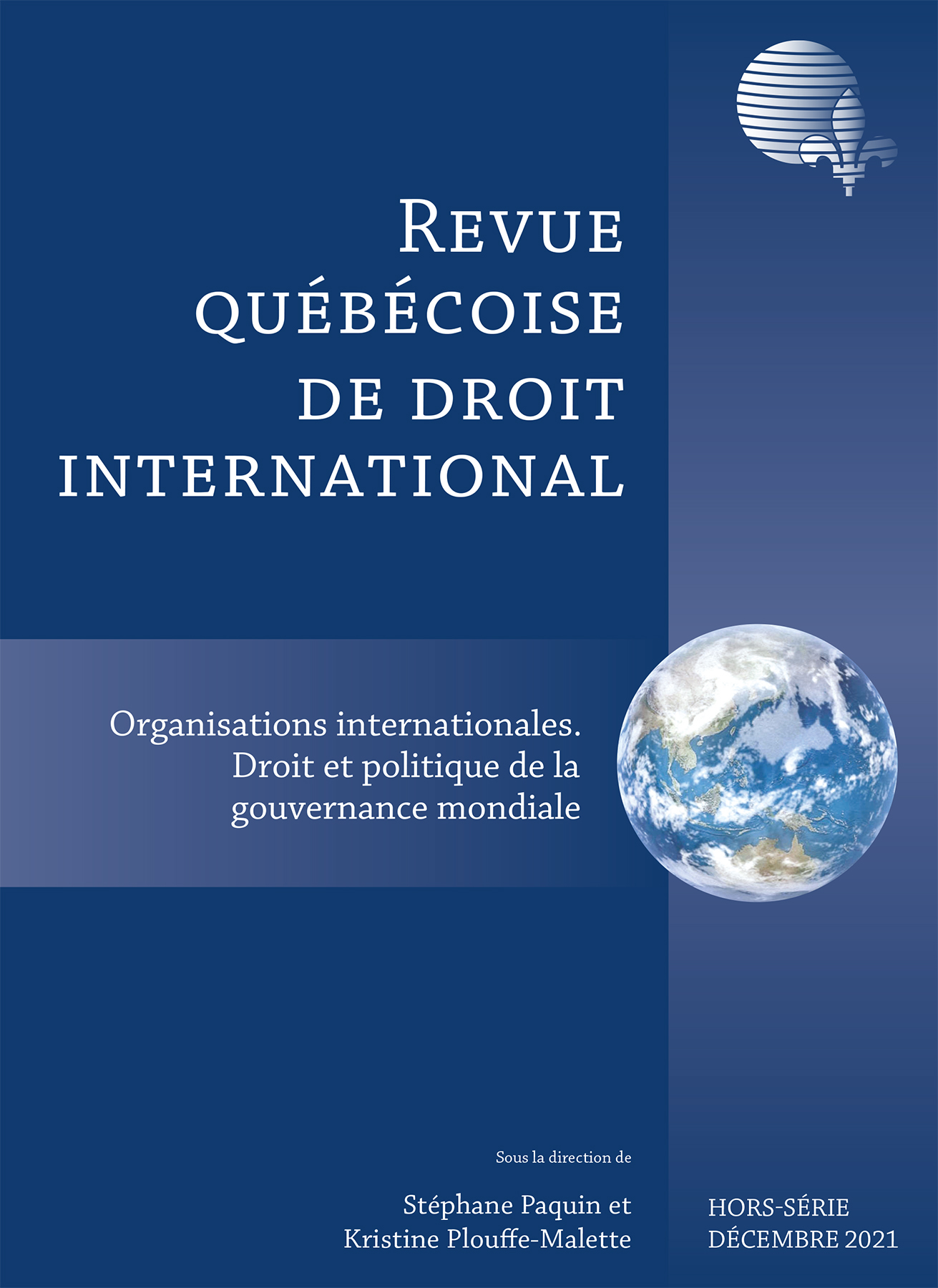En sciences sociales, une théorie est un outil d’abstraction et de simplification de la réalité qui permet au chercheur de discriminer ce qui est fondamental de ce qui ne l’est pas pour comprendre un aspect du monde. Les théories sont des hypothèses organisées qui agissent comme des décodeurs qui donnent un sens à une réalité complexe. Une perspective théorique, pour sa part, est constituée d’un ensemble de théories qui sont compatibles entre elles. Une perspective théorique peut se concevoir comme des lunettes qu’on met pour guider notre analyse. Quand on porte des lunettes jaunes, le monde nous apparaît teinté de jaune, alors que lorsqu’on les remplace par des lunettes rouges, ce même monde nous semble plutôt rouge. Or ce n’est pas le monde qui a changé, mais bien la lentille des lunettes. Suivant cette logique, quand on regarde à travers les lunettes de la perspective théorique libérale, on perçoit plus volontiers la coopération entre les États dans la gouvernance mondiale. En revanche, dès lors qu’on enfile les lunettes des réalistes, on observe plutôt un monde marqué par des relations de pouvoir entre les grandes puissances qui nuisent au fonctionnement des organisations internationales. Les débats théoriques sur les organisations internationales et la gouvernance mondiale opposent diverses écoles de pensée. Ce sont les auteurs de tendance libérale qui ont poussé le plus loin la réflexion sur ces questions, mais leurs idées sont toutefois critiquées par les chercheurs de la perspective constructiviste et de la réaliste, pour les perspectives les plus citées. Ces trois perspectives sont également fortement contestées par les diverses perspectives de théories critiques que ce soit la perspective néogramscienne, la perspective environnementale critique, la perspective féministe et la perspective postcoloniale. Dans cet article, nous présentons successivement les principaux débats entre ces écoles de pensée. En règle générale, les auteurs libéraux, qui projettent essentiellement les débats issus des Lumières en politique mondiale, perçoivent de manière positive les organisations, les régimes et le droit international dans la gouvernance de la politique mondiale. Dans le cas du droit international, même si ce dernier est moins hiérarchique et plus difficilement applicable que le droit national, ils admettent qu’il demeure l’un des principaux instruments pour encadrer et favoriser la coopération dans la politique mondiale. Sans droit international, il y aurait moins de prévisibilité pour les États : les territoires et les espaces aériens n’existeraient pas ; les paquebots pourraient circuler sur les mers, mais à leurs risques et périls ; la propriété à l’extérieur du territoire national ne serait pas protégée du pillage ou de la dégradation ; les ressortissants n’auraient pas de protection ou de droits à l’étranger ; les relations diplomatiques seraient difficiles tout comme le commerce international, la conversion des devises, etc. Plusieurs courants sont présents au sein de la perspective libérale, nous présentons les plus importants. Le théoricien qu’on associe le plus à l’approche « fonctionnaliste » des organisations internationales est David Mitrany avec son ouvrage A Working Peace System : An Argument for the Functional Development of International Organization publié en 1943. Après l’échec de la Société des Nations, l’objectif de Mitrany est de penser un système international qui favoriserait la paix. Mitrany partage l’analyse des théoriciens réalistes que nous verrons plus loin sur la politique de puissance des États, Hans Morgenthau, un fondateur de la perspective réaliste, a d’ailleurs signé la préface de l’édition 1966 de son livre. La proposition de Mitrany repose sur l’idée qu’au lieu d’espérer la paix d’un improbable accord politique entre grandes puissances, mieux vaut saisir ce qui unit ces États et exploiter leurs liens comme autant de possibilités de resserrer les interdépendances afin de …
Les organisations internationales dans la théorie des relations internationales[Record]
Professeur titulaire, École nationale d’administration publique.