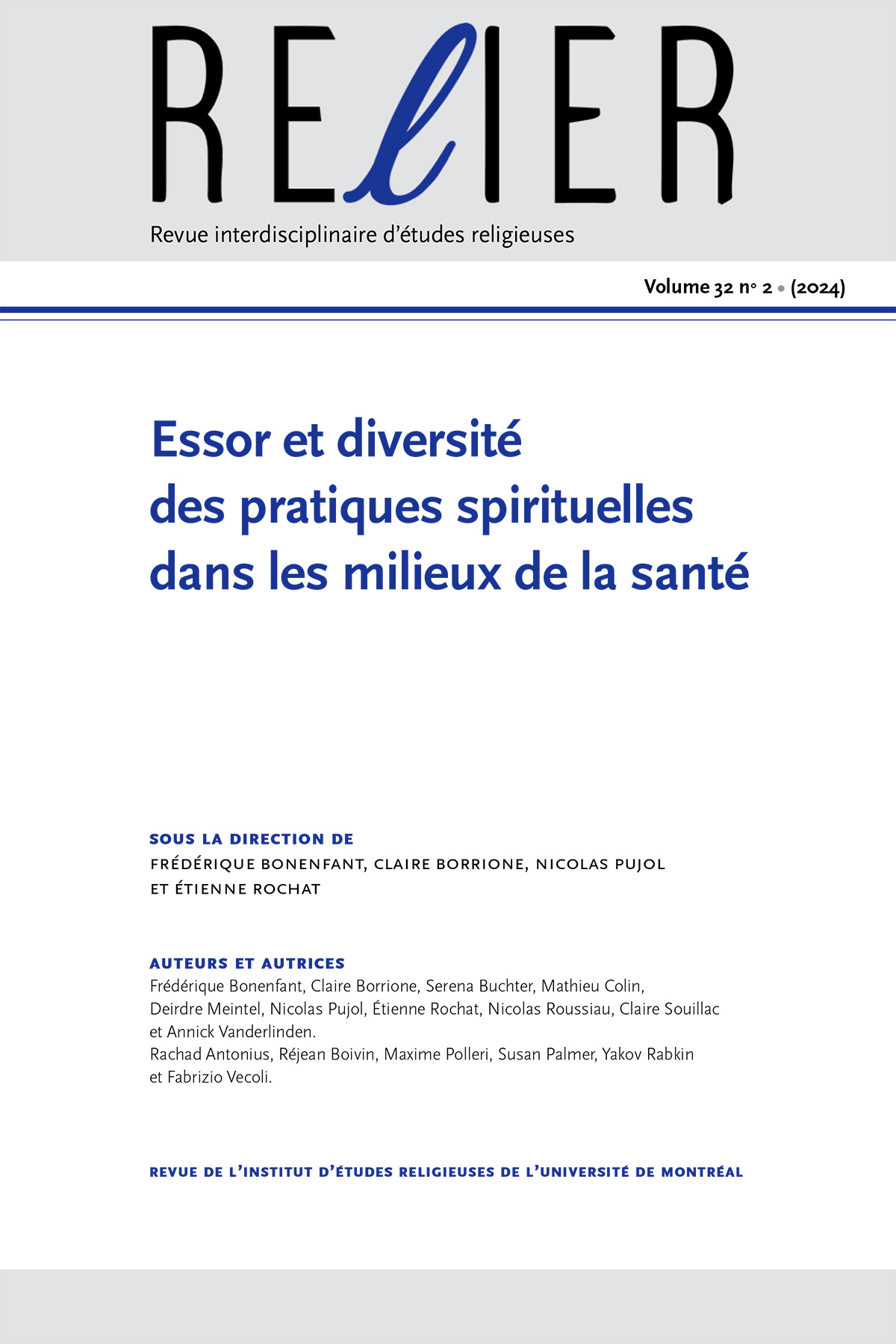Abstracts
Résumé
Ce travail porte sur la construction identitaire du spirite kardéciste. Comment s’enchevêtrent dans le médium agentivité propre et participation des esprits ? Sa conception de soi en est-elle transformée ? À qui attribuer les fruits de l’interaction médiumnique ? Nous tenterons de donner des éléments de réponse en proposant une comparaison avec la théologie chrétienne, en particulier la mystique de Claire d’Assise, et sa contemplation au « miroir de la Croix ». En quoi ces comparaisons peuvent-elles nourrir la réflexion sur la double-agentivité ?
Mots-clés :
- kardécisme,
- mysticisme chrétien,
- identité,
- agentivité,
- transformation
Abstract
This research aims to deal with the kardecist medium’s construction of identity. How does the medium deal with his own identity? Is his conception of Self transformed? The paternity of the creations achieved under mediumship – artwork, healing acts – remain somehow ambiguous: who is at the outset, the medium or the spirits? We will try to answer these questions through a comparison with the Christian theology, especially the mystic spirituality of Clare of Assisi and her desire to reflect on Christ and his crucifixion. What can this theological path bring up to the issue of double agentive constructions?
Keywords:
- kardecism,
- christian mysticism,
- identity,
- agency,
- transformation
Article body
Introduction
Né en France au 19e siècle, le kardécisme, communément appelé « spiritisme moderne », repose sur trois piliers : charité, réforme intime et apprentissage médiumnique, autour desquels il s’est stabilisé. Nous nous intéresserons ici aux deux derniers aspects, qui soulèvent une injonction de transformation et des questions identitaires. Indissociablement liés, réforme intime et apprentissage médiumnique procèdent d’exercices spirituels évoquant ceux de la philosophie antique (Foucault 1994), dont l’objectif est pour le spirite kardéciste d’acquérir un contrôle sur soi, et donc sur sa médiumnité, ainsi que son rapport avec ses esprits. Par l’effort de maîtrise qu’elle requiert de sa part, la médiumnité permet au médium de dominer son incertitude intérieure et extérieure.
Dans notre thèse, nous avons considéré la médiumnité kardéciste tout à la fois comme l’expression d’un sentiment d’incertitude et comme un « rachat de la présence » (De Martino 1971, 88), c’est-à-dire le rétablissement de l’intégrité menacée de l’individu. Résolument optimiste, cette interprétation de la médiumnité souligne l’effort de dépassement des crises existentielles. Le kardécisme reflète une préoccupation identitaire. La question centrale de la construction de soi se fait aigüe dans le cas du sujet-médium : comment en effet être soi lorsque d’autres sont présents à et en soi ? Ainsi, la définition de soi s’avère centrale dans les études actuelles portant sur les spiritismes.
Sociologie, anthropologie, psychologie ont problématisé l’identité en termes de frontière : individuelle comme collective, elle se définit par ses limites – entre « soi » et « l’autre », entre « nous » et « eux ». A fortiori une identité plurielle est-elle équivoque ? Dans la relation avec les esprits, l’identité de la personne se révèle problématique : elle est par essence poreuse, ouverture à l’autre, et donc à définir, construire, négocier.
À son tour, la labilité du « soi » se trouve corrélée au problème de la créativité et plus essentiellement de la création-même du sujet-médium : dans l'inspiration qui le visite, quelle est la part « du volontaire et de l’involontaire » (Aubrée et Laplantine 1990) ? L’ambiguïté de la relation aux esprits, comme celle de la connaissance qui en émane, pointe un aspect énigmatique du rapport à l’intellection, à l’intuition, à l’origine de l’inspiration : où s’arrête et commence l’implication du sujet spirite ? Quel est son rapport avec l’entité ? Comment qualifier l’interaction ? Qui est l’auteur de la création ? Il s’agit là d’autant de questions qui suggèrent des rapports à préciser entre soi et autrui… Où sont les limites du soi et de ce qui lui appartient ?
Depuis le De Anima d’Aristote (384-322 av. J.-C.), la tradition philosophique métaphysique n’a cessé d’interroger le processus d'intellection, et par conséquent les liens entre intellect humain et intellect divin : comment pensons-nous ce que nous pensons ? D’où provient ce que nous pensons ? En sommes-nous la source ? L’objet de la noétique est de tenter de répondre à ces questions. Dans l’origine indéfinie de l’inspiration et les modalités de son appropriation, une certaine transcendance est évoquée.
La médiumnité kardéciste donne à appréhender cette intégration de la dualité comme un travail de négociation continuelle dont découle la répartition du soi et de l’Autre. La « participation » du médium à l’oeuvre commune ne lui est ni complètement étrangère ni complètement propre. Elle réalise cette conciliation préservant l’agentivité personnelle et l’agentivité des esprits, transcendante au sujet personnel. Il s’agit ainsi d’une « cocréation ». À l’inverse, dans l’idéal mystique chrétien, la duplicité du « je » se trouve résolue en Dieu : l’ego s’est anéanti pour laisser place en lui au Saint Esprit. Et à ce point, l’agentivité transcendante constitue l'unique pôle désirable et le chemin le plus sûr pour se trouver Soi, c’est-à-dire renaître à son soi divin.
La spiritualité de Claire d'Assise et sa métaphore du « miroir de la croix » visent, par l’ouverture au Saint Esprit, la transformation de l’être intime. Avec l’aide quelque peu mystérieuse du Saint-Esprit, l’imitation et la conformation à l’agir du Christ transforment le croyant en image de Dieu, tandis qu’il chemine, par là-même, à la rencontre de son « vrai » soi (Delio 2015). Ainsi, dans le catholicisme, la co-construction se réalise avec l’Esprit Saint – soit un Esprit, Divin celui-là.
Nous souhaitons dans cet article, par le biais de l’analogie entre le kardécisme et la mystique chrétienne de Claire d’Assise, examiner la manière dont leur positionnement respectif peut éclairer la question de la double-agentivité, et celle du lien entre le soi et l’autre.
À cette fin, nous exposerons en premier lieu, à partir des données d’une enquête de terrain multi-située et des propos de nos informateurs[1], la conception kardéciste du rapport avec les esprits, pour mieux y lire la place, les modalités, les formes de l’agentivité et de la négociation de soi. Ensuite, nous préciserons brièvement l’historicité de la notion de sujet-agent (De Libera 2007 ; 2008), avant de proposer un détour théologique permettant d’approfondir le rapport à l’au-delà dans la tradition chrétienne. Nous tenterons alors, depuis la spiritualité franciscaine, de décliner les conséquences de la double-agentivité dans l’un et l’autre cas : dans le kardécisme avec les esprits, et dans le mysticisme clarissien avec le Saint-Esprit, afin d’engager une réflexion sur les implications philosophiques de ces différents rapports à l’au-delà.
1. Contour de la doctrine spirite et rapport aux esprits dans le kardécisme
Le kardécisme a été fondé en France au milieu du 19e siècle par le pédagogue lyonnais Hyppolite Léon Denizard Rivail, plus connu sous le pseudonyme d’Allan Kardec. Il s’ancre à la fois dans la tradition française du magnétisme, et dans celle du « modern spiritualism » américain. C’est aux États-Unis que s’est déroulée la première communication médiumnique stricto sensu[2]. Elle y déclencha une vague de « médiumnité », relayée par les cultes charismatiques évangélistes qui fleurissaient à l’époque, avant de traverser l’Atlantique et de donner lieu à la vogue des tables tournantes d’abord en Angleterre, puis en France et bientôt dans toute l’Europe. Allan Kardec étudia ces phénomènes spirites et, dans un contexte social progressif et positiviste, les formalisa en une doctrine philosophique, scientifique et religieuse[3]. Cette dernière prêchait la croyance en la réincarnation et établissait la médiumnité en tant qu’instrument de médiation avec les esprits désincarnés. Elle se voulut science plus que religion, bien qu’elle puisât ses enseignements dans le christianisme primitif. Exportée au Brésil par des disciples d’Allan Kardec exilés à la fin du 19e siècle, elle se structura dans une dialectique avec le catholicisme et les autres cultes médiumniques (candomblé, animisme) déjà implantés sur le sol brésilien, à partir duquel elle s’est disséminée partout dans le monde, réveillant dans les années 1970 un spiritisme français devenu marginal au cours du 20e siècle.
Ma recherche menée sur ces trois lieux d’origine du kardécisme m’a permis de cerner un noyau d’activités et modi operandi communs. Le spiritisme repose en effet sur des pratiques et discours hérités des textes fondateurs d’Allan Kardec, offrant une unité transnationale à la doctrine, par-delà les spécificités locales (Souillac 2016). Ainsi, sur les trois continents, les centres sont organisés autour de conférences publiques, de groupes d’étude des textes de Kardec hiérarchisés selon leur avancée, de séances de fluidothérapie (thérapie magnétique par imposition des mains) – voire l’évangélisation infantile, et des projets caritatifs selon la taille du centre. Bien sûr, la médiumnité y occupe une place incontournable parce que les groupes existent sur le critère affinitaire d’une morale partagée et de ce vécu médiumnique commun. Ainsi, le coeur discret de chaque centre est la « table médiumnique », où officient les médiums pour un « travail » thérapeutique de secours à des personnes en difficulté – souvent psychologique –, dont ils recherchent la cause spirituelle, c’est-à-dire son origine dans le monde des esprits. Il n’est pourtant pas si aisé d’accéder à la table médiumnique ! De fait, je n’y suis pas parvenue, même en simple observatrice et non praticienne, bien que j’aie entrevu à de nombreuses reprises cette possibilité, sans que jamais elle ne se concrétise – ce qui est révélateur du parcours évolutif assez hiérarchisé du spirite au sein du centre qu’il fréquente : participer à cette activité est le couronnement d’un cheminement patient d’étude, mais aussi d’un engagement assidu dans la durée aux diverses activités du centre, qu’il vient sanctionner. Il convient donc de respecter un protocole, car le groupe des médiums est jaloux de ses prérogatives. Y participer sans la préparation adéquate peut en outre représenter un danger pour le néophyte.
Je m’appuierai donc, pour présenter la médiumnité kardéciste, sur les entretiens semi-dirigés que j’ai menés auprès de 60 personnes, ainsi que sur leur témoignage. Ce sujet a souvent été abordé par mes informateurs dans le sillage de préoccupations morales, car la médiumnité ne constitue pas une fin en soi, mais est au service d’une raison plus noble, à savoir devenir une meilleure version de soi, pouvoir aider, etc.
Le socle de l’édifice spirite repose sur trois principes : Étude, Charité, Réforme intime. La réforme de soi, surtout, s’avère incontournable. Elle tient aux efforts que le spirite consent pour s’adapter à un nouvel état et une nouvelle identité, ceux de médium, de par la mise en oeuvre d’une réforme morale et la fréquentation des groupes d’étude. Cette réforme par laquelle le spirite tente de se défaire de ses vices et défauts, et l’apprentissage médiumnique, procèdent d’exercices spirituels évoquant ceux de la Grèce antique (Hadot 1981) : l’examen de conscience, une certaine discipline, le filtrage des représentations et la possession de soi sont en effet essentiels pour la maîtrise de la médiumnité. La rééducation du regard et de la perception relèvent d’injonctions morales, dont la traduction en acte est laissée à l’estimation du kardéciste, guidé par une morale évangélique.
Il s’agit d’une purification de l’âme qui vise à niveler les excès : le spirite s’évertuera à adopter un mode de vie sain, à cultiver une piété solide, à fréquenter assidument le centre, ainsi qu’à s’engager socialement. Rosemarie, médium clairaudiente[4] de Salvador, témoigne :
Cela me plairait mais c’est une grande responsabilité. […] – une personne qui travaille à la table médiumnique ne peut pas boire, et des fois, je prends des bières... […] doit avoir une vie très... ordonnée...
Entretien du 30 avril 2013
La médiumnité oblige ainsi le spirite à se gouverner – à dépasser les troubles induits par l’interférence des esprits – et ce d’autant plus que les heurts de sa médiumnité font écho à ses déséquilibres intérieurs – étant donné que les émotions négatives sont supposées attirer des esprits inférieurs. Elle fait donc l’objet d’un apprentissage, qui permet d’en surmonter les éléments gênants, notamment lorsqu’elle a surgi de manière impromptue dans la vie du spirite. Cet « apprentissage » est celui imposé par la réforme intime et diffère selon chaque personne : il consiste non en l’assimilation de « techniques médiumniques » mais en celle de nouvelles habitudes de vie, plus éthiques, modérées, justes. Par le travail sur soi qu’il entreprend, le spirite domine petit à petit les manifestations médiumniques et s’y adapte, négociant et renégociant sans cesse ses propres limites, reprécisant ce qu’il est et ce qu’il n’est pas, dans un processus itératif de subjectivation. Plus il se connaît, plus il devient maître de lui-même, et plus sa médiumnité se stabilise.
Les formes de manifestation de la médiumnité de mes informateurs sont variées. Elles procèdent de rêves ou cauchemars, de prémonitions ou intuitions, de visions ou d’auditions de voix, de l’écriture automatique ou d’inspirations. Pour certains, la médiumnité relève d’une hyperesthésie. D’aucuns m’ont relaté leur expérience de l’« obsession »[5] et le processus qui leur a permis de la surmonter – le plus souvent le suivi des groupes d’étude et la mise en oeuvre de cette réforme de soi qui en découle, dans les cas plus sévères des « cures de désobsession » (prises en charge par les médiums aguerris qui délivrent de l’esprit perturbateur au cours de séances à la « table médiumnique » durant lesquelles le patient comme l’esprit « obsesseur » sont amadoués, pacifiés). D’autres à l’inverse évoquent leurs échanges avec des guides « alliés » comme c’est le cas pour Rosemarie : « Je sens les choses que j’ai à faire, dans ma tête […] L’esprit parle avec moi, c’est-à-dire, mon ange gardien : “ne fais pas ça, ça ne va pas être positif” » (même entretien).
Par ailleurs, la médiumnité peut révéler une vulnérabilité des individus. La crise médiumnique apparaît comme le symptôme d’une crise identitaire. En effet, la plupart des spirites connaissent une période de doute existentiel qui prélude à leur affiliation : remise en cause métaphysique, rejet de leur croyance antérieure, souci de santé, divorce ou deuil, etc. Ils traversent un épisode médiumnique ou sont conduits au spiritisme par une curiosité sourde qui les amène à côtoyer ce phénomène.
Cette quête diffuse (Souillac 2017) manifeste une « labilité identitaire[6] » – parfois causée par la médiumnité, parfois à l’inverse prédisposant à son déclenchement. Nathalie, une informatrice parisienne, a témoigné de ce délicat exercice de composition avec sa médiumnité : « Le problème du médium, c’est que je n’ai jamais été complètement incarnée, « c’est pas » [sic] évident de trouver sa place, on se sent toujours un peu à part » (Entretien du 29 septembre 2014). La médiumnité témoigne d’une fragilité identitaire, et à son tour fragilise. C’est d’ailleurs une raison invoquée de l’accès dûment contrôlé à l’enseignement médiumnique. Soraya escomptait ainsi acquérir, par la fréquentation des groupes d’étude, « une vraie formation à la médiumnité », afin d’« exploiter » ses possibilités, comme elle l’a précisé, de « canaliser ces choses que je ne maîtrise pas, qui peuvent me desservir, qui pourraient aussi me servir, m’apporter. » (Entretien du 7 mai 2014)
Pour caractériser la double-agentivité spirite, Diana Espirito Santo a suggéré l’idée de l’élaboration d’un « soi étendu », d’un « soi multiple » (Espirito Santo 2013). Mais avant d’évoquer plus avant cette hypothèse, faisons un détour historique.
2. Personne et double-agentivité
L’archéologie des conceptions de la personne révèle que l’avènement du sujet-agent procède d’un long dialogue entre théologie et philosophie, depuis l’Antiquité tardive jusqu’à l’âge classique, plus ou moins complètement occulté par la philosophie (De Libera 2007, 343).
Il repose tout d’abord sur l’introduction par Augustin, dans le De Trinitate, du modèle périchorétique par lequel l’âme est immanente à ce qu’elle pense ou fait – d’après le modèle trinitaire d’immanence mutuelle des « trois personnes en une seule substance » (215). Influencé par le questionnement de la noétique néo-platonicienne sur l’intellection, il conçoit les actes mentaux comme étant « de l’âme elle-même » (263).
Par la suite, Saint Thomas aurait introduit le sujet pensant ou sujet-agent : « l’âme n’est sujet qu’en étant agent, quand elle opère son opération propre qui est pensée ou volition » (329). Au passage, la théologie trinitaire a transformé le sujet d’attribution, d’appropriation « en un sujet d’imputation, un sujet responsable », introduisant dès lors la conscience. Ainsi, l’identité personnelle consiste en une identité de conscience et non de substance (Pécharman 2014). Ce bref rappel laisse entrevoir combien les concepts de sujet-agent et d’individualité sont équivoques et discutables, tant dans leur origine que dans leurs implications ; on comprend que la question de l’agentivité a toujours été problématique, or le problème de la double-agentivité en milieu spirite demeure inscrite dans cette histoire.
Diana Espirito Santo conçoit ce processus d’individuation à l’oeuvre dans la transformation véhiculée par l’apprentissage médiumnique, comme une construction de soi par les choix que le médium opère à partir des influences perçues : « nous devons discerner entre ces influences spirituelles et nous-mêmes. Toutes ces dernières filtrent à travers nous, mais nous sommes les décideurs ultimes de ce que l’on en fait », témoigne l’un de ses informateurs (Espirito Santo 2013, 10-11). Cintia Cavalcante, leader d’un groupe californien que j’ai fréquenté, souligne combien cette relation est unique, propre à chaque médium :
Ta guidance ne te dit pas quoi faire, autrement où serait l’effort ? […] Tes guides ne te donnent pas de réponse, ils peuvent t’inspirer. […] Ils sont déjà passés par là, ils connaissent, ils veulent que tu fasses par toi-même. […] Nos guides nous inspirent, nous parlent, nous interrogent, mais nous dire quoi faire, ils ne le pourraient pas, sinon ils interfèreraient avec notre libre-arbitre. […] [Ils] nous conseillent : « tu sais, tu devrais faire ça, ou peut-être tu devrais vérifier ça » […]. Ils peuvent m’inspirer, venir dans mes rêves, m’interroger – ils me posent beaucoup de questions : « serais-tu en train de répéter des schémas de comportement peut-être ? » […] C’est une expérience personnelle, ce phénomène de guidance, chacun y a un rapport différent et c’est ce qui est beau.
Entretien du 18 juin 2014
Claudia, présidente du groupe parisien, affirme : « Ils viennent nous dire quand ils pensent qu’ils doivent dire quelque chose, sinon ils s’en fichent » (entretien du 8 mai 2014). Guillaume, un jeune membre du même groupe, évoque l’aspect collaboratif de l’échange spirituel :
Quand on fait quelque chose dans le monde physique, on a besoin de leur assistance, donc s'ils ne sont pas prêts en haut, on n’aura pas de résultat probant. […] C’est une collaboration, nous on y prend part. […] Le monde physique n’est que le haut de l’iceberg, si ça se passe dans le monde physique c’est que tout existe dans le monde spirituel qui a permis que ça arrive. En tout cas il y a cette équipe, tu ne peux pas travailler tout seul.
Entretien du 27 avril 2014
En un mot, il n’existe pas de manière uniformisée de faire sienne la présence des esprits. Le kardécisme tend à ramener cet apprivoisement au perfectionnement moral perçu comme causant progressivement la maîtrise médiumnique. Dans le kardécisme, la médiumnité est un habitus qui se dompte par la probité morale. Quant à la question identitaire, elle se subsume sous la question morale, et en ce sens, nous le verrons, elle rejoint à sa façon le coeur de la mystique chrétienne.
3. Le questionnement de Barbara
La question complexe du positionnement identitaire dans le kardécisme peut être illustrée par une réflexion corollaire menée par l’une de mes informatrices bahianaise, au sujet de l’essence de sa créativité. Barbara, une jeune kardéciste de 24 ans, s’interrogeait sur l’« autoraria », l’autorité intellectuelle de ses créations. Elle écrivait de la poésie, et la « question éthique » la taraudait :
Comment partager ce que je n’ai pas fait seule ?
Entretien du 2 août 2013
Ce que tu as fait « avec des esprits » ? Ce que tu as « reçu » ?
C’est ça… je n’ai pas fait seule, je formulais des mots que je ne connaissais pas, qui avaient un sens différent de ce que je supposais. Alors je tentais de comprendre : qui partage de l’énergie ? Quelle est l’implication éthique de ceci ? Qui donc peut bien avoir fait ça avec moi ? Parce que je n’en avais pas idée… […] Parce qu’il y a ceci : la question éthique... Si je n’ai pas fait seule, alors… Et cette autre question… […] : est-ce que je me suis impliquée avec celui qui voulait me transmettre la poésie ? Parce que de mon côté, il y a eu un effort ! Je ne sais pas si... Quand j’écris de la poésie, je ne sais pas si c’est de l’orgueil, mais je pensais : “purée, ça, c’est ma partie, de quoi vous vous mêlez ? ”... Qu’est-ce que c’est que cette affaire ? Cette chose de l’autoraria... Elle est si belle, mais bon sang... Comment vais-je dire que c’est vous qui l’avez faite alors que je ne sais même pas qui vous êtes, mais je ne peux pas prétendre que je l’ai faite seule... Cela devient une chose un peu dramatique comme ça, je dois encore explorer ça, cette question de la vanité de la composition, faire une poésie qui se fait en partage, faire avec quelqu’un... dont je ne sais pas qui c’est, etc. Je ne sais comment qualifier cette expérience.
Ainsi Barbara réfléchissait sur l’origine de son inspiration : quelle était sa part ? Quel était son lien avec l’entité qui lui soufflait sa poésie ? À qui fallait-il attribuer la paternité de la création en rendant justice à l’une et à l’autre ? Il s’agit là de maintes questions irrésolues qui suggèrent des rapports à préciser entre doute et confiance, entre soi et autrui, entre identité et légitimité… Où sont les limites du soi et de ce qui lui appartient ?
Le désarroi de Barbara quant à l’origine et la nature de l’inspiration révèle un aspect problématique du rapport à la créativité. Dans l’interaction avec les esprits, cette dernière peut couler de source, être plus ou moins douloureuse, souple et libre. Des mots peuvent être soufflés, des idées se présenter en lien avec un certain effort de réflexion ou de concentration dans le travail intellectuel… Les médiums psychographes écrivant sous une dictée plus ou moins consciente, les médiums-artistes créant dans une collaboration plus ou moins active ou d’abnégation avec les esprits, soulèvent également ces questions, tout comme l’« apométrie » ou la « chirurgie spirituelle » spirite[7].
Quelques-uns de mes informateurs parisiens débattaient ainsi entre eux de la source de la guérison dans l’acte thérapeutique spirite : qui guérit ? « Quelle est la part de l’entité spirituelle ? Quelle est la part des humains ? Quel est le rôle du médium ? », se demandait Quentin, un jeune spirite parisien. Il doutait du fait que l’être humain soit réellement utile, tandis que Denis le réhabilitait, estimant pour sa part que les humains et les esprits intervenaient à parts égales. Une Brésilienne parisienne, abondait dans ce sens, évoquant la méditation que le spirite exerce afin d’aider les entités à diriger leur action… Cette question restait ainsi en suspens.
Les interrogations de Barbara et des médiums sur la part revenant à l’être humain dans les actes de création ou de guérison évoquent l’hypothèse aristotélicienne de l’« Intellect Agent », reprise par Averroès (1126-1198). Dans son traité De l'âme, III, 5, Aristote (-384 – -322) évoque un intellect « agent » – fonction qui permet la saisie du pensable, c’est-à-dire de l’Intellect – opposé à l'intellect patient (ou passif) – qui recueille quant à lui les connaissances venues des sens. L’intellect lui-même est, selon Aristote, séparé, unique, éternel (De l'âme, III, 5). La notion d’« intellect agent », qui provient du commentaire d'Averroès au traité d’Aristote, est passée dans le latin intellectus agens. Dans l’usage de la scolastique, l'expression « intellect agent » qualifie dès lors la pure essence de l’Intellect qui est un principe actif conçu comme immanent et en même temps transcendant – c’est-à-dire tout à la fois comme un sixième sens permettant d’exprimer une pensée, et cette pensée elle-même qui est déjà là, en soi, présente. D’ailleurs, les commentateurs grecs, arabes et latins d’Aristote, ont souvent identifié l’intellect agent à Dieu.
Le néo-platonisme antique s’empara de cette idée déjà présente chez les présocratiques, en considérant que « toutes choses sortent de Dieu comme de leur principe et se rapportent à lui comme à leur fin » (Des Places 1981, 328) – ce jusqu’au Pseudo-Denys l’Aréopagite qui, au 6e siècle, alléguait :
Tout être ne tient son propre être limité que de sa participation à la plénitude et à la totalité de l’être, et aspire à une participation toujours plus entière à l’Absolu, si bien que la fin et la perfection spécifiques de chaque être spirituel est [sic] l’intuition, la contemplation du Dieu infini, par une connaissance supra-rationnelle.
Des Places 1981, 324
Au 12e siècle, le philosophe andalou Averroès reprit la thèse néo-platonicienne, fidèle à Aristote : elle fut jugée hérétique[8]. En effet, elle nierait totalement la part de l’individu au profit du seul Esprit transcendant. Elle implique que le sujet n’est pas sujet de lui-même ; il ne le serait que dans la mesure où il participerait activement à l’Esprit ; ce serait l’Esprit qui ferait le sujet. Dès lors, les pourfendeurs de cette thèse lui reprochaient d’évacuer toute responsabilité morale de l’homme. Peut-on aussi aisément évacuer le soi ? Ici se pose toute la question du rapport entre la grâce de l’Esprit et le libre-arbitre de la créature.
C’est depuis ce même dilemme que les médiums kardécistes avouent ne pas comprendre la source de l’inspiration. De leur point de vue, cet Intellect Agent semble se personnaliser – endosser les personnalités de multiples esprits dont « l’identité » leur demeure souvent énigmatique. La médiumnité impose une conciliation entre présence à soi et effraction de l’autre – qui ne va pas de soi, et dont découle la préservation de l’unité personnelle. Lorsqu’une certaine symbiose est atteinte, l’agentivité personnelle et celle de l’autre peuvent s’allier. Les réactions diverses à cette altérité inspirante dépendent de la complexion de chacun et de la part qu’y prennent confiance et doute, affirmation de soi et abnégation, action et contemplation, volontarisme et lâcher prise. Nathalie a exprimé combien elle se sentait agie, mais d’une manière ajustée à qui elle est : « je vois comment les esprits m’utilisent là où je suis bonne. Ils vont vers le médium, et ils voient qui tu es et ce que tu peux donner ; c’est eux qui voient quel outil tu es. Moi ils m’utilisent dans la prière, dans les radiations. » (Entretien du 29 septembre 2014)
Nous avons vu que la double-agentivité se pacifiait dans le for intérieur du spirite grâce à un travail moral entrepris sur lui-même : la transformation ontologique du spirite représente un effort de spiritualisation. De même, dans la tradition chrétienne, c’est par un effort similaire conçu comme imitation du Christ que l’on devient soi-même – un Soi sanctifié par le Saint Esprit au fil d’un cheminement de purification.
4. Symbolisme chrétien de la transformation en Christ
Dans le catholicisme, différentes écoles ont visé la transformation de l’être intime de manière à le conformer au Christ, ainsi la tradition ignacienne du discernement dans la prière. Ses exercices spirituels (Loyola 1548) guident en effet le chrétien pour l’amener à distinguer ce qui, en lui, procède de la Volonté de Dieu, par des examens réitérés de ses pensées, paroles et actions, par des méditations bibliques, afin de diriger son comportement sur la bonne voie. Les maîtres du Carmel Thérèse d’Avila et Jean de la Croix ont également décrit les manières de se disposer à l’accueil transformateur du Saint Esprit, notamment par l’oraison. Tous deux ont dissocié l’oraison active, menée par le méditant, de l’oraison passive, laissée à l’instigation de Dieu, et conduisant à l’union, surnaturelle, qui advient à l’âme sans qu’elle n’y fasse plus rien.
Comme dans le kardécisme, un chemin de purification est le préliminaire à l’état d’union avec le divin. Pour s’y disposer, les âmes « réservent des heures au recueillement, emploient bien leur temps, s’appliquent aux oeuvres de charité envers leur prochain, un ordre harmonieux règne dans leur langage » écrit Sainte Thérèse dans Le Château de l’âme. « Il ne s’agit pas de beaucoup penser mais de beaucoup aimer » (D’Avila 2015, 7). La Sainte suggère également de « se dégager de tout ce qui n’est pas nécessaire », de considérer « ses propres défauts, sans examiner avec tant de soin ceux des autres » (id., 14-18), et de beaucoup prier, jusqu’à ce point où c’est l’Esprit Saint, et non plus le méditant, qui mène l’oraison.
À son tour, Jean de la Croix explicite les étapes de l’ascension de l’âme vers Dieu et les purifications actives de « l’aspirant » à l’union divine, ce qu’il peut de son plein chef mettre en oeuvre pour y parvenir. Il s’agit tout d’abord de dompter ses tendances et habitudes en leur refusant satisfaction : c’est la « nuit active des sens », c’est-à-dire une phase de mortification. Lui succède la « nuit de l’entendement » : il convient alors de faire taire « les sens intérieurs qui sont l’imagination et la fantaisie », et de se défier de leurs impressions (de la Croix 1947) ; puis vient la « nuit de la mémoire et de la volonté ». Alors la prière, de « méditation discursive », devient « oraison de passivité ». Saint Jean décrit l’état muet dans lequel se trouve l’âme face aux visions et révélations qu’elle entrevoit. L’âme qui marche en terra incognita, s’en remet à la foi, moyen accordé à l’homme face au mystère divin, et, in fine, seul guide dans la ténèbre du sens.
Impliquant toujours un travail sur soi, le thème de l’imitation a inspiré nombre de mystiques chrétiens, dont la volonté de s’identifier au Christ sur la croix a guidé la vocation religieuse. Selon Thérèse d’Avila, l’oraison surnaturelle est une union dans laquelle, par l’imitation, la personne est transformée dans le Christ, unie à lui. Elle écrit dans Le Château intérieur (ou château de l’âme) : « pour acquérir la véritable humilité, nous devons jeter et arrêter les yeux sur Jésus-Christ. » (2015, 11) De même, d’après Jean de la Croix : « Il faut avoir le désir habituel d’imiter le Christ en toute chose, de se conformer à sa vie qu’il faut bien considérer afin de savoir bien l’imiter et d’agir en tout comme lui-même l’aurait fait. » (de la Croix 1947, 13)
La tradition chrétienne a ainsi indiqué la nécessité d’imiter le Christ et de transformer l’âme à sa ressemblance afin que le Divin puisse agir en elle, pointant une double-agentivité où l’âme s’efforce de s’oublier pour mieux devenir, sous l’action du Divin, celle qu’Il souhaiterait qu’elle fût. La prière attribuée à saint François est éloquente à ce titre : « c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle » : la spiritualité franciscaine paraît idéal-typique à cet égard. Avant donc d’approfondir la métaphore du miroir de la croix chez Claire d’Assise, présentons brièvement son historicité.
5. La contemplation au Miroir
La métaphore du miroir connaît un usage philosophique de l’Antiquité au 15e siècle. Lucrèce, Sénèque, ou Apulée l’ont considérée soit comme un instrument de vision indirecte (de ce qui est invisible ou ne peut être perçu directement), soit en tant qu’instrument édifiant d’« embellissement moral » (Wolff 2011), à l’origine de la tradition des « miroirs des rois[9] ». La métaphore du miroir était déjà présente dans les Écritures : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, comme par l’Esprit du Seigneur. » (2 Co, 3, 18) – tout comme la « promesse de la transformation » par l’Esprit divin (Jónsson 1995, 69).
La symbolique du miroir fut fixée dès l’Antiquité tardive par Saint Augustin (354-430). Au Moyen-Âge, le topos du « miroir de l’âme » donna naissance à un genre littéraire (Jónnson 1995), porté par l’apparition des miroirs en verre et l’intérêt pour la catoptrique (Ribémont 2008). Christianisé, le miroir a sous-tendu « le discours de la prédication, selon lequel les images symboliques étaient considérées comme les plus efficaces auxiliaires », afin de « capter l’attention, enseigner, émouvoir et graver dans la mémoire avec efficacité » (Blanchard 1997, 183).
Le poète François Malaval compare dans ces vers le miroir commun à celui de l’âme :
Blanchard 1997, 190Mon miroir quoy que utile
Est un miroir stérile,
Il ne me fait voir que ce qu’il prend de moy.
Dieu miroir très sublime
En m’exprimant, s’imprime
Me fait voir qui je suis, et ce qu’il est en soy.
Cette littérature édifiante, fondée sur les notions d’exemplarité et d’identification, renvoie à la « pensée sotériologique » (Pomel 2003) : « le chrétien doit déchiffrer l’image que lui renvoie le miroir pour comprendre sa condition, mais il doit aussi s’en inspirer pour que ses actes en ce monde préparent son salut » (Dominguez 2003).
Du 12e au 15e siècle, les textes de ce genre tracent la ligne de conduite définie par les miroirs édifiants – une conduite morale dans laquelle la contemplation du Christ mène à l’imitation de l’exemple christique. Le miroir renvoie tout à la fois à l’Église, c’est-à-dire à ce qu’elle est, et à ce qu’elle doit être, devenir : il en est ainsi du « miroir de l’église », dans l’ouvrage de sermons éponyme d’Honorus d’Autun, moine bénédictin qui prescrit : « Tous les prêtres doivent suspendre ce miroir devant les yeux de l’Église, afin que l’Épouse du Christ voie là-dedans ce qui déplaît encore à son époux, et qu’elle arrange ses moeurs et ses actes selon son image. » (Dominguez 2003) Le miroir fait référence à la plénitude divine, et soit invite à participer de cette plénitude que Dieu nous a donnée en partage et que l’on trouve en soi (nous sommes imago dei), soit marque au contraire la nature pécheresse et le fossé que doit s’efforcer de surmonter le croyant pour rejoindre Dieu.
6. Contemplatio / Imitatio
C’est par la contemplation au « miroir de la croix » que Claire d’Assise (1194-1253), disciple de Saint François, fondatrice de l’ordre des Pauvres Dames (les Clarisses), cherche à illustrer l’enjeu de la transformation en Christ. La spiritualité de Sainte Claire d’Assise, figure mystique d’agissante-agie, qui se qualifiait elle-même de « serviteur inutile », nous aidera à discerner ce que peut être un lien d’union avec l’au-delà : l’accueil du Saint Esprit doublé d’un effort tendu vers l’imitation du Christ. L’idée de cette contemplation est que nous devenons ce que nous contemplons ou regardons ; nous sommes des imitateurs. Jésus a dit : « Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean, 14,9). En imitant le Christ, exemple d’une humanité dignifiée, nous devenons des images de Dieu – si Dieu nous a « créés à son image », mais il s’agit pourtant là d’une vérité à actualiser. La façon dont Sainte Claire conçoit le miroir est exposée dans deux de ses missives adressées à Agnès de Prague : « Pose ton esprit sur le miroir de l’éternité, pose ton âme dans la splendeur de la gloire, pose ton coeur sur l’effigie de la divine substance et transforme-toi tout entière par la contemplation dans l’image de la divinité. » Troisième Lettre à Agnès, 1238 (1991, 196-197) et
Ce miroir, regarde-le chaque jour, Ô Reine, épouse de Jésus-Christ, et mire sans cesse en lui ta face, pour ainsi tout entière, intérieurement et extérieurement, te parer [...] de toutes les vertus [...]. Dans ce miroir resplendit la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité et l’ineffable charité. [...]
Aussi ce miroir, posé sur le bois de la croix, avertissait lui-même les passants de ce qu’il fallait considérer là [...].
Quatrième Lettre à Agnès, 1253 (1991, 201-202)
Selon elle, la contemplation au miroir ne va pas sans transformation en Christ : « Tu supplées merveilleusement à ce qui est défectueux [...] dans l’imitation des traces de Jésus-Christ pauvre et humble », écrit la Sainte (202).
C’est à partir du concept de pauvreté que Sainte Claire conçoit la symbolique du miroir. Elle identifie cette pauvreté ontologique, dans la relation à Dieu, à la reconnaissance de notre besoin de Lui, de notre dépendance. Jésus, parangon et modèle à suivre, s’est donné pour les hommes, mais aussi, complètement, à son Père, en lui obéissant jusqu’à la mort : il a vécu pauvre car il a vécu totalement de la volonté de son Père. À la pauvreté de Jésus répond celle de son Père. En effet, Dieu lui-même est pauvre, puisqu’Il ne peut faire autrement que se donner, et a donc besoin de sa création en tant que vase et se donnant à son tour. Selon Claire d’Assise, Dieu est relationnel – c’est ce qu’il faut entendre par le terme « trinitaire » – car il ne peut faire autrement que déverser continuellement son trop-plein d’amour. Le Fils est dès l’origine engendré du Père et en passant de l’un à l’autre, cet amour engendre à son tour le Saint Esprit. Lorsqu’à notre tour, nous entrons en relation avec ce Dieu qui (se) donne et (se) rend l’amour, « nous entrons dans le grand mystère de Dieu en entrant dans le grand mystère de notre être propre, celui d’être créés comme personnes qui peuvent refléter l’image de Dieu. » (Delio 2015, 46-47). Ainsi, la personne pauvre est prête à regarder au « Miroir de la Croix ».
7. Image et identité
La notion de miroir décrit qui nous sommes par rapport à Dieu. Dans nos miroirs matériels, nous ne voyons que « l’image extérieure », tandis qu’au miroir du Christ, nous voyons « qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à être en étant transformés en l’image du Christ » (Delio 2015, 78). Cette transformation consiste à s’identifier à Jésus, pour le refléter et le donner à voir à son tour. On trouve dès lors « son vrai soi » en devenant reflet du Divin. D’où la double-image portée par la métaphore du miroir : miroir de la plénitude divine, et image de l’humanité incomplète et souffrante – si elle ne s’efforçait de lui ressembler et de se laisser pénétrer par l’Esprit Divin pour transformer ses comportements.
Par sa « théologie du miroir », « Claire suggère que le “soi” [...] est créé en relation à Dieu. » (Delio 2015, 102). L’image d’un Dieu qui se donne à sa création, comme Jésus s’est donné, à son Père, pour les hommes, par une abnégation complète, comprend la relation, le don et la foi. Pour que l’être humain soit à son image, il faut qu’il donne et se donne, avec foi, à l’oeuvre de Dieu en lui. Vivant en « personne pauvre », le croyant parvient « à ce lieu de vulnérabilité où Dieu peut faire son entrée » (69), où l’Esprit le conforme à cette image. Cette imitation laissée à l’oeuvre de Dieu est décrite par Jean de la Croix en ces termes :
Si l’âme se purifie entièrement, et se dégage de toutes les représentations ou images, [...] elle se trouvera dans le dénuement complet et la pauvreté d’esprit ; devenue simple et pure, elle se transformera aussitôt dans la simple et pure Sagesse divine, qui n’est autre que le Fils de Dieu.
de la Croix 1947, 162
Si l’imitation du Christ, suggérée dans les Écritures, est amplement développée par cette littérature du Miroir à laquelle Claire d’Assise et Jean de la Croix, parmi d’autres, font honneur, l’action de l’Esprit Saint, y demeure élusive – ainsi dans Luc (12,12), on peut lire « l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire » –, et c’est peut-être précisément cette agentivité particulière, qui requiert une cession de soi, que ces mystiques, en retraçant leur cheminement spirituel, se sont efforcés de dépeindre.
Conclusion
Depuis l’Antiquité, la question philosophique du sujet a toujours été délicate. Elle devient encore plus critique chez le sujet-médium, en posant une double-expérience d’être au monde : celle d’être un sujet actif et réflexif, constructeur de lui-même, et celle de ne pas l’être du tout, ou pas totalement. Cette double-condition se trouve idéalisée dans la spiritualité chrétienne, mais demeure problématique dans la conception spirite du rapport à l’au-delà, qui, pour sa part, ne s’appuie pas sur un dogme fixé mais sur un enseignement en grande partie empirique, tâtonnant. C’est pourquoi selon cette conception spirite, le « je » reste toujours à négocier, et trouve le plus souvent sa résolution en termes d’alliance, ou de cocréation avec les esprits. Un tel état de fait est subi ou désiré selon les expériences des sujets, mais cette co-partition caractérise toujours une relation stabilisée et harmonisée entre le sujet et ses esprits.
Pour la mystique chrétienne à l’inverse, on est créature de Dieu et c’est ce dernier qui agit en nous. Finalement, en termes radicaux, « Je est un autre ». Ce « je » ne s’appartient pas. Si être soi, c’est être à l’image de Dieu, alors l’ancien « je » doit se dépouiller de ses oripeaux pour devenir le « je » impersonnel habité et agi par l’Esprit. D’après la mystique clarissienne, il s’agit, afin de laisser l’Esprit saint oeuvrer, de rechercher une posture de disponibilité et d’accueil : la pauvreté en Christ – disposition que Jean de la Croix ou Thérèse d’Avila trouvent dans l’oraison de passivité.
Pour parvenir à ce point d’accueil, il faut avoir admis sa dépendance foncière par rapport au divin. La théologie de Sainte Claire se fonde ainsi sur un idéal de pauvreté mystique, qui part du principe que la personne humaine, créature en tout point dépendante de son créateur, « ne possède pas, elle reçoit seulement. Notre pauvreté est la mesure de notre réceptivité ; Dieu remplit le vide. » (Delio 2015, 55-56) Cette grâce, cependant, n’enlève rien à l’homme de sa responsabilité morale : nous sommes réceptacles de l’amour Divin, à condition de l’accepter – décision laissée à notre libre-arbitre. En apprenant à l’accueillir, nous nous découvrons tels que Dieu nous fait.
L’idéal de pauvreté de la mystique clarissienne serait-il susceptible d’inspirer le médium dans sa pratique ? L’équilibre désirable d’une clarisse ne s’accomplit qu’en renonçant à rechercher son impulsion propre pour reconnaître sa nature de créature dépendante de son créateur. Se dessinent alors des sujets agis qui deviennent agents pour peu qu’ils agissent librement selon l’impulsion divine. Dans cette conception, la tension entre des sujets agents et des sujets agis se dissipe au profit de la prise de conscience et de l’acceptation progressives de l’état de fait que le sujet est agent du choix d’être agi, de se laisser façonner. Une telle option, radicale, nécessite une confiance aveugle en « l’Esprit », le concours de la foi. Admettre la passivité dans son cheminement est d’ailleurs une constante de la mystique chrétienne : chez Jean de la Croix de même que Thérèse d’Avila succède, au travail de mortification, la nuit obscure de la foi – autre nom de la pauvreté, dans laquelle l’être s’efface pour se découvrir agi par l’Autre divin.
Dans le kardécisme, se laisser « habiter » n’est pas permis d’emblée : là aussi un travail préalable de transformation morale s’avère nécessaire pour se concilier des esprits qui soient « guides » et non perturbateurs. Moyennant ce travail de « purification » morale et physique, ainsi que de discernement intérieur, lequel modifie à son tour les influences qui l’entourent, le médium peut s’allier des entités fiables, dont le concours procède alors d’une présence encourageante et sage comme celle du daimôn de l’Antiquité Grecque. Plus le médium tempère sa conduite et s’élève, plus l’influence spirituelle qu’il s’attire s’élève et favorise cet effort de « sanctification », rejoignant la spiritualité clarissienne et plus largement chrétienne du miroir. Les guides, ces « entités supérieures », ne sont-ils pas, pour le spirite, des échos du Saint Esprit ?
L'image de la contemplation au miroir du Christ renvoie à l’imitation de Jésus Christ. Elle est tournée vers ce travail d’introspection et de conformation au Christ, en lien avec les autres. On s’individue – on devient soi-même – en imitant le Christ et sa foi. L'impératif de transformation en Christ de la spiritualité clarissienne nécessite une disposition de pauvreté, d’abandon, d'accueil de l'Esprit – double-agentivité d’abnégation consentie dans laquelle l’âme s’efforce de céder la place à l’action du Divin ; comme dans un vase communicant, plus elle est petite, plus le divin en elle est grand.
Dans la tradition spirite, la réforme intime renvoie également à un travail de perfectionnement moral, de « sanctification », engagé avec soi-même dans le rapport aux autres – humains et esprits. La charité est également incontournable – hors la charité point de salut (Kardec 1998a). De fait, si certains médiums rencontrés sont dans une démarche de quête de soi nimbée des enjeux new age du développement personnel, elle passe par l’autre ; l’amélioration de soi est une visée imprégnée de charité chrétienne – pilier de la doctrine – car c’est en s’intéressant à son prochain que l’on apprend à se connaître. En outre, le perfectionnement de soi auquel tendent les spirites kardécistes vise à harmoniser leur rapport à eux-mêmes et à leurs esprits – rapport en miroir dans lequel les esprits soutiennent les dispositions présentes en chacun, dessinant une double-agentivité de conciliation, où le spirite, atténuant ses dissensions internes, permet à des esprits élevés d’entrer en scène pour le guider.
Ainsi, un fond relationnel sous-tend le processus d'individuation de l'être. Que ce soit dans la métaphore du miroir, concentrée sur l’imitation du Christ, ou dans la doctrine spirite, centrée sur l’interlocution avec les esprits cadrée par la « réforme intime », l’on devient soi en étant tourné non vers soi-même, mais paradoxalement, vers l'autre : le grand Autre et/ou les autres.
Appendices
Note biographique
Claire Souillac est docteure en Anthropologie, diplômée en Juin 2018 de l’I.H.E.A.L (Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine), Laboratoire CREDA, UMR 7227, École Doctorale 122 de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, en co-tutelle avec le département de sciences sociales de l’Université Fédérale de Bahia (PPGCS, ECSAS, UFBA, Salvador, Brésil).
Notes
-
[1]
Une soixantaine d’entretiens furent conduits à Paris, San Francisco et Salvador, entre 2013 et 2015.
-
[2]
Canular ou non, l’épisode des soeurs Fox à New York en 1848 donna naissance au spiritualisme anglo-saxon.
-
[3]
La doctrine est le fruit d’un travail de recoupement systématique de propos d’esprits recueillis « par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres, et dans diverses contrées » (Kardec 1998b, 10).
-
[4]
La clairaudience est un type de médiumnité qui consiste, pour le sujet, à entendre des voix.
-
[5]
L’obsession serait « le contrôle que certains esprits parviennent à acquérir sur certaines personnes » (Curso básico du Centre Spirite ‘Luz Eterna’ de Curitiba, Brésil (1978)).
-
[6]
Ernesto De Martino a forgé le concept de « labilité de la présence » (De Martino 1971, 96-97) dont je m’inspire. Il y avance que la présence au monde des individus n’est pas donnée, assurée, garantie mais remise en question voire mise en péril en « certains moments critiques de l’existence ». Il s’agit pour les individus de maintenir ou rétablir un certain équilibre à cet être au monde potentiellement instable – l’individu met alors en oeuvre des stratégies pour lutter contre l’angoisse liée à cette instabilité, parfois due à « une simple rupture de l’ordre habituel des choses ».
-
[7]
Au Brésil, apometria désigne une technique d’intervention opérée dans l’aura d’une personne pour la soulager d’un certain mal ; elle est présente dans le kardécisme et d’autres cultes du « continuum médiumnique » comme l’umbanda (de Camargo 1961).
-
[8]
Sous le terme d’ « averroïsme », l’Église catholique a condamné en 1270 la thèse du « monopsychisme ».
-
[9]
Il s’agit de traités éthiques à l’usage des souverains.
Bibliographie
- Assise, C. d’ et F. d’Assise (1992). Écrits. Cerf.
- Aubrée, M. et F. Laplantine (1990). La Table, le Livre et les Esprits. J. C. Lattès.
- Avila, T. (2015) [1577]. Le Château de l’âme (Édition numérique). Vivre ensemble. (Ouvrage original publié en 1577).
- Blanchard, J.-V. (1997). La catoptrique dévote : les miroirs et l’éloquence sacrée au début du XVIIe siècle. Dans C. Biet et V. Jullien (dir.), Le siècle de la lumière. 1600-1715 (pp. 183-193). ENS Éditions (Theoria).
- Camargo Ferreira, C. P. (1961). Kardecismo e umbanda. Uma interpretação sociologica. Pioneira.
- Croix, J. (1947). La montée du Carmel. Seuil. (Ouvrage original publié en 1587).
- De Libera, A. (2007-2008). Archéologie du Sujet, Tomes I & II. Vrin.
- De Martino, E. (1971). Le Monde magique. Marabout université.
- Delio, I. (2015). Claire d’Assise. Un coeur plein d’amour. Les Éditions franciscaines.
- Des Places, E. (1981). Le Pseudo-Denys l’Aréopagite, ses précurseurs et sa postérité, Dialogues d’histoire ancienne, 7, 323-332.
- Dominguez, V. (2003). Madeleine au miroir. Dans F. Pomel (dir.), Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale. (pp. 303-322). Presses Universitaires de Rennes.
- Espirito Santo, D. (2013). Observaciones sobre la relación entre la “cosmo-lógica” y la construcción de la persona en el espiritismo cubano. Ateliers d'anthropologie, 38. http://ateliers.revues.org/9368
- Foucault, M. (1994). L’herméneutique du sujet. Dans D. Defert et F. Ewald (dir.), Dits et écrits, tome IV (pp. 213-219). Gallimard.
- Hadot, P. (1981). Exercices spirituels et philosophie antique. Études Augustiniennes.
- Jónsson, E. (1995). Le miroir : naissance d'un genre littéraire. Belles Lettres.
- Kardec, A. (1998a). Le livre des esprits. Union Spirite Française et Francophone. (Ouvrage original publié en 1857).
- Kardec, A. (1998b). Le livre des médiums. Union Spirite Française et Francophone. (Ouvrage original publié en 1861)
- Loyola, I. (2014). Exercices spirituels. Payot et Rivages. (Ouvrage original publié en 1548).
- Pécharman, M. (2014). Alain de Libera, archéologue du sujet. Methodos, 14. http://journals.openedition.org/methodos/3819
- Pomel, F., dir. (2003). Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale. Presses universitaires de Rennes.
- Ribémont, B. (2008). F. Pomel (dir.), Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale, Rencension, Cahiers de recherches médiévales et humanistes. http://journals.openedition.org/crmh/243
- Souillac, C. (2016). Le kardécisme actuel sur trois continents : circulation, identité et réinvention. Cahiers de l’URMIS, 16. http://journals.openedition.org/urmis/1342
- Souillac, C. (2017). La trajectoire kardéciste de Fernanda : une spirite en quête. Cahiers des Amériques latines, 85, 149-164.
- Wolff, É. (2011). Quelques réflexions sur les miroirs dans la Rome antique et le Moyen-Âge latin. Dans J. Pigeaud (dir.), Miroirs (pp. 205-214). Presses Universitaires de Rennes.