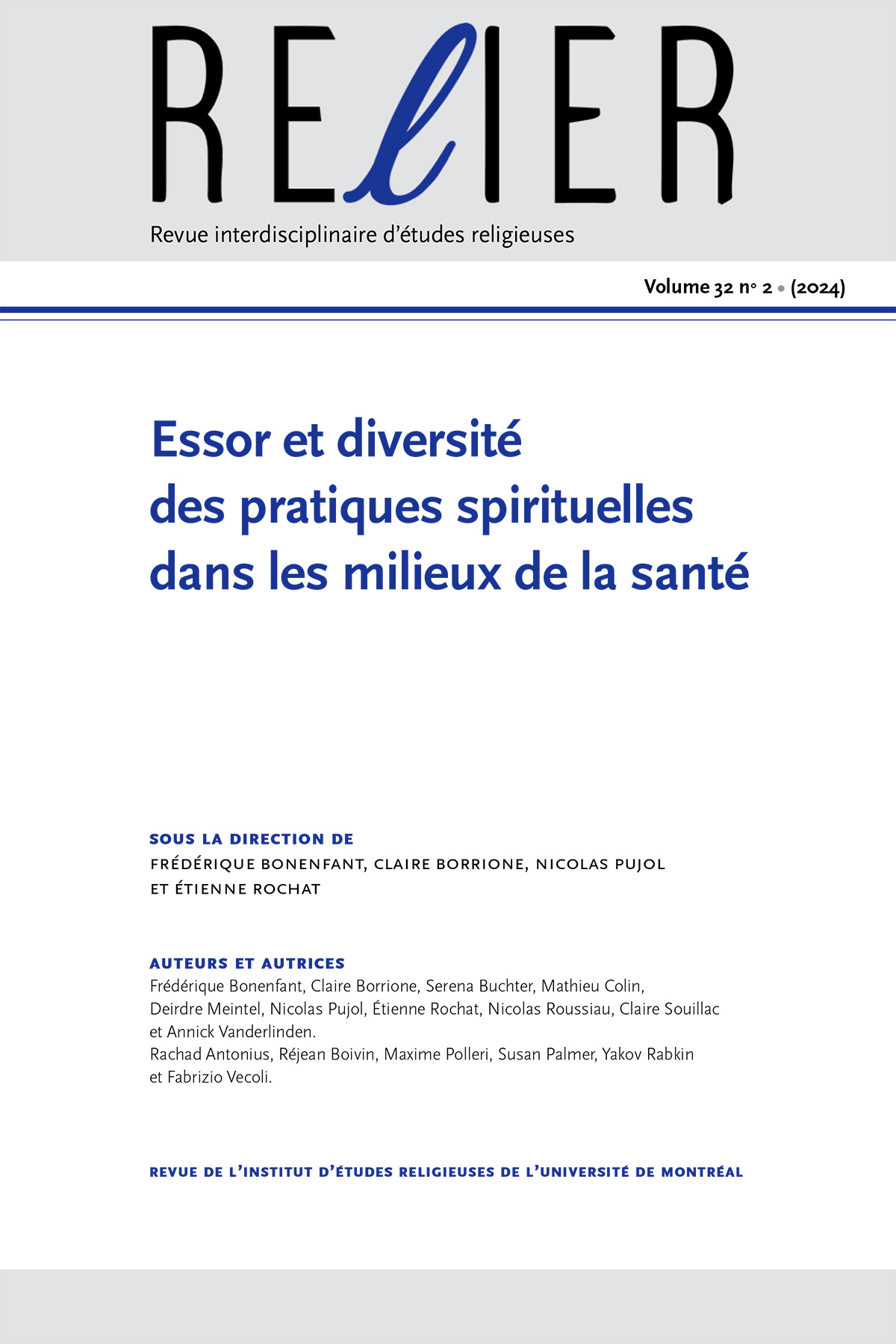Article body
Introduction
À l’occasion de la publication des résultats de la recherche SPIPRA, la revue RELIER propose un dossier intitulé : « Mieux comprendre l’essor et la diversité des pratiques spirituelles dans les milieux de la santé ». Les articles de ce numéro traitent de thématiques et de problématiques liées à l’ouverture du monde biomédical à la spiritualité ainsi qu’à l’intégration de la spiritualité dans le monde du soin, témoins d’un champ encore en construction, celui du Spiritual Care[1]. Avant de le présenter, il est nécessaire de replacer ce numéro traitant de l’intégration de la spiritualité dans le monde du soin dans le contexte dans lequel il a été publié et de faire une remarque sur ce qui ressort d’une première lecture du sommaire.
1. Contexte large
Le monde biomédical est traversé par des courants d’une force inouïe également très contradictoires. D’une part, les avancées technologiques, bien que critiquées par ceux-là mêmes qui les font advenir, ouvrent des possibilités de redéfinition de l’humain qui vont bien au-delà de la « simple » réparation d’organes. D’autre part, des voix issues de milieux très divers (politique, sciences humaines, etc.) se font entendre de plus en plus fort pour exiger une réforme du système de soins afin de le rendre plus humain, davantage démocratique et surtout « plus au service de la population ». Celles-là montrent qu’en fait, le système de santé est en crise, crise de valeurs autant que de lisibilité, de sens, crise liée aux difficultés qu’aussi bien les acteurs que les patients et la population dans son ensemble ont à comprendre, le type de médecine et de santé que promeut ce système. L’un de ces courants s’adosse à l’idée-force que la spiritualité, devenue une sorte de couteau suisse de la santé, permet de réhumaniser la médecine, favoriser la guérison, redonner du sens à l’activité des soignants, faciliter l’acceptation des patients en balisant leur trajectoire (avec des rituels par exemple), renouveler la réflexion en éthique clinique, en mettant en lien autonomie du patient (surtout en fin de vie) et expression de sa spiritualité.
Même avec cette mise en contexte, la lecture du sommaire peut malgré tout quelque peu dérouter tant ce dossier fait état d’une grande disparité. Comment ces divers écrits peuvent-ils bien parler d’un même champ disciplinaire (celui du Spiritual Care) alors qu’ils émanent d’auteurs de disciplines différentes et rapportent expériences, pratiques et réflexions sur l’intégration de la spiritualité dans des champs disciplinaires du soin eux aussi différents ? Cette diversité et cette disparité ne sont pas le fruit du hasard, mais la conséquence du fait que chaque grand champ disciplinaire du soin porte une conception et une visée singulière du soin et que l’intégration de la spiritualité n’échappe ni à cette conception ni à cette visée. Autrement dit, chaque grand champ disciplinaire a une manière déterminée de penser et/ou d’intégrer la thématique de la spiritualité en son sein. Compte tenu de ce qui précède, ces articles centrés sur le traitement réservé à la spiritualité dans les champs disciplinaires que sont la pastorale hospitalière, l’accompagnement spirituel, les sciences infirmières, la recherche en psychologie et en médecine, et les réflexions que ces thèmes suscitent en sociologie du religieux, ne pouvaient que composer un ensemble très divers. Faut-il pour autant accepter cet état de fait et ne rien pouvoir nommer qui traverse ces expériences, pratiques et réflexions ? Convient-il d’accepter de n’avoir aucun jeu de langage pour répondre (ne serait-ce que partiellement) aux questions évidentes que posent ce corpus ? De quelle spiritualité parle-t-on ? Quel est son lien avec le religieux contemporain ? Pourquoi le monde du soin s’ouvre-t-il à cette thématique ? Comment le fait-il et dans quelles intentions ? Existe-t-il des catégories qui permettraient de situer ces pratiques les unes par rapport aux autres ?
2. La recherche SPIPRA et son rôle
La recherche SPIPRA s’est déroulée entre 2019 et 2022 et a justement tenté de donner une cohérence théorique à cette disparité en cherchant à mieux comprendre l’intérêt croissant du monde du soin dans sa globalité pour la spiritualité dans le monde francophone. Sur la base d’enquêtes de terrain, elle a abouti à l’élaboration d’un cadre théorique ayant permis de caractériser cet intérêt et d’en expliciter précisément la diversité et la dynamique. Plus concrètement, SPIPRA est une recherche internationale francophone interdisciplinaire (sociologie, théologie, sciences infirmières, psychologie), financée par le RESSPIR[2] et d’autres partenaires. 9 pratiques se réclamant de la spiritualité (3 en France, 3 au Québec, 3 en Suisse) dans le monde de la santé ont fait l’objet d’un travail d’enquête qualitatif approfondi faisant émerger une théorisation articulant cinq thématiques principales : la médicalisation des pratiques se réclamant de la spiritualité, la subjectivisation des conceptions de la spiritualité, la psychologisation de la spiritualité, les différents modes d’intégration de celle-ci dans les pratiques ainsi que le rapport à la théorie et à la transmission des connaissances concernant ces pratiques. De plus, deux axes ont été définis pour situer ces dernières, l’un horizontal qualifiant la visée de la pratique, allant d’une visée spirituelle à une visée thérapeutique, et l’autre vertical qualifiant le type de spiritualité en jeu, allant d’une spiritualité individu-normée à une visée culturo-normée. Les résultats de la recherche SPIPRA offrent donc au champ du Spiritual Care tout à la fois un ancrage historique avec une généalogie de pensée, un espace où situer les pratiques et un jeu de langage (une grammaire) pour comparer les pratiques entre elles. Dans le présent dossier, ces résultats permettent de mieux cerner les liens entre les contributions, de les caractériser et de renouveler la discussion et les questions à leur propos.
3. Les articles de ce dossier
Le premier article (collectif) : « Pourquoi le monde biomédical s’intéresse-t-il à la spiritualité ? Résultats de l’étude SPIPRA » et le second de Frédérique Bonenfant : « Dépasser la distinction classique entre religion et spiritualité qui traverse le champ de la santé » présentent précisément en détail la recherche SPIPRA (sa genèse, sa méthode et ses résultats) ainsi que l’une des conséquences fort importantes de ces résultats (cf. ci-dessus), à savoir la remise en question de la distinction entre spiritualité et religion, fondement de son inscription et de sa légitimation dans les milieux du soin. Reprise avec les réflexions actuelles sur le religieux, cette distinction regorge de problématiques déontologiques et éthiques que les résultats de la recherche SPIPRA sont en mesure de définir utilement. Ces deux articles servent de matrice interprétative pour les écrits qui suivent, car ils permettent de relancer une discussion jusque-là au point mort, faute de pouvoir, précisément, relier et comparer les expériences, pratiques et réflexions entre elles.
L’article d’Annick Vanderlinden : « Une expérience d’intégration des aumôniers dans une équipe pluri-professionnelle en cancérologie thoracique » raconte les difficultés auxquelles les aumôniers et une équipe soignante font face pour trouver des manières de favoriser le travail des premiers, ainsi que de collaborer d’une manière formalisée pour les seconds. Une relecture de cet article avec la théorisation de la recherche SPIPRA montre que ce double mouvement est facilité lorsque les soignants décident de faire confiance aux représentants des cultes présents pour accompagner tout autant les spiritualités culturo-normées que celles individu-normées, et que les aumôniers sont assurés que leur visée demeure spirituelle et/ou d’hospitalité, sans devenir thérapeutique. En d’autres termes les soignants veulent que les aumôniers de toutes religions soient à même de considérer avec respect, bienveillance et compassion l’ensemble des subjectivisations en matière de spiritualité qui vont se présenter à eux, et les aumôniers, quant à eux, veulent éviter une forme d’instrumentalisation de la pastorale hospitalière par le monde bio-médical. Une telle résistance peut se traduire comme visant à conserver une pratique non médicalisée et également bien distincte des interventions psychologiques.
L’article de Deirdre Meintel : « Un savoir et un savoir-faire : les intervenants en soins spirituels » décrit tout d’abord une société québécoise au sein de laquelle le fait de revendiquer une appartenance religieuse ou même un attachement à une spiritualité peut être source de discrimination jusque dans la famille et explique que cette même appartenance confine souvent au tabou au sein des institutions de santé. Dans ce contexte, les savoirs et les savoir-faire des Intervenants en soins spirituels (ISS) sont d’une grande pertinence pour prendre en compte et en charge une dimension des personnes qui est en lien direct avec leur bien-être, voire avec leur guérison. En effet, dans ce contexte, ce sont eux qui ont le privilège de permettre aux patients de mobiliser leurs « forces intérieures » en lien avec « le mouvement de l’esprit ». C’est pourquoi ils devraient être également au service d’autres populations que celle des malades et/ou des personnes en soin de longue durée. Une relecture de cet article avec la théorisation de la recherche SPIPRA montre que la visée de la pratique des ISS est clairement thérapeutique, même si l’auteure n’envisage pas une forme de médicalisation en lien avec la guérison ou de psychologisation en lien avec le bien-être.
L’article de Nicolas Roussiau : « Intérêts et limites des échelles psychométriques dans l’étude des rapports entre santé et spiritualité » se propose tout d’abord de montrer l’intérêt d’une recherche scientifique rigoureuse et de qualité dans ce champ. L’auteur discute ensuite de manière très approfondie l’intérêt et les limites des échelles pour effectuer cette recherche. Il n’évite pas le débat épistémologique que ces pratiques de recherche occasionnent et propose une manière élégante de le faire avancer. Une relecture de cet article avec la théorisation de la recherche SPIPRA montre une visée thérapeutique assumée sous la forme d’une « EBMisation » de la spiritualité. Cette relecture affine la formulation de deux questions importantes que l’auteur explore : d’une part, ces échelles sont-elles à même de capter non seulement les spiritualités culturo-normées, mais aussi les spiritualités individu-normées ? et d’autre part, est-ce que les spiritualités individu-normées échappent à toute forme d’uniformisation ou retrouve-t-on des caractéristiques communes qui permettent l’élaboration du « construit » présenté par l’auteur ?
L’article de Serena Buchter : « La revanche spirituelle de Jean Watson » ou comment les sciences infirmières, toujours en quête de reconnaissance et d’autonomisation dans le monde bio-médical, pourraient se nourrir des conceptions mystiques et spiritualistes du patient, des acteurs de soins et du travail de Jean Watson. Pour atteindre ce but, s’il est atteignable, il est nécessaire de suivre le descriptif exhaustif que cette auteure fait du développement des théories de Jean Watson ainsi que leur passionnante reprise sur la base de thèmes phares de la Foi chrétienne. La reprise la plus emblématique étant certainement celle de l’infirmière comme figure de transcendance dans un soin dépendant d’une « sacred science ». Une relecture de cet article avec la théorisation de la recherche SPIPRA montre bien comment une redéfinition complète des pratiques de soins infirmiers à l’aide d’un concept de spiritualité dépend d’une visée thérapeutique. Ce concept de spiritualité parle d’une spiritualité culturo-normée qui est agie (plutôt que proposée) par les soignants pour le bien des patients. Cet état de fait nécessitera de mener une discussion éthique sur son pouvoir sur des personnes jugées vulnérables. De plus, si l’on discute des sciences infirmières de ce point de vue, les catégories de la médicalisation et de la psychologisation révèlent l’intention de promouvoir une santé et un rapport à soi de la personne malade radicalement différents de ceux que promeuvent la bio-médecine et la psychologie, reliés à des thèmes du religieux chrétien. Cet état de fait va relancer une confrontation et un débat importants pour le champ qui nous occupe.
4. L’intérêt des résultats de la recherche SPIPRA pour deux difficultés
Deux difficultés majeures subsistent dans ce champ, présentes en creux à la lecture des textes de ce numéro. Ces deux difficultés sont l’absence du lien traditionnel entre la recherche, la clinique et l’enseignement d’une part, et l’absence d’une forme d’interdisciplinarité ou d’interprofessionnalité d’autre part. La faute n’incombe pas aux auteurs, car ces deux difficultés sont celles qu’un paradigme scientifique naissant, relié à ce champ émergent de la spiritualité dans le monde du soin, doit encore autoriser. Les résultats de la recherche SPIPRA permettent néanmoins de faire un pas en avant, puisque, d’une part, ils favorisent la formulation de questions transversales (et de ce fait interdisciplinaires) et de l’autre, ils révèlent la nécessité absolue de relier bientôt, dans ce champ, ces trois pôles habituels du monde du soin. À titre d’exemple, la remise en question de la distinction entre spiritualité et religion, qui amène à conclure qu’aussi bien les spiritualités culturo-normées que celles individu-normées se situent dans le domaine du religieux dit contemporain, permet de mener une réflexion renouvelée sur la place et surtout sur le rôle du religieux dans le monde du soin. Cette réflexion, grâce à son important potentiel de recherche, pourrait aider à penser et à mettre en oeuvre une interprofessionnalité dans le champ du Spiritual Care.
Autrement dit, l’ensemble des articles de ce numéro bénéficie de ce « retour » du religieux dans le champ. En effet, si les spiritualités individu-normées émargent aussi aux analyses du religieux dit contemporain, aumôniers et soignants bénéficieront d’une base nouvelle de discussion quant à la place du religieux dans la définition de leur collaboration comme dans leur pratique. Il se pourrait que les aumôniers soient légitimés à se préoccuper de ces spiritualités individu-normées et qu’une partie de l’action des médecins et soignants auprès des patients et de leurs proches puisse être heureusement et utilement analysée à l’aide de ce dont ce religieux est porteur. Enfin, la construction d’échelles ou de questionnaires, utiles pour bénéficier d’un type de données pour la recherche, pourrait s’appuyer sur les apports de cette sociologie du religieux, notamment pour l’élaboration du « construit » de la spiritualité dont ils ne dépendent pas encore suffisamment, loin s’en faut.
5. La spiritualité, le religieux et la confrontation du système de soins
Il convient d’évoquer un dernier point pour ouvrir ce dossier et clore ce liminaire. La recherche SPIPRA a retenu comme pertinents les travaux du professeur François Gauthier[3] (Gauthier 2020) afin de mieux comprendre l’intérêt du monde des soins pour la spiritualité et surtout la manière dont il intègre cette spiritualité. Ce dernier montre comment la logique de marché détermine des comportements humains aussi en lien avec le religieux, ce qu’il résume par une formule choc : « deviens qui tu es en consommant ». Associer cette formule aux travaux de Charles Taylor portant sur l’importance de l’authenticité amène à comprendre la double intégration de la spiritualité dans le monde du soin (Taylor 2018). L’on est donc conscient, tout d’abord, de l’importance accordée aux spiritualités individu-normées (avec l’authenticité comme valeur première pour qualifier le vécu spirituel des patients et des acteurs de la santé) et ensuite, de la forte tendance du système à favoriser une standardisation du Spiritual Care avec une visée thérapeutique et de faire de la spiritualité un adjuvant à la bio-médecine. Le retour du religieux, en lien avec une importance grandissante de la spiritualité, pourrait favoriser une réflexion critique plus globale sur le système de soins et ses buts (déjà observée dans la résistance de certains acteurs à se mouler dans des pratiques ainsi déterminées). Il se pourrait en effet que certains discours (notamment ceux de la bioéthique issue de théologiens) trouvent là une occasion de déployer enfin leur potentiel de transformation de ce système.
Appendices
Notes
-
[1]
Face aux difficultés de traduction, le Réseau santé, soins et spiritualité (RESSPIR) a choisi de conserver les termes anglais. L’équipe SPIPRA a elle aussi décidé de garder cette expression.
-
[2]
Le Réseau santé, soins et spiritualité (RESSPIR) est un réseau francophone international dont le but est le développement du Spiritual Care ; www.resspir.org.
-
[3]
Que le professeur Gauthier trouve ici l’expression de la gratitude de l’équipe de recherche SPIPRA pour sa disponibilité lors de nos échanges.
Bibliographie
- Gauthier, F. (2020). Religion, Modernity, Globalisation. Nation State to Market. Routledge.
- Taylor, C. (2018). The Ethics of Authenticity. Harvard University Press.