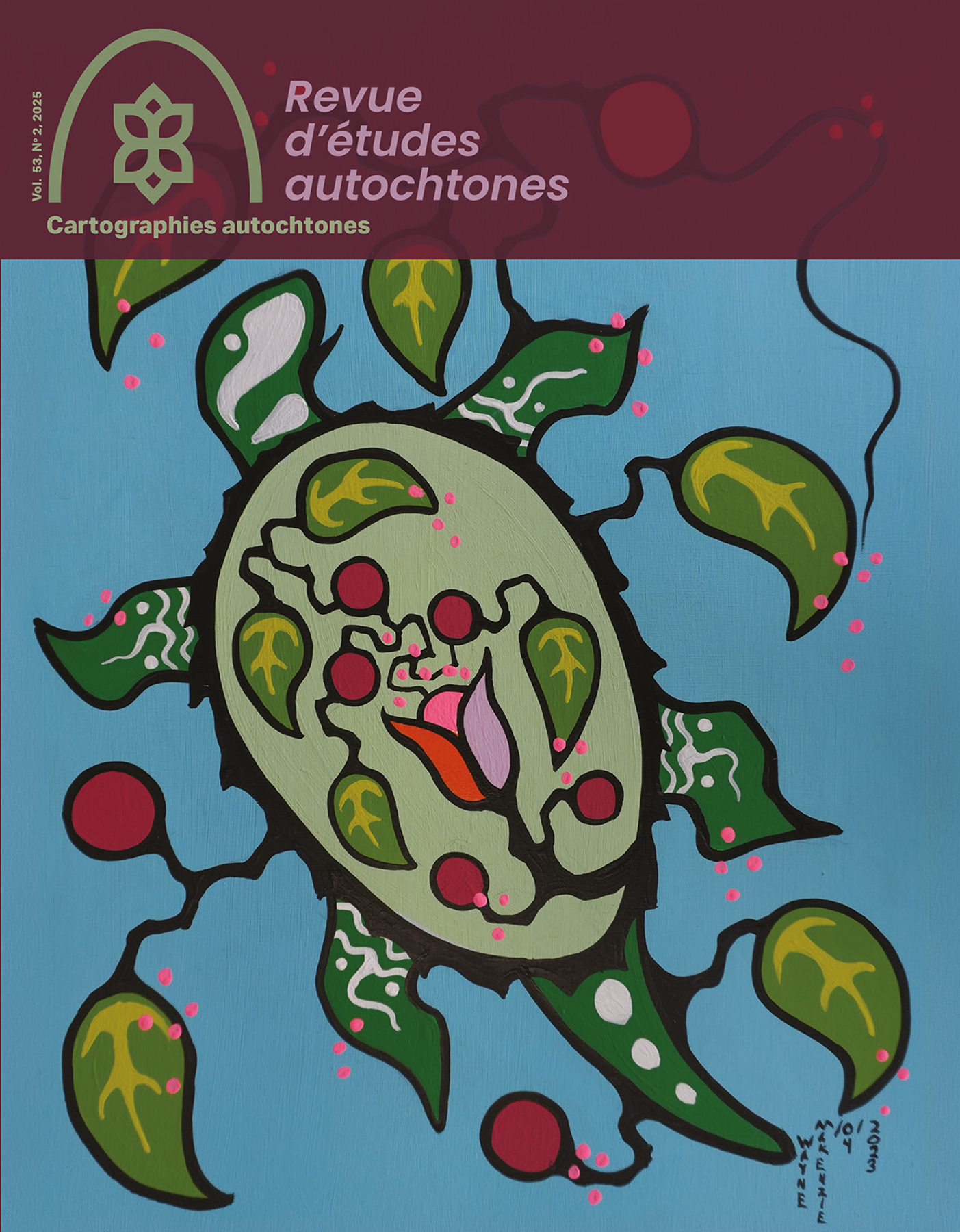Ce livre de l’anthropologue Daniel Clément fait partie de la collection Les récits de notre terre dont chaque tome est dédié à la tradition orale de différentes nations autochtones. Les premières pages proposent une présentation introductive de grands thèmes qui permettent de mieux situer les particularités de la nation Wolastoqey. Toutefois, d’entrée de jeu, le titre de l’ouvrage crée un malaise. En effet, notons que l’emploi du terme « Malécite » est plutôt désuet et ne respecte pas la volonté exprimée, notamment, par la seule communauté de la nation qui se trouve au Québec, à savoir la communauté Wahsipekuk qui a officiellement repris son appellation traditionnelle, Wolastoqiyik Wahsipekuk, en 2019. Le terme « malécite », tout comme ses nombreuses variantes, est un terme à connotation péjorative dérivé de la langue Mi’kmaq et qui signifie « la langue brisée » ou « locuteurs lents » en référence à la différence notable entre ces deux langues issues de peuples qui sont pourtant voisins de territoire (Walis et Wallis 1957 ; Spinney 2010). C’est dans l’introduction et les notes en fin de volume que l’auteur indique la provenance des récits de la tradition orale wolastoqey utilisés dans son ouvrage. Ces derniers sont puisés principalement dans des publications d’anthropologues, tels que Mechling (1914) et Speck (1917) qui ont collecté des récits auprès de personnes wolastoqey dans différentes communautés au début du xxe siècle, principalement celles de Neqotkuk (Tobique), Woodstock et Sitansisk (St Mary’s). Clément a aussi eu recours aux travaux de chercheurs amateurs, notamment Leland, dont l’éthique de travail a malheureusement fait l’objet de critiques sévères, notamment en raison de la liberté prise par ce dernier de transformer arbitrairement les récits pour les rendre plus agréables à lire (Bear Nicholas 2008). Quant aux ouvrages sur la tradition orale wolastoqey, quoique plus contemporains, rédigés de la main de personnes de cette nation (Bélanger 2021 ; Paul 2017 ; Polchies et al. 2015 ; Sappier 2017), ils ne figurent pas dans la bibliographie du livre de Clément. Le coeur de l’ouvrage est constitué d’une suite d’histoires qui ont été réparties en neuf catégories en fonction des personnages principaux qui s’y retrouvent. Le fait de rassembler dans un même livre des récits de la tradition orale wolastoqey en langue française est le principal, voire le seul, point positif de ce document. En effet, dans l’ensemble du corpus écrit sur le sujet, il n’y a que très peu de sources disponibles en français. L’introduction est fort sommaire, très peu documentée. Les textes choisis sont courts et ne sont pas accompagnés de notes explicatives qui permettraient de mettre en contexte les récits qui forment un assemblage disparate. Par exemple, les récits de la création atkuhkewakonol sont traités au même titre que les récits de la « vie ordinaire » ou akonutomakonol alors qu’une approche respectueuse de la tradition orale devrait prendre en considération les protocoles et l’éthique propres à ces deux catégories de récits. (Dana et al. 2021 ; Teeter et LeSourd 2009) Également, le choix d’avoir recours uniquement à des sources secondaires et de laisser de côté les récits provenant d’auteurs et d’autrices contemporaines wolastoqiyik a pour effet de cantonner l’existence de tradition orale wolastoqey à un lointain passé. Les efforts déployés pour rendre plus accessibles au grand public les récits de la tradition orale wolastoqey se font donc malheureusement au détriment de la rigueur et de la qualité. En effet, si Daniel Clément cite la provenance de la version des histoires sélectionnées à la fin de son ouvrage, il n’indique pas sur quelle base s’est opéré ce choix. Or, compte tenu de la rareté du …
Appendices
Ouvrages cités
- Bear Nicholas, Andrea. 2008. « The Assault on Aboriginal Oral Traditions: Past and Present ». Dans Aboriginal Oral Traditions: Theory, Practice, Ethics. Sous la direction de Renée Hulan et Renate Eigenbrod, 13-44. Halifax : Fernwood Publishing.
- Bélanger, Edith. 2021. Les arbres murmurent notre histoire. Berthier-sur-Mer, Québec : La Plume d’Oie.
- Dana, Carol A., Margo Lukens et Conor M. Quinn. 2021. Still They Remember Me. Amherst : University of Massachusetts Press.
- Mead, Alice et Arnold Neptune. 2015. Giants of The Dawnland: Ancient Wabanaki Tales. South Portland, Maine : Loose Cannon Press.
- Mechling, W. H. 1914. Malecite Tales. Vol. Memoir 49. Anthropological Series 4. Ottawa : Governement Printing Bureau.
- Paul, Patrick J. 2017. Tales from a warm wigwam. Tobique : Blurb.
- Polchies, M., A. Polchies, M. Tomah et J. Sacobie. 2015. Käloskapeyal naka kansohseyal atkohkakänäl. Canadian Association of University Teachers.
- Sappier, Roche. 2017. Glooscap Tales. Woodstock : Chapel Street Editions.
- Speck, Franck G. 1917. « Malecite Tales ». The Journal of American Folklore 30(118) : 479-485.
- Spinney, A. M. 2010. Passamaquoddy ceremonial songs: aesthetics and survival. Amherst : University of Massachusetts Press.
- Teeter, Karl V. et Philip S. LeSourd. 2009. Tales from Maliseet Country: The Maliseet Texts of Karl V. Teeter. Lincoln : University of Nebraska Press.
- Wallis, Ruth Sawtell et Wilson D. Wallis. 1957. Malecite Indians of New Brunswick. Vol. 40. Anthropological Series 148. Ottawa : The Minister of Northern Affairs and National.