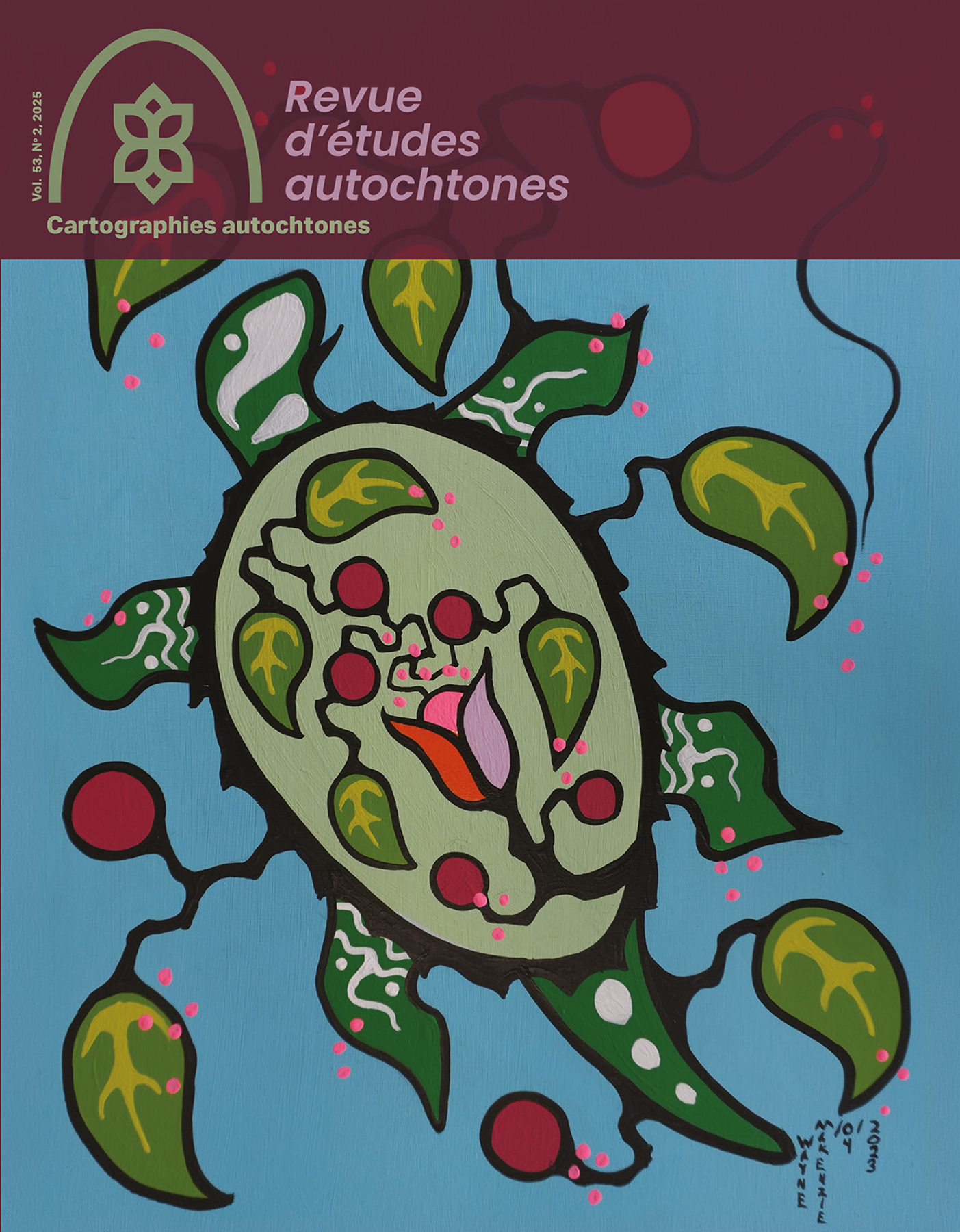Les premières rencontres que nous, les Indiens, avons eues avec les Blancs ont dû être extrêmement difficiles. Admettons que je ne connaisse pas la langue française et que la personne en face de moi ne connaisse pas ma langue, comment fait-on pour communiquer ? Est-ce qu’on se donne des claques dans la face ? Est-ce qu’on se dit bonjour ? Comment fait-on ça ? Quelles méthodes ont été utilisées ? Est-ce qu’on faisait semblant de se comprendre ? C’est un peu ce genre de réflexions qui se sont présentées à moi lorsqu’on a commencé à parler de toponymie, de nommer les endroits. Nous ne donnions pas des noms à proprement parler aux endroits. Nous les identifiions plutôt avec la signification qu’ils avaient pour nous. Lorsque j’écoutais mes parents, leurs amis et leur famille parler d’un endroit, c’était toujours de cette façon : « Te souviens-tu de l’endroit où nous avions attrapé une vingtaine d’esturgeons ? » Il n’y avait pas de nom pour désigner cet endroit, mais ils savaient qu’il y avait un lien avec le poisson, le name. C’était doux, c’était respectueux. Ils n’en faisaient pas une appropriation : ce n’était qu’un passage de leur voyage et de leur déplacement. Ce passage permettait de s’assurer que tout était beau, que tout était bien, que tout était selon l’ordre établi. Puis ils poursuivaient leur chemin. Évidemment, quand on a commencé à rencontrer les immigrants, les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivants, il fallait adopter quelque chose qui puisse établir une relation pour permettre d’accepter leur présence, et aussi pour eux de pouvoir accepter la nôtre. Je dis ces choses-là parce que j’ai eu accès à des archives qui ont été écrites au début des rencontres entre les Autochtones et les arrivants. Ces archives ont été écrites par les Blancs au début de leurs rencontres avec les Autochtones. Du côté des Autochtones, il y avait des personnes qui étaient des diplomates. Ces personnes savaient comment se comporter dans ce genre de rencontres. C’était toujours elles qui étaient les premières à prendre la parole. Dans une des archives que j’ai lue, un arrivant écrivait dans un rapport que les Autochtones qu’il a rencontrés expliquaient d’où ils venaient. Ils décrivaient l’endroit d’où ils venaient et ils expliquaient leur façon d’y vivre. Ils expliquaient aussi le nombre de personnes qui y vivaient, sans nécessairement établir un chiffre exact. Ils affirmaient qu’une bonne quantité de personnes y vivait. Selon les propos de l’auteur, les personnes disaient : « Je viens d’un lac clair, d’un lac qui a les eaux bleues. Nous vivons là de temps en temps, mais nous nous déplaçons. » Ce n’est qu’après avoir décrit l’endroit qu’ils spécifiaient son « nom ». Au début, l’Abitibi ne s’appelait pas Abitibi, mais s’appelait plutôt le lac bleu. Ce n’est que plus tard qu’on s’est aperçu que le lac avait à la fois le versant nord et le versant sud du pays. L’Autochtone qui décrivait l’endroit où il était décrivait aussi ce qu’il y faisait. Dans le lac, il y avait plusieurs activités qui tournaient autour du poisson. C’était l’aliment principal. Ainsi, la langue qui était utilisée à ce moment référait surtout à la description du temps où ils étaient à cet endroit. L’Autochtone ne parlait pas d’autres choses que de l’eau, du lac bleu, des poissons. Le vocabulaire se limitait pas mal à ça. Puis il nommait les autres groupes de personnes qui vivaient tantôt au nord, tantôt au sud. Nous parlions des Kitcisakinnik, « les gens du grand lac ». Nous parlions des Timiskaming, « les gens du Témiscamingue …
Ejinikedek – Le nom qu’on lui donne[Record]
…more information
Ejinagosi Kistabish
Richard
Aîné Anicinabe de la Première Nation Abitibiwinni, Président de Minwashin
Transcrit par Adam Archambault, Doctorat sur mesure en études autochtones, École d’études autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue