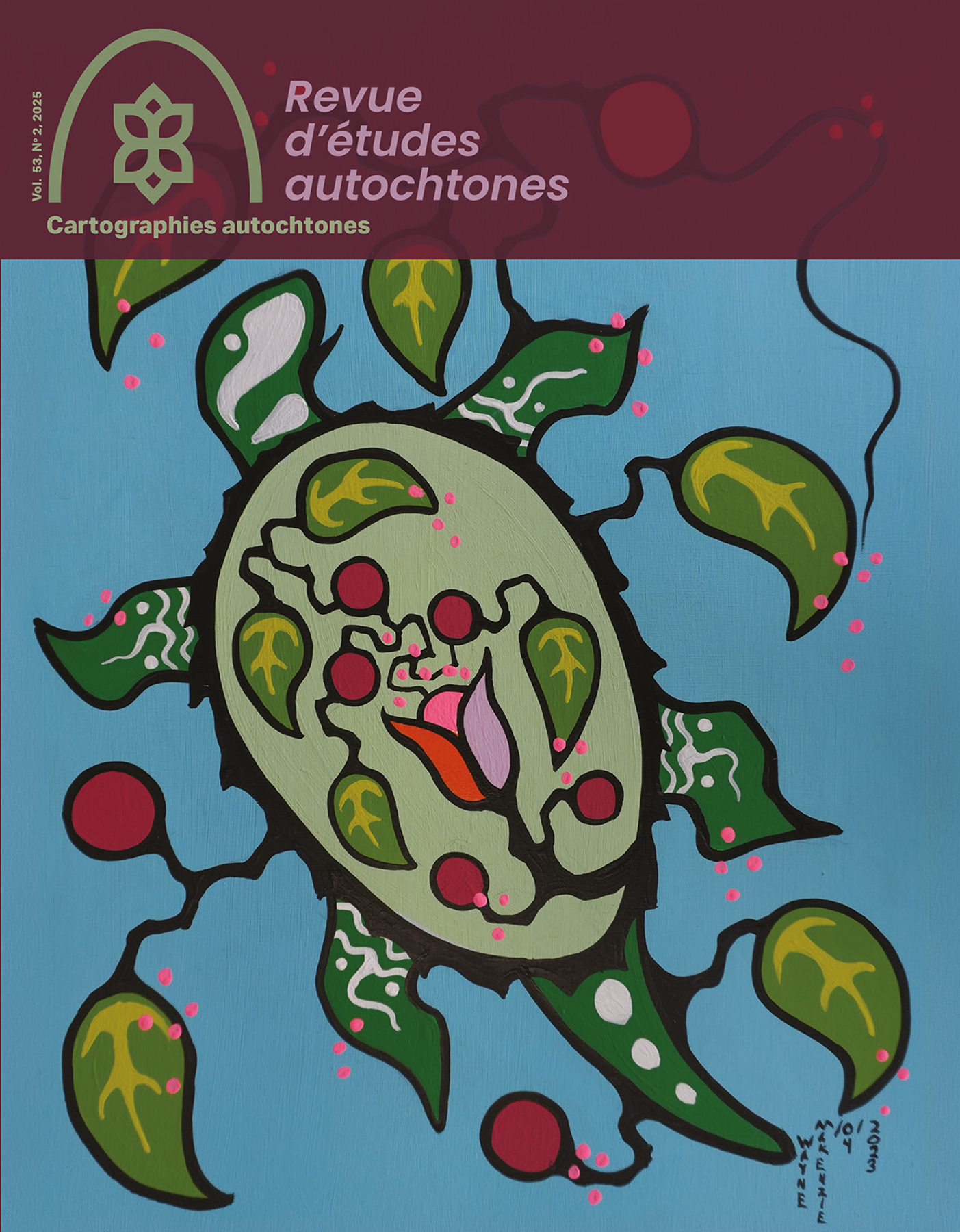Article body
Bonjour tout le monde, kwei !
Je suis ici aujourd’hui pour parler du projet Masko Cimakanic Aski, qui est le nom donné à notre territoire familial, ainsi que le nom de l’aire protégée que nous voulons faire reconnaître par le gouvernement du Québec. Le territoire de Masko Cimakanic Aski est situé près de la réserve de Wemotaci au sein du Nitaskinan, le territoire ancestral des Atikamekw Nehirowisiwok.
Avant de mettre en place le projet, nous avons demandé à l’une des personnes qui transmettait l’information au sujet des aires protégées dans les communautés atikamekw nehirowisiwok si les peuples autochtones avaient une place dans les projets d’aires protégées du gouvernement. Nous voulions savoir si les Autochtones étaient consultés sur cette politique et sur la manière dont sont définies les aires protégées. Elle nous a répondu que ce n’était pas le cas. Nous avons donc commencé à discuter avec les personnes en place pour que s’amorce notre projet Masko Cimakanic Aski et pour ainsi faire valoir notre propre conception de ce qu’est ou devrait être une aire protégée autochtone, selon nos propres valeurs et pratiques de gestion et de préservation des ressources territoriales.
En cours de route, nous nous sommes aperçus que nous étions inutiles dans le développement du projet d’aire protégée. Nous n’avions jamais accès aux décisions et nous n’étions même jamais contactés, ne serait-ce que par téléphone. Nous avons été ignorés. C’est encore exactement ce qui se passe actuellement. Tout est décidé à l’extérieur des communautés, que ce soit au niveau des fonctionnaires ou à partir des municipalités de la région qui prennent aussi part aux discussions. Les peuples autochtones n’ont jamais eu le droit de prendre une décision relative à la manière dont sont pensées et organisées les aires protégées du Québec, même celles qui se trouvent sur nos propres territoires. Nous avons été vexés et choqués. Nous avons tenté d’amener des éléments importants dans les processus de décisions, comme le droit de consentement préalable et éclairé, mais nous avons encore été ignorés.
Cette attitude n’est pas seulement envers nous, mais également envers les Québécoises et Québécois. Dans le cadre des négociations autour de l’aire protégée Masko Cimakanic Aski, notre proposition d’inclure toute la partie sud du territoire dans l’aire protégée a été refusée par le gouvernement. Dans les négociations, le gouvernement a plutôt suggéré d’agrandir la partie nord du territoire, où la coupe forestière n’est de toute façon pas rentable en raison du type d’arbres qui y pousse. Cette attitude du gouvernement est décrite par ce qu’on appelle le « racisme environnemental ». C’est aussi un racisme de nature civilisationnelle. À partir de l’article de Gina Thésée, Paul Carr et Carlo Prévil (2017) intitulé « Enjeux du Vert en Noir et Blanc : Racisme environnemental et antiracisme critique en contextes de racialisation », vous comprendrez pourquoi le problème que nous vivons est à la fois une attitude de « racisme environnemental » et un racisme social qui se fait auprès d’autres groupes au Québec.
Cet article aborde le concept de « racisme environnemental » qui définit bien la situation que ma famille et nos communautés vivent :
La corrélation établie entre les vulnérabilités environnementales et la variable raciale permet de considérer la racialisation comme un prédicteur significatif des vulnérabilités environnementales et, conséquemment, d’élaborer un concept qui rende compte de cette articulation prévisible et permette de comprendre les dynamiques systémiques qui y sont à l’oeuvre : il s’agit du « racisme environnemental ». […] Selon Porteilla, le racisme environnemental est un écocide qui ne dit pas son nom, puisqu’il fonctionne sur le déni des droits fondamentaux des peuples autochtones, dont le droit à un environnement sain qui leur permette de jouir de leurs terres ancestrales selon leurs modes de vie spirituels, culturels, matériels et socioéconomiques. Ses multiples manifestations, historiques et contemporaines, comprennent la prise unilatérale de décisions qui conduisent à la destruction des territoires naturels et à la mise en péril du milieu de vie des peuples autochtones et d’autres populations.
Thésée, Carr et Prévil, 2017 : 53
On sait que la position du gouvernement encourage les multinationales à exploiter le territoire du Québec et des Autochtones. Par ses positions sur l’exploitation du territoire, le gouvernement perpétue le « racisme environnemental » qui doit être également considéré comme un « racisme civilisationnel » :
Nous situons le racisme environnemental à cette même profondeur civilisationnelle. Le racisme environnemental prend effectivement appui sur des représentations, des assomptions et des interventions construites par les groupes dominants et utilisées à l’encontre des personnes et des communautés racialisées comme éléments de justification de la détérioration de leurs environnements et de l’érosion de leur écocitoyenneté.
Thésée, Carr et Prévil, 2017 : 54
À partir de cet article de Gina Thésée, Paul Carr et Carlo Prévil ainsi que de notre propre expérience, il semble évident que le « racisme environnemental » existe et que nous en vivons les conséquences. Toutefois, les personnes qui sont en poste le nient. Il y a une négation du « racisme environnemental » par rapport à l’exploitation abusive du territoire du Québec qui appartient aux Québécois et aux Autochtones. Nous devons prendre en considération ces attitudes néfastes dans les démarches du projet Masko Cimakanic Aski.
Bientôt, nous rencontrerons à nouveau des fonctionnaires pour échanger sur la mise en place de l’aire protégée. Ces personnes sont portées à se concentrer uniquement sur des approches unidirectionnelles. Elles vont venir nous parler des lois environnementales qui ont été implantées au Québec. Elles vont nous informer de ces lois, mais elles ne nous demanderont pas : « et vous, qu’avez-vous comme lois ? Qu’avez-vous comme droits ? ». Même si elles ne nous le demandent pas, nous leur rappellerons que les peuples autochtones n’ont jamais cédé leurs droits territoriaux et qu’elles doivent nous écouter. C’est en ce sens que notre famille et les personnes de Masko Cimakanic Aski prendront position.
Nous nous devons de protéger notre territoire. C’est pourquoi nous avons nommé notre projet Masko Cimakanic Aski. Masko veut dire « ours ». Cimakanic veut dire « le guerrier » ou « le conseiller » qui veut lutter pour l’équilibre et qui se porte à la réflexion de la cohabitation avec son territoire. Aski, ça signifie « la terre » et la relation avec tout ce qui la forme. C’est ce nom que nos ancêtres ont toujours utilisé pour parler de notre territoire : Masko Cimakanic Aski. Celui-là provient de notre origine cosmique et spirituelle, et fait également référence à la constellation de la Grande Ourse. Nous avons donc une histoire par rapport à ce nom et c’est pourquoi nous avons nommé le projet de cette façon.
Nous nous devons tout de même d’utiliser les instances de droit actuelles. Nous avons donc pris contact avec certains avocats ouverts aux situations autochtones et au droit autochtone pour nous donner une direction. D’autres avocats des grands centres nous ont rappelé qu’en tant que membres d’une communauté autochtone, nous ne pouvions pas avoir directement recours aux services d’avocats pour les questions relatives au territoire. Avec la Loi sur les Indiens, seul le conseil de bande est reconnu comme interlocuteur juridique sur les enjeux de territoire. C’est la situation au Québec encore aujourd’hui. C’est totalement aberrant, mais c’est malheureusement la réalité sociale que nous vivons en tant que peuple autochtone et en tant que familles qui se préoccupent de leur territoire.
Nous avons également fait appel à des groupes militants pour nous assister dans notre lutte. Nous considérons important d’avoir l’appui de mouvements environnementaux québécois pour venir nous donner un coup de main. D’ailleurs, les jeunes atikamekw nehirowisiwok, particulièrement ceux de la Matawinie, ont déjà pris position contre l’exploitation des mines et l’exploitation forestière qui se font sur le territoire. L’initiative des jeunes, c’est quelque chose d’assez réconfortant. Notre famille s’engage à faire de même et demandera du soutien si le gouvernement essaie de faire entrer les coupes forestières à l’intérieur de l’aire protégée. C’est un devoir, un engagement.
Voilà la situation que nous vivons et les démarches qui sont faites dans le cadre du projet Masko Cimakanic Aski.
Mikwetc, je vous dis merci.
Appendices
Note biographique
Christian Coocoo est originaire de la communauté atikamekw de Wemotaci, au Québec. Formé en anthropologie à l’Université Laval de Québec, il est coordonnateur des Services culturels au Conseil de la Nation Atikamekw depuis 1998. Il travaille activement à la valorisation et à la pérennisation de la culture de sa nation. Il initie et coordonne des d’activités de documentation, de transfert et de rayonnement sur l’histoire, les savoirs et les savoir-faire traditionnels atikamekw. Il collabore également depuis plusieurs années à différents projets de recherche avec des organismes et des chercheurs de différentes universités. ccoocoo@atikamekwsipi.com
Note
-
[*]
Ce texte est une version manuscrite de la présentation « Masko Cimakanic Aski – Aire Protégée » de Charles Coocoo, tenue dans le cadre du Séminaire de cartographies autochtones. L’évènement s’est déroulé du 12 au 14 mai 2021 au Pavillon des Premiers-Peuples de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Pour consulter les enregistrements du Séminaire : <https://www.uqat.ca/seminaire-cartographies-autochtones/>.
Bibliographie
- Thésée, Gina, Paul R. Carr et Carlo Prévil. 2017. « Enjeux du Vert en Noir et Blanc : Racisme environnemental et antiracisme critique en contextes de racialisation ». Dans Éducation, Environnement, Écocitoyenneté : Repères contemporains. Sous la direction de Lucie Sauvé, Isabel Orellana, Carine Villemagne et Barbara Bader, 47-66. Québec : Presses de l’Université du Québec.
- Porteilla, Raphaël. 2005. « Racisme et discrimination, la position des peuples autochtones ». Dans La nouvelle question indigène. Sous la direction de Jean-Claude Fritz, 433-450. Paris : L’Harmattan.