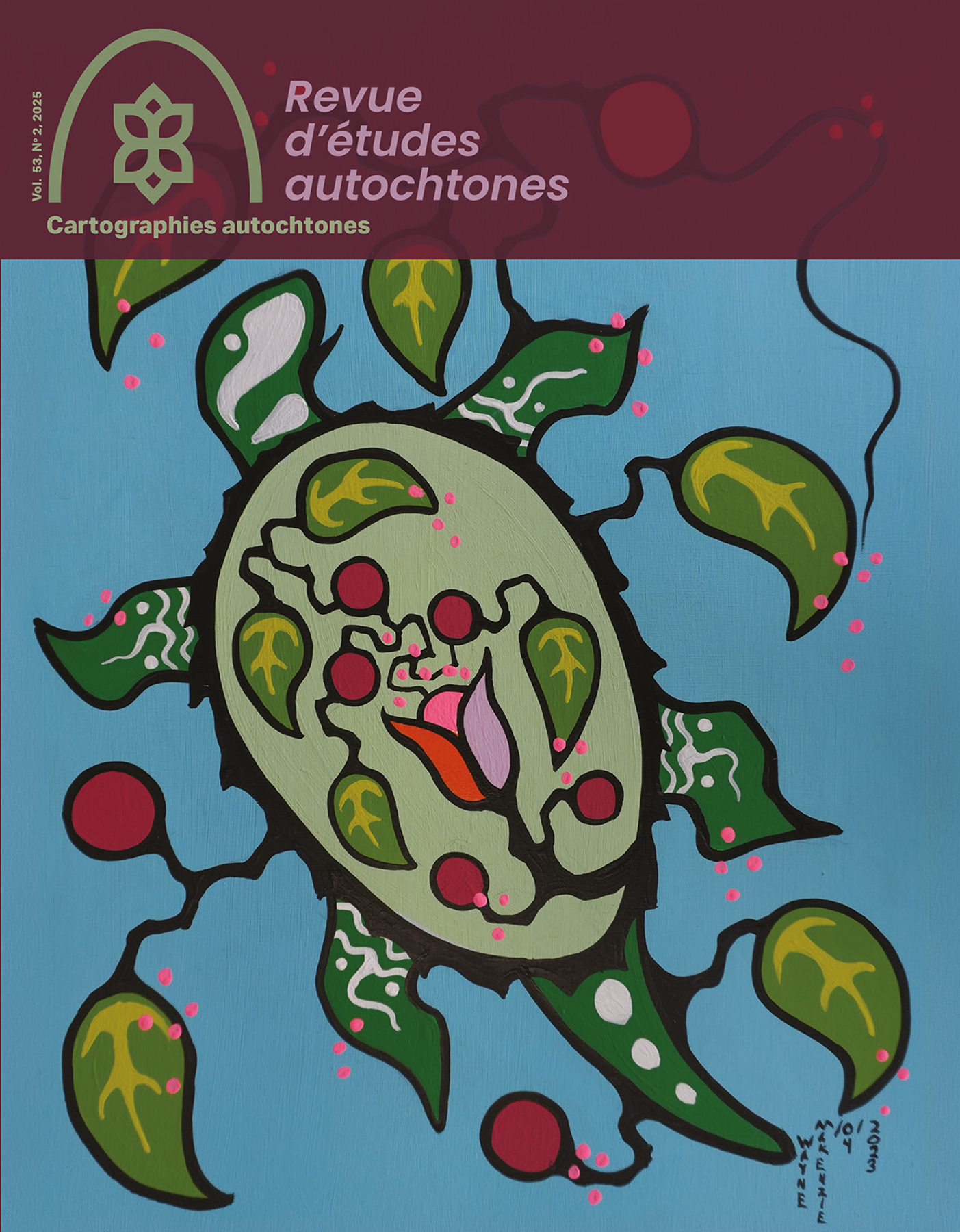Abstracts
Résumé
Depuis plusieurs décennies, les membres du peuple Walbunja (nation Yuin) aspirent à exercer leur souveraineté et affermir leur influence sur les projets de développement économique et de gestion environnementale concernant leur territoires terrestres et marins. Situé sur la côte sud-est de la Nouvelle Galles du Sud en Australie, le territoire des Walbunja est sujet à des pressions intenses, toujours grandissantes, liées à l’expansion urbaine, à une industrie touristique florissante, à l’agriculture et à la pêche commerciale. Cet article explore les opportunités et les défis politiques et ontologiques que représentent la cartographie collaborative et récits numériques autochtones pour soutenir les projets de résurgence de gestion environnementale walbunja. Ces outils numériques peuvent-ils contribuer aux projets de décolonisation envisagés par les Walbunja et autres groupes autochtones ? Peuvent-ils également favoriser l’émergence de synergies entre différentes conceptions et relations au territoire ? Ou conduisent-ils plutôt à l’alourdissement de l’enchevêtrement territorial et ontologique dans l’espace numérique ?
Mots-clés :
- récits numériques,
- contre-cartographie,
- transfert des savoirs,
- relations autochtones-allochtones,
- résurgence
Abstract
For several decades, members of the Walbunja people (Yuin nation) have aspired to exercise their sovereignty and strengthen their influence over the economic development and environmental management projects concerning their land and sea territories. Located on the populated south-eastern seaboard of New South Wales in Australia, the territory the Walbunja are caretaker for is subject to intense and ever-increasing pressures linked to urban expansion, a thriving tourist industry, agriculture and commercial fishing. This paper explores the political and ontological opportunities and challenges that indigenous collaborative mapping and digital storytelling platforms represent for Walbunja sovereignty and environmental stewardship of resurgent projects. Can these digital tools contribute to the decolonization projects envisaged by the Walbunja and other Indigenous groups? Can they facilitate the emergence of synergies between different conceptions and relationships to the territory? Or do they rather allow an extension of a territorial and ontological entanglement in the digital space?
Keywords:
- Digital storytelling,
- counter-cartography,
- knowledge transfer,
- Indigenous-non Indigenous relations,
- resurgence
Resumen
Desde hace varias décadas, los miembros del pueblo Walbunja (nación Yuin) aspiran a ejercer su soberanía y hacer valer su influencia sobre los proyectos de desarrollo económico y gestión medioambiental relativos a sus territorios terrestres y marítimos. Situado en la costa sudoriental de Nueva Gales del Sur (Australia), el territorio Walbunja está sometido a intensas y crecientes presiones derivadas de la expansión urbana, una próspera industria turística, la agricultura y la pesca comercial. Este artículo explora las oportunidades y los retos políticos y ontológicos que presentan la cartografía colaborativa y los relatos digitales Indígenas para apoyar los proyectos de resurgimiento de gestión medioambiental Walbunja. ¿Pueden estas herramientas digitales contribuir a los proyectos de descolonización previstos por la tribu Walbunja y otros grupos Indígenas? ¿Pueden también favorecer la emergencia de sinergias entre diferentes concepciones y relaciones con el territorio? ¿O, por el contrario, conducen a un aumento del enredo territorial y ontológico en el espacio digital?
Palabras clave:
- relatos digitales,
- contra-cartografía,
- transferencia de conocimientos,
- relaciones indígenas y no nativos,
- resurgimiento
Article body
Depuis plusieurs décennies, les membres du peuple Walbunja (nation Yuin) aspirent à raffermir leur influence sur le développement économique et la gestion environnementale de leurs territoires terrestres et marins. Le territoire des Walbunja (fig. 1) longe le littoral du comté de l’Eurobodalla dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud ; une région connue sous le nom de la Côte Sud (South Coast). Située à quelques 280 km au sud de Sydney, cette région est réputée pour ses longues plages de sable blanc et ses eaux cristallines. Les terres et espaces marins dont les Walbunja sont les gardiens ont été profondément transformés par les processus coloniaux, qui débutèrent vers 1820, avec principalement, l’exploitation aurifère, l’agriculture et l’exploitation forestière. Ces territoires sont aujourd’hui confrontés à des pressions grandissantes, notamment liées à l’accroissement démographique, à l’expansion urbaine et à la gentrification, au tourisme et à la pêche commerciale. À ce jour, les Walbunja n’ont eu que peu d’emprise sur les décisions concernant leur territoire, et ce, en dépit de leur poids démographique considérable au sein de la population de Mogo, de Batemans Bay et des villages adjacents[1]. Malgré une participation continue des Walbunja aux consultations orchestrées par les autorités municipales, étatiques et fédérales, leurs démarches, pour que leurs besoins, leurs aspirations et leurs préoccupations soient pris en compte par ces diverses institutions coloniales, se heurtent continuellement à des obstacles politiques, légaux et sociaux.
L’incompréhension généralisée, partagée par la population non autochtone relative aux Walbunja, à leur culture, à leurs savoirs et à leur mode de vie, représente également une limite majeure aux projets de résurgence de ces derniers. Les liens historiques et contemporains qu’entretiennent les Walbunja avec leur Country[2], leurs manières de prendre soin de l’environnement (looking after Country), leur spiritualité – sous-tendues par une relation filiale avec leur Country et les non-humains [êtres ancestraux, esprits, animaux, végétaux et autres] – qui l’habitent et leurs aspirations en ce qui a trait à leurs territoires côtiers urbains et péri-urbains demeurent largement invisibles aux yeux de nombreux habitants non autochtones et de la population transitoire (touristique) de la région. Bien que les non-Autochtones en soient souvent inconscients, plusieurs de leurs projets font obstacle à la résurgence du mode de vie et pratiques walbunja. Malgré ces tensions, plusieurs membres de la communauté, dont les membres Walbunja de notre équipe et coauteurs de cet article, sont ouverts à partager certaines de leurs connaissances et perspectives avec la population allochtone dans l’espoir d’ouvrir leurs yeux à d’autres façons de faire et d’être. À travers cette ouverture et invitation à l’échange, ils espèrent transformer les relations que non-Autochtones entretiennent avec le territoire. Une meilleure compréhension des projets et aspirations des Walbunja a le potentiel de susciter l’émergence de projets communs tels que la collaboration entre les rangers Walbunja et Burrawang Coastal Club détaillée plus bas.
Figure 1
Territoire Walbunja (Country). Les frontières de ce territoire ne sont pas rigides
Figure 2
Panneau d’interprétation touristique du belvédère du Cap Melville (promontoire important pour les Walbunja qui donne une vue sur un ensemble sur de leurs sites (ex. l’île Broulee et l’île Barling)). Ce panneau ne fait aucune référence au territoire et sites walbunja
Comme dans bien d’autres contextes coloniaux, la présence des Walbunja sur leur territoire et leur conception de l’espace sont fréquemment occultés par les représentations cartographiques coloniales (Peluso 1994 ; Louis 2007 ; Potter 2020). Bien qu’ils résident et maintiennent des liens étroits avec leur territoire ancestral, l’ampleur de l’urbanisation affectant leurs terres et les cartes représentant cette nouvelle réalité tendent à soutenir la perception erronée qu’il ne s’agit plus d’un lieu walbunja. Cette situation fait écho au concept d’urbs nullius, c’est-à-dire « un espace urbain dépourvu de la présence souveraine et de droits fonciers autochtones », proposé par le chercheur Déné Glen Coulthard (2014 : 176).
Le projet Environmental Stewardship Resurgence in Walbunja Land and Sea Country souligne l’importance des rapports contemporains que maintiennent les Walbunja avec leur territoire terrestre et marin pour leur bien-être physique, spirituel, culturel et économique. Les activités de cartographie entreprises dans le cadre de ce projet révèlent une densité importante de sites et lieux significatifs pour cette communauté Yuin. Ces sites incluent des lieux de sépulture, d’anciens amas de coquillages, des trappes de pierres autrefois utilisées pour la pêche dans les rivières et estuaires, des sites genrés, tels les lieux initiatiques, les sites d’accouchements, des promontoires utilisés pour le repérage des bancs de poissons, des arbres cicatrisés, des lieux de campements récents et plus anciens. Il s’agit d’un paysage jonché de mémoire, de noms et de relations passées, présentes et futures qui demeure relativement méconnu de la plupart des habitants et touristes de la Côte Sud. Les panneaux interprétatifs installés par le comté de l’Eurobodalla, NSW National Parks and Wildlife Services et Batemans Marine Park sur les pistes de randonnées et les belvédères le long du littoral donnent un aperçu plus que minimaliste du passé aborigène de cette région (fig. 2). Cette représentation cartographique des lieux ou des événements historiques est généralement muette en ce qui a trait à l’étendue de la dépossession coloniale et à la contemporanéité walbunja.
Dans cet article, nous explorons certains des avantages et défis associés au recours à la cartographie collaborative, aux applications permettant l’enregistrement des savoirs autochtones (p. ex. Cybertracker) et au récit numérique (p. ex. ArcGIS Storymaps) pour soutenir la résurgence des responsabilités des Walbunja envers les environnements terrestres et marins qui composent leur Country ainsi que l’exercice de leur souveraineté, au quotidien, sur leur territoire.
Lorsqu’utilisés pour rejoindre le grand public et mettre en lumière les modes de vie et intérêts contemporains des Walbunja, ces outils numériques peuvent-ils transformer positivement les liens entre les ces derniers et les non-Autochtones vivant sur leur territoire ? Peuvent-ils stimuler une ouverture chez les allochtones et améliorer leur compréhension des relations réciproques contemporaines qu’entretiennent les Walbunja avec leur Country ? En d’autres termes, les outils tels que la cartographie collective et les récits numériques (digital storytelling) peuvent-ils contribuer à déstabiliser les perspectives ontologiques occidentales et à favoriser des relations renouvelées entre les allochtones, les peuples autochtones, Country, et l’État australien ? Comme le souligne Kramm (2021), l’autodétermination autochtone, et nous voudrions également ajouter leur souveraineté et leurs projets de résurgence, nous pousse à aborder ces écarts de pouvoir ontologique et l’imposition des ontologies occidentales sur les modes de vie autochtones, mais aussi ce potentiel de changement évoqué plus haut.
Malgré cette invisibilité au sein du paysage urbain et péri-urbain, les façons d’être au monde walbunja continuent de coexister dans des relations dynamiques, enchevêtrées, et souvent tendues, avec les non-Autochtones qui ont pris en charge leurs territoires. En contribuant à rendre ces relations visibles, nous espérons soutenir une prise de conscience générale des liens étroits entre les Walbunja et Country et la valeur de leurs responsabilités environnementales pour le bien-être du territoire, des non-humains et pour la population de la Côte Sud de manière plus générale. Nous espérons également inspirer un changement de perception, chez les Allochtones qui habitent et fréquentent ce territoire, en ce qui a trait à la nature de ce paysage côtier.
Nous avons organisé cet article en quatre parties. Nous proposons d’abord un aperçu théorique des occasions et défis offerts par la cartographie collective et les récits numériques en contextes autochtones. Nous brossons ensuite un bref portrait des Walbunja, de leur relation avec la Côte Sud ainsi qu’avec les Allochtones qui habitent également leur territoire, suivi d’une description de la méthodologie et méthodes auxquelles nous avons eu recours dans le cadre de ce projet. Enfin, nous terminons cet article par une discussion concernant la capacité de cette cartographie collaborative et récits numériques à rendre visibles les façons d’être au monde Walbunja, à transmettre les savoirs Walbunja entre générations et à favoriser l’émergence de synergies entre différentes conceptions et relations au territoire.
Cartographie collective, récits numériques et peuples autochtones
Les pratiques de cartographies autochtones existent depuis des milliers d’années (Hirt 2009 ; Poirier, dans ce numéro). Au fil des millénaires, ces pratiques ont été employées comme outils de navigation, mais également comme mode d’expression des relations et compréhensions particulières de la terre, de la mer et des entités célestes des peuples les ayant élaborées. Certaines de ces représentations cartographiques ont été gravées sur des supports physiques, parfois permanents (inscrits sur la pierre, sur des peaux animales, ou dans l’écorce), parfois éphémères, comme celles tracées dans le sable (voir par exemple Woodward et Lewis 1998 ; Sutton 1998a, 1998b pour l’Australie). D’autres ont été transmises à travers des processus cognitifs et mnémoniques, portés par les récits oraux, la nomenclature des lieux, les chants et les danses (p. ex. Hirt 2009 ; Thomassin 2019 ; Poirier, dans ce numéro). Certaines peintures réalisées par les Aborigènes du centre et du Nord de l’Australie ont aussi été comparées à de la cartographie. Ces pratiques cartographiques et les récits qui en découlent racontent différentes perspectives ontologiques. Elles contiennent des informations clés concernant les liens particuliers qu’entretiennent divers peuples avec leurs territoires, pour ceux qui peuvent les décoder et les comprendre. Elles peuvent également comporter des informations sur les protocoles et les significations rattachées à certains lieux. En territoire walbunja et yuin, des marques furent, par exemple, gravées sur les arbres pour faciliter la navigation, mais également pour avertir les passants de la nature sacrée ou genrée de certains lieux.
Les empiétements coloniaux violents et continus en territoires autochtones ont suscité différents besoins et stratégies cartographiques. Comme le soulignent Thomas McGurk et Sébastien Caquard (2020), plusieurs peuples autochtones se sont approprié les techniques de cartographie occidentales afin de formaliser leurs revendications territoriales et projets politiques. Cette stratégie est progressivement devenue une exigence des processus de revendications des droits aux territoires et une partie intégrante des relations que les Autochtones ont avec les régimes juridiques coloniaux (Potter et al. 2016). Ces expressions cartographiques des territoires autochtones, incluant les peintures aborigènes mentionnées ci-haut, inscrites dans les démarches de revendications territoriales, peuvent être décrites comme des « cartographies enchevêtrées », pour reprendre les mots de Sylvie Poirier, celles-ci juxtaposant des compréhensions et relations ontologiquement différentes des territoires contestés (Poirier 2021 et Poirier, dans ce numéro).
Au cours des deux dernières décennies, plusieurs groupes autochtones, qu’ils habitent des espaces métropolitains ou des localités éloignées des centres urbains, ont adopté et adapté les technologies de cartographie et de communication numériques à des fins diverses, allant de la relance de leurs pratiques traditionnelles au rétablissement de leurs systèmes de nomenclature et aux processus de transfert intergénérationnel de leurs savoirs. L’accès de plus en plus facile aux ordinateurs, mais plus spécifiquement aux téléphones intelligents, aux systèmes de géopositionnement (GPS), aux tablettes et aux médias sociaux, a également permis aux membres des communautés autochtones de documenter et d’enregistrer eux-mêmes leurs récits, leurs savoirs et leurs relations au territoire (Ens 2012 ; de Largy Healy 2013 ; Peterson 2017). Ces outils leur ont permis d’élargir et de partager leurs connaissances, leurs cultures et leurs modes de vie par le biais de films, d’animations, de podcasts, de blogs et d’autres médias sociaux (voir par exemple les travaux de Carlson et Frazer, 2018, 2021 ; Goudie et Davey 2009 ; Kral 2010, 2014).
Plus récemment, les logiciels et les applications open source tels que Cybertracker sont apparus comme des outils utiles permettant à certains groupes autochtones de (re)prendre le contrôle sur leurs récits cartographiques et de traduire la collecte de données géographiques et environnementales dans leurs propres termes et centrées sur leurs priorités et perspectives. D’autres outils virtuels, tels que ArcGIS Storymaps, permettent l’agencement dynamique de cartes géographiques, de textes, d’enregistrements audio et vidéo, de peintures et dessins ainsi que d’oeuvres musicales. ArcGIS StoryMaps, que nous utilisons dans le cadre de ce projet, mais également les plateformes gratuites telles que Google Earth, constituent des outils particulièrement attrayants pour la transmission intergénérationnelle des savoirs (voir par exemple les travaux de Thom, Colombi et Degai 2016 ; de Coocoo et Studnicki-Gizbert, ainsi que ceux de Éthier, dans ce numéro ; voir aussi Clapperton-Richard et al. 2021). L’écrivain et cinéaste aborigène tagalaka Victor Steffensen souligne par ailleurs que l’accès facile aux caméras vidéo et équipements d’enregistrement audio permet « d’amener Country dans la salle de réunion » (Steffensen 2019 : 229) et de stimuler ces relations intergénérationnelles. Que ce soit à travers les films ou la cartographie, les jeunes autochtones qui prennent part à ces projets sont encouragés à dialoguer avec leurs aînés et leur culture à travers ces pratiques quotidiennes de numérisation. Bien que de façon générale, les productions numériques n’offrent qu’une relation indirecte et incorporelle avec le territoire et les aînés, ces technologies peuvent néanmoins faciliter le rapprochement entre générations, particulièrement au moment de la production, et favoriser les pratiques de partage des connaissances culturelles. La professeure Larissa Behrendt, Euahlayi et Gamilaroi, note avec justesse que le récit, qu’il soit numérique ou traditionnel, est une « pratique transformatrice » et un « acte de souveraineté qui renforce l’identité, les valeurs et les visions du monde autochtones » (Behrendt 2019 : 175). Le récit multimédia numérique en particulier, incluant les récits portés par la cartographie, offre aux Autochtones une occasion unique de mettre en oeuvre des projets de résurgence et de renouveler leur responsabilité envers leurs territoires, grâce à des équipements et des outils contemporains considérablement adaptables aux pratiques intergénérationnelles de partage des connaissances.
La cartographie est un acte politique (Peluso 1995) indissociable des rapports de pouvoir encadrant les sociétés qui les imaginent (Halder et Michel 2018 ; Chartier 2020). Elle est aussi un acte social producteur de relations et représentatif de différents mondes (par ce qu’elle inclut et exclut, consciemment ou inconsciemment) et de géographies très différentes (Halder et Michel 2018 ; Yates 2021 ; Poirier 2021 et Poirier, dans ce numéro). Comme le souligne Benoit Éthier (2020, et dans ce numéro), la cartographie autochtone déployée pour soutenir les projets d’autodétermination et de résurgence est une forme de contre-cartographie puisqu’elle vise à déstabiliser, à bouleverser les formes de territorialisation coloniales (Peluso, 1995), à (re)présenter et à recomplexifier le territoire d’un point de vue autochtone (Hunt et Stevenson 2017 ; Chartier 2020). La collecte de données cartographiques ou autre sur le territoire demeure néanmoins empreinte d’une certaine méfiance associée aux expériences de dépossession coloniale vécues par tant de groupes autochtones. Sherrie Nye, coauteure de cet article, souligne d’ailleurs que pour plusieurs aînés, partager leur savoir est associé à la crainte d’une perte d’accès à leur territoire.
Défis associés aux technologies numériques et à l’accès en ligne
En dépit des avantages et occasions qu’ils offrent, plusieurs défis sont également rattachés au recours à ces technologies numériques. Christie souligne notamment l’intérêt porté par les agences gouvernementales aux initiatives de cartographie et aux bases de données autochtones pour développer et élargir leurs propres bases de données à des fins souvent contraires aux aspirations autochtones (Christie 2005 ; voir aussi Snipp 2016 ; Poirier 2021). Les données numériques accessibles en ligne produites sur les sites culturels autochtones sont ainsi susceptibles d’être récupérées et réappropriées par les autorités coloniales pour soutenir leurs propres projets (Hunt et Stevenson 2017). Même lorsque ces données sont gardées secrètes, il demeure un risque qu’elles tombent entre les mains d’instances gouvernementales ou d’intérêts privés (voir Peterson 2017 ; Éthier et al. 2019).
Les pratiques cartographiques, incluant celles décrites comme participatives ou contre-cartographies, et la collecte des savoirs écologiques autochtones sont souvent associées à des processus de distillation et d’abstraction qui tendent à extraire les informations qui ne correspondent pas à une compréhension occidentale du monde (Nadasdy 2003). Ces pratiques portent donc en elles le risque de perpétuer un déséquilibre entre les ontologies autochtones et occidentales, entre les intérêts humains et non humains (Yates 2021) et entre les genres (McGurk et Caquard 2020). Comment les droits appartenant aux producteurs de ces savoirs peuvent-ils continuer à être protégés à la suite de la publication de ces données en ligne ? L’utilisation de la cartographie numérique et des plateformes Internet peuvent-elles soutenir l’extension des pratiques coloniales d’exploitation, d’extraction et de contrôle, en particulier celles qui remplacent la compréhension qu’un peuple a de lui-même avec une vision du monde qui favorise les intérêts coloniaux ? Cela semble confirmer l’avertissement d’Audre Lorde (2018) selon lequel les outils du maître ne peuvent pas démanteler la maison du maître. D’un autre côté, bien qu’avisée, cette proposition ne nie-t-elle pas, dans une certaine mesure, l’ingéniosité et la capacité des peuples autochtones à s’approprier, à réorienter et à réinventer ces outils à leurs propres fins comme le sous-tendent les principes de la contre-cartographie (Peluso 1995), et à percevoir, à éviter ou à atténuer ces écueils politiques potentiels ? En contextes où plusieurs territorialités coexistent et s’opposent, la contre-cartographie apparait comme un outil nécessaire offrant un contrepoids aux représentations coloniales du territoire soutenant, par exemple, les projets d’expansion urbaine à venir. Cette contre-cartographie peut en effet permettre de faire voir le territoire autrement en dehors des relations de possession qui tendent à dominer les conceptions occidentales, capitalistes et coloniales au territoire (Chartier 2020).
Malgré le potentiel porté par les récits numériques pour la préservation et la transmission des savoirs, ces plateformes offrent moins de contrôle sur les conditions de partage et d’accès aux connaissances une fois qu’elles sont publiées en ligne (voir aussi Éthier et al. 2019). Par conséquent, il importe d’interroger dans quelle mesure la cartographie et les récits numériques améliorent ou entravent la continuité des récits oraux et des traditions fondées sur cette pratique. Éthier et al. (2019) questionnent entre autres l’impact des médiums écrits sur la capacité des récits à demeurer flexibles et à s’adapter à de nouveaux contextes. Allant dans le même sens, Chartier parle du « risque d’oubli épistémologique des modes de relation au territoire » (2020 : 17) potentiellement associé à cet exercice. Est-ce que cette forme de représentation du territoire constitue un obstacle supplémentaire générant une distance plus grande entre les ainés et les générations dont les vies sont maintenant profondément enchevêtrées avec le monde virtuel ? Quels codes et arrangements doivent être mis en place pour assurer le maintien de « l’autorité coutumière » (Éthier et al. 2019) et de la « responsabilité relationnelle » associée au transfert de savoir sur le territoire dont parle Louis (2007) ?
En dépit de l’importance du maintien de liens étroits avec le territoire, l’espace numérique est de plus en plus présent dans la vie de tous les jours et une partie intégrante de la vie des plus jeunes. Ces derniers sont à la fois transformés par leur relation avec le virtuel, mais aussi agents transformateurs de cette réalité. Comme l’a souligné la professeure aborigène Marcia Langton, Yiman et Bidjara, les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication pour les jeunes autochtones sont immenses. Elles encouragent les jeunes autochtones à prendre part à la transmission de leur culture et peuvent procurer une certaine fierté associée à cette possibilité de contribuer au bien-être de leurs communautés (Langton 2013 ; voir également Goudie et Davey 2009 ; de Largy Healy 2013).
Dans le cadre de cet article, nous considérons les perspectives ontologiques occidentales (largement anglo-saxonnes) et autochtones (walbunja) comme dynamiques, commensurables et en relation plutôt que fixes, distinctes et incommensurables. Comme l’écrit Mathias Kramm, lui-même s’inspirant de Mario Blaser (2013), les ontologies sont à la fois politiquement négociées et productrices de processus politiques (Kramm 2021). Cette position implique que les relations entre les Autochtones et les Allochtones sont transformatrices et multidirectionnelles. Elles portent notamment en elles le potentiel d’engendrer des changements profonds chez les Allochtones en ce qui a trait aux relations au territoire et entités non humaines (voir Yates 2021). Ce potentiel transformateur requiert toutefois que les univers autochtones et allochtones se rencontrent et entrent en dialogue. La création de récits et de géographies numériques autochtones semble être une des voies possibles pour faciliter les rencontres entre ces univers de sens.
Les Walbunja
La présence des Walbunja et de leurs ancêtres dans cette région remonte à plusieurs millénaires. De nombreuses lignes de chants (songlines), dont celle d’umbarra (le canard noir, un des totems des Walbunja) parcourent leur Country et témoignent des connections intimes et anciennes de ce peuple et d’autres peuples Yuin avec cette région. Les ancêtres des Walbunja vivaient notamment de la pêche, de la chasse, de la cueillette et du troc. Leurs migrations saisonnières les amenèrent bien au-delà de leur territoire. Sur la côte, leurs migrations s’étalèrent de la frontière de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de l’État du Victoria jusqu’au sud de Sydney. À l’intérieur des terres, par-delà les montagnes, ils se rendaient jusqu’à Canberra.
Dans les années 1830, les autorités coloniales de la Nouvelle-Galles du Sud commencèrent à redistribuer les territoires terrestres des Walbunja à des agriculteurs, soldats et autres colons blancs (Goulding et Waters 2005). L’apparition de fermes laitières et de l’industrie du bois se traduisit par un défrichement extensif des terres, le déplacement des Walbunja et de violentes altercations. Bien que l’établissement de colons en territoires walbunja fût, au départ, relativement lent, la découverte de gisements aurifères au cours des années 1850 accéléra le processus de dépossession enclenché vingt ans plus tôt. Plusieurs villes et villages émergent à cette époque, notamment autour des mines.
Fondé sur des politiques de ségrégation et d’assimilation, l’établissement de missions et de réserves vers la fin du xixe siècle poursuivit la relocalisation de plusieurs familles walbunja vers de petites réserves entre Batemans Bay et Moruya. Sous la gouverne du Conseil pour la Protection des Aborigènes (Aboriginal Protection Board), toutes les dimensions de la vie des Aborigènes y étaient contrôlées. Parler le dhurga, la langue des Walbunja, et la pratique de cérémonies étaient interdits (Donaldson 2006 ; White 2010). À travers ce conseil, le gouvernement se donna également le droit de retirer les enfants aborigènes de leurs familles (en particulier ceux issus d’unions mixtes) pour les placer dans des familles blanches ou en institutions (époque connue sous le nom de stolen generations (du milieu des années 1800 jusque dans les années 1970). Plusieurs aînés walbunja racontent avoir dû eux-mêmes se cacher de la police pour éviter d’être retirés de leur famille.
La cohabitation entre les colons et les Walbunja a été largement marquée par la brutalité et le racisme. Malgré ce climat de conflit, de peur et de méfiance, des relations plus conviviales se sont également développées entre colons et Walbunja. Certaines de ces relations émergèrent de la participation, souvent saisonnière, des Walbunja au sein de l’industrie de la pêche (chasse à la baleine), de l’horticulture (principalement dans les champs de pois et de fèves) et de l’industrie forestière (moulins à bois) (White 2010). Les Walbunja agencèrent leur participation dans cette nouvelle économie capitaliste dans la continuation de leur économie non monétaire (incluant le troc avec les colons). Leurs contributions à l’économie locale et au développement de la région sont considérables (ibid.).
En dépit de l’ampleur de leur dépossession et d’une expansion urbaine continuelle, de la perte d’accès à leur territoire et à leurs ressources, de leur langue, de leur culture et d’une partie de leurs savoirs, les Walbunja ont été en mesure de préserver des liens forts avec leurs territoires terrestres et marins (Donaldson 2006). Au fil des ans, ils sont devenus de plus en plus actifs politiquement.
Au début des années 2000, leur participation aux consultations appuyant la planification des zones de conservation pour le parc marin de Batemans (Batemans Marine Park) a mis en lumière la continuation des liens profonds et des responsabilités que les Walbunja entretiennent, en tant que peuple maritime, envers leurs environnements côtiers et marins. Le processus de consultation encadré par les autorités du parc marin a permis aux Walbunja d’identifier les sites côtiers et marins importants pour leur communauté, incluant leurs zones de pêche traditionnelle passées et actuelles. Ces riches espaces marins sont importants pour les pêcheurs walbunja depuis des temps anciens. Alors que la conservation des espèces vivant dans ces zones est désirée à la fois par les Walbunja et les autorités du parc marin, l’importance de la continuité des pratiques des pêcheurs walbunja dans ces zones ne semble pas avoir été comprise ni prise en considération par les gestionnaires du parc. À la suite de ces consultations, les autorités du parc marin établirent des « zones sanctuaires » où toute forme de pêche ou de collecte est interdite[3], comprenant la plupart des sites répertoriés par les membres de la communauté, par exemple, les sites archéologiques aborigènes (amas de coquillages) et zones de pêche traditionnelles. Bien que cette stratégie de conservation ne soit généralement pas perçue par le grand public comme une forme de dépossession coloniale, l’établissement de ces zones de non-prélèvement eut comme conséquences de limiter de façon significative l’accès des Walbunja à leurs territoires de pêche traditionnels et à leurs ressources marines (voir aussi Egloff 2000). De façon générale, l’établissement de ces zones sanctuaires par le parc marin, combiné aux règlements associés à la pêche dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, ont des impacts importants sur la souveraineté alimentaire, le bien-être général et la capacité de transmettre leurs savoirs et culture aux jeunes Walbunja. (Smyth et al. 2018).
La pratique de la pêche de subsistance et commerciale est centrale à l’identité Walbunja. Cette stratégie a contribué à criminaliser certains aspects du mode de vie walbunja[4]. Elle enfreint leurs droits de pratiquer et de transmettre leur culture, de maintenir leurs engagements économiques et spirituels avec leur Country et contraint leur droit à l’autodétermination tel qu’énoncé par la Déclarations des Nations Unies.
Au moment de la publication de cet article, les territoires des Walbunja, et de la nation yuin auxquels ils appartiennent, faisaient l’objet de revendications devant le National Native Title Tribunal. Ces revendications concernent la reconnaissance légale de leurs titres autochtones sur un territoire terrestre et marin couvrant près de 17 000 km2 et s’étirant dans la mer sur trois milles nautiques (National Native Title Tribunal 2018).
Méthodologie
Cet article est le fruit d’une collaboration de recherche qui s’est épanouie depuis 2014 et qui comprend Linda Carlson, directrice du Mogo Local Aboriginal Land Council (MogoLACL)[5], les équipes de rangers[6] de MogoLALC (Sherrie Nye McCarron, Adam McCarron, Jake Chatfield et Alex Nye) et Batemans Bay Local Aboriginal Land Council (principalement Andrew White et Adam Nye), Annick Thomassin et Janet Hunt de l’Australian National University (ANU) et, plus récemment, Kim Spurway et Karen Soldatic (Institute for Culture and Society, Western Sydney University), Tayla Nye (ANU) avec les conseils avisés de Bruce Doran (Fenner School of Environment and Society, ANU). Au départ, le projet pilote Seachange (2015-2018), dirigé par Thomassin, Carlson et Hunt, visait à créer un système de collecte de données permettant d’accumuler les informations requises à la réalisation des contrats des rangers (p. ex., des données sur la qualité de l’eau, sur les espèces invasives ou protégées, etc.) et des informations concernant la culture walbunja, leurs relations et compréhension de Country et les liens généalogiques qu’ils entretiennent avec celui-ci. Ce projet avait pour objectif de créer une base de données où les utilisateurs de ces données écologiques seraient exposés à la réalité walbunja afin de les amener à percevoir les liens forts qui les unissent à l’ensemble du territoire et des non-humains qui l’habitent.
Les mégafeux de forêts qui ont dévasté la Côte Sud à la fin 2019 et début 2020 ont démontré l’urgence et la nécessité de développer de meilleures approches de gestion des risques et catastrophes afin de définir et minimiser les menaces futures notamment associées aux changements climatiques. Les feux, mais également les inondations de 2020-2021 et l’érosion des zones côtières posent des risques importants pour de nombreux sites walbunja. Sur la côte, l’érosion causée par la montée du niveau de la mer expose progressivement des amas de coquillages anciens et des sépultures. Certains pièges à poissons et crustacés ont également été exposés, notamment dans la rivière Clyde, après les feux. La documentation de ces sites peut permettre d’illustrer l’impact et les risques associés aux changements climatiques sur le patrimoine culturel walbunja ainsi que la densité des liens passés et contemporains qu’ils entretiennent avec ce territoire.
Depuis la fin 2020, nous travaillons à l’élaboration d’outils de cartographie collaborative et de récits numériques afin d’amplifier la visibilité de la présence contemporaine walbunja dans cette zone de la Côte Sud. Ce travail est guidé par trois objectifs principaux, soit de soutenir les aspirations de la communauté walbunja d’accroître son influence sur les décisions concernant ses territoires ancestraux ; de créer des outils virtuels dynamiques et appropriés pour faciliter la transmission intergénérationnelle de leurs savoirs, relations et façons d’être au monde ; et enfin de créer des outils virtuels permettant le rapprochement entre les Walbunja et la population allochtone vivant au sein de leur territoire.
Commençant timidement en mars 2020, alors que l’Australie se préparait à un premier confinement lié à la pandémie de coronavirus, le projet sur lequel repose cet article a consisté en des ateliers de cartographie collective et en une série d’entrevues ouvertes réalisées principalement en territoire walbunja avec des aînés et d’autres membres clés de leur communauté. Ces activités de cartographie collective se veulent un moyen de mettre en évidence les manières walbunja d’être en relation avec le territoire, informées par les principes de responsabilité relationnelle, de représentation respectueuse et d’appropriation réciproque (Louis 2007).
Au total, 20 membres de la communauté walbunja de Mogo et des environs, âgés entre la vingtaine et la septantaine, ont participé au projet, soit en groupe ou à travers des entrevues individuelles. Les ateliers de cartographie collective, d’abord avec les membres walbunja de notre équipe (fig. 3) et ensuite avec les aînés et autres walbunja, ont permis de créer des ébauches cartographiques basées sur l’expérience et les savoirs de membres de la communauté en lien avec leur territoire.
Figure 3
Exercice d’ébauche cartographique par l’équipe de ranger du Mogo Local Aboriginal Land Council
Ces ateliers et entrevues ont généré des discussions enthousiastes et animées concernant l’emplacement de certains sites, le nom de certains lieux et les activités leur étant associées. Ils permirent aux aînés présents de parler de leurs connexions intimes avec certains lieux importants pour eux et leur famille. Ces ateliers et entretiens visaient à documenter géographiquement et narrativement les sites, récits et pratiques chers aux Walbunja. Ces sites inclurent à la fois d’anciens campements, des amas de coquillages, des carrières d’ocre, des arbres aux troncs cicatrisés dont l’écorce fut extraite, jusqu’à aujourd’hui, pour la construction de canoës, de boucliers ou d’autres objets. Il y a des sites initiatiques et genrés, des trappes pour la capture de poissons et crustacés. Il y a les sites plus récents, où les familles locales avaient l’habitude de camper, de se baigner, d’aller pêcher et chasser, dans des buts commerciaux, d’échange non monétaire ou simplement pour nourrir leur famille. Ils incluent des lieux où se concentrent des aliments traditionnels utilisés dans certains plats qu’ils préparent, les plantes médicinales et le lomandra utilisé pour tresser les paniers vendus dans leur galerie d’art. Il y a les sites importants au-delà de leur territoire et qui attestent des liens et de la porosité de leurs frontières, par exemple, Gulaga – la mère des Walbunja – une montagne située au sud de leur territoire. Plusieurs sites ne sont pas accessibles en raison du développement urbain, de leur localisation sur des terres privatisées, et de clôtures installées par le NSW National Parks and Wildlife Services.
Alors que les ateliers de cartographie favorisaient le partage de récits et de savoirs sur les lieux identifiés dans le cadre de ces exercices, plusieurs des histoires émergeant des entrevues ont permis d’ajouter et de visiter de nouveaux sites ou zones aux cartes produites. Afin de constituer le récit numérique associé à ce projet, les informations provenant des esquisses de cartes et entrevues, des extraits audio et vidéo ont été sélectionnés et intégrés à la plateforme digitale ArcGIS StoryMaps et seront bientôt disponibles publiquement en ligne (voir fig. 4 à 6) après avoir été examinés par des membres de la communauté walbunja. Guidé par les principes de souveraineté associés aux données et informations sur et/ou par les Autochtones (Indigenous data sovereignty), ce processus de révision vise à assurer que les informations amassées et publiées reflètent les intérêts et priorités des Walbunja, qu’aucune information problématique ne soit rendue publique et rendue accessible aux personnes non autorisées (voir Snipp 2016). Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé l’application cartographique Cybertracker pour géopositionner certains sites, les connaissances, les noms de lieux, les histoires et les enchevêtrements coloniaux en territoire walbunja. Ce travail est toujours en cours.
La plupart des entretiens avec les aînés et membres de la communauté ont été réalisées par quatre des membres walbunja de notre équipe, trois dans la vingtaine et un dans la quarantaine. Ainsi, ce projet a permis de libérer du temps et de donner une place importante à ces jeunes rangers, qui ont pu échanger avec leurs aînés, écouter leurs histoires, partager leurs connaissances et participer à la documentation de ces récits pour les générations à venir. De plus, en réalisant la majorité des entrevues, nos collègues walbunja – principalement Adam Nye, Tayla Nye, Jake Chatfield and Jordan Nye – ont pu adapter la direction de ces entretiens aux priorités de leurs aînés ainsi qu’à leurs propres aspirations. Ils ont également pu développer une maîtrise du matériel et contrôler à la fois l’accès, la diffusion, l’interprétation et la réinterprétation des savoirs partagés (voir aussi Hirt 2009 ainsi qu’Éthier, dans ce numéro). Le processus menant à la création des cartes et récits numériques, dans sa capacité à engendrer des engagements avec les aînés, mais également avec le Country, est donc lui-même porteur de résurgence et générateur de relations intergénérationnelles (fig. 7). Comme le dhurga, la langue des Walbunja et autres communautés yuin, n’est plus parlé couramment, les entretiens et ateliers se sont déroulés en anglais. Nous espérons intégrer plusieurs concepts et noms issus de cette langue aux cartes et récits produits au cours d’une nouvelle phase de ce projet.
Figures 4, 5 et 6
Aperçu du récit numérique créé dans le cadre de ce projet à partir de la plateforme ArcGIS Storymaps
Pour saisir la nature des relations qu’entretiennent les non-Autochtones envers Country et des transformations possibles de ces relations, il nous a semblé opportun d’interroger les perspectives d’Allochtones vivant ou visitant le territoire walbunja. Une grille d’entrevue destinée à interroger cette population a été développée par les membres walbunja de notre équipe. Cette grille d’entrevue vise à explorer les manières dont les non-Autochtones perçoivent le territoire et Country. Elle interroge le degré de familiarité des résidents allochtones de la région de Mogo et de Batemans Bay, avec la culture aborigène walbunja. Certains d’entre nous, qui ne sommes pas Autochtones, avons donc été sollicités pour tester cette partie de l’enquête. Cet aspect additionnel de notre projet fera partie de prochains terrains de recherche.
Dans le cadre de ce projet, certains membres de la communauté allochtone associés au Burrawang Coastal Club, qui consiste en des chalets à temps partagé près de Batemans Bay, nous ont donné accès à leur propriété, ce qui nous a permis de documenter les sites et certains récits associés à leur domaine et aux terres qui lui sont adjacentes. Ce Club est situé près de zones importantes aux Walbunja, incluant les plages Barlings et Little Paddock, ainsi que de l’Île Barlings, un site culturellement réservé aux hommes (fig. 8). Certaines familles walbunja ont campé sur cette partie du territoire jusqu’à tout récemment, incluant la famille d’Adam McCarron. La documentation cartographique de sites importants pour les membres walbunja de notre équipe s’est donc réalisée sur ces terres privées. Cette initiative a inspiré certains copropriétaires de ce Club à se renseigner sur l’histoire et les familles walbunja associées à leur « propriété ». Ces relations entre les Walbunja et les membres du Burrawang Coastal Club ont, depuis 2020, soutenu l’émergence de collaborations incluant le retour du brûlis (cultural burning)[7] par les rangers walbunja de Batemans Bay (fig. 9).
Discussion
Notre projet s’articule autour des avantages potentiels que les technologies numériques et les applications virtuelles offrent pour la concrétisation de la résurgence des responsabilités environnementales walbunja et le renouvellement des relations avec les communautés allochtones de la Côte Sud. La production de géographies numériques et de récits virtuels associée à ce projet est donc nourrie par des aspirations partagées au sein de notre équipe et des membres de la communauté walbunja : transformer et remettre en question les régimes de propriété coloniaux, les rapports extractivistes à l’environnement et les épistémologies rationalistes. Elle permet également aux walbunja de se représenter et de se raconter eux-mêmes (voir aussi de Largy Healy 2013, dans le contexte des Terres D’Arnhem au nord de l’Australie). En d’autres termes, l’exercice de contre-cartographie porté par ce projet espère soutenir la renégociation des conditions de coexistence entre les Walbunja, les Allochtones et les autorités coloniales régionales, étatiques et fédérales à travers leur territoire.
Les informations accumulées dans le cadre des ateliers de cartographie collective et entrevues révèlent la densité de leurs relations avec la Côte Sud. Comme l’explique Keith Nye, aîné walbunja, chaque promontoire, chaque baie, chaque plage et chaque lagon est doté d’un nom, d’une histoire et de liens avec leurs familles et leurs ancêtres (fig. 10). En dépit de la continuation des processus coloniaux et de l’étalement urbain, qui contraint l’accès à une grande partie de leur territoire, ainsi que de l’actualisation de leurs pratiques et responsabilités envers leur Country, plusieurs de ces relations, savoirs et façons d’être au monde, et, quand la situation le permet, leurs responsabilités environnementales, continuent de coexister avec les façons d’être allochtones à travers leur territoire.
Partager et rendre visible cette présence contemporaine et mode d’être walbunja au sein du territoire peut jouer un rôle important pour soutenir la réalisation de leur objectif d’accroître leur influence sur les décisions concernant le développement et la gestion environnementale sur la Côte Sud. En produisant leurs propres cartographies et récits leur étant associés, ils espèrent générer des conditions favorables à des négociations plus égalitaires avec les autorités municipales, agences gouvernementales étatiques – incluant le Département des Pêches, le parc marin de Batemans et NSW National Parks and Wildlife Services – et fédérales ainsi qu’avec les entrepreneurs privés ayant des projets pour la région. Ce travail de contre-cartographie et de récit numérique vise aussi à être porteur de rapprochements entre les différentes générations de Walbunja, et entre les Walbunja et la population non-Autochtone vivant sur la Côte Sud.
Figure 7
Certains des sites identifiés par les membres de la communauté ayant pris part à ce projet, compilés par l’équipe de recherche à l’aide d’ArcGIS Storymaps
Figure 8
Plage de Barlings
Figure 9
Activité de brûlis sur les terres du Burrawang Coastal Club en territoire walbunja
Figure 10
Aîné walbunja examinant un amas de coquillage récemment exposé par l’érosion de l’île Broulee
Figure 11
Révéler l’emplacement de certains sites et éléments importants du paysage peut mener à la désacralisation de ces lieux. L’emplacement de ce vieil arbre, important pour les Walbunja, était inscrit sur un panneau routier. Plusieurs visiteurs ont cru bon d’y inscrire leurs noms au couteau
En enchevêtrant leurs connaissances, mémoire, récits personnels, familiaux et ethniques à ces cartes et à ces bases de données, en renommant les lieux, en expliquant les responsabilités héritées envers le paysage terrestre et marin, nous espérons que cet exercice pourra fournir des récits alternatifs et transformateurs permettant de bouleverser les processus de dépossession, d’exclusion et de destruction qui continuent d’affecter la communauté walbunja et leur Country. En produisant et en contrôlant l’utilisation et l’accès des données produites sur leur territoire, les Walbunja accroissent leurs chances de contrôler la manière dont leur Country est raconté. En développant une base de données complexe contenant des savoirs tant géographiques que culturels et environnementaux concernant des sites qui sont importants aux yeux de leur communauté, il devient possible de déployer rapidement ces informations si, par exemple, un projet de développement immobilier, industriel ou touristique menace un site important. Beaucoup de travail reste à accomplir afin d’identifier les pistes disponibles pour que ces savoirs et données soient reconnus légalement et aient un poids politique.
Alors que les plateformes de cartographie et de récits numériques peuvent aider à atteindre, à sensibiliser un large public et à donner aux jeunes générations et aux Walbunja vivant loin de leurs territoires un accès semi-direct aux voix et aux connaissances de leurs aînés, cette expérience virtuelle demeure une relation indirecte avec Country pouvant être interprétée comme étant en contradiction avec les ontologies relationnelles aborigènes partagées par les Walbunja. Comme l’ont souligné certains aînés alors que nous tentions de faire progresser ce projet de manière virtuelle durant la pandémie, la compréhension et la relation avec Country nous demande d’être présents sur le territoire. Comment alors concilier l’expérience pleinement incarnée lorsque présents avec Country et l’expérience généralement désincarnée des espaces virtuels ? Ces technologies rendent-elles ces relations plus instrumentales, supprimant les liens étroits avec Country et les relations avec les non-humains ? Est-ce que les (re)présentations virtuelles du monde et de la mémoire walbunja permettent de transmettre leurs perspectives ontologiques ? Représentent-elles plutôt de nouvelles réalités enchevêtrées et codées à travers les possibilités et limites posées par le monde virtuel ? Dans le cadre de notre projet, le processus de collecte d’informations et de récits a en lui-même créé un espace de rencontres de qualité entre les jeunes Walbunja rangers (coauteurs de cet articles) et les aînés, et une invitation de la part de plusieurs aînés à poursuivre ces échanges.
Nous avons mentionné plus haut l’existence d’une certaine réticence chez les aînés à partager leurs connaissances par rapport à leurs pratiques et à l’emplacement de certains sites, particulièrement les sites sacrés. En partageant ces savoirs avec les Allochtones et institutions coloniales, ils courent le risque que ces sites soient mal appropriés ou mal gérés. Ceux-ci risquent aussi d’être utilisés de manières allant à l’encontre de leurs intérêts, comme ce fut le cas lors de l’établissement du parc marin de Batemans. Ils peuvent également faire l’objet de vandalisme (fig. 11). L’élaboration de protocoles sous-jacents à la prise de décision concernant le partage et l’entreposage de ces informations est donc primordiale. Comme nous l’avons aussi mentionné plus haut, la révision par des membres de la communauté walbunja des cartes et récits produits dans le cadre de ce projet avant qu’ils soient publiés fait partie des mesures en place pour contrôler ce qui est partagé en ligne.
Pour éviter de révéler l’emplacement précis des sites importants, certaines des cartes en cours de développement utilisent des frontières floues, des points approximatifs et marqueurs de densité plutôt que d’identifier des zones précises (Potter, Doran et Matthews 2016). Le recours à des frontières floues et graduelles est également utile pour illustrer la porosité des frontières entre territoires walbunja et les territoires d’autres communautés yuin (notamment les Murramurang au Nord et les Brinja au Sud) correspondant davantage à leur perspective ontologique relationnelle. Ces frontières se prolongent aussi dans l’océan.
Ce travail de cartographie et ces récits numériques sont profondément entrelacés avec la crise climatique, de plus en plus évidente en Australie. La superposition des zones affectées par les mégafeux de 2019-2020 avec les limites du territoire walbunja donne un aperçu des risques auxquels leurs sites sont de plus en plus exposés. La multiplication des feux de brousse, des inondations et l’accélération de l’érosion côtière, associés aux changements climatiques, menacent directement l’intégrité et la santé de leur territoire. Au cours des dix dernières années, plusieurs amas de coquillages et sépultures ont été exposés par l’érosion et ont requis leur attention.
L’intensité et l’étendue des mégafeux de 2019-2020 ont inévitablement porté atteinte au patrimoine culturel walbunja. L’identification cartographique de ces sites peut contribuer à les protéger de manière adéquate. En maintenant le contrôle sur leurs données, les rangers et membres de la communauté peuvent décider de révéler l’emplacement de certains sites lorsqu’ils le jugent nécessaire. Cette approche, centrée sur les relations envers leur Country et le rétablissement des responsabilités des Walbunja, mais aussi des Allochtones avec celui-ci, fait écho à la proposition de Kyle Whyte (2020) d’adopter des réponses aux défis posés par les changements climatiques basées sur des « épistémologies de coordination ». Ces épistémologies de coordination mettent l’accent sur nos liens moraux et nos responsabilités envers le territoire (ici Country), les non-humains et les humains qui y vivent, contrastant avec les « épistémologies de crises », qui servent souvent à valider des interventions violentes et nuisibles, et qui visent à maintenir un statu quo relatif qui, jusqu’à présent, n’a pas servi les peuples autochtones, les groupes marginalisés et les non-humains. En proposant des outils favorisant les rapprochements entre différents groupes et une compréhension autre du territoire, les récits numériques associés à ce projet soutiennent cet appel vers la coordination.
Un point important souligné par (Hunt et Stevenson 2017) est que les technologies numériques ne sont pas utilisées ni adoptées de manière homogène. Ces technologies sont adaptées, intégrées, pourvues de nouvelles raisons d’être et infusées de nouveaux sens. La cartographie et le récit numérique sont ainsi des processus itératifs et vivants. Ils prennent la forme de représentations fluides, toujours en conversation avec les réalités hors ligne. À bien des égards, il s’agit d’un parcours se voulant décolonial, non linéaire et en développement, plutôt que d’un produit fini.
Conclusion
La sévérité des mégafeux de 2019-2020 a mené à une certaine prise de conscience au sein de la population non Autochtone de la valeur des systèmes de connaissances et des pratiques de gestion aborigènes des terres (en particulier leur recours au brûlis) pour prévenir de telles catastrophes. Dans les jours et semaines qui suivirent les feux, les médias traditionnels et médias sociaux furent inondés de commentaires provenant de journalistes et du grand public suggérant que ces pratiques millénaires doivent faire partie des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Ce n’est certainement pas la première fois que les pratiques et savoirs autochtones sont présentés comme des aspects clés de la gestion environnementale. Les désastres dits « naturels », auxquels la population australienne est de plus en plus confrontée, contribue à renforcer cette tendance qui émergea plus particulièrement vers la fin des années 1970. Cet accent mis sur l’intégration des savoirs et pratiques autochtones comme solutions aux problèmes environnementaux tend cependant à occulter l’impact que plus de deux cents ans de colonisation et de dépossession ont eu sur ces systèmes de savoirs (Borrows 2017 ; Thomassin et al. 2019).
Malgré cette prise de conscience, les liens indissociables unissant ces pratiques de gestion, ou plutôt, ces responsabilités envers le territoire et les philosophies et relations filiales que les autochtones entretiennent avec leur territoire demeurent l’objet d’une incompréhension considérable de la part des Allochtones. Comme le souligne John Borrows (2018), Anishinabe (Anichinabé) et professeur de droit à l’Université de Victoria (Colombie-Britannique), il n’est pas suffisant d’encourager le renouveau des responsabilités et lois autochtones pour faire face aux crises environnementales grandissantes. Les Autochtones doivent être en mesure de se réconcilier avec leurs territoires en renouvelant leurs responsabilités envers celui-ci et les non-humains. Mais cette réconciliation repose également sur la capacité des non-Autochtones à transformer et à renouer leurs rapports au territoire. Il n’est cependant pas clair dans quelle mesure les Allochtones perçoivent que cette prise de conscience doit s’accompagner d’une transformation importante de leurs propres rapports au territoire (terrestre, marin et aquatique), aux non-humains et aux ressources soi-disant naturelles.
Faisant écho à ce constat, peut-être de manière plus directement évidente en milieu urbain et péri-urbain qu’en localités éloignées, la résurgence du mode de vie Walbunja et le renouvellement de leur relation et responsabilités envers leur Country sont largement tributaires de changements radicaux des relations qu’entretient la population non autochtone avec le territoire. Pour ce faire, et non sans réticences, plusieurs membres de la communauté sont prêts à partager leurs savoirs et leurs perspectives philosophiques. Il importe donc de créer des ponts avec les Allochtones et de complexifier leur compréhension du territoire. En plus de rendre visible la présence, les pratiques et les responsabilités des Walbunja envers leur Country, ce projet espère à la fois cartographier et raconter le territoire à partir d’une perspective Walbunja. Il porte également une attention particulière aux rapports de pouvoir et systèmes de savoirs privilégiés par les structures cartographiques et systèmes d’information géographique (SIG) (Louis 2007 ; Chartier 2020) pouvant miner ces efforts de résurgence.
Il est trop tôt pour affirmer si le recours à la cartographie collaborative et aux récits numériques progressivement engendrés dans le contexte du projet Environmental Stewardship Resurgence in Walbunja Land and Sea Country créera une plateforme favorable à l’émergence de nouveaux dialogues entre les Walbunja et la population allochtone de la Côte Sud. Plusieurs questions demeurent dans ces espaces aux territorialités profondément enchevêtrées (Dussart et Poirier 2017), où les liens et la présence autochtones avec le territoire sont souvent occultés par les institutions coloniales et membres de la population allochtone. En donnant une certaine visibilité à la présence, aux pratiques et aux aspirations contemporaines des Walbunja au sein de ce paysage côtier urbanisé, ces plateformes numériques offrent plusieurs outils pouvant soutenir la renégociation des relations entre Walbunja et Allochtones, et entre Allochtones et Country. Au fur et à la mesure que ce projet se poursuit, nous espérons interroger ce potentiel (trans)formateur porté par la cartographie et les récits numériques en interagissant, hors ligne, avec les résidents non autochtones et représentants du gouvernement au sein du territoire walbunja (voir l’exemple du Burrawang Coastal Club). Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette démarche, bien que récente, est déjà entamée. En fait, le processus de collecte des données sur lequel reposent ces outils numériques a été lui-même un catalyseur de rencontres et de rapprochements.
Ce projet de cartographie digitale présente aussi un moyen de préserver, de renouveler et d’amplifier les savoirs territoriaux et de générer des outils utiles à la transmission intergénérationnelle de ces savoirs au sein de la communauté walbunja, particulièrement pour les jeunes, qui n’ont pas un accès aisé au territoire ancestral soit parce qu’ils vivent ailleurs ou en raison de l’expansion urbaine rapide de cette région. Alors que les cartes et récits produits dans le cadre de ce projet représentent un des moyens de communiquer la mémoire, les savoirs et relations au territoire des aînés aux générations futures, le processus de collectes d’information et d’histoires par de jeunes Walbunja (coauteurs de cet article) fut en lui-même un vaisseau de transmission et d’intégration de ces savoirs. Ce faisant, ces membres de la communauté Walbunja participent à la création d’outils de représentation cartographiques et de récits numériques adaptés à leur contexte et à leurs besoins tout en jetant les assises des récits et savoirs qu’ils auront un jour à transmettre aux générations futures, en tant qu’aînés.
Il reste à déterminer dans quelle mesure il est possible de cartographier plusieurs perspectives ontologiques en mobilisant la cartographie collaborative et le récit numérique. Peut-on cartographier des mondes différents d’une manière qui leur permette d’interagir et de coexister pleinement ? L’articulation et l’interaction de ces plateformes numériques complémentaires permettent-elles de défamiliariser la familiarité de la population allochtone et des visiteurs envers le paysage terrestre et marin de la Côte Sud ? Cette contre-cartographie et ces récits numériques peuvent-ils éventuellement permettre aux non-Autochtones de comprendre et de ressentir le territoire des Walbunja différemment, y compris Country, en tant qu’agent et en tant que parent ? Cette expérience peut-elle permettre aux habitants et aux visiteurs non autochtones de cesser de voir la Côte Sud comme un centre touristique et de commencer à le ressentir et à le comprendre du point de vue des Walbunja ?
Les relations et collaborations qui émergent progressivement entre les rangers Walbunja du Batemans Bay Local Aboriginal Land Council et Burrawang Coastal Club démontrent le potentiel de transformation des façons d’être avec le territoire et un mouvement vers une épistémologie de coordination. Comme le souligne Peter Sharpe (Burrawang Coastal Club, communication personnelle), cette collaboration est née d’un désir de maintenir la santé du territoire englobé par le Club. Au fil de leurs échanges lors des sessions de brûlis, les perceptions de Peter Sharpe sur ce que constitue une terre en santé ont changé considérablement. Bien qu’on ne puisse pas nécessairement parler ici de transformation de perspectives ontologiques, Peter Sharpe et le Club acceptent désormais que Country, et non pas les échéanciers rigides établis par les institutions coloniales, détermine quand il faut brûler. Il semble donc que ce partage de connaissances et façons d’être au monde, en personne ou à travers le virtuel, puisse effectivement changer les manières d’être.
Appendices
Remerciements
Ce projet est financé par le programme Indigenous Research Exchange de l’Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS), de la foundation Watervale et du programme Indigenous Languages and Arts de l’Office for the Arts (Gouvernement de l’Australie). Merci à Benoit Éthier, à Éric Chalifoux et aux deux examinateurs externes pour leurs précieux commentaires et suggestions.
Notes biographiques
Annick Thomassin, Ph.D. en anthropologie (Université McGill, 2019) est chercheure et enseignante aux Centre for Heritage and Museum Studies et Fenner School for Environment and Society de l’Australian National University. Elle a plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de l’anthropologie sociale et de l’écologie politique, travaillant sur une gamme de sujets, y compris la (co)gestion des ressources côtières, les pêches autochtones et les pratiques d’intendance environnementale, les perspectives économiques autochtones, les relations autochtones-colons-État, l’intersection des ontologies autochtones et occidentales, et les conceptualisations de la souveraineté. Annick est à la tête des projets Environmental Stewardship Resurgence in Walbunja Country et Reviving Dhurga to better talk with Country: Environmental Custodianship & Disasters sur lesquels se base cet article. annick.thomassin@anu.edu.au
Kim Spurway travaille dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et des urgences humanitaires depuis plus de 25 ans. Ses domaines de recherche comprennent les approches critiques des catastrophes naturelles et des crises humanitaires. Kim a travaillé en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient ainsi que dans les communautés autochtones de la Nouvelle Galles du Sud et de l’Australie Occidentale. Kim est co-chercheuse sur le projet de résurgence de la gérance de l’environnement dans le pays de Walbunja à Mogo, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. K.Spurway@westernsydney.edu.au
Tayla Nye est membre du peuple Walbunja de la nation Yuin et assistante de recherche affiliée au Centre for Heritage and Museum Studies (CHMS), Australian National University. Elle est un membre clé de l’équipe du projet Environmental Stewardship Resurgence in Walbunja Country et Reviving Dhurga to better talk with Country: Environmental Custodianship & Disasters. tayla.a.nye@gmail.com
Adam Nye, Sherrie Nye McCarron, Adam McCarron et Jake Chatfield sont membres du peuple Walbunga de la nation Yuin, assistants de recherche et ranger affiliés au Mogo Local Aboriginal Land Council et Batemans Bay Local Aboriginal Land Council. Ils sont des membres clé de l’équipe des projets Environmental Stewardship Resurgence in Walbunja Country et Reviving Dhurga to better talk with Country: Environmental Custodianship & Disasters.
Notes
-
[1]
Selon le recensement de 2021 de l’Australian Bureau of Statistics (ABS 2021a, 2021b), le pourcentage de la population s’identifiant comme Autochtone pour la localité de Mogo est de 22 % et Batemans Bay 7 %. À l’échelle nationale, les Aborigènes et Insulaires du Détroit de Torres représentent 3,2 % de la population (ABS 2021a, 2021b). Le nombre de personnes s’identifiant spécifiquement comme Walbunja n’est néanmoins pas connu.
-
[2]
Country est un concept aborigène englobant qui définit le territoire comme un monde sensible et intentionnel auxquels les nations aborigènes sont généalogiquement et spirituellement liées. Country, dans les mots d’Adam Nye (ranger Walbunja et contributeur à cet article), est un lien vivant et spirituel ressenti et perçu par ceux qui en sont conscients. La décision de préserver le terme de Country, plutôt que d’opter pour une traduction inexacte telle que territoire, est intentionnelle et a pour objectif d’attirer l’attention sur le fait que pour les Walbunja, Country est plus qu’un espace physique externe mais un être à part entière avec qui l’humain est en relations. Le possessif « leur » est employé pour signifier la relation qu’entretiennent les Walbunja avec Country plutôt que l’idée de « propriété ». Le mot territoire est utiliser dans cet article lorsque nous parlons plus spécifiquement de lieu physique.
-
[3]
En 2019, des changements furent apportés aux conditions associées aux différentes zones du parc marin de Batemans. Il est désormais possible de pratiquer certaines activités de pêche et collecte dans les zones sanctuaires. La pêche au filet pratiquée par les pêcheurs walbunja est néanmoins toujours interdite.
-
[4]
Des amendes de plusieurs milliers de dollars allant jusqu’à des peines d’emprisonnement ont été délivrées aux pêcheurs walbunja au fil des ans (voir Thorpe et Proust 2022).
-
[5]
Les Local Aboriginal Land Councils sont des organisations autonomes communautaires australiennes. Leurs rôles consistent principalement à représenter les Autochtones australiens (les Aborigènes et les insulaires du Détroit de Torres) vivant sur leur territoire notamment en matière de reconnaissance des droits fonciers traditionnels. Les frontières administratives des territoires desservis par chaque Local Aboriginal Land Council ne correspondent généralement aux frontières des territoires traditionnels. Le territoire Walbunja est partagé entre le Mogo Local Aboriginal Land Council et le Batemans Bay Local Aboriginal Land Council.
-
[6]
Les premières équipes de rangers autochtones émergèrent en Australie à partir de 2007 dans le cadre du programme fédéral Working on Country (maintenant connu sous le nom de Programmes de Rangers Indigènes). L’équipe de rangers affiliée aux Mogo et Batemans Bay Local Aboriginal Land Councils est toutefois autofinancée et ne fait pas partie de ce programme.
-
[7]
Pour plus de détails sur la pratique du brûlis (cultural burning) voir The Biggest Estate on Earth par Bill Gammage (2012), Dark Emu par Bruce Pascoe (2018), Fire de Victor Steffensen (2020) et dans le contexte de la Nouvelle-Galles du Sud, lire Bhiamie Williamson (2021).
Médiagraphie
- Australian Bureau of Statistics. 2021a. « Batemans Bay ». 2021 Census Community Profiles https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/community-profiles/2021/ILOC10600201, consulté 22 août 2022.
- Australian Bureau of Statistics. 2021b. « Mogo ». 2021 Census of Population and Housing https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/community-profiles/2021/SAL12671, consulté 22 août 2022.
- Behrendt, Larissa. 2019. « Indigenous storytelling: decolonizing institutions and assertive self-determination: implications for legal practices ». Dans Decolonizing Research: Indigenous Storywork as Methodology. Sous la direction de Jo-Ann Archibald, Q’um Q’um Xiiem, Jenny Bol Jun Lee-Morgan et Jason De Santolo, 175-186. United Kingdom : Bloomsbury Publishing.
- Blaser, Mario. 2013. « Ontological conflicts and the stories of peoples in spite of Europe: Toward a conversation on political ontology ». Current Anthropology 54(5) : 547-568.
- Borrows, John. 2017. « Challenging Historical Frameworks: Aboriginal Rights, The Trickster, and Originalism ». The Canadian Historical Review 98(1) : 114-135.
- Borrows, John. 2018. « Earth-Bound: Indigenous Resurgence and Environmental Reconciliation ». Dans Resurgence and Reconciliation: Indigenous-Settler Relations and Earth Teachings. Sous la direction de Michael Asch, John Borrows et James Tully, 49-82. Toronto : University of Toronto Press.
- Carlson, Bronwyn et Ryan Frazer. 2018. Social media mob: Being Indigenous online. Sydney, NSW : Macquarie University.
- Carlson, Bronwyn et Ryan Frazer. 2021. « Attending to Difference in Indigenous People’s Experiences of Cyberbullying: Toward a Research Agenda ». Dans The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse (Emerald Studies In Digital Crime, Technology and Social Harms). Sous la direction de Jane Bailey, Asher Flynn et Nicola Henry, 145-163. Bingley : Emerald Publishing Limited.
- Chartier, Daniel. 2020. « Renversements décoloniaux de la cartographie de l’Arctique ». Captures 5(1). https://doi.org/10.7202/1073476ar.
- Christie, Michael. 2005. « Aboriginal knowledge traditions in digital environments ». Australian Journal of Indigenous Education 34 : 61-66.
- Clapperton-Richard, Adèle, Lola Montes, Chloé Pelletier et Guillaume Proulx. 2021. Rapport-Synthèse du Séminaire de Cartographies Autochtones 12-14 Mai 2021. École d’études autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
- Coulthard, Glen. S. 2014. Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition. Minneapolis : University of Minnesota Press.
- de Largy Healy, Jessica. 2013. « Yolngu Zorba meets Superman: Australian Aboriginal people, mediated publicness and the culture of sharing on the Internet ». Anthrovision 1(1).
- Donaldson, Susan Dale et Environmental & Cultural Services. 2006. Stage two Eurobodalla Eboriginal cultural heritage study: Stories about the Eurobodalla by Aboriginal People. Public Report.
- Dussart, Françoise et Sylvie Poirier. 2017. Entangled territorialities: negotiating indigenous lands in Australia and Canada. Toronto : University of Toronto Press.
- Egloff, Brian. 2000. « Sea long stretched between’: perspectives of Aboriginal fishing on the south coast of New South Wales in the light of Mason v Tritton ». Aboriginal History 24 : 200-211.
- Ens, Emilie Jane. 2012. « Monitoring outcomes of environmental service provision in low socio-economic Indigenous Australia using innovative CyberTracker technology ». Conservation and Society 10(1) : 42-52.
- Éthier, Benoit. 2020. « Analyzing entangled territorialities and Indigenous use of maps: Atikamekw Nehirowisiwok (Quebec, Canada) dynamics of territorial negotiations, frictions, and creativity ». The Canadian Geographer / Le Géographe canadien 64 : 32-48.
- Éthier, Benoit, Christian Coocoo et Gérald Ottawa. 2019. « Orocowewin Notcimik Itatcihowin: The Atikamekw Nehirowisiw Code of Practice and the Issues Involved in Its Writing ». Potchefstroom Electronic Law Journal 22 : 1-25.
- Gammage, Bill. 2012. The Biggest Estate on Earth: How Aborigines made Australia. Allen & Unwin.
- Goudie Samia et Natalie Davey. 2009. « Hope Vale Digital Storytelling Project Using the Camera: Telling Stories our Way ». 3C Media 5 : 29-48.
- Goulding, Megan et Kate Waters. 2005. Eurobodalla Aboriginal Cultural Heritage Study South Coast New South Wales. Goulding Heritage Consulting Pty Ltd.
- Halder, Severin et Boris Michel. 2018. « Editorial – This is not an Atlas ». Dans This is Not an Atlas: A Global Collection of Counter-cartographies. Sous la direction du Kollectiv Orangotango+, 12-25. Germany : Transcript Verlag.
- Hirt, Irène. 2009. « Cartographies autochtones. Éléments pour une analyse critique ». L’Espace géographique 38(2) : 171-186.
- Hunt, Dallas et Shaun A. Stevenson. 2017. « Decolonizing geographies of power: indigenous digital counter-mapping practices on turtle Island ». Settler Colonial Studies 7(3) : 372-392.
- Kral, Inge. 2010. « Plugged In: Remote Australian Indigenous Youth and Digital Culture ». CAEPR Working Paper 69/2010. Canberra : Centre for Aboriginal Economic Policy Research.
- Kral, Inge. 2014. « Shifting perceptions, shifting identities: communication technologies and the altered social, cultural and linguistic ecology in a remote indigenous context ». Australian Journal of Anthropology 25(2) : 171-189.
- Kramm, Matthias. 2021. « The role of political ontology for Indigenous self-determination ». Critical Review of International Social and Political Philosophy 24(6).
- Langton, Marcia. 2013. « Foreword ». Dans Information Technology and Indigenous Communities. Sous la direction de Lyndon Ormond-Parker, Aaron Corn, Cressida Fforde, Kazuko Obata, Sandy O’Sullivan, v-x. Canberra : AIATSIS Research Publications.
- Lorde, Audre. 2018. The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House. United Kingdom : Penguin Books Limited.
- Louis, Renee Pualani. 2007. « Can You Hear us Now? Voices from the Margin: Using Indigenous Methodologies in Geographic Research ». Geographical Research 45 : 130-139.
- McGurk, Thomas et Sébastien Caquard. 2020. « To what extent can online mapping be decolonial? A journey throughout Indigenous cartography in Canada ». The Canadian Geographer/Le Géographe canadien 64(1) : 49-64.
- Nadasdy, Paul. 1999. « The Politics of TEK: Power and the “Integration” of Knowledge ». Arctic Anthropology 36(1-2) : 1-18.
- National Native Title Tribunal. 2018. The Applicant on behalf of the South Coast People v Attorney General of New South Wales (South Coast People). http://www.nntt.gov.au/searchRegApps/NativeTitleClaims/NTDA%20Extracts/NC2017_003/SNTAExtract_NC2017_003.pdf, consulté le 4 août 2022.
- Pascoe, Bruce. 2018. Dark Emu. Broome, Western Australia : Magabala Books.
- Peluso, Nancy. 1995. « Whose Woods Are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia ». Antipode 27 : 383-406.
- Peterson, Nicolas. 2017. « Is There a Role for Anthropology in Cultural Reproduction? Maps, Mining and the ‘Cultural Future’ in Central Australia Dans Entangled Territorialities: Negotiating Indigenous Lands in Australia and Canada ». Sous la direction de Françoise Dussart et Sylvie Poirier, 235-252. Toronto : University of Toronto Press.
- Poirier, Sylvie. 2021. « « Une carte n’est pas le territoire. » Réflexions sur l’écart entre les conceptions et pratiques étatiques et autochtones de la territorialité ». Dans Rapport-Synthèse du Séminaire de Cartographies Autochtones. Sous la direction de Adèle Clapperton-Richard, Lola Montes, Chloé Pelletier et Guillaume Proulx, 18-21. École d’études autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
- Potter, Sandra. 2020. « Indigenous governance, GIS, and the context-driven modelling of values, concerns and seasonal uses of Country within the Yawuru estate ». Thèse de doctorat, Australian National University.
- Potter, Sandra, Brunce Doran et Dean Mathews. 2016. « Modelling collective Yawuru values along the foreshore of Roebuck Bay, Western Australia using fuzzy logic ». Applied Geography 77 : 8-19.
- Smyth, Luke, Hayley Egan, Rod Kennett et Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies. 2018. Livelihood values of Indigenous customary fishing: Final report to the Fisheries Research and Development Corporation. Canberra.
- Snipp, Matthew C. 2016. What does data sovereignty imply: what does it look like? Dans Indigenous Data Sovereignty: Toward an agenda. Sous la direction de Tahu Kukutai et John Taylor, 39-55. CAEPR Research Monograph N˚ 38. Canberra : ANU Press.
- Steffensen, Victor. 2019. « Putting the people back into Country ». Dans Decolonizing Research: Indigenous Storywork as Methodology. Sous la direction de Jo-Ann Archibald, Q’um Q’um Xiiem, Jenny Bol Jun Lee-Morgan et Jason De Santolo, 224-238. London, United Kingdom : Bloomsbury Publishing.
- Steffensen, Victor. 2020. Fire Country: How Indigenous Fire Management Could Help Save Australia. Hardie Grant Explore.
- Sutton, Peter. 1998a. « Icons of Country: Topographic Representations in Classical Aboriginal Traditions ». Dans The history of cartography, Volume 2, Book 3 : Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies. Sous la direction de David Woodward, David et G. Malcolm Lewis, 353-386. Chicago : The University of Chicago Press.
- Sutton, Peter. 1998b. « Aboriginal Maps and Plans ». Dans The history of cartography, Volume 2, Book 3 : Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies. Sous la direction de David Woodward, David et G. Malcolm Lewis, 387-416. Chicago : The University of Chicago Press.
- Thom, Brian. 2020. « Addressing the Challenge of Overlapping Claims in Implementing the Vancouver Island (Douglas) Treaties ». Anthropologica 62 (2) : 295-307.
- Thom, Brian, Benedict J. Colombi et Tatiana Degai. 2016. « Bringing Indigenous Kamchatka to Google Earth: Collaborative Digital Mapping with the Itelmen Peoples ». Sibirica 15(3) : 1-30.
- Thomassin, Annick. 2019. « Ina Ngalmun Lagau Malu (This Part of the Sea Belongs to Us): Sea Rights and Politics of Co-management in Zenadh Kes (Torres Strait) ». Thèse de doctorat en anthropologie, Université McGill, Montréal.
- Thomassin, Annick, Timothy Neale et Jessica Weir. 2018. « The Natural Hazard Sector’s Engagement with Indigenous Peoples: A Critical Review of Canzus Countries ». Geographical Research 57(2) : 164-177.
- Thorpe, Nakari et Keira Proust. 2022. « Aboriginal man found guilty of fishing offences says he was practising his culture ». ABC South East NSW, 4 août 2022. https://tinyurl.com/45k6hrwz, consulté le 4 août 2022.
- White, John. 2010. « Peas, beans and riverbanks: seasonal picking and dependence in the Tuross Valley ». Dans Indigenous Participation in Australian Economies: Historical and anthropological perspectives. Sous la direction de Ian Keen, 109-126. ANU E-Press.
- Whyte, Kyle Powys. 2020. « Against Crisis Epistemology ». Dans Routledge Handbook for Critical Indigenous Studies. Sous la direction de Brendan Hokowhitu, Aileen Moreton-Robinson, Linda Tuhiwai-Smith , Chris Andersen et Steve Larkin, 52-64. Routledge Handbooks Online.
- Williamson, Bhiamie. 2021. Cultural Burning in New South Wales: Challenges and Opportunities for Policy Makers and Aboriginal Peoples, Centre for Aboriginal Economic Policy Research Working Paper N˚ 139/2021. Australian National University. https://doi.org/10.25911/Q1PY-8E04.
- Woodward, David et G. Malcolm Lewis, dir. 1998. The history of cartography, Volume 2, Book 3: Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies. Chicago : The University of Chicago Press.
- Yates, Amanda Monehu. 2021. « Transforming geographies: Performing Indigenous Māori ontologies and ethics of more than human care in an era of ecological emergency ». New Zealand Geographer 77 : 101-113.
List of figures
Figure 1
Territoire Walbunja (Country). Les frontières de ce territoire ne sont pas rigides
Figure 2
Panneau d’interprétation touristique du belvédère du Cap Melville (promontoire important pour les Walbunja qui donne une vue sur un ensemble sur de leurs sites (ex. l’île Broulee et l’île Barling)). Ce panneau ne fait aucune référence au territoire et sites walbunja
Figure 3
Exercice d’ébauche cartographique par l’équipe de ranger du Mogo Local Aboriginal Land Council
Figures 4, 5 et 6
Aperçu du récit numérique créé dans le cadre de ce projet à partir de la plateforme ArcGIS Storymaps
Figure 7
Certains des sites identifiés par les membres de la communauté ayant pris part à ce projet, compilés par l’équipe de recherche à l’aide d’ArcGIS Storymaps
Figure 8
Plage de Barlings
Figure 9
Activité de brûlis sur les terres du Burrawang Coastal Club en territoire walbunja
Figure 10
Aîné walbunja examinant un amas de coquillage récemment exposé par l’érosion de l’île Broulee
Figure 11
Révéler l’emplacement de certains sites et éléments importants du paysage peut mener à la désacralisation de ces lieux. L’emplacement de ce vieil arbre, important pour les Walbunja, était inscrit sur un panneau routier. Plusieurs visiteurs ont cru bon d’y inscrire leurs noms au couteau