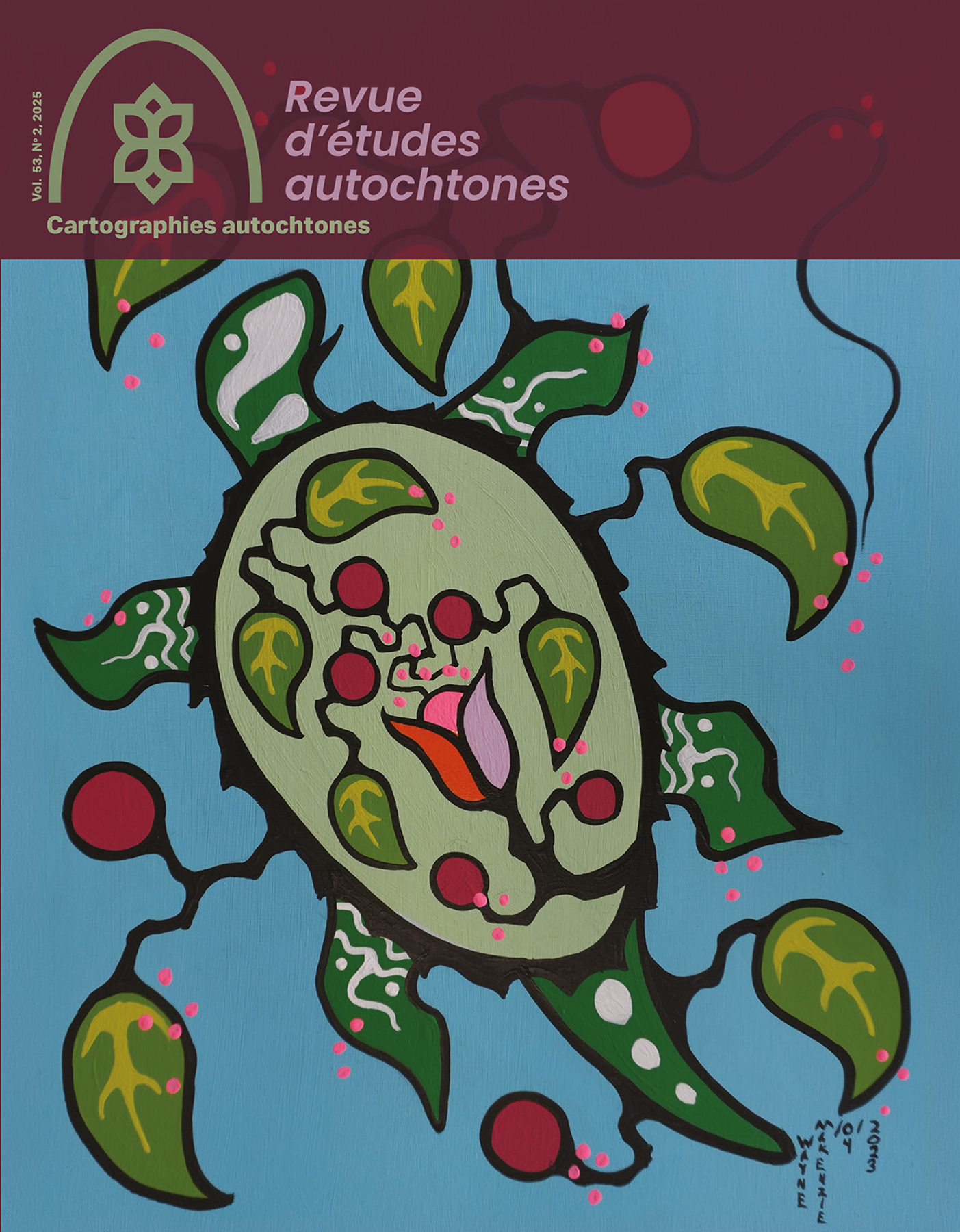Abstracts
Résumé
Au Canada, les Premières Nations accordent une importance croissante aux points de vue des jeunes dans leurs projets d’autodétermination politique et territoriale. Cet article présente un atelier de cartographie participative d’une journée mis en oeuvre dans le cadre du partenariat de recherche « Tshishipiminu » (2011 à 2019) entre des géographes de l’Université Laval et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, autorité politique de la Nation Ilnu de Mashteuiatsh (Québec). L’atelier a été réalisé en avril 2016 avec des jeunes Pekuakamiulnuatsh de 15 et 16 ans pour documenter leurs représentations et pratiques du territoire. L’activité a mobilisé cartes et objets comme supports de discussions collectives et la production de cartes mentales comme outils d’expression des espaces vécus. L’atelier montre que si les jeunes n’ont pas tous et toutes une vision politique de leur territoire, ils et elles continuent généralement à y pratiquer les activités liées à la culture ilnu (chasse, pêche, artisanat, etc.). Les transformations coloniale et industrielle du territoire ne les empêchent pas, en outre, d’éprouver des sentiments d’appartenance à l’égard de celui-ci. Enfin, ils et elles se réapproprient des espaces d’origine coloniale, dont l’ilnu assi (la « réserve »), devenu un marqueur d’identification.
Mots-clés :
- territoire,
- cartographie participative,
- carte mentale,
- jeunes,
- Pekuakamiulnuatsh
Abstract
In Canada, First Nations are placing increasing emphasis on youth perspectives in their political and territorial self-determination projects. This article presents a one-day participatory mapping workshop carried out as part of the ‘Tshishipiminu’ research partnership (2011 to 2019) between geographers at Université Laval and Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, the political authority of the Ilnu Nation of Mashteuiatsh (Quebec). The workshop was conducted in April 2016 with young Pekuakamiulnuatsh aged 15 and 16 to document their representations and practices of the territory. The activity used maps and objects as supports for collective discussions, and sketch mapping as a means of expressing lived spaces. The workshop showed that while not all young people have a political vision of their territory, they generally continue to practise activities linked to Ilnu culture (hunting, fishing, handicraft, etc.). Moreover, the colonial and industrial transformations of the territory have not prevented them from feeling a sense of belonging to it. Finally, they are reappropriating colonial spaces, including ilnu assi (the ‘reserve’) which has become a marker of identification.
Keywords:
- territory,
- participatory mapping,
- sketch mapping,
- youth,
- Pekuakamiulnuatsh
Resumen
En Canadá, las Primeras Naciones conceden cada vez más importancia a los puntos de vista de los jóvenes en sus proyectos de autodeterminación política y territorial. Este artículo presenta un taller de cartografía participativa de un día de duración llevado a cabo en el marco de la asociación de investigación «Tshishipiminu» (2011 a 2019) entre geógrafos de la Universidad Laval y Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la autoridad política de la Nación Ilnu de Mashteuiatsh (Quebec). El taller se celebró en abril de 2016 con jóvenes Pekuakamiulnuatsh de 15 y 16 años para documentar sus representaciones y prácticas del territorio. La actividad utilizó mapas y objetos como base para discusiones colectivas y la producción de mapas mentales como herramientas para expresar los espacios vividos. El taller puso de manifiesto que, si bien no todos los jóvenes tienen una visión política de su territorio, en general siguen practicando actividades vinculadas a la cultura Ilnu (caza, pesca, artesanía, etc.). Las transformaciones coloniales e industriales del territorio no les han impedido sentir que pertenecen a él. Por último, se están reapropiando de espacios de origen colonial, entre ellos el ilnu assi (la «reserva»), que se ha convertido en un marcador de identificación.
Palabras clave:
- territorio,
- cartografía participativa,
- mapa mental,
- jóvenes,
- Pekuakamiulnuatsh
Article body
Tandis que les Premières Nations, les Inuit et les Métis du Canada aspirent toujours davantage à des formes d’autodétermination politique et territoriale, ils mesurent l’importance de tenir compte des points de vue des jeunes[1], qui représentent l’avenir de leurs sociétés (Big-Canoe et Richmond 2014 ; Landry et al. 2020). Or, les jeunes sont souvent négligés dans les études autochtones (Jérôme 2005), et leurs aspirations, leurs représentations et leurs pratiques du territoire sont peu documentées. Les recherches tendent à privilégier les savoirs de ceux et celles que l’on appelle les aînés, considérés dans les sociétés autochtones comme les dépositaires des connaissances relatives au territoire et à la culture.
Ce constat a également été effectué par les Pekuakamiulnuatsh, l’une des onze communautés innues des provinces du Québec et du Labrador[2], aujourd’hui sédentarisée à Mashteuiatsh sur les rives du Pekuakami (« lac plat » en nehlueun, nommé lac Saint-Jean dans la toponymie québécoise). En 2011, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, l’organisation politique et administrative des Pekuakamiulnuatsh (appelée aussi Katakuhimatsheta – le « Conseil des élus »), a conclu un partenariat de recherche avec l’Université Laval[3] intitulé « Tshishipiminu » – « notre rivière » en nehlueun. Les partenaires souhaitaient réfléchir ensemble, en partageant expertises et savoirs, aux relations des Pekuakamiulnuatsh à Nitassinan/Tshitassinu[4], leur territoire. La démarche se voulait participative afin de produire des connaissances utiles aux Pekuakamiulnuatsh, et dans un format accessible à la population ilnu (Desbiens et al. 2014 ; 2015). Les partenaires souhaitaient ainsi s’inscrire dans une démarche de décolonisation des savoirs (Smith 1999). Celle-ci est d’actualité au Canada, où des acteurs autochtones et non autochtones oeuvrent depuis plusieurs décennies pour des pratiques de recherche respectueuses des peuples autochtones, de leurs aspirations, de leurs épistémologies et de leurs ontologies (Asselin et Basile 2012 ; Collignon 2010 ; Louis et Grossman 2020) tout en contribuant au « vivre ensemble » des composantes autochtones et non autochtones de la société (Lévesque 2012).
Le partenariat « Tshishipiminu » a d’abord porté sur les impacts du développement hydroélectrique sur l’occupation ilnu de la rivière Péribonka. Au temps du nomadisme, ce cours d’eau constituait un axe majeur de transport vers l’intérieur du territoire. À partir des années 1950, il est devenu impraticable pour la navigation en canot (sauf sur des tronçons délimités), en raison de la construction d’infrastructures hydroélectriques (barrages et réservoirs) et des effets cumulatifs d’autres activités d’exploitation du territoire (foresterie, drave, villégiature, etc.) (Cardin 2022). Les résultats de « Tshishipiminu » ont mis en évidence que ces transformations paysagères et territoriales sont perçues diversement au sein de la Première Nation, notamment en fonction des générations. Le partenariat a également montré que la colonisation, en superposant les paysages européens aux paysages ilnu, a parfois invisibilisé ces derniers, mais sans nécessairement détruire l’attachement et les liens culturels et politiques des Pekuakamiulnuatsh à leur territoire. Ce constat est corroboré par la communauté innue de Pessamit, dont le territoire, bien que partiellement submergé par l’eau des réservoirs hydroélectriques, demeure vivant dans la mémoire des Pessamiulnuatsh (Gagnon et Desbiens 2018). Cette continuité émotionnelle et culturelle est également observable dans les villes nord-américaines construites par les colons sur des territoires autochtones. Renee Pualani Louis, cartographe kanaka hawai’i, affirme à ce propos : « […] notre lien à la terre n’a pas disparu, mais a été recouvert […] notre responsabilité de prendre soin du territoire où vivaient nos ancêtres ne nous a jamais été enlevée […] elle est toujours là » (Collignon et Hirt 2017). Les paysages autochtones transformés par l’histoire coloniale et le développement industriel ou urbain pourraient ainsi être comparés à des « palimpsestes » dont il faut gratter la surface pour en distinguer les strates : le présent et le passé, le visible et l’invisible, ou encore le matériel et l’immatériel. Les appartenances individuelles et collectives à ce paysage-palimpseste s’expriment à travers la mémoire ou l’oubli, et par des attachements différenciés au territoire, tissés par plusieurs générations d’un même groupe social.
Les études ont aussi montré que les Autochtones ayant migré vers les villes au xxe siècle n’ont pas pour autant perdu leur identité (Wilson et Peters 2005). De plus, ils et elles n’ont cessé de défier les prescriptions identitaires et les assignations à territorialité (Hancock 2008) de l’État colonial, en particulier sa tendance à associer autochtonie et ruralité, et à confiner les Autochtones dans les « réserves[5] ». Au moment de leur création au xixe siècle, ces espaces se sont inscrits dans ce que Cole Harris a décrit comme un « environnement carcéral », marqué par une idéologie de la frontière, déterminant où les Autochtones avaient le droit ou non d’aller (Harris 2004 : 78-79)[6]. Or, ces espaces sont aussi devenus au fil du temps des espaces d’identification et d’appartenance, qui ont même inspiré des écrivains et écrivaines autochtones du Canada (Fontaine 2011) et des États-Unis (Treuer 2014).
En 2016, afin de mieux connaître cette diversité de représentations et de pratiques territoriales, les partenaires de « Tshishipiminu » ont souhaité en savoir davantage sur celles des jeunes. Ils ont travaillé à la réalisation d’un atelier cartographique d’une journée proposé à huit élèves âgés de 15 et 16 ans de l’école secondaire Kassinu Mamu de Mashteuiatsh. L’auteur et les autrices de cet article font partie des adultes ayant animé l’atelier : d’une part, deux géographes, Irène Hirt (Université de Genève) et Caroline Desbiens (Université Laval), codirectrice du partenariat ; d’autre part, deux membres de la Première Nation Ilnu travaillant pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : Hélène Boivin, coordonnatrice des affaires gouvernementales et stratégiques (retraitée) et codirectrice du partenariat, et Michel Nepton, cartographe et conseiller en aménagement du territoire.
La première partie de cet article présente les enjeux territoriaux, politiques et culturels contemporains auxquels les Pekuakamiulnuatsh sont confrontés, et la manière dont le partenariat de recherche s’est inscrit dans ces enjeux. La seconde partie décrit les méthodes de cartographie participative mobilisées durant l’atelier : d’un côté, la réalisation par les élèves et des accompagnants adultes de cartes mentales exprimant leurs espaces vécus[7] ; de l’autre, des conversations autour de cartes et d’objets révélant des pratiques et des représentations territoriales, tout en favorisant l’échange intergénérationnel des savoirs. Ces méthodes seront contextualisées par rapport à la relation des Pekuakamiulnuatsh aux cartes. La troisième partie est dédiée à la discussion des observations tirées de cette journée et à l’analyse des cartes mentales.
La politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh
L’accès au territoire est essentiel à la transmission de notre culture. Tout Pekuakamiulnu doit avoir accès à Tshitassinu [notre territoire] afin de pratiquer ilnu aitun [mode de vie ilnu] avec sa famille ou ses proches, et ainsi léguer son héritage.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2017a : 4
Avant sa constitution en « réserve » en 1856[8], Mashteuiatsh était un lieu de rassemblement d’été pour les peuples autochtones de la région. Les Ilnuatsh y ont été regroupés et sédentarisés avec d’autres nations algonquiennes[9] : des Atikamekw, des Waban-Aki et des Eeyou (Cris), qui toutes s’identifient aujourd’hui comme des Pekuakamiulnuatsh. Jusqu’aux années 1950-1960, certaines familles ilnu effectuaient encore des migrations saisonnières – du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la baie d’Ungava – à pied, en canot et en traîneau : en automne, elles se rendaient au nord dans leurs territoires de chasse ; au printemps, elles revenaient au sud pour se rassembler avec d’autres familles et nations sur les rives des lacs et du fleuve Saint-Laurent. Un grand nombre de Pekuakamiulnuatsh continuent aujourd’hui à pratiquer ilnu aitun, c’est-à-dire les activités liées à l’occupation et à l’utilisation de Nitassinan : chasse, pêche, piégeage et cueillette de plantes et petits fruits à des fins de subsistance, cérémonielles ou sociales. Pour ce faire, ils et elles combinent généralement le travail salarié avec de courts séjours en territoire. Cependant, la sédentarisation forcée, l’altération des liens familiaux par l’envoi des enfants dans les pensionnats et l’exploitation du territoire par des acteurs extérieurs (foresterie, mines, hydroélectricité, loisirs, etc.) sont autant de facteurs cumulatifs affectant la capacité des Pekuakamiulnuatsh à se rendre en territoire par-delà Ilnu assi (l’espace de la « réserve ») pour y pratiquer ilnu aitun, transmettre les connaissances qui y sont associées et cultiver un sentiment d’appartenance et d’identification à Nitassinan (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2017a : 19).
La superficie actuelle de l’Ilnu assi de Mashteuiatsh (16,27 km2) constitue une portion infinitésimale de Nitassinan (environ 112 570 km2) (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2017a : 5). Si les Pekuakamiulnuatsh ont un droit exclusif de chasse et de piégeage dans la réserve de castors[10] de Roberval (env. 60 000 km2), ils et elles sont aussi nombreux à occuper des lots dans la réserve faunique Ashuapmushuan. Celle-ci est appréciée en raison de sa proximité avec Mashteuiatsh et de sa tranquillité liée à son statut de « réserve faunique » (absence d’activités intensives d’exploitation des ressources et de centres de villégiature non autochtones, existence d’une réglementation stricte de la chasse à l’orignal) (fig. 1).
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan exerce son autonomie politique et administrative à l’intérieur d’Ilnu assi. Sur Nitassinan, il encadre la pratique d’ilnu aitun des membres de la communauté en se fondant sur le Code d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu et sur le Code de pratique sur les prélèvements fauniques (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2017b et 2017c). Ces documents permettent d’affirmer et de protéger les droits ancestraux des Pekuakamiulnuatsh, tout en préservant les ressources et en gérant les conflits sur Nitassinan. La cohabitation avec les non-Autochtones constitue une préoccupation majeure pour le Conseil des élus. La présence non autochtone se traduit par des pourvoiries, des terres privées, des districts municipaux ainsi que des zones d’exploitation contrôlée (ZEC, terres publiques destinées à la chasse, à la pêche et aux activités de plein air, notamment, administrées par des organismes à but non lucratif). Dans ce contexte, les 200 camps autochtones et 143 territoires de chasse familiaux de la réserve de castors n’ont qu’un faible impact territorial et environnemental en comparaison avec les 11 000 baux récréatifs détenus par des personnes non autochtones (Hélène Boivin, comm. pers., 7 avril 2016). Un tel enchevêtrement territorial (Dussart et Poirier 2017 ; Éthier 2020) entraîne inévitablement des conflits d’usages.
Figure 1
Carte du Nitassinan de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Depuis 1979, les Pekuakamiulnuatsh négocient un traité moderne avec les gouvernements provincial et fédéral pour obtenir une plus grande autonomie politique et une participation à la gestion du territoire et des ressources naturelles sur Nitassinan (Boivin et al. 2017). Les négociations n’ont jusqu’à présent abouti qu’à la signature, en 2004, d’une Entente de principe d’ordre général (EPOG). Pekuakamiulnuatsh Takuhikan met par ailleurs en oeuvre une politique d’affirmation culturelle et une stratégie d’occupation et d’utilisation du territoire (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2005, 2017a). Le programme Ilnu aitun en fait partie. Créé par le secteur de l’aménagement du territoire du Conseil des élus en 2008, il facilite l’accès au territoire à tous les membres de la communauté. Pour ce faire, il offre des services d’approvisionnement et de transport en territoire, des prêts pour l’achat de matériel de chasse ou la location de camps. De plus, des rassemblements sont organisés deux fois par an sur Nitassinan pour renforcer le sentiment d’appartenance collective : au printemps, lors de la chasse aux oiseaux migrateurs (Pehkupessekau ou Pointe-Racine sur la rivière Mistassini), et à l’automne, lors de la chasse au gros gibier (Ushkui shipi – rivière aux Écorces). Enfin, indépendamment des négociations territoriales, les Pekuakamiulnuatsh sont devenus des partenaires respectés dans différentes instances régionales de planification et de développement territorial, notamment en participant aux activités forestières ou au développement hydroélectrique.
La politique d’affirmation culturelle de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan considère le territoire comme indissociable de la transmission de la culture et des connaissances autochtones. Autrefois, les Ilnuatsh associaient l’éducation en classe à la sédentarisation forcée, aux politiques d’assimilation culturelle conduisant à la « désindianisation » (Miroux 2022) des enfants et au démantèlement de la transmission familiale des savoirs. Aujourd’hui, le domaine de l’éducation fait l’objet d’une réappropriation culturelle. Si la famille demeure le principal vecteur de transmission d’ilnu aitun, l’école joue un rôle non moins important. Elle met l’accent sur l’apprentissage du nehlueun, crucial pour la pratique de la culture et le maintien des liens au territoire (Tipi et Boivin 2020). Depuis l’an 2000, l’école secondaire Kassinu Mamu a mis en place une « école dans le bois » (expression courante chez les Ilnuatsh). Elle encourage les élèves à acquérir savoirs et savoir-faire traditionnels in situ, aux côtés de celles et ceux que les Pekuakamiulnuatsh appellent les « transmetteurs de culture », c’est-à-dire les aînés, les chasseurs et chasseuses ou d’autres personnes expérimentées. Les séjours de plusieurs jours dans le bois se font sur une base volontaire, organisés chaque saison en fonction des activités de chasse et de piégeage. Les jeunes n’ayant pas la possibilité d’aller en forêt avec leur famille ont ainsi un accès garanti à la vie en territoire. Celles et ceux démontrant de solides compétences et connaissances culturelles peuvent devenir « jeunes transmetteurs », en prenant en charge une partie de l’éducation des élèves moins âgés, devenant ainsi de « jeunes ambassadeurs de la culture ilnu » (Delamour 2017 : 70-76). Les six élèves participant à l’atelier de cartographie participative étaient toutes et tous de « jeunes transmetteurs ».
Une diversité de territorialités
Le partenariat de recherche « Tshishipiminu », présenté en introduction, s’est ancré dans la politique d’affirmation culturelle du Conseil des élus. Il a été précédé d’une année d’échanges entre les membres du Comité patrimoine ilnu, Caroline Desbiens et Irène Hirt, pour identifier un sujet permettant « de répondre aux besoins et aspirations des deux parties » (Résolution 2012/05/23, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, lettre d’accompagnement). Ces négociations ont orienté la recherche sur l’histoire de l’occupation ilnu de la rivière Péribonka, à la suite de la construction de quatre barrages hydroélectriques : Chute-du-Diable (1952), Chute-à-la-Savane (1953), Chute-des-Passes (1959) et Péribonka IV (2008), ce dernier étant exploité par la société québécoise Hydro-Québec, les autres par une entreprise privée, l’aluminerie Rio Tinto Alcan. Deux réservoirs – Lac Manouane et Passes-Dangereuses, construits dans les années 1940 – alimentent les barrages.
Les modalités de la recherche ont été discutées par l’ensemble des partenaires autochtones et non autochtones. Le projet s’est d’abord fondé sur des données de la « Grande Recherche », réalisée dans les années 1980 par le Conseil Attikamek-Montagnais (CAM) pour appuyer les négociations territoriales[11], et sur des travaux existants (dont ceux de Charest 1980 ; Courtois 1978 ; Massell 2010). Afin d’actualiser ces données, des entrevues avec des Pekuakamiulnuatsh ont été réalisées. Les partenaires pensaient initialement recruter et rémunérer des personnes de la communauté désireuses de se former aux techniques de l’entrevue semi-directive. À défaut d’avoir pu trouver un candidat ou une candidate autochtone, cette tâche a finalement été effectuée par Irène Hirt, de même que les recherches en archives, notamment auprès de Rio Tinto Alcan.
Le parti pris des partenaires n’était pas de « mener des recherches ‘‘exhaustives’’, mais de trouver des façons ‘‘expressives’’ de présenter l’expérience de la transformation du territoire par le développement hydroélectrique telle que vécue par des membres de la communauté de Mashteuiatsh » (Desbiens et al. 2015 : 4). Le Conseil des élus a aussi exprimé le souhait que le partenariat fasse ressortir la perception ilnu des barrages, et que les résultats soient diffusés prioritairement au sein de la communauté (résolution 2012/05/23). Une exposition de dix panneaux thématiques a donc été montée au Musée ilnu de Mashteuiatsh (novembre 2013-février 2014), puis transportée à Pessamit et à Uashat Mak Mani-Utenam, deux communautés innues situées sur la Côte-Nord, et au musée régional de Sept-Îles. Un recueil reproduisant les panneaux a en outre été diffusé gratuitement dans la communauté de Mashteuiatsh (Desbiens et al. 2104, 2015).
Une première observation issue des résultats de ce projet a porté sur la dimension générationnelle de la perception du développement hydroélectrique. Les Pekuakamiulnuatsh qui ont vu de leurs propres yeux la construction d’un barrage et l’inondation de leurs territoires familiaux disent avoir éprouvé tristesse et souffrance, refusant parfois de se confronter à ces nouveaux « paysages de la peur » (Tuan 2013), où les repères géographiques et affectifs ont disparu. En revanche, certains de leurs enfants ou petits-enfants ont tendance à naturaliser[12] ces paysages hydroélectriques, sans que cela affecte forcément leurs liens au territoire. Un participant à la recherche s’est exprimé à ce sujet :
Le fait d’avoir des barrages, t’as une perte d’attachement parce que tu perds une partie de tes souvenirs. Les générations qui suivent ne sentent pas ça parce qu’elles l’ont pas connue [la rivière]. […] Je dis souvent qu’un barrage, ça fait mal à la génération qui le vit. Les générations qui suivent vont vivre avec ça, y sont habituées
Pekuakamiulnu, né en 1947, interviewé en 2012
De plus, entre le rejet radical et l’acceptation des barrages, les Pekuakamiulnuatsh expriment souvent des attitudes plus nuancées. Certains jeunes, par exemple, tout en regrettant la transformation industrielle du paysage, disent apprécier les perspectives d’emploi offertes par la construction du barrage Péribonka IV ou les activités d’exploitation forestière. Pour eux, c’est un moyen d’acquérir une expérience professionnelle, de gagner leur vie et, selon un participant, de continuer à vivre sur Nitassinan et de maintenir des liens affectifs avec celui-ci.
Une deuxième observation montre que le degré d’attachement à la rivière Péribonka est influencé par l’histoire familiale, laquelle à son tour découle de l’appartenance à l’une ou l’autre des Premières Nations regroupées au xixe siècle à Mashteuiatsh : les familles d’origine nomade pratiquaient la chasse, d’autres familles se dédiaient à l’agriculture et d’autres encore à la commercialisation des fourrures. Il n’est donc guère surprenant que les Pekuakamiulnuatsh les plus affectés par la construction du barrage Péribonka IV soient issus des familles ayant des territoires de chasse dans cette zone, et qui naviguaient encore sur la rivière avant l’inondation du secteur des Fourches (confluence des rivières Manouane et Péribonka), en 2008.
Un dernier constat concerne la distance entre Mashteuiatsh et la rivière Péribonka, en comparaison avec d’autres secteurs de Nitassinan. En effet, la majorité des personnes ayant partagé leur histoire ont déclaré se rendre régulièrement dans des campements et des terrains de piégeage situés dans la réserve faunique d’Ashuapmushuan. Proche de Mashteuiatsh, celle-ci est aisément accessible et donc idéale pour de courts séjours dans le bois (par exemple, en fin de semaine), contrairement à la rivière Péribonka, qui s’avère beaucoup plus éloignée (voir fig. 1). Ces éléments suggèrent que les barrages sur la rivière Péribonka, cumulés aux autres transformations du territoire, ont rendu l’occupation de ce secteur plus difficile.
La colonisation a donc obligé les Pekuakamiulnuatsh à faire face à de nouvelles réalités sociospatiales, correspondant à autant de cycles de déterritorialisations et de reterritorialisations (Raffestin 1986 ; Cardin 2022). Autrement dit, les Pekuakamiulnuatsh ont opposé aux processus de dépossession coloniale des pratiques de résistance et de réappropriation du territoire. Ces observations ont aussi permis de documenter la diversité des rapports ilnu au territoire, en fonction de l’origine ethnique et familiale, de l’âge ou des biographies individuelles. Cette diversité caractérise également d’autres communautés innues : par exemple, dans son livre Kuessipan (2018) – et le film du même nom produit par Myriam Verrault (2019) –, la romancière innue Naomi Fontaine raconte la « multiplicité des possibles » chez les Innus de Uashat mak Mali-Utenam, pour lutter contre la « tendance à mettre tout le monde dans le même panier » (Verreault et Fontaine 2019 : 9).
Ces observations mettent à mal la vision homogénéisante que la société dominante au Québec tend à avoir des peuples autochtones. En outre, à Mashteuiatsh, elles sont importantes pour le Conseil des élus, qui a besoin de connaître les caractéristiques sociales et la nature des liens au territoire des membres de sa communauté, de façon à mieux projeter celle-ci dans l’avenir.
Une cartographie culturelle de Nitassinan
En 2014, le partenariat « Tshishipiminu » s’est poursuivi avec l’objectif d’approfondir la dimension générationnelle des rapports des Pekuakamiulnuatsh à Nitassinan. Les partenaires ont convenu d’explorer les points de vue des jeunes, moins pris en compte que ceux des adultes ou des aînés dans la documentation des savoirs autochtones. Ils ont donc associé l’école secondaire Kassinu Mamu à l’organisation d’un atelier de cartographie participative.
Les Pekuakamiulnuatsh et les cartes
Jusque tard dans le xxe siècle, l’histoire de la cartographie a restreint cette dernière à une perspective occidentalocentrée et aux conventions de la science moderne. Les cartes produites par les sociétés non occidentales étaient perçues comme du « folklore » ou, au mieux, comme des « objets ressemblant à des cartes » (map-like-objects) (Edney 2018 : 68). Les approches de cartographie critique développées à partir des années 1980 ont proposé une conception plus inclusive de la cartographie. Celle-ci s’intéresse à la pluralité des dispositifs cartographiques, c’est-à-dire aux variations historiques et culturelles de l’acte social de codifier et de représenter les savoirs spatiaux (Woodward et Lewis 1998 ; Warhus 1997 ; Johnson et al. 2005 ; Edney 2018).
Cette large perspective de la cartographie permet d’affirmer que les Pekuakamiulnuatsh, à l’instar d’autres peuples nomades, maîtrisaient des savoirs cartographiques sophistiqués. Grâce à leurs compétences en matière d’orientation et de navigation, les Pekuakamiulnuatsh parcouraient des milliers de kilomètres (Hamelin 2003), et leurs connaissances intimes du territoire et de ses écosystèmes ont produit un mode de vie lié à la chasse, en particulier du caribou, dans un climat et un environnement naturel contraignants (Charest 2020). Comme ailleurs dans les Amériques, ces connaissances étaient recherchées par les Européens souhaitant conquérir les régions qui leur étaient inconnues. Ils ont même demandé à certains Innus de leur dessiner des cartes (Vincent 2016 : 101).
Au début du xxe siècle, les Innus, soutenus par l’anthropologue Franck Speck, ont aussi commencé à mobiliser des cartes (au sens restreint du terme cette fois), dans le but de défendre leurs droits territoriaux. Pour cela, ils ont dû adopter le langage, les techniques et les modes de représentation cartographiques des États modernes (Pulla 2016 : 289). Les Innus ont ainsi pratiqué la « contre-cartographie » (Peluso 1995), bien avant qu’elle ne se généralise auprès d’autres peuples autochtones, dans la deuxième moitié du xxe siècle[13]. Plus tard, dans les années 1980, la « Grande Recherche », mise en oeuvre pour négocier des droits territoriaux, a produit des centaines de cartes et le témoignage de plus de 400 individus en lien avec leur utilisation du territoire : portages, campements, zones de chasse, de pêche et de cueillette, terrains de piégeage, lieux de naissance et de mort, etc. Aujourd’hui, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie du savoir-faire de ses propres géographes, urbanistes, cartographes et spécialistes des systèmes d’information géographique (SIG) pour administrer l’Ilnu assi et participer à la gestion des ressources sur Nitassinan. C’est le cas de Michel Nepton, coauteur de ce texte, cartographe pour le compte de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (voir Gagnon 2020 à ce sujet). Quant à Hélène Boivin, elle est familière avec le rôle stratégique des cartes dans les processus politiques, puisqu’elle a participé durant plusieurs décennies aux négociations territoriales de la Nation Ilnu (Boivin et al. 2017).
Figure 2
Salle d’exposition de l’Odyssée des Bâtisseurs avec carte au sol et cartes en papier apportées pour l’atelier
Avec de telles compétences, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan n’a nullement besoin de recourir à des experts externes pour élaborer ses cartes (voir fig. 1). Les partenaires autochtones de « Tshishipiminu » ont toutefois accueilli avec intérêt l’expertise en géographie culturelle des chercheuses non autochtones, utile pour explorer la dimension vécue du territoire des jeunes, ainsi que leurs expériences préalables de cartographie participative dans d’autres contextes autochtones : avec des communautés du peuple mapuche au Chili en ce qui concerne Irène Hirt (2012), et avec des communautés autochtones urbaines du Québec pour Caroline Desbiens (Desbiens et Lévesque 2018 et 2021).
Cartes et objets : des médiateurs de l’espace vécu des jeunes Ilnuatsh
Durant l’atelier d’avril 2016, les cartes ont constitué à la fois des supports iconographiques favorisant l’émergence de savoirs et les résultats du processus participatif (Hirt et Roche 2013). La matinée a été consacrée à encourager les jeunes élèves à parler de leurs pratiques et représentations territoriales à partir d’échanges autour de cartes. Les partenaires ont choisi d’effectuer ces activités à l’Odyssée des Bâtisseurs – musée situé à Alma, la deuxième ville du Saguenay–Lac-Saint-Jean[14] – en raison de la carte hydrologique recouvrant l’intégralité du plancher de la salle d’exposition principale. Elle coïncide en partie avec le Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh (fig. 2, 3 et 4), offrant ainsi la possibilité de déambuler dans un territoire ancestral à échelle réduite. Le fait que cette carte au sol ne représente que des rivières et des lacs, en l’absence d’autres informations, semblait en outre idéal : pour reprendre l’image du « palimpseste », évoquée en introduction, les participants et participantes ilnu pouvaient ainsi identifier des lieux à partir de leurs propres toponymes sans avoir d’abord à gratter la « strate » des noms eurocanadiens.
Il est vrai, par ailleurs, que ce musée, célébrant l’eau comme facteur clé de la croissance économique de la région via l’hydroélectricité et la production d’aluminium, matérialise des formes de colonialité du pouvoir (Quijano 1992). Le nom lui-même (Odyssée des Bâtisseurs) cristallise la vision modernisatrice et capitaliste, dominante au Québec, considérant l’industrialisation et l’urbanisation du territoire comme une évolution « naturelle ». Cette dimension n’a pas été relevée ni commentée par les élèves. En revanche, les jeunes ont fini par se détourner de la carte au sol pour s’intéresser aux cartes en papier amenées par les partenaires de la recherche, dont une carte de la réserve faunique d’Ashuapmushuan et une carte topographique de la région du lac Saint-Jean. En organisant l’atelier, personne n’avait anticipé le fait que le rectangle d’emprise de la carte au sol exclue les secteurs ouest du Nitassinan, dont la réserve d’Ashuapmushuan. Celle-ci, comme déjà mentionné, est très fréquentée par les Pekuakamiulnuatsh en raison de sa proximité avec Mashteuiatsh. Les élèves, ne faisant pas exception à cette tendance, se sentaient donc davantage concernés par les espaces représentés sur ces cartes papier que par ceux de la carte au sol.
Les objets ont également été considérés comme des médiateurs favorisant l’échange d’expériences, de récits et de connaissances sur le territoire. Chaque jeune avait reçu la consigne d’apporter un objet, une photographie ou un dessin jugé significatif de sa relation au territoire. Toutes et tous ont apporté des objets centraux dans la culture ilnu, ce qui a surpris l’un des accompagnateurs, qui s’attendait aussi à voir des objets dénués de signification du point de vue des savoirs traditionnels (par exemple, un téléphone cellulaire). Le contexte de l’atelier, focalisé sur les savoirs ilnu, a certainement orienté implicitement la consigne vers la culture matérielle ilnu. Cette dernière est en effet centrale dans la documentation et la transmission des connaissances culturelles, et l’établissement du lien au territoire et entre générations. En outre, de nombreux objets, volés ou achetés, et conservés dans les musées occidentaux, sont perçus comme des symboles de la colonisation qu’il est nécessaire de se réapproprier (Delamour 2017 : 79). Enfin, la plupart des objets nécessaires à la vie dans le bois au temps du nomadisme ne sont plus essentiels dans le quotidien actuel des Ilnuatsh. Certains objets n’en sont pas moins des symboles identitaires forts, des médiateurs culturels et des dépositaires de mémoire, notamment parce que leur production implique la répétition de gestes techniques et la réactivation de connaissances et de savoir-faire ancestraux (Dubuc 2006 : 36-37). Renvoyant à des personnes et à des événements, les objets facilitent la reconnexion avec l’histoire et le patrimoine culturel.
Dans la deuxième partie de la journée, les jeunes ont réalisé des cartes mentales. En réalité, celles-ci correspondent moins à des cartes qu’à des dessins à main levée, ne respectant pas forcément les conventions de la cartographie scientifique moderne (échelle, orientation, etc.). La carte mentale permet à la personne qui dessine d’extérioriser son univers subjectif (Toureille 2016) et de communiquer sa vision du monde, de sa ville, de son quartier ou encore de son territoire. Elle est une « fenêtre » sur son espace vécu (Frémont 1999 [1976]), ou du moins une traduction de celui-ci, dont on ne comprend pleinement le sens que s’il est expliqué par son auteur ou son autrice. La carte mentale est particulièrement appropriée pour étudier les identités et les territorialités dans une perspective relationnelle (Barth 1998 [1967]) : elle reflète le point de vue d’un individu tout en révélant comment celui-ci se situe par rapport à l’altérité et à l’ailleurs (nous/eux – ici/là-bas). Elle condense des processus d’identification, de différenciation et de catégorisation de soi et des autres, influencés par l’âge, le genre, les origines sociales, etc. (Toureille 2016)
Figure 3
Description de la rivière Péribonka et de son potentiel hydroélectrique « Péribonka (rivière faisant son chemin dans le sable). 547 km. Affluent le plus imposant du lac Saint-Jean avec un débit maximal de 3288 m3/s, il fournit 42 % des apports d’eau du lac. Coulant du nord vers le sud, il alimente quatre centrales hydroélectriques. »
Figure 4
Aînée désignant un lieu sur la carte au sol
Si la carte mentale a été formalisée scientifiquement, entre autres par des géographes et des urbanistes (Gould, White 1992), elle ne correspond pas moins à un geste relativement intuitif, exigeant peu de technicité et de moyens. C’est pourquoi, sans doute, la carte mentale est fréquemment mobilisée par des acteurs communautaires ruraux ou urbains, y compris autochtones, pour qui elle peut constituer un médiateur efficace de la territorialité dans des contextes d’oralité, tout en gardant à l’esprit que certaines personnes ne sont pas à l’aise avec le dessin. En Amérique latine, on parle d’ailleurs de mapa parlante (la « carte qui parle », en espagnol).
Figure 5
Des objets apportés par les jeunes
L’atelier d’Alma
Les élèves, deux jeunes filles et six jeunes hommes, étaient accompagnés de deux aînées ilnu, et de plusieurs autres adultes, dont leur enseignante de nehlueun, un accompagnateur scolaire ainsi que des personnes de Mashteuiatsh ou de l’Université Laval qui ont assuré la logistique (transport, alimentation) ou qui ont participé à l’animation. L’ensemble des activités a été filmé à des fins de documentation, avec l’accord des participantes et participants (Les propos rapportés plus loin entre guillemets sont issus de ces enregistrements.).
Les questions posées en français aux jeunes par les animateurs et animatrices ont été les suivantes : que signifie le territoire pour vous ? quelles sont vos pratiques territoriales ? dans quels lieux réalisez-vous ces pratiques ? qu’avez-vous appris de ces pratiques en relation avec l’histoire, la langue et la culture des Pekuakamiulnuatsh ?
« Que raconte ton objet ? »
Après avoir parcouru la carte au sol et regardé les cartes en papier, les jeunes, assis en cercle, ont présenté leur objet et la signification qu’ils et elles lui attribuaient. À la demande des animateurs et animatrices, les élèves ont ensuite placé leur objet sur la carte topographique en papier de la région du lac Saint-Jean, en racontant leurs territoires de chasse familiaux et les activités réalisées dans le bois : la trappe, la chasse, la pêche, la cueillette, l’artisanat et le respect des animaux chassés.
Les objets apportés, centraux dans la culture ilnu, étaient les suivants : une hache, deux couteaux-croches, une paire de mitaines brodées, des mocassins, des raquettes et un capteur de rêves (fig. 5). Tous, à l’exception du dernier objet, ont une fonction utilitaire dans le bois : « […] J’ai apporté une hache, « ushtashk », a déclaré un jeune homme, […] parce que c’est un objet qui est utile en territoire, tu peux rien faire sans une hache ». Un autre jeune homme a pris des mocassins, « parce que ça [l]’aide à marcher sur le territoire pour aller à la trappe, à la chasse, et chercher d’autres affaires qu[‘il a] besoin pour vivre […].
Un autre, encore, a insisté sur l’utilité des raquettes traditionnelles (asham) pour se déplacer sur la neige : « Je les trouve plus pratiques que les raquettes de ‘‘Blancs’’ [il trace des guillemets avec ses doigts]. Parce qu’y calent vraiment moins […]. Un skidoo, tu peux aller vite, bin loin, mais avec ça, tu peux aller à des places, comme à des collets. »
Plusieurs jeunes ont indiqué qu’un membre de leur famille avait fabriqué l’objet. Pour l’un d’eux, son couteau-croche cristallisait sa relation à son oncle : « Mukutagan. Je l’utilise beaucoup. L’été passé, j’allais tout le temps au site Uashassihtsh[15] pour parler ou travailler avec mon oncle. […] C’est lui qui l’a fait. » L’une des deux jeunes filles (l’autre n’a pas apporté d’objet) a présenté des mitaines brodées avec ces mots : « C’est ma mère qui les a faites, avec la peau d’orignal que mes parents ont tannée, ça représente bien le territoire pour moi. » Hélène Boivin a souligné l’importance d’une telle transmission des savoirs dans un contexte de disparition des techniques artisanales de fabrication des objets.
Si les capteurs de rêves sont issus de la culture anishinaabe, ils ont été adoptés comme symbole autochtone à la suite du mouvement panautochtone des années 1960. Malgré leur production de masse pour le tourisme, ils sont très appréciés des Ilnuatsh comme objet de décoration, marqueur d’identité ou artefact spirituel. C’est un jeune Pekuakamiulnu, qui a grandi à Montréal avant de s’installer à Mashteuiatsh avec sa mère, qui a apporté un capteur de rêves ; il lui rappelle son arrivée dans la communauté et sa satisfaction de l’avoir fabriqué de ses propres mains : « C’est la première affaire artisanale que j’ai faite de toute ma vie. J’étais quand même assez fier, c’est beau. » Sa famille n’ayant pas de territoire de chasse sur Nitassinan, il a placé son capteur de rêves sur la carte, à l’emplacement de sa maison dans l’Ilnu assi, tout en précisant qu’il apprécie particulièrement les sorties scolaires dans le bois.
Un élève s’est montré réticent à l’idée de mettre son objet sur la carte : « Je veux pas le placer, parce que dans le temps, les vrais Innus n’avaient pas de frontières. On pouvait aller où on veut. Je trouve que ça a pas rapport qu’on mette des terrains de même : ça divise les familles. » Michel Nepton, géographe et cartographe ilnu, ayant en outre une excellente connaissance de Nitassinan grâce à son vécu personnel et familial, a rebondi en mettant en perspective deux dimensions du territoire : d’un côté, le territoire politique et stratégique des Pekuakamiulnuatsh, lequel, dans le contexte des revendications territoriales, doit s’adapter aux principes territoriaux de l’État québécois et canadien ; de l’autre, le territoire culturel. « Ce n’est pas le même geste, a-t-il précisé, ce n’est pas que ça t’appartient, mais que t’as un souvenir, que t’as fait telle activité. Le territoire t’interpelle dans tes émotions. C’est différent que de mettre un drapeau, une délimitation. »
« Dessinez votre Nitassinan »
« Dessinez votre Nitassinan » : telle est la consigne reçue par les participants et les participantes de l’atelier pour esquisser leur carte mentale durant l’après-midi. À leur disposition : des feuilles blanches (format lettre), des stylos, des crayons et des tampons (pied, plume, coeur, etc.). Chaque personne a ensuite commenté sa carte. L’exercice était intimidant pour les jeunes, face à leurs camarades et aux adultes attentifs. Il a donc été ponctué de plaisanteries et de rires.
Quelques jours après l’activité, les jeunes ont reçu un livret de photographies de leurs cartes. Dans les mois suivants, celles-ci ont été redessinées à l’aide d’un logiciel informatique par Sophie Kurtness, graphiste et artiste ilnu de Mashteuiatsh, en vue d’une exposition à l’école Kassinu Mamu (automne 2017 – printemps 2018) et au Musée ilnu de Mashteuiatsh (automne 2018). Dans un but de transmission de la langue, des traductions en nehlueun de certaines annotations effectuées par les jeunes ont aussi été ajoutées. Le travail graphique visait à rendre les dessins plus lisibles pour le public de l’exposition. Afin d’éviter qu’il entraîne une transformation ou un lissage de la vision des jeunes, ces derniers ont validé ces versions redessinées. L’exposition était constituée d’une affiche par participant ou participante avec les éléments suivants : une photographie de la personne tenant dans ses mains son dessin original[16] ; un bref commentaire de sa part sur sa carte ; la version redessinée par la graphiste. Nous commenterons dans cet article les dessins originaux des jeunes, en les mettant en perspective avec quelques-unes des cartes des accompagnants et accompagnantes adultes (pour un exemple de carte redessinée, voir fig. 6).
Figure 6
Exemple de carte mentale redessinée par la graphiste Sophie Kurtness (dessin original, voir fig. 13)
Les dessins rendent compte d’espaces vécus à diverses échelles géographiques : deux cartes montrent l’Ilnu assi (la « réserve »), une carte représente les territoires ancestraux hors Ilnu assi, et quatre cartes incluent les deux espaces. Sur les trois cartes des adultes, deux figurent l’ensemble du territoire ancestral, et l’une le secteur dit « des Fourches » (confluence des rivières Péribonka et Manouane).
Limites territoriales
Les dessins réalisés par deux jeunes (fig. 7 et 8) et deux adultes (voir fig. 9 pour l’un d’entre eux) représentent Nitassinan avec les limites territoriales tracées par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le cadre des négociations territoriales avec les gouvernements provincial et fédéral (voir fig. 1). Nous suggérons que cette forme aisément identifiable est la « logo-carte » des Pekuakamiulnuatsh. Selon l’historien Benedict Anderson, (2002), une logo-carte est une représentation d’un territoire étatique reconnaissable grâce à son seul contour cartographique, contribuant à renforcer l’imaginaire de la nation et du territoire. Par extension, la carte des négociations confère une identité cartographique aux Pekuakamiulnuatsh.
Figure 7
Carte avec délimitations territoriales et lieux de rassemblement
Figure 8
Carte avec délimitations territoriales, territoires familiaux et noms de rivière
Figure 9
Le coeur comme métaphore du territoire (carte de Hélène Boivin)
La Figure 7 révèle une conscience particulièrement affirmée de la dimension politique de Nitassinan, son auteur ayant ajouté la mention « territoire de la nation innu de Mashteuiatsh ». Outre « Mashteuiatsh (Pointe-Bleu) », il a représenté les deux lieux de rassemblement saisonniers de la communauté – Pehkupessekau et Ushkui-Shipi –, reconnaissables par le symbole d’une tente rouge. La Figure 8 met l’accent sur les territoires familiaux (« territoire à mon père ; « ancien territoire à mon mushum [grand-père] »).
En commentant son dessin, Hélène Boivin a partagé avec les jeunes la vision qu’elle défend depuis 1995, à travers son implication dans le dossier des négociations territoriales (Boivin et al. 2017) (fig. 9) : « Le Nitassinan, c’est comme notre coeur. C’est à travers lui qu’on vit et que s’exprime le mode de vie des Innus. ». Par cette métaphore du territoire comme coeur et des cours d’eau comme autant de veines alimentant le Pekuakami et/ou d’artères irriguant Nitassinan, elle souligne la dimension vitale du territoire pour la survie collective des Pekuakamiulnuatsh.
Cadre urbain et espaces du quotidien
Le toponyme le plus fréquent dans les cartes mentales des écoliers, quelle que soit l’échelle de représentation, est Mashteuiatsh ou son diminutif « Mashto », qui faisait beaucoup rire les jeunes. Les deux cartes centrées sur Ilnu assi rendent compte d’un environnement urbain construit. L’une a été dessinée par le jeune venu vivre à Mashteuiatsh à l’adolescence. Elle est centrée sur le bâtiment administratif principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et les quatre tipis en pierre sculptée, érigés sur la promenade Ouiatchouan, au bord du lac (fig. 10). L’autre carte insère ces éléments dans un espace plus large, avec le dépanneur (épicerie) Chez Richard, les écoles primaire et secondaire, la piste de sprint, l’église, le musée, les routes, les rues et la voie ferrée traversant Mashteuiatsh (fig. 11).
La mention Chez Richard, présente sur deux cartes (fig. 11 et 12), a montré l’importance de se retrouver dans ce lieu d’approvisionnement de proximité, le seul dans la communauté, si on exclut la station-service, les supermarchés les plus proches étant à Roberval ou à Saint-Prime, soit à une dizaine de kilomètres de la communauté. Un participant (fig. 12) l’a même érigé en point nodal de sa territorialité : « J’ai mis un coeur à côté. C’est un point de repère. Si tu vas à Mashto, tu vas chez Richard. Tout le monde va chez Richard... Un peu plus loin, y a le lac du Milieu. Parce qu’il est entre chez Richard et dans le bois. »
Figure 10
Ilnu assi (« réserve ») de Mashteuiatsh, avec une attention portée sur les bâtiments administratifs de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Figure 11
Centre d’Ilnu assi (« réserve ») de Mashteuiatsh
Vivre dans le bois
Quatre cartes représentent des tentes ou des lieux de campement. Des activités caractéristiques de la vie en territoire et des pratiques liées à ilnu aitun sont dessinées sur trois des cartes qui représentent le territoire à l’échelle de Nitassinan : la pêche, la chasse, la cueillette de baies et le canotage. La Figure 13 a été dessinée par un jeune homme dont la famille se rend régulièrement dans le territoire. Elle montre un espace vécu particulièrement riche quant à la pratique des activités traditionnelles : « C’est la rivière où je fais du canot. C’est ici que j’ai tué mon premier orignal. Plus haut, c’est un lac où on tue des oiseaux. On chasse des oiseaux migrateurs. Et là, c’est un bûché [coupe forestière] où c’est qu’on mange des bleuets. »
Les deux jeunes filles sont les seules à avoir dessiné une carte en équipe (fig. 14). Celle-ci évoque leur voisinage dans le bois : « On a dessiné nos camps. La route avec la ligne jaune au milieu est un point d’accès. C’est la seule qui va en territoire, asphaltée. On la prend quand on se visite. » La proximité des camps sur l’image, symbolisant l’amitié et la complicité entre les deux jeunes filles, était perceptible pendant qu’elles dessinaient à deux mains.
Les éléments relatifs à l’exploitation intensive du territoire – coupes de bois, barrages hydroélectriques, pourvoiries, exploitation forestière, etc. – sont absents sur les représentations des jeunes. Ils sont en revanche explicites sur les cartes de deux accompagnateurs. Le barrage Péribonka IV, notamment, est dessiné par l’un d’entre eux qui a vu le campement de sa famille être inondé par la mise en eau du barrage dans le secteur du portage de la rivière Serpent, au nord du site des Fourches (fig. 15).
Figure 13
Dessin riche en activités et pratiques liées à ilnu aitun
Figure 14
Carte montrant le voisinage de deux jeunes filles dans le bois
De la carte politique à l’expérience vécue du territoire
L’atelier de cartographie participative avait pour objectif de permettre à des jeunes de l’école secondaire de Mashteuiatsh, considérés comme possédant des connaissances significatives de leur culture, de partager leurs représentations et pratiques du territoire.
Premièrement, les méthodes participatives (discussion autour d’objets et de cartes, dessins de cartes mentales) ont favorisé la réflexivité des jeunes quant à leur lien au territoire et aux pratiques d’ilnu aitun, ainsi que le partage de connaissances avec les adultes présents : le sens habituel de la transmission s’en est ainsi trouvé interverti, passant des jeunes vers les adultes, et non inversement. L’atelier, par le seul fait d’avoir existé, a favorisé la réappropriation discursive et symbolique du territoire par les participants et participantes, bien qu’il soit difficile d’en mesurer l’intensité ou d’en évaluer la qualité. Le fait que les objets amenés par les jeunes soient intimement liés à leur famille, et souvent produits par un membre de celle-ci, confirme les observations déjà existantes à ce propos (Delamour 2017 ; Dubuc 2006) : à savoir que les objets de la culture matérielle ilnu sont producteurs de liens, tant avec le territoire qu’entre générations.
Deuxièmement, les dessins suggèrent que les jeunes n’ont pas forcément intériorisé une vision politique de leur territoire. Seuls deux d’entre eux ont dessiné des frontières, correspondant clairement aux contours de Nitassinan tels qu’ils figurent sur la carte des négociations territoriales des Pekuakamiulnuatsh – une « logo-carte » dessinée aussi sur deux des cartes mentales des adultes.
Troisièmement, la représentation des espaces vécus des jeunes montre que leur identification et leur sentiment d’appartenance ne concernent pas exclusivement le « bois ». L’environnement urbain d’Ilnu assi (la « réserve »), dans lequel l’épicerie constitue un point de rencontre nodal, constitue une référence pour plusieurs jeunes. Comme ailleurs en Amérique du Nord, les jeunes Pekuakamiulnuatsh reterritorialisent donc la culture et l’identité ilnu au sein de nouvelles configurations spatiales : entre le Nitassinan et l’Ilnu Assi, ils se font une place – « leur place ». Ce faisant, ils mettent en échec, du moins partiellement, les assignations identitaires et territoriales externes.
Quatrièmement, l’atelier confirme l’idée que les pratiques et représentations territoriales des jeunes dépendent de l’origine de leur famille. « La communauté n’est pas un groupe homogène, c’est un groupe de personnes qui viennent de différents endroits. C’est ce qui fait la richesse de la communauté », a souligné, lors de l’atelier, Hélène Boivin. Enfin, une mise en perspective avec le premier volet du partenariat de recherche « Tshishipiminu » permet d’élargir ces conclusions. Au cours des derniers siècles, les territoires ilnu ont été en constante évolution : entre les vastes espaces du temps du nomadisme d’un côté, et les espaces étriqués de la sédentarisation forcée, ou désarticulés par l’exploitation intensive des ressources de l’autre, de nouveaux territoires voient le jour, faits d’interstices, de réappropriations et de circulations « résurgentes » (Simpson 2018). Malgré les changements du paysage physique, l’attachement identitaire et culturel demeure grâce aux dynamiques d’adaptation, mais aussi de refus ou de négociation propres à chaque génération.
Cela ne revient pas à valider ni à accepter la déstructuration coloniale du territoire, mais à garder à l’esprit que les territorialités sont vivantes et dynamiques : plutôt que de les mesurer à l’aune des pratiques « ancestrales », jugées souvent plus « authentiques », celles des jeunes doivent être soutenues et encouragées, car elles sont la manifestation de la contemporanéité des peuples autochtones (Poirier 2000). Cette contemporanéité s’oppose au « déni de co-évolution » (Fabian 2017) qui, dans les imaginaires coloniaux de la société dominante, relègue les peuples autochtones dans le passé. Les cartes des jeunes ont permis de documenter des espaces, des échelles et des frontières différentes de celles vécues par leurs ancêtres, tout en démontrant la continuité du sentiment d’appartenance et d’identification à leur peuple, leur culture et leur société. Aussi pourrait-on affirmer que chaque génération porte en elle son propre territoire. Comme le suggèrent les cartes produites par les jeunes, c’est bien cette action – individuelle, collective et surtout intergénérationnelle – qui permet de projeter les Pekuakamiulnuatsh dans le futur.
Figure 15
Carte représentant l’ennoiement d’un campement familial sur le portage de la rivière Serpent
Appendices
Remerciements
Cette recherche a bénéficié du soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH #890-2014-0038). Nous tenons à remercier Justine Gagnon, Paul-Antoine Cardin, Louise Siméon, Jimmy Siméon, Huguette Vollant et Mendy Bossum-Launière, qui ont pris en charge la logistique, l’animation de l’atelier, la traduction des termes en nehlueun (la langue des Ilnuatsh) et la captation vidéo des activités. Nous exprimons également toute notre gratitude aux jeunes, aux aînées, aux accompagnateurs et aux représentants de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ayant généreusement participé à l’atelier : cet article est le fruit de vos partages et savoirs, et il vous est dédié. Enfin, nous remercions les évaluateurs ou évaluatrices de cet article pour leurs précieux commentaires.
Notes biographiques
Irène Hirt est professeure au Département de géographie et environnement de l’Université de Genève depuis 2018, où elle dirige la maîtrise en géographie politique et culturelle. Entre 2010 et 2013, elle a été boursière Marie Curie à l’Université Laval. Elle a ensuite été chercheure titulaire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France de 2015 à 2018. Depuis les années 2000, elle participe à des projets collaboratifs avec des partenaires autochtones s’inscrivant dans des processus de réappropriation du territoire (Québec et Chili). Ses principaux articles traitent des enjeux politiques, territoriaux et épistémologiques de la cartographie pour les peuples autochtones. Elle a codirigé des numéros thématiques sur ce sujet dans les revues Justice spatiale/Spatial justice et Le Géographe canadien/The Canadian Geographer. Elle a codirigé avec B. Debarbieux l’ouvrage collectif Politiques de la carte (éditions ISTE Group), lequel paraîtra aussi en 2022 sous le titre The Politics of Mapping chez Wiley. irene.hirt@unige.ch
Caroline Desbiens est professeure au Département de géographie de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Patrimoine et tourisme autochtones. Ses recherches portent sur la mémoire et le sens des lieux, les relations interculturelles et la mise en valeur des patrimoines territoriaux dans le nord du Québec, en lien avec le développement des ressources. Parmi ses projets actuels, elle collabore avec les Innus (Lac-Saint-Jean et Côte-Nord) pour documenter les sites culturels touchés par la construction de barrages hydroélectriques. Elle s’intéresse aussi à la toponymie, aux savoirs et pratiques des femmes et à la visibilité des Autochtones dans le paysage Québécois, incluant les milieux urbains. C. Desbiens a été professeure invitée à l’Université de Bergame et de Bordeaux, conseillère scientifique au Musée de la Civilisation, et commissaire à la Commission de toponymie du Québec. Son livre Power from the North: Territory, identity and the culture of hydroelectricity in Quebec (UBC Press 2013) est paru en français aux Presses de l’Université Laval en 2015. Caroline.Desbiens@ggr.ulaval.ca
Hélène Boivin est originaire de la communauté de Mashteuiatsh (lac Saint-Jean) et est membre de la Nation des Pekuakamiulnuatsh. Elle a fait ses études en sciences sociales à l’Université du Québec à Chicoutimi. Au cours des 35 dernières années, elle a oeuvré dans plusieurs domaines en milieu autochtone : santé mentale, culture, muséologie, arts, emploi et formation, développement économique et politique. Elle est actuellement coordonnatrice aux relations gouvernementales et stratégiques au bureau de soutien politique de sa communauté. Depuis le 25 mai 2019, elle est également présidente élue de la Commission Tipelimitishun (« se gouverner soi-même »), chargée de consulter les membres de sa nation sur le contenu d’un projet de constitution, de rédiger un projet et de le soumettre en référendum. Très impliquée dans son milieu, elle a fait partie de plusieurs associations, dont celle du Parc sacré, pour lequel elle a initié la réalisation et la publication du recueil Savoirs des Pekuakamiulnuatsh sur les plantes médicinales. Elle a également collaboré à l’écriture de divers articles scientifiques. helene.boivin@mashteuiatsh.ca
Michel Nepton est originaire de la communauté de Mashteuiatsh en bordure des rives du Pekuakami ou lac Saint-Jean. Il a étudié en tourisme ainsi qu’en foresterie et en géomatique appliquée avant d’être diplômé en géographie de l’Université du Québec à Chicoutimi. Il occupe le poste de conseiller en aménagement du territoire au sein de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans la direction Gestion Tshitassinu. Au cours des années, il a participé à des travaux portant sur l’occupation et l’utilisation historique et contemporaine du territoire par les Pekuakamiulnuatsh. michel.nepton@mashteuiatsh.ca
Notes
-
[1]
La catégorie « jeune », définie diversement selon les contextes, renvoie dans cet article à des personnes âgées entre 15 et 16 ans, encore scolarisées.
-
[2]
Les Pekuakamiulnuatsh utilisent la graphie invariable ilnu, non francisée, contrairement à la forme innue utilisée sur la Côte-Nord. Un membre de la communauté ilnu de Mashteuiatsh est un ilnu ou Pekuakamiulnu (pluriel : Ilnuatsh ou Pekuakamiulnuatsh). Les Innus étaient autrefois appelés « Montagnais ». Le nehlueun est un dialecte de l’innu-aimun (langue des Innus), parlé par les Pekuakamiulnuatsh.
-
[3]
Le partenariat a émergé d’une collaboration entre le Comité patrimoine ilnu (CPI) – qui relevait à l’époque du secteur Patrimoine, culture et territoire (PCT) de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – et l’Université Laval, dans le cadre de l’ARUC (Alliance de recherche universités-communautés) « Tetauan / Habiter le Nitassinan Mak Innu Assi », financée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada. Entre 2015 et 2019, le partenariat « Tshishipiminu » a été renouvelé grâce à une « subvention de développement de partenariat » du CRSH (#890-2014-0038).
-
[4]
Nitassinan/Tshitassinu : noms donnés par les Ilnuatsh à leur territoire ancestral, signifiant « notre terre, notre territoire ». Nitassinan est utilisé pour s’adresser à des personnes ne faisant pas partie de la nation ilnu, Tshitassinu lorsque les Ilnuatsh parlent entre eux (Tshi- réfère au « nous inclusif » et Ni- au « nous exclusif »). En géographie, la « territorialité » désigne l’ensemble des relations (culturelles, politiques, économiques…) établies par une société à son espace (Raffestin 1986), médiées par des pratiques et des représentations ; la territorialisation étant considérée ici comme l’ensemble des processus de construction sociale du territoire.
-
[5]
Les « réserves » sont les portions de terres sur lesquelles, au Canada et aux États-Unis, les peuples autochtones ont été sédentarisés, le plus souvent contre leur volonté, à partir du xixe siècle. Au Canada, le mot « réserve » est inscrit dans la Loi sur les Indiens (1876), toujours en vigueur.
-
[6]
Pour un portrait global des « réserves » au Québec, voir Dacquet 2022.
-
[7]
La notion d’« espace vécu » fait référence à l’ensemble des lieux fréquentés par une personne ou un groupe social, aux relations sociales se déployant dans ces lieux ainsi qu’aux valeurs exprimant un attachement à ces lieux (Frémont 1999 [1976]).
-
[8]
Les terres de Mashteuiatsh (anciennement Pointe-Bleue ou Ouiatchouan) ont été attribuées aux Autochtones du lac Saint-Jean par la Couronne, en vertu de l’Acte pour mettre à part certaines étendues de terre pour l’usage de certaines tribus de sauvages dans le Bas-Canada de 1851 (Villeneuve 1984 : 25-26).
-
[9]
Les peuples algonquiens constituent une famille linguistique.
-
[10]
Les réserves de castors ont été créées par le gouvernement du Québec entre 1932 et 1954 pour protéger les populations de castors. Seuls les Autochtones et les Inuit ont le droit d’y chasser et d’y trapper. La réserve de Roberval (1951) est divisée en 143 terrains familiaux, sous la responsabilité d’un katipelitak (gardien ou gardienne d’un terrain) et la supervision de la direction des Droits et protection du territoire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
-
[11]
En 1975, les Attikameks et les Innus ont fondé ensemble le CAM. Jusqu’à sa dissolution en 1994, son objectif était de promouvoir les droits des deux nations dans le cadre de la négociation territoriale menée avec les gouvernements fédéral et provincial. La « Grande Recherche » visait à documenter et à administrer la preuve de l’occupation et de l’utilisation autochtone du territoire.
-
[12]
Un tel constat a également été observé au Chili, où des plantations de pins et d’eucalyptus, essences d’arbres importées, sont parfois « naturalisées » par les habitants et habitantes (Aliste et al. 2018).
-
[13]
L’adoption de la cartographie étatique par les peuples autochtones, depuis les années 1960, produit des effets oscillant, selon les contextes, entre empowerment et effets indésirables (Corbet et al. 2020). Ces effets résultent entre autres de l’impératif de traduire les manières-d’être-au-monde autochtones dans la conception euclidienne de l’espace (Rundstrom 1995) ou dans les termes de la « grammaire territoriale » de l’État moderne (Gros et Dumoulin-Kervran 2011). Cette « domestication étatique » (Bryan et Wainwright 2009) est souvent considérée par les peuples autochtones comme une nécessité pour « exister sur la mappemonde » (Hirt et Desbiens 2020).
-
[14]
Ce musée, créé en 2004, est géré par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Le musée n’a fait que prêter l’espace, n’intervenant aucunement dans les activités de l’atelier.
-
[15]
Uashassihtsh : site de transmission culturelle à Mashteuiatsh, également utilisé pour organiser des événements tels que le rassemblement d’été.
-
[16]
Pour préserver l’anonymat des jeunes, encore mineurs en 2016, ces photos ne sont pas reproduites ici. Toutes les cartes mentales sont publiées ici avec l’autorisation des personnes concernées et de leurs parents.
Références citées
- Aliste, Enrique, Mauricio Folchi et Andrés Núñez. 2018. « Discourses of Nature in New Perceptions of the Natural Landscape in Southern Chile ». Frontiers in Psychology 9 (art. no 1177) : 1-16.
- Anderson, Benedict. 2002. L’Imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. Paris : La Découverte.
- Asselin, Hugo et Suzy Basile. 2012. « Ethique de la recherche avec les peuples autochtones : qu’en pensent les principaux intéressés ? » Ethique publique 14(1) : 333-345.
- Barth, Fredrik, dir. 1998. Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Reissued. Long Grove, Ill : Waveland Press.
- Bellier, Irène et Veronica González-González. 2015. « Peuples autochtones. La fabrique onusienne d’une identité symbolique ». Mots. Les langages du politique 108 : 131-150.
- Big-Canoe, Katie et Chantelle A.M. Richmond. 2014. « Anishinabe youth perceptions about community health: Toward environmental repossession ». Health & Place 26 : 127-135.
- Boivin, Hélène, Irène Hirt et Caroline Desbiens. 2017. « Les droits au territoire de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Entrevue avec Hélène Boivin/The Right to the Pekuakamiulnuatsh First Nation’s Territory. Interview with Hélène Boivin ». Traduit par Sharon Moren. Justice spatiale/Spatial justice JSSJ, no 11. http://www.jssj.org/article/les-droits-au-territoire-de-la-premiere-nation-des-pekuakamiulnuatsh-entrevue-avec-helene-boivin-membre-de-la-premiere-nation-des-pekuakamiulnuatsh-impliquee-dans-le-dossier-de-la-negociation-terri/.
- Cardin, Paul-Antoine. 2022. « Pelipaukau Shipi : géographie des effets cumulatifs du développement industriel selon les savoirs et territorialités des Pekuakamiulnuatsh ». Thèse de doctorat en géographie, Québec : Université Laval. http://hdl.handle.net/20.500.11794/102384.
- Charest, Paul. 1980. « Les barrages hydro-électriques en territoire montagnais et leurs effets sur les communautés amérindiennes ». Recherches amérindiennes au Québec IX(4) : 323-337.
- Charest, Paul. 2020. Des tentes aux maisons : la sédentarisation des Innus. Québec : Les Éditions GID.
- Collignon, Béatrice. 2010. « L’éthique et le terrain ». L’Information géographique 74(1) : 63-83.
- Collignon, Béatrice et Irène Hirt. 2017. « Les peuples autochtones et la justice spatiale. Un entretien avec Renee Louis Pualani/Indigenous Peoples and Spatial Justice. An Interview with Renee Louis Pualani ». Traduit par Carole Cancel. Justice spatiale/Spatial justice JSSJ, no 11. http://www.jssj.org/article/les-peuples-autochtones-et-la-justice-spatiale-un-entretien-avec-renee-louis-pualani/.
- Corbett, Jon, Jeff Hackett, Rachel Olsen et Steve DeRoy. 2020. « Indigenous Mapping ». Dans International Encyclopedia of Human Geography. Sous la direction de Audrey Kobayashi, 217-221. Amsterdam : Elsevier.
- Courtois, Gilbert. 1978. « Étude sur l’impact des barrages hydro-électriques sur les terrains de chasse des Montagnais du Lac Saint-Jean pour le conseil Attikamek-Montagnais. » Musée de Mashteuiatsh.
- Dacquet, Benjamin. 2022. « Des territoires dans le territoire : portrait géohistorique de la création des réserves autochtones au Québec ». Maîtrise en sciences géographiques - avec mémoire, Québec: Université Laval. http://hdl.handle.net/20.500.11794/102926.
- Delamour, Carole. 2017. « « S’il faut rapatrier tout ce qui est sacré, c’est la terre qui va venir à nous ». Le processus de rapatriement des objets culturels et sacrés des Ilnuatsh de Mashteuiatsh, au Québec ». Thèse de doctorat en anthropologie, Montréal/Paris : Université de Montréal/Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. http://hdl.handle.net/1866/20409.
- Desbiens, Caroline, Irène Hirt et Comité Patrimoine Ilnu. 2015. « Développement industriel et négociations territoriales au Canada : défis et enjeux d’une nouvelle forme de traité ». Dans Terres, territoires, ressources politiques, pratiques et droits des peuples autochtones. Sous la direction de Irène Bellier, 191-208. Paris : L’Harmattan.
- Desbiens, Caroline, Irène Hirt et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Comité Patrimoine Ilnu. 2014. « ‘Il ne faut pas avoir peur de voir petit’: l’acclimatation engagée comme principe de recherche en contexte autochtone ». Dans Boîte à outils des principes de la recherche en contexte autochtone : éthique, respect, équité, réciprocité, collaboration et culture. Sous la direction de Nancy Gros-Louis, Karine Gentelet et Suzy Basile, 69-75. Québec : Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Centre de recherche en droit public, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/enjeux_ethique-recherche-article_contributions.pdf?sfvrsn=2.
- Desbiens, Caroline et Carole Lévesque. 2018. « Territoires autochtones ». Dans Le Québec d’une carte à l’autre. Sous la direction de Yves Brousseau et Guy Mercier, 20-21. Québec : Presses de l’Université Laval.
- Desbiens, Caroline et Carole Lévesque. 2021. « ‘Villes en vue’ : nouvelles géographies culturelles de l’autochtonie au Québec, Canada ». Dans Autochtonies : Regards croisés sur les territorialités et les territoires des peuples autochtones. Sous la direction de Éric Glon et Bastien Sepúlveda, 343-358. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
- Dubuc, Elise. 2006. « De la forêt au musée, aller et retour. La culture matérielle innue ». Cap-aux-Diamants 85 : 36-40.
- Dussart, Françoise et Sylvie Poirier, dir. 2017. Entangled territorialities: negotiating indigenous lands in Australia and Canada. Toronto, Buffalo, London : University of Toronto Press.
- Edney, Matthew. 2018. « Map history: discourse and process ». Dans The Routledge handbook of mapping and cartography. Sous la direction de Alexander Kent et Peter Vujakovic, 68-79. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York : Routledge.
- Éthier, Benoit. 2020. « Analyzing entangled territorialities and Indigenous use of maps: Atikamekw Nehirowisiwok (Quebec, Canada) dynamics of territorial negotiations, frictions, and creativity ». The Canadian Geographer / Le Géographe canadien 64(1) : 32-48.
- Fabian, Johannes. 2017. Le temps et les autres : comment l’anthropologie construit son objet. Toulouse : Anacharsis.
- Fontaine, Naomi. 2011. Kuessipan : à toi. Montréal : Mémoire d’encrier.
- Frémont, Armand. 1999 [1976]. La région, espace vécu. Paris : Flammarion.
- Gagnon, Justine. 2020. « De la carte au territoire : Portée et usages des outils cartographiques au sein de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Entrevue avec Michel Nepton, membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et conseiller en aménagement du territoire ». The Canadian Geographer / Le Géographe canadien 64(1) : 10-19.
- Gagnon, Justine et Caroline Desbiens. 2018. « Mapping memories in a flooded landscape: A place reenactment project in Pessamit (Quebec) ». Emotion, Space and Society 27 (mai) : 39-51.
- Gros, Christian et David Dumoulin Kervran, dir. 2011. Le multiculturalisme « au concret » : un modèle latino-américain. Paris : Presses Sorbonne nouvelle.
- Hamelin, Louis-Edmond. 2003. « L’Imaginaire des Grands Voyages indiens au Québec ». Rabaska 1 : 43-59.
- Hancock, Claire. 2008. « Décoloniser les représentations : esquisse d’une géographie culturelle de nos “Autres” ». Annales de géographie 660-661(2-3) : 116-128.
- Harley, Brian. 1988. « Maps, Knowledge, and Power ». Dans The Iconography of Landscape: essays on the symbolic representation, design and use of past environments. Sous la direction de Denis Cosgrove et Daniel Stephen, 277-312. Cambridge : Cambridge University Press.
- Hirt, Irène. 2012. « Mapping Dreams/Dreaming Maps: Bridging Indigenous and Western Geographical Knowledge ». Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization 47(2) : 105-120.
- Hirt, Irène et Caroline Desbiens. 2020. « Exister sur la mappemonde: Cartographies autochtones ». Techniques & culture, no 74 (octobre) : 216-217.
- Hirt, Irène et Stéphane Roche. 2013. « Cartographie participative ». Dans Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation. Sous la direction de I. Casillo, R. Barbier, L. Blondiaux, F. Châteauraynaud, J.-M. Fourniau, R. Lefebvre, C. Neveu, et D. Salles. Paris : GIS Démocratie et Participation. http://www.dicopart.fr/fr/dico/cartographie-participative.
- Jérôme, Laurent. 2005. « Jeunes autochtones : espaces et expressions d’affirmation ». Recherches amérindiennes au Québec 35(3) : 3-6.
- Johnson, Jay T, Renee Louis Pualani et Albertus Hadi Pramono. 2005. « Facing the future: encouraging critical cartographic literacies in indigenous communities ». ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 4(1) : 80-98.
- Landry, Véronique, Hugo Asselin et Carole Lévesque. 2020. « Lien au territoire selon les générations chez les Anicinapek et les Cris ». Organisations & Territoires 29(1) : 125-138.
- Lévesque, Carole. 2012. « La coproduction des connaissances en sciences sociales ». Dans L’Etat du Québec 2012. Sous la direction de Miriam Fahmy, 290-296. Montréal : Boréal.
- Louis Pualani, Renee et Zoltán Grossman. 2020. « Indigenous Methods and Research with Indigenous communities ». Dans Research ethics for human geography. Sous la direction de Helen F. Wilson et Jonathan Darling, 143-156. Thousand Oaks : SAGE.
- Massell, David. 2010. Quebec hydropolitics: The Peribonka concessions of the Second World War. Montréal : McGill-Queen’s University Press.
- Miroux, Franck. 2022. « Les pensionnats indiens du Canada et le rétablissement d’une indianité volée : de l’historiographie au récit de fiction ». Thèse de doctorat en études anglophones, Toulouse : Université Toulouse le Mirail. https://theses.hal.science/tel-03693160/.
- Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 2005. Politique d’affirmation culturelle des Pekuakamiulnuatsh. Mashteuiatsh, Commission consultative sur la culture. https://www.mashteuiatsh.ca/bureau-politique-1/politique-daffirmation-culturelle-des-pekuakamiulnuatsh.html.
- Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 2017a. « Stratégie d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu ». Mashteuiatsh. https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/bureau/pdf/StrategieOccupationUtilisationTshitassinu.pdf.
- Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 2017b. « Code d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu no 2017-01 ». Mashteuiatsh. https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/bureau/pdf/201701CodeOccupationUtilisationTshitassinu.pdf.
- Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 2017c. « Code de pratique sur les prélèvements fauniques no 2017-03 ». Mashteuiatsh. https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/bureau/pdf/201703CodePratiquePrelevementsFauniques.pdf.
- Peluso, Nancy Lee. 1995. « Whose woods are these? Counter-mapping forest territories in Kalimantan, Indonesia ». Antipode 27(4) : 383-406.
- Poirier, Sylvie. 2000. « Contemporanéités autochtones, territoires et (post)colonialisme ». Anthropologie et Sociétés 24 (1) : 137-153.
- Pulla, Siomonn P. 2016. « Critical Reflections on (Post)colonial Geographies: Applied Anthropology and the Interdisciplinary Mapping of Indigenous Traditional Claims in Canada during the Early 20th Century ». Human Organization 75(4) : 289-304.
- Quijano, Aníbal. 1992. « Colonialidad y modernidad/racionalidad ». Perú Indígena 13(29) : 11-20.
- Raffestin, Claude. 1986. « Ecogenèse territoriale et territorialité ». Dans Espaces, jeux et enjeux. Sous la direction de Franck Auriac et Roger Brunet, 172-185. Paris : Fayard-Fondation Diderot.
- Rundstrom, Robert. 1995. « GIS, indigenous peoples, and epistemological diversity ». Cartography and Geographic Information Systems 22(1) : 45-57.
- Simpson, Leanne Betasomosake. 2018. Danser sur le dos de notre tortue. Montréal : Nota Bene [Varia].
- Thongchai Winichakul. 2009. Siam mapped: A history of the geo-body of a nation. Nachdr. Honolulu : Univ. of Hawaii Press.
- Tipi, Şükran et Hélène Boivin. 2020. « Territorialité, langue, toponymie et traité chez les Pekuakamiulnuatsh ». Anthropologica 62 : 276-294.
- Toureille, Étienne. 2016. « Cartes mentales et autres techniques projectives visuelles ». Dans Les outils qualitatifs en géographie : méthodes et applications. Sous la direction de Marianne Morange et Camille Schmoll, 117-141. Malakoff : Armand Colin.
- Treuer, David. 2014. Indian roads. Un voyage dans l’Amérique indienne. Traduit par Danièle Laruelle. Paris : Albin Michel.
- Tuan, Yi-fu. 2013. Landscapes of fear. Minneapolis : University of Minnesota Press.
- Verreault, Myriam et Naomi Fontaine. 2019. Entretien avec Myriam Verreault (réalisatrice-scénariste) et Naomi Fontaine (co-scénariste et auteur du livre Kuessipan). Dossier de presse. Ciné-Sud Promotion, https://cinesudpromotion.com/fr/tous-les-films/98-films-presse/373-kuessipan.
- Villeneuve, Larry. 1984. « Historique des réserves et villages indiens du Québec ». Affaires indiennes et du nord Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2017/aanc-inac/R5-311-1984-fra.pdf.
- Vincent, Sylvie. 2016. « ‘Chevauchements’ territoriaux : Ou comment l’ignorance du droit coutumier algonquien permet de créer de faux problèmes ». Recherches amérindiennes au Québec 46(2-3) : 91-103. https://doi.org/10.7202/1040438ar.
- Wainwright, Joel et Joe Bryan. 2009. « Cartography, territory, property: Postcolonial reflections on indigenous counter-mapping in Nicaragua and Belize ». Cultural geographies 16(2) : 153-178.
- Warhus, Mark. 1997. Another America: Native American maps and the history of our land. 1st St. Martin’s Griffin ed. New York: St. Martin’s Griffin.
- Wilson, Kathi et Evelyn J Peters. 2005. « “You can make a place for it”: remapping urban First Nations spaces of identity ». Environment and Planning D: Society and Space 23(3) : 395-413.
- Woodward, David et G. Malcolm Lewis, dir. 1998. « Introduction ». Dans The History of Cartography, Vol. 2, Book 3, Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies, 1-10. Chicago; London : The University of Chicago Press.
List of figures
Figure 1
Carte du Nitassinan de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Figure 2
Salle d’exposition de l’Odyssée des Bâtisseurs avec carte au sol et cartes en papier apportées pour l’atelier
Figure 3
Description de la rivière Péribonka et de son potentiel hydroélectrique « Péribonka (rivière faisant son chemin dans le sable). 547 km. Affluent le plus imposant du lac Saint-Jean avec un débit maximal de 3288 m3/s, il fournit 42 % des apports d’eau du lac. Coulant du nord vers le sud, il alimente quatre centrales hydroélectriques. »
Figure 4
Aînée désignant un lieu sur la carte au sol
Figure 5
Des objets apportés par les jeunes
Figure 6
Exemple de carte mentale redessinée par la graphiste Sophie Kurtness (dessin original, voir fig. 13)
Figure 7
Carte avec délimitations territoriales et lieux de rassemblement
Figure 9
Le coeur comme métaphore du territoire (carte de Hélène Boivin)
Figure 10
Ilnu assi (« réserve ») de Mashteuiatsh, avec une attention portée sur les bâtiments administratifs de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Figure 11
Centre d’Ilnu assi (« réserve ») de Mashteuiatsh
Figure 13
Dessin riche en activités et pratiques liées à ilnu aitun
Figure 14
Carte montrant le voisinage de deux jeunes filles dans le bois