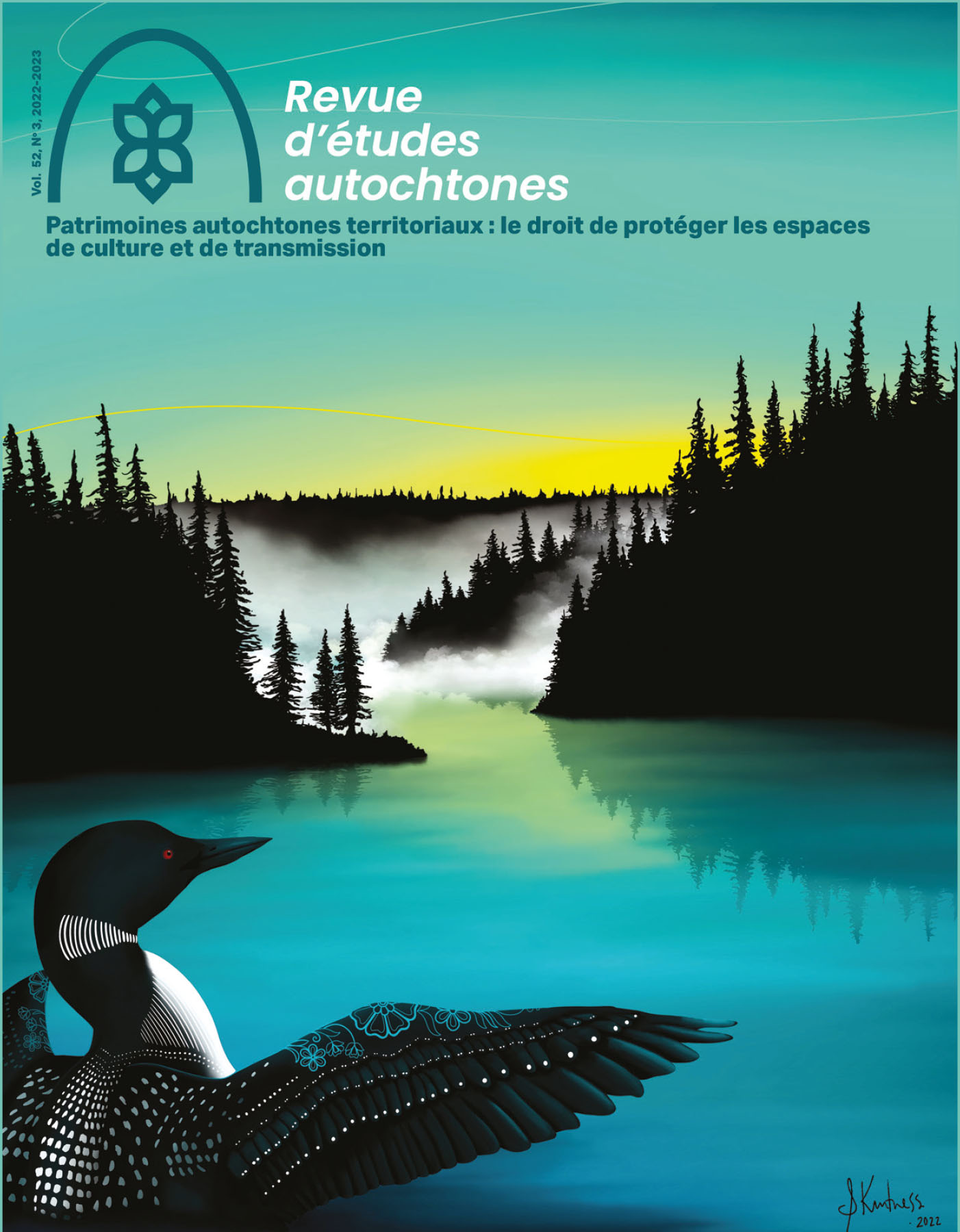L’étude réalisée par Heidi Bohaker propose de revisiter l’histoire diplomatique anishinaabe depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui en passant par l’impact de la colonisation sur la culture politique de ce peuple. Néanmoins, plutôt que de rédiger une simple monographie politique, l’autrice choisit d’aborder la question de l’alliance via le concept de doodem, souvent traduit par le terme « clan », et de leur rencontre autour de « feux » (ou council fire). Par l’usage de ces concepts, l’autrice parvient à manifester l’environnement politique des Anishinaabek où chaque terme politique est formé de multiples facettes. Ainsi, le doodem n’est pas juste un outil diplomatique, il incarne aussi un animal symbolique propre à un groupe (p. 46), un élément rappelant un lien avec ses ancêtres (p. 48-49), un concept possédant des caractéristiques humaines comme une âme ou une descendance (p. 55), ou encore une réalité mobilisée lors des adoptions d’un nouveau membre de la communauté (p. 72). En ressort un travail montrant la complexité du fonctionnement de la société anishinaabe dont le système d’alliance n’est pas seulement utilisé dans les relations avec d’autres communautés, mais aussi dans la structure même de la société : chaque clan, chaque famille, chaque groupe se lie aux autres dans un grand ensemble cohérent. Tous les doodems se réunissent et entretiennent des liens politiques, économiques et matrimoniaux afin de maintenir les feux (p. 150). En ressort une grille de lecture fluide capable de s’adapter à tout type de situation et de relier ce concept aux autres cultures politiques des groupes proches. Par exemple, Bohaker indique que les Anishinaabe peuvent inclure ou exclure certains animaux par les alliances matrimoniales. À ce sujet, elle mentionne l’introduction du loup parmi les autres doodems comme le résultat d’un mariage entre les Anishinaabe et les Lakotas (p. 83). Cette simple information permet d’introduire l’équivalence du doodem dans les univers traditionnels d’autres communautés, expliquant ainsi comment le peuple anishinaabe interagit avec les autres communautés d’Amérique du Nord. Ainsi, de la même manière que les individus sont intégrés dans les clans et les familles par des processus d’adoption, leur doodem, fragment essentiel de leur identité, les accompagne. Selon nous, cette volonté de ne pas se tenir à une définition trop simple de ce concept permet à Bohaker d’aborder ses sources avec un esprit plus ouvert et permet une meilleure correspondance à une réalité politique autochtone capable de s’adapter à l’Autre, qu’il s’agisse d’une communauté voisine ou de colons européens. D’une manière plus large, cette étude de nouveaux concepts politiques permet de renouveler une historiographie qui se cantonne souvent aux rencontres autour de feux (Delâge et Sawaya 2001 ; Jennings et al. 1995 ; Goldstein 1969 ; Sawaya 1998 ; White 1992), et qui présente ici l’existence d’un univers politique se confondant avec le quotidien des communautés. Les doodems sont à la fois des éléments de détermination culturelle (p. 48-57), des représentations politiques de groupes autonomes, mais aussi des éléments de la tradition orale des Anishinaabek dont les origines permettent de retracer l’histoire de leur peuple (p. 46). Bohaker ajoute un nouveau degré de compréhension des communautés autochtones dont l’approche décentralisée du domaine politique se renforce avec cette étude : outre le partage d’un capital politique entre tous les membres d’une même société (p. 24-26), chaque individu s’approprie la culture diplomatique propre à son clan via son doodem de référence. Cette décentralisation politique se retrouve alors dans l’organisation des feux avec d’autres communautés où chaque décision rapportée par les représentants est décidée en collégialité par l’ensemble des individus lors de « feux internes ». Malgré tout, si l’étude des différents représentants et des mécanismes …
Appendices
Bibliographie
- Brown, Ian W. 1989. « The Calumet Ceremony in the Southeast and Its Archaeological Manifestations ». American Antiquity 54(2) : 311-331.
- Ceci, Lynn. 1982. « The Value of Wampum among the New York Iroquois: A Case Study in Artifact Analysis ». Journal of Anthropological Research 38(1) : 97-107.
- Delâge, Denys et Jean-Pierre Sawaya. 2001. Les traités des Sept-Feux avec les Britanniques : droits et pièges d’un héritage colonial au Québec. Québec : Éditions du Septentrion.
- Havard, Gilles. 1992. La Grande Paix de Montréal de 1701 : les voies de la diplomatie franco-amérindienne. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.
- Havard, Gilles. 2017. Empire et métissages: Indiens et Français dans les Pays d’En-Haut, 1660-1715. Québec : Éditions du Septentrion.
- Jaenen, Cornelius J. 1976. Friend and Foe : Aspects of French-Amerindian Cultural Contact in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. New York : Columbia University Press.
- Jennings, Francis, William N. Fenton, Mary A. Druke et David R. Miller, dir. 1995. The History and Culture of Iroquois Diplomacy: An Interdisciplinary Guide to the Treaties of the Six Nations and Their League. New York : Syracuse University Press.
- Gohier, Maxime. 2008. Onontio le médiateur : la gestion des conflits amérindiens en Nouvelle-France, 1603-1717. Québec : Septentrion.
- Goldstein, Robert A., 1969. French-Iroquois Diplomatic and Military Relations, 1609-1701. La Hague : Mouton & Co.
- Lainey, Jonathan. 2004. La « monnaie des Sauvages » : les colliers de wampum d’hier à aujourd’hui. Québec : Éditions du Septentrion.
- Sawaya, Jean-Pierre. 1998. La fédération des sept feux de la vallée du Saint-Laurent. Québec : Éditions du Septentrion.
- Snyderman, George S. 1954. « The Functions of the Wampum ». Proceedings of the American Philosophical Society 98(6) : 469-494.
- Trigger, Bruce G. 1976. The Children of Aataentsic: A History of the Huron People to 1660. Montréal : McGill-Queen’s University Press.
- White, Richard. 1992. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815. Cambridge : Cambridge University Press.