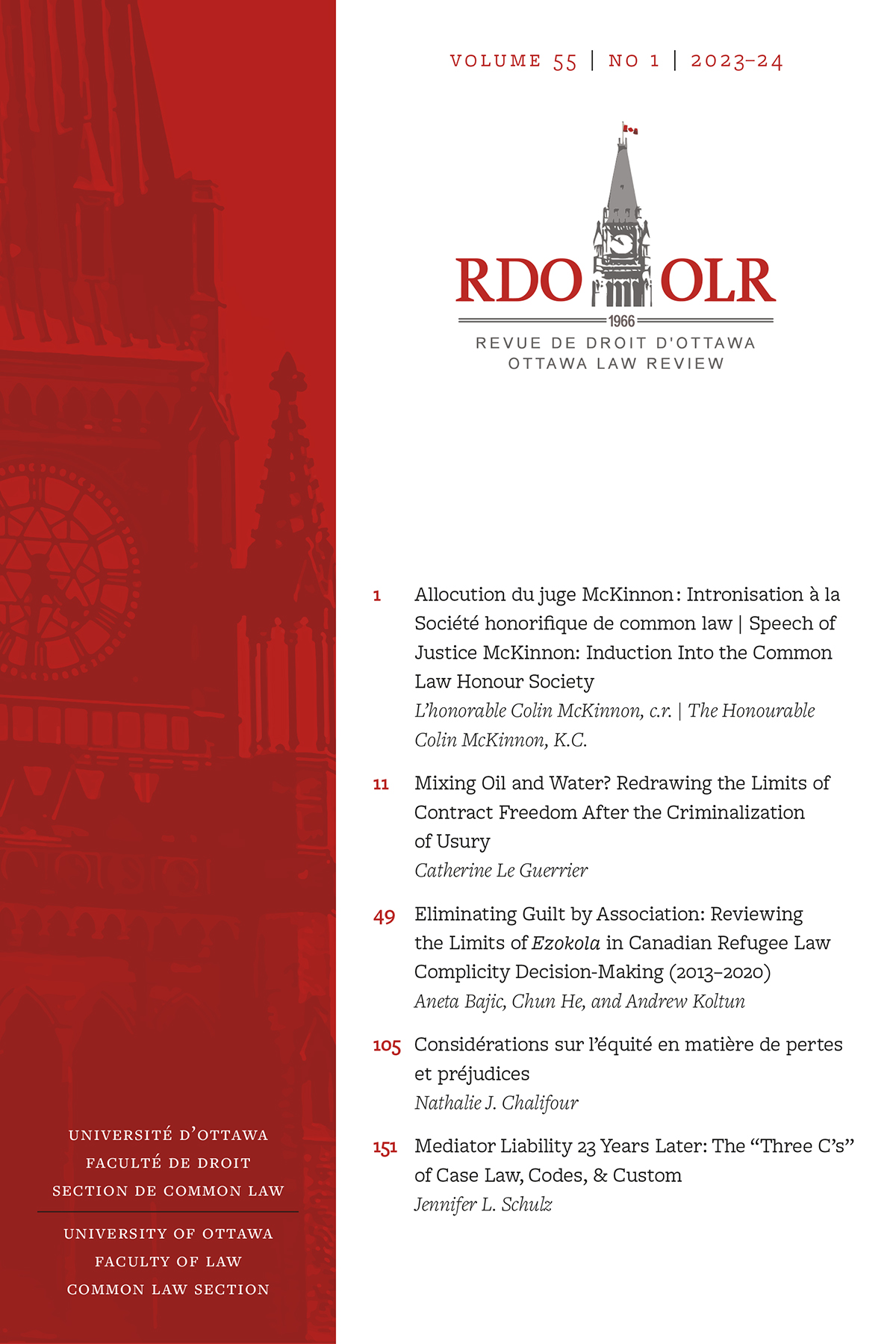Abstracts
Abstract
Theorists who debate whether private law should remain truly private rarely consider the possibility of a disruptive collision between private law and regulation that would force the former to engage with public policy concerns. This article shows an example of such a collision, which was caused by Parliament’s choice to criminalize the act of agreeing to receive interest at more than 60% per year. Rather than voiding the contracts of sophisticated parties that ran afoul of the prohibition, Canadian common law courts adapted the doctrine of illegality and rules on severance rapidly to allow them to be upheld in part: first, the courts severed the obligation to pay any interest on the loan; next, they used blue-pencil severance to reduce the amount of interest owed; and lastly, they created a new remedy, “notional severance,” to craft a new contract for the parties, effectively making contract law directive rather than facilitative. In the end, notional severance was interpreted restrictively as only allowing lenders to recoup interest at exactly 60% per year. This paper argues that these collective doctrinal changes were haphazard, and compares them to the ways in which the Québec civil law courts responded to the new criminal provision. It also suggests that theories which stress the resemblance and proximity of private law with regulation are best suited to understand this line of jurisprudence, through which judges made the contract law directive to assert a competing vision of freedom of contract, rather than deferring to Parliament’s view.
Résumé
Les théoriciens et théoriciennes qui débatent de la possibilité de donner au droit privé un caractère plus « public » tiennent rarement compte du fait qu’une collision entre le droit privé et la règlementation pourrait forcer le droit privé à se prononcer sur des questions de politique publique. Cet article présente un exemple d’une telle collision, provoquée par la criminalisation par le Parlement canadien de l’acte de percevoir des intérêts à un taux supérieur à 60 % par an. Plutôt que d’annuler les contrats des parties averties qui allaient à l’encontre de cette interdiction, les tribunaux canadiens de common law ont rapidement adapté la doctrine de l’illégalité et les règles sur la divisibilité pour les maintenir en partie : tout d’abord, les tribunaux ont supprimé l’obligation de payer tout intérêt sur le prêt ; ensuite, ils ont utilisé la divisibilité au moyen du « trait au crayon bleu » pour réduire le montant des intérêts dus ; et enfin, ils ont créé un nouveau recours, celui de la « divisibilité fictive », pour proposer un nouveau contrat pour les parties, donnant ainsi au droit des contrats un rôle directeur plutôt que facilitateur. En fin de compte, il fut décidé que la « divisibilité fictive » permet seulement d’imposer un taux d’intérêt d’exactement 60 % par an. Cet article soutient que ces changements relatifs à la doctrine étaient incohérents et les compare à la façon dont les tribunaux de droit civil du Québec ont réagi à la nouvelle disposition du Code criminel. Il suggère également que les théories qui mettent l’accent sur la ressemblance et la proximité entre le droit privé et la réglementation sont les mieux placées pour comprendre cette jurisprudence, par laquelle les juges ont mis de l’avant une autre vision de la liberté contractuelle, plutôt que de se référer à celle du Parlement.