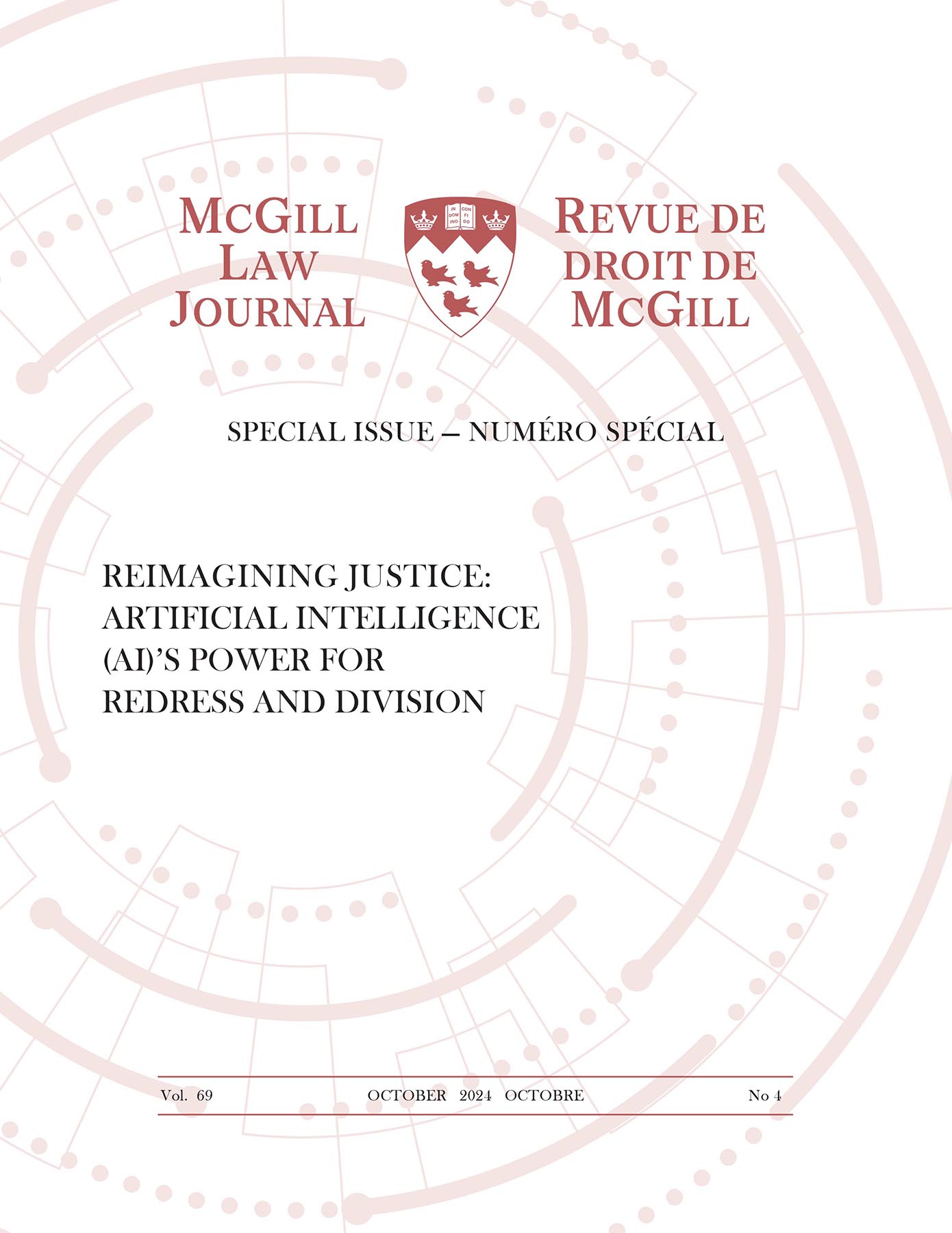Abstracts
Résumé
Les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont de nouveaux modèles d’entreprise qui émergent avec le Web 3.0. Elles permettent à des individus et des institutions de collaborer sans se connaître et sans se faire confiance. Les DAO sont donc conçues pour organiser une communauté d’inconnus autour d’un projet commun où la confiance en la technologie remplace la confiance en l’associé. Leur nature favorise une coopération horizontale, ce qui devrait, par conséquent, réduire les risques de comportements opportunistes par une minorité. Pour certains, il n’y aurait, ainsi, aucun intérêt à se soumettre à un cadre légal contraignant pour limiter les risques d’actions opportunistes.
Il existe actuellement des milliers de DAO, dont certaines sont structurées comme des sociétés, d’autres comme des sociétés à responsabilité limitée, d’autres encore comme des associations à but non lucratif non constituées en société et enfin certaines comme des entités étrangères. Cependant, la plupart des DAO ne s’associent à aucune forme juridique particulière. La responsabilité des participants à la DAO, en cas de faute, constitue l’un des défis les plus importants de l’organisation. Sans responsabilités et sans sanctions, l’organisation ne pourra être utile et dépasser les limites de l’environnement numérique.
Afin de mettre la DAO à l’épreuve, nous testerons les difficultés structurelles pour le droit des sociétés à l’encadrer. Les solutions du droit des sociétés semblent, cependant, assez peu praticables, puisqu’elles finissent toujours par retourner vers une forme de centralisation incompatible avec la DAO. D’autre part, ces véhicules juridiques occultent systématiquement le rôle du curateur au sein de l’organisation. Une prospection dans des pans connexes du droit, alliant des éléments du droit des sociétés et du droit de la fiducie, comme avec le business trust américain, pourrait par contre ouvrir des perspectives intéressantes pour l’encadrement de la DAO.
Abstract
Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) are new business models emerging with Web 3.0. They enable individuals and institutions to collaborate without knowing or trusting each other. DAOs are, therefore, designed to organize a community of strangers around a common project, where trust in the technology replaces trust in each other. Their nature favours horizontal cooperation, which should consequently reduce the risk of opportunistic behavior by a minority. For some, there is therefore no need to submit it to a restrictive legal framework to limit the risk of opportunistic behaviour.
There are currently thousands of DAOs, some of which are structured as corporations, some as limited liability companies, some as unincorporated non-profit associations and others as foreign entities. However, most DAOs do not associate themselves with any particular legal form. The liability of DAO members in the event of wrongdoing is one of the structure’s most important challenges. Without liability and sanctions, the DAO will not fulfill its utility and will remain solely within the limits of the digital environment.
To put the DAO to the challenge, we will assess corporate law’s structural difficulties in framing it. The solutions it offers seem, however, rather impractical, since they ultimately push forward a form of centralization incompatible with DAOs. Furthermore, these legal vehicles systematically obscure the role of the trustee within the organization. Exploration of connex areas of law, combining elements of corporate law and trust law, as with the American business trust, could open up interesting perspectives for the supervision of DAOs.
Article body
Introduction
Les organisations autonomes décentralisées ou decentralized autonomous organizations (ci-après « DAO »[1]) sont de nouveaux modèles d’entreprise qui émergent avec le Web 3.0. Elles permettent à des individus — voire même à des entités — de collaborer sans se connaître et sans se faire directement confiance[2]. La particularité de ces organisations est qu’elles existent dans l’univers numérique des chaînes de blocs publiques sans être rattachées à un État[3].
Selon l’Office québécois de la langue française, les DAO sont des « [o]rganisation[s] n’ayant aucun propriétaire, dont la gestion est automatisée selon un ensemble de contrats intelligents et pour [lesquelles] la participation humaine est limitée ou inexistante »[4]. Quant aux contrats intelligents, il s’agit de « [p]rogramme[s] dont le code est inscrit dans une chaîne de blocs et dans [lesquels] est défini un ensemble d’instructions qui s’exécutent de manière automatique lorsque certaines conditions sont réunies »[5].
Les DAO sont donc conçues pour organiser une communauté d’inconnus autour d’un projet commun où la confiance en la technologie remplace la confiance en l’associé. À la différence du modèle centralisé et hiérarchisé de la société que l’on connaît depuis l’ère industrielle, les DAO sont de nature à favoriser une coopération horizontale, ce qui devrait par conséquent réduire les risques de comportements opportunistes par une minorité de membres. Il faut toutefois retenir que si les solutions offertes par la technologie offrent de nouvelles avenues, elles engendrent aussi des frictions puisqu’elles doivent se subordonner au droit alors qu’elles ont été conçues hors de celui-ci.
Il existe actuellement, sur la planète, des milliers de DAO en activité, dont certaines sont structurées par défaut comme des sociétés de personnes, d’autres par la loi, comme des sociétés à responsabilité limitée et d’autres, enfin, par l’effet des tribunaux — comme les associations à but non lucratif non constituées en société. Ainsi, à l’exception des quelques pays qui ont encadré législativement les DAO[6], la plupart de ces organisations n’entrent parfaitement dans aucun des moules verticaux existants. Par conséquent, elles ne peuvent bénéficier d’aucun bouclier permettant de limiter la responsabilité de leurs membres.
La responsabilité des membres d’une DAO en cas de faute constitue l’un des défis les plus importants de ce type d’organisation. Sans régime de représentation et de responsabilité, il est difficile d’amener l’organisation à dépasser les limites de l’environnement numérique. Voilà pourquoi un groupe d’experts promeut l’adoption d’une loi type, la Model Law for Decentralized Autonomous Organizations, qui propose une unification du régime des DAO à l’international afin d’aider les États à moderniser leur droit des sociétés et en faire des personnes morales[7].
Le régulateur québécois sera, ainsi, confronté à de nombreux défis techniques et juridiques pour réglementer les contrats intelligents et les DAO, comme il sera démontré dans la première partie de ce texte (1.). Par exemple, bien que la qualité de membre d’une DAO se matérialise par la détention d’un jeton de gouvernance, la complexité des structures et des processus de prise de décision rend extrêmement difficile l’identification d’un représentant capable de parler au nom de l’organisation. De plus, aucun détenteur de jeton ne souhaite prendre la responsabilité de défendre l’entité au nom « d’inconnus ».
Dans une seconde partie, nous testerons les difficultés structurelles pour le droit des sociétés à encadrer la DAO (2.). L’essentiel du problème semble reposer sur l’impossibilité pour le droit de s’arrimer à ces nouveaux modèles de gouvernance, en raison de la friction entre la décentralisation de la DAO et la verticalité inhérente au droit des sociétés.
I. La complexité de la gouvernance de la DAO
La DAO est une entité qui offre l’occasion à des personnes qui ne se connaissent pas nécessairement[8] de collaborer pour des projets communs (commerciaux, caritatifs, de financement, etc.) dans un environnement transparent, sécuritaire et qui répond aux besoins de l’écosystème du Web 3.0[9]. Plus spécifiquement, la DAO est un véhicule pour exploiter une entreprise, qui agit de façon autonome puisqu’elle est en tout ou en partie contrôlée par le code (les contrats intelligents)[10] et décentralisée, puisque son aire de jeu est située sur une chaîne de blocs publique[11] comme Ethereum[12]. La complexité de la gouvernance de la DAO constitue un casse-tête pour les droits nationaux. Ces organisations n’ont pas de conseil d’administration et/ou de direction générale. Le contrat intelligent remplace la structure hiérarchique gérée par des humains interagissant en personne et contrôlant les biens. La réception des propositions et l’émission des paiements ont été définies dans le code du contrat intelligent. La DAO n’est en fait qu’un logiciel à code ouvert (open source) appartenant à tous ceux qui ont acheté un jeton.
Par conséquent, pour ses partisans de la première heure, il n’y aurait aucun intérêt pour la DAO à se soumettre à un cadre légal contraignant pour limiter les risques d’actions opportunistes car le code informatique s’en chargerait (A.). La réalité est toutefois fort différente. On constate que l’architecture de la DAO n’élimine pas les risques de conflits. Bien au contraire, comme le démontre le contentieux bZeroX, LLC[13], l’absence d’un cadre légal entraîne divers enjeux lorsque la DAO agit à l’intérieur des limites d’un État (B.).
A. The DAO : une gouvernance inadéquate
En droite ligne avec le courant cypherpunk[14] qui souhaite assurer le respect de la vie privée par l’utilisation de la cryptographie, la DAO repose sur une chaîne de blocs publique, laquelle fonctionne avec le pseudonymat des membres. De plus, la participation des membres dans la DAO est entièrement soumise au code, à la lex cryptographia où le code est loi[15]. Pour les tenants de ce courant, la certitude de la science mathématique et le caractère irrévocable du contrat intelligent dépassent de loin la bonne foi[16] entre les parties et le système judiciaire pour résoudre un différend[17]. L’affaire The DAO démontre que, malgré le remplacement de la confiance entre les parties par la confiance en la technologie, un grand nombre d’asymétries informationnelles existent encore entre les membres[18].
La première DAO, The DAO, a été créée en 2016 pour le financement de projets destinés au développement du protocole Ethereum. Il s’agissait alors d’un fonds d’investissement décentralisé où les décisions étaient prises par les détenteurs de jetons, lesquels devaient voter pour déterminer quand et au profit de qui libérer tout ou une partie des fonds. Après avoir réussi à amasser l’équivalent de 150 millions de dollars américains en Ethers, The DAO a fait l’objet d’un piratage lui soutirant le tiers de ses fonds. La gouvernance de cette DAO était extrêmement décentralisée[19] : des 150 millions ramassés en quelques jours, l’investisseur le plus important possédait moins de 4 % des jetons. Les 100 premiers détenteurs se partageaient moins de 50 % de la propriété totale de cette DAO.
Une telle décentralisation est-elle bénéfique pour une organisation ? La doctrine traditionnelle sur la gouvernance[20] enseigne que les structures plates (horizontales) de prise de décision ne sont efficaces que dans les petites organisations ou au sein de petites unités individuelles pour les grandes organisations. Des experts néo-zélandais expliquent que lorsque les pouvoirs décisionnels sont trop dispersés au sein d’une structure plate, « l’efficience et l’efficacité de la gouvernance peuvent échouer » [notre traduction][21]. D’où leur conclusion que, dans l’affaire The DAO, la plus grande faiblesse de l’organisation était, en fait, l’ensemble des caractéristiques visant à soutenir le cadre décisionnel décentralisé que la complexité des contrats intelligents exige. D’une part, parce que le déploiement accéléré d’un code aussi complexe a mené à un comportement occasionnellement imprévisible[22]. D’autre part, car les risques créés par cette imprévisibilité ont été exacerbés par le mode de décisions décentralisées trop lent et trop lourd pour répondre aux menaces réalisées par la suite[23].
Si un système de gouvernance adéquat avait été mis en place, un plan de réponse aux incidents (incident response plan ou IRP) écrit en langage clair et simple aurait pu conduire certaines personnes à geler rapidement les fonds et à corriger le code[24]. Au lieu de cela, sans gestionnaire pour prendre des décisions, certains participants ont refusé d’adopter le hard fork, une modification du protocole de la chaîne de blocs qui aurait obligé tous les utilisateurs à mettre à jour leur logiciel pour continuer à participer au réseau, lequel aurait alors été divisé en deux chaînes de blocs, soit l’une respectant les nouvelles règles, et l’autre les anciennes. Dans une structure centralisée — descendante par nature — les décisions sont prises par quelques personnes, ce qui permet une voie d’action unique et unifiée, cohérente avec la direction et les activités générales de l’organisation. En revanche, au sein d’une structure décentralisée, ce ne sont plus quelques personnes qui doivent décider pour l’organisation, mais l’ensemble des membres de la DAO qui possèdent des jetons de gouvernance et qui peuvent voter. En résumé, plus d’une raison peut expliquer l’échec de The DAO :
le manque de maturité d’investisseurs ayant permis la collecte d’une somme très importante par un projet naissant et peu avancé, l’absence d’outils technologiques mis à la disposition de la communauté pour faciliter les prises de décisions et la gestion des fonds et le faible avancement des processus de mise en production des smart contracts (tests en production répétés, absence d’audit, de testnet, de bug bounty programs, etc.[25])
Sans oublier que la plupart des membres étaient incapables de lire ou de comprendre le code source du contrat intelligent[26]. Cette incapacité à réagir ou cet illettrisme a été lourd de conséquences, puisque cela a conduit au schisme que l’on connaît. Cette affaire démontre que les conditions de la gouvernance décentralisée n’étaient pas remplies et que bien des éléments entrent en jeu pour assurer le succès d’une DAO.
Cette saga aura porté un dur coup à l’essor des DAO. Il faudra attendre quelques années avant que cette affaire soit oubliée et que la croissance de ces entreprises soit à nouveau au rendez-vous. Ainsi, depuis 2021, en raison d’une communauté blockchain plus importante et surtout mieux informée, de meilleures pratiques et le développement d’outils de gestion[27], le nombre de DAO et leur capitalisation ont augmenté considérablement selon Deepdao.io[28].
B. Le contentieux bZeroX, LLC : l’intention de s’affranchir du droit
Un problème important se pose avec les DAO lorsqu’elles excluent la « gouvernance des personnes » et la remplacent par une « gouvernance par le code » exclusivement informatique. Comment tenir les individus responsables en cas de problème[29] ? Qui aura l’obligation de rendre compte des actions de la DAO[30] ? Face à ce nouveau paradigme pour la gouvernance d’entreprise, le contentieux américain bZeroX, LLC permet de repenser la gouvernance alors que la DAO, originaire du monde numérique, est saisie par le droit dans l’univers physique.
Le jugement par défaut rendu en juin 2023 dans cette affaire[31] permet de constater que les États seront confrontés à de nombreux défis techniques et juridiques pour encadrer les contrats intelligents et les DAO. Bien que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine pavoise en décrivant comme une « grande victoire » [notre traduction][32] son jugement par défaut contre Ooki DAO, l’incertitude demeure sur la façon dont elle devra procéder pour faire exécuter sa décision.
En théorie, la qualité de membre d’une DAO se matérialise par la détention d’un jeton de gouvernance. En pratique toutefois, il s’avère difficile[33] d’établir un lien direct entre le jeton et son détenteur en raison du pseudonymat, ce qui amène à s’interroger sur la possibilité réelle d’exécuter le jugement et surtout, pour l’avenir, sur les probabilités d’encadrer efficacement les DAO : « [l]es tentatives de la CFTC de recouvrer son jugement seront le véritable test de la théorie selon laquelle certaines DAO sont “à l’épreuve de l’exécution” en raison de leur décentralisation » [notre traduction][34].
L’une des raisons pour lesquelles cette affaire a retenu l’attention du public est liée aux déclarations publiques à l’effet que les DAO ont été délibérément créées pour contourner la loi. Ceci l’a rendue « peu sympathique » aux yeux de plusieurs, dont ceux du juge de l’affaire. C’est bien ce que démontre l’analyse du contentieux opposant bZeroX, LLC et Ooki DAO à la CFTC[35]. Selon cette dernière, les fondateurs de bZeroX, LLC ont vu une opportunité d’utiliser une DAO afin d’échapper à la réglementation et aux sanctions. L’autorité de régulation américaine a sanctionné séparément les plateformes de commerce de cryptoactifs. Elle a reproché à bZeroX, LLC, qui a créé Ooki DAO, de ne pas respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la traçabilité des échanges des Futures Commission Merchants. Ainsi, la CFTC a d’abord infligé une amende d’un montant de 250 000 $ à la société bZeroX, LLC, puis a démarré une action en justice devant les tribunaux de Californie contre la DAO elle-même, en soutenant que Ooki DAO, en tant que successeure de la société bZeroX, réutilisait les mêmes logiciels développés que cette dernière. Les responsables de de la DAO auraient même pris le risque de déclarer leur stratégie publiquement, comme exprimé par l’un de leurs fondateurs :
Nous nous préparerons au nouveau cadre réglementaire en assurant la pérennité de [bZeroX]. Actuellement, de nombreux acteurs du secteur reçoivent des mises en demeure, et les législateurs se demandent si les entreprises de finance décentralisée doivent s’inscrire ou non comme fournisseurs de services d’actifs virtuels —au fond, nous allons faire tout ce qu’il faut pour nous protéger contre les demandes des organismes de réglementation en transférant tout à la communauté [notre traduction][36].
La CFTC n’a toutefois pas été aussi naïve que le prétendent les représentants de bZeroX, LLC. Sa poursuite contre bZerox, LLC a démontré qu’elle n’a pas laissé la société s’en tirer « par magie » suite à la mutation de cette dernière en DAO. L’organisation bZerox a, en effet, été accusée :
-
d’offrir illégalement des services de commerce de marge et de levier au détail[37];
-
d’exercer des activités réservées aux négociants-commissionnaires en contrats à terme dûment inscrits et;
-
de n’avoir adopté aucun programme d’identification des clients, en contravention avec le Bank Secrecy Act.
Cette affaire peut sembler emblématique de la volonté des créateurs de DAO d’échapper au droit tant que leurs activités demeurent confinées à des investissements purement dématérialisés sur une chaîne de blocs[38]. C’est également la limite de l’aspect virtuel des DAO, puisqu’elles sont « rattrapées par le droit lorsque leurs activités entrent en contact avec le monde physique »[39].
Dans les motifs de la décision, sans examiner en profondeur les faits particuliers au dossier, le tribunal souligne, en premier lieu, et à plusieurs reprises, qu’Ooki DAO avait la possibilité de comparaître et de présenter une défense, mais que c’est à dessein qu’elle ne l’a pas fait. Nous sommes partiellement en accord avec le juge sur ce point[40]. La complexité de la structure et de la gouvernance informatique de la DAO rend extrêmement difficile l’identification d’un représentant ayant la capacité et l’autorité en droit de s’exprimer au nom de l’organisation. De plus, on peut comprendre qu’aucun détenteur de jeton ne souhaite prendre la responsabilité de défendre l’entité au nom « d’inconnus » et de perdre l’immunité que lui confère l’anonymat[41]. Tout membre qui se présenterait devant le tribunal reconnaîtrait « publiquement » sa qualité de détenteur de jetons, ce qui ferait de lui une cible parfaite pour l’exécution de la décision[42]. Par conséquent, plutôt qu’une stratégie planifiée et intentionnelle de la DAO de ne pas comparaître au procès, il s’agit peut-être de la conséquence de la structure de la DAO où aucun des détenteurs de jetons n’a intérêt à se présenter et à supporter le coût total de l’action pour des inconnus.
On peut se demander comment, dans un tel contexte, la CFTC réussira à faire exécuter sa décision. Normalement, avec une décision rendue par défaut et en cas de refus de paiement, la CFTC exercerait un recours devant les tribunaux pour faire appliquer la décision. Les mêmes problèmes que lors de la signification de la plainte se poseraient, soit ceux liés à l’incapacité de signifier le recours à la DAO[43]. Comment, alors, forcer Ooki DAO à payer ? Comment accéder aux clés privées des fonds pour les libérer afin d’exécuter le jugement ? Comme le tribunal a déjà conclu que la DAO est une association non constituée en société, la responsabilité pourra être supportée conjointement et solidairement par les membres. Ainsi, s’il devient impossible de recouvrer contre la DAO, la CFTC devra se tourner vers les détenteurs de jetons s’il est possible de les identifier.
Bien que certains experts déclarent qu’il existe déjà plusieurs structures juridiques en droit positif capables d’encadrer la DAO, à l’exception de quelques lois[44], ces moules n’ont pas été construits pour y intégrer une organisation horizontale gouvernée par du code informatique :
Currently, there are thousands of DAOs, some of which are structured as corporations, some – as limited liability companies, some – as unincorporated nonprofit associations, and some – as offshore entities. However, most of the DAOs do not associate with any form of legal entity. By default, these DAOs are general partnerships, and therefore, unincorporated associations. They still carry legal liability for the actions of their members, and since there is no limited liability shield, the group liability becomes the liability of each individual member of such DAO[45].
Pour répondre à ce besoin de partage de responsabilité et à l’obligation de rendre compte, la doctrine propose plusieurs approches.
II. Quelle structure juridique pour accueillir la DAO ?
Les structures juridiques développées pour l’exploitation d’une entreprise mettent généralement en place un régime de responsabilité légale afin que les membres et/ou le groupement soient tenus responsables des obligations de l’organisation de la même façon qu’ils en partagent les bénéfices. Qu’il s’agisse de la fiction de la personnalité morale ou de celle du patrimoine d’affectation, l’objectif est de constituer une cloison entre le patrimoine de l’exploitant et celui de la personne morale ou de la fiducie, dans le but ultime de limiter la responsabilité des parties. La DAO n’est pas différente à cet égard.
Alors que le droit des sociétés paraît inadapté, conduisant la DAO vers une forme de centralisation et de hiérarchisation des organes (A.), le regard tourné vers le droit des fiducies pourrait offrir des assises intéressantes pour l’encadrement des DAO et la responsabilité de ses acteurs hors de l’environnement numérique (B.).
A. La hiérarchisation des organes en droit des sociétés
La situation des DAO est incertaine à plusieurs égards. Premièrement, la qualification de société ne s’impose pas naturellement. Rappelons que, en droit des sociétés, seuls quelques États à travers le monde ont des régimes juridiques spécialement conçus pour les DAO[46]. Ces régimes juridiques qui les qualifient de sociétés à responsabilité limitée n’existent donc pas seulement en vertu du code informatique, mais aussi en vertu de la loi. Les DAO sont, ainsi, traitées comme toute société de droit et assujetties à la personnalité juridique. Elles se distinguent toutefois des autres sociétés par le fait que leur gouvernance se trouve ficelée dans un contrat intelligent.
Toutes les autres DAO sont créées exclusivement pour l’univers numérique des chaînes de blocs; elles n’ont aucun lien avec un ordre juridique en particulier et elles tirent exclusivement leur existence du code informatique[47]. Les DAO qui seront rattrapées par le droit dans l’univers physique pourront être traitées comme des sociétés étrangères.
Il s’avère donc important de clarifier leur statut juridique. Sans reconnaissance légale, les investisseurs risquent de ne pas pouvoir profiter de la responsabilité limitée, leurs biens personnels pouvant donc constituer le gage des créanciers de la DAO. D’autre part, si un tribunal québécois arrivait à la conclusion qu’une DAO constituait une forme de société, les détenteurs de jetons seraient assujettis à l’ensemble du corpus légal du droit des sociétés, ce qui pourrait impliquer des obligations en tant qu’associés qu’ils n’avaient pas envisagées. Enfin, il ne faut pas oublier la possibilité de classifier le jeton comme une valeur mobilière. Dans un tel cas, les membres de la DAO risqueraient d’être qualifiés d’investisseurs et la société devrait avoir la possibilité d’émettre de tels titres[48].
Afin de remédier à cette incertitude juridique, certains experts mondiaux de la chaîne de blocs ont proposé une loi type, la Model Law for Decentralized Autonomous Organizations (A.) dont le régime juridique est adapté aux caractéristiques de la technologie[49]. À défaut d’adopter un tel modèle, il faudra s’interroger sur la possibilité de puiser dans les ressources du droit québécois des sociétés (B.).
1. La loi type sur les DAO
La Model Law for Decentralized Autonomous Organizations est fondée sur l’équivalence fonctionnelle et réglementaire. Ainsi, ses auteurs ont identifié les situations où la technologie de la chaîne de blocs remplit de facto le but nominatif d’une règle de droit à laquelle un modèle de société semblable à la DAO est soumis, et ont adapté les règles applicables en considérant ses spécificités technologiques. L’objectif de la loi est de combler le fossé entre les considérations techniques et juridiques.
Ainsi, la législation proposée prévoit que les statuts de la DAO doivent être énoncés en langage clair et compréhensible pour un profane, ce qui permet de remédier à l’incompréhension du contrat intelligent[50]. Ainsi, afin de limiter les asymétries informationnelles, tout membre doit pouvoir consulter les statuts sans avoir de connaissances pointues en informatique[51].
La personnalité juridique est attribuée à la DAO conditionnellement au respect de plusieurs conditions, lesquelles viennent régler plusieurs problèmes se posant actuellement avec la DAO :
Pour qu’une DAO puisse bénéficier de la personnalité juridique, elle doit remplir les conditions suivantes :
a) La DAO doit être déployée sur une chaîne de blocs sans permission;
b) La DAO doit fournir une adresse publique unique par laquelle n’importe qui peut examiner les activités de la DAO et surveiller ses opérations;
c) L’ensemble du code logiciel de la DAO doit être en format libre accès dans un forum public pour permettre à quiconque de l’examiner;
d) Le code logiciel de la DAO doit avoir été soumis à une assurance qualité;
e) Il doit y avoir au moins une interface graphique qui permettra à un profane de lire la valeur des variables clés des contrats intelligents de la DAO et de surveiller toutes les transactions provenant de, ou adressées à, l’un des contrats intelligents de la DAO. L’interface graphique précisera également si les membres peuvent échanger leurs jetons sans restriction et, dans le cas contraire, mentionnera clairement les restrictions en vigueur;
f) La DAO doit avoir des statuts compréhensibles pour un profane. Les statuts doivent être accessibles au public par le biais d’une interface graphique ou d’un forum public. Les informations sensibles peuvent être retirées des statuts avant leur publication, si de tels retraits sont nécessaires pour protéger la vie privée des membres individuels ou des participants de la DAO;
g) Le système de gouvernance de la DAO doit être techniquement décentralisé, bien que pas nécessairement décentralisé sur le plan opérationnel, conformément à l’article 3 paragraphe 7;
h) Indépendamment du système de gouvernance choisi, il doit toujours y avoir au moins un membre de la DAO à tout moment;
i) Il doit y avoir un mécanisme spécifié publiquement qui permet à un profane de contacter la DAO. Tous les membres et administrateurs de la DAO doivent pouvoir accéder au contenu du mécanisme de communication;
j) La DAO doit utiliser ou fournir un mécanisme de résolution des litiges qui liera la DAO, les membres et les participants;
k) La DAO doit se référer ou fournir un mécanisme de résolution des litiges pour résoudre tout litige avec des tiers qui, de par leur nature, peuvent être réglés par une résolution alternative des litiges [notre traduction][52].
Ainsi, une fois les conditions de l’article 4 paragraphe 1 satisfaites, la DAO aura une responsabilité semblable à celle d’une personne morale. Quant aux membres[53], ils n’auront que l’obligation de libérer leurs contributions engagées envers la DAO sur la chaîne de blocs. Si la DAO épuise ses actifs, les membres ne seront responsables que jusqu’à la libération de leurs contributions[54]. Enfin,
si la DAO refuse de se conformer à un jugement, une ordonnance ou une sentence exécutoire rendue à son encontre, les membres qui ont voté contre le respect du jugement, de l’ordonnance ou de la sentence seront responsables de tout paiement monétaire ordonné dans le jugement, l’ordonnance ou la sentence au prorata de leur part des droits de gouvernance dans la DAO[55].
Les paragraphes e), h) et i) supposent qu’un humain soit en mesure de garder le contrôle sur le fonctionnement de la DAO et capable de faire des choix qui ne soient pas imposés par le système numérique. Ainsi, un profane doit pouvoir lire, comprendre et être capable de surveiller toutes les transactions provenant ou adressées aux contrats intelligents. De plus, il doit toujours y avoir au moins un membre de la DAO accessible à tout moment indépendamment du système de gouvernance privilégié par le code. Un mécanisme de communication doit être en place et permettre à un profane de contacter la DAO en tout temps et tous les membres et administrateurs doivent pouvoir accéder au contenu de ce mécanisme.
Enfin, la gouvernance d’une DAO doit toujours être techniquement — mais pas nécessairement — opérationnellement décentralisée. Ainsi, d’un point de vue technique, la DAO doit offrir au moins le potentiel d’une gouvernance décentralisée. Par exemple, un contrat intelligent contrôlé par un compte externe ne constituera pas une DAO au sens de la loi type car une seule entité peut affecter unilatéralement le fonctionnement du contrat intelligent. Ainsi, dans la mesure où un contrat intelligent serait gouverné par une chaîne de blocs publique, cette condition serait techniquement respectée, même si dans les faits une seule entité contrôle la majorité des jetons de la DAO. On constate avec surprise que le régime juridique proposé dans la loi type est construit sur le modèle de la société par actions et que la décentralisation exigée ne sera, dans bien des DAO, qu’apparente.
2. Le droit québécois des sociétés
Au Québec, il est impossible d’appliquer — à l’oppoaé du droit français — la théorie de la réalité de la personne morale[56] aux DAO. L’article 299 CcQ, situé dans le chapitre consacré aux personnes morales, prévoit d’ailleurs l’hégémonie de la théorie de la fiction :
299. Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois, directement par la loi.
Elles existent à compter de l’entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement par la loi ou par l’effet de celle-ci; autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont applicables.
Quant à l’article 2188 CcQ, il dispose que seules les sociétés par actions constituent des personnes morales, ce qui vient sonner le glas de la théorie de la réalité[57].
Parmi les autres formes de sociétés, certains auteurs américains défendent un rattachement de la DAO à une forme de « general partnership »[58] — de société en nom collectif —, en raison de l’absence de formalité pour l’enregistrement de l’entreprise numérique[59]. Ce modèle pourrait convenir pour les DAO qui sont créées dans le seul but lucratif de l’enrichissement des participants[60], comme dans le cas de The DAO, ce qui n’épuise toutefois pas la diversité des formes de DAO moins adaptées à cette structure. Pour De Filipi & Wright, cette perspective présente au moins deux inconvénients[61]. Le premier se révélerait dans l’hypothèse d’un dommage causé par la DAO à un tiers, ou encore en cas de problème de solvabilité de l’organisation décentralisée. Dans ce cas, le general partnership ne permettrait pas de protéger les investisseurs et ceux-ci seraient sommés de porter la responsabilité du dommage[62]. Par voie de conséquence, le deuxième inconvénient est le résultat du premier, dans la mesure où cette responsabilité partagée entre les participants pourrait constituer un aspect freinant l’investissement, notamment de grands investisseurs, qui risqueraient de perdre plus que ce qui a été investi[63]. Essentiellement pour les mêmes raisons, nous sommes d’avis que le droit québécois des sociétés de personnes ne permettrait pas d’obtenir une protection juridique adéquate sur le plan de la responsabilité et de la solvabilité qui échoient à la DAO.
De plus, au Québec, les sociétés en nom collectif et en commandite doivent s’immatriculer au Registre des entreprises et, à défaut, seront réputées être des sociétés en participation[64]. Considérant l’importance de l’anonymat pour les membres de la DAO et l’absence de conseil d’administration, l’obligation d’immatriculation serait difficile à respecter pour une DAO constituée sous l’une de ces formes. En outre, la « société en nom collectif ne peut faire appel public à l’épargne ou émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis et de l’obligation de réparer le préjudice qu’elle a causé aux tiers de bonne foi »[65]. Il serait donc impossible, avec ce véhicule, d’émettre des jetons d’investissement et de respecter la Loi sur les valeurs mobilières. Seule la société en commandite, parmi les sociétés de personnes, est autorisée à émettre des titres négociables[66]. Toutefois, considérant la verticalité entre les droits et les pouvoirs des associés, dont le commandité est le seul autorisé à administrer la société, nous sommes d’avis que ce véhicule juridique n’est pas conçu pour recevoir la DAO. Pour ce qui est de la société en participation, elle ne pourrait, là encore, constituer un socle idéal pour la DAO : la société en participation constitue un groupement de fait qui ne possède — à la différence des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite — aucun patrimoine, ni aucune individualité juridique. Dès lors, ceci en fait un véhicule juridique peu intéressant pour l’exploitation d’une entreprise[67].
Pour ce qui est de la société par actions, elle requiert la présence d’un conseil d’administration composé de personnes physiques[68]. La réalité de la culture cypherpunk sous-jacente à de nombreuses DAO conduirait à ce que peu choisissent de se constituer en société par actions, dans la mesure où cela implique la restauration d’un conseil d’administration classique renvoyant à la structure pyramidale habituelle.
B. Le droit des fiducies à la rescousse
Quelle structure juridique adopter pour une organisation décentralisée alors que, malgré l’absence de conseil d’administration et la transparence offerte par la technologie, on dénote plusieurs asymétries informationnelles et opérationnelles ? Malgré l’intention prédominante de la communauté internationale de faire des DAO des personnes morales, il semble — à tout le moins en droit québécois — que la porte du droit des fiducies mérite d’être entrouverte afin de vérifier si le recours à ce concept pourrait se justifier par la recherche d’une supervision humaine qui se matérialise dans bien des DAO par la création d’un curateur.
En effet, au sein d’une DAO, le curateur a une double mission de vérification et de protection[69]. Premièrement, il assure la vérification de l’identité de l’adresse publique de la personne présentant une proposition de vote, de l’adéquation entre l’opération soumise au vote et de la finalité annoncée. La vérification permet au curateur de filtrer de façon discrétionnaire les propositions de vote, dont celles qui devraient être rejetées. Deuxièmement, le curateur a pour rôle de protéger les investissements de la DAO contre les attaques, par exemple les attaques à 51 %[70]. On constate donc que la concentration de pouvoirs entre les mains de cet acteur peut menacer l’aspect horizontal et démocratique de la DAO. C’est ici que la solution du business trust et de la fiducie, un véhicule juridique souple et comparable — à plus d’un égard — au régime offert par le trust[71] de common law, est intéressante[72].
Sous le CcQ, « [l]a fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer »[73]. Les fiducies sont classifiées en trois groupes[74] en fonction de l’affectation propre à chacune : les fiducies personnelles[75], constituées à titre gratuit dans le but de procurer un avantage à une personne déterminée ou qui peut l’être; les fiducies d’utilité sociale[76], généralement sans but lucratif et servant des objectifs d’intérêt général; et finalement, les fiducies d’utilité privée[77] qui constituent la technique d’organisation privilégiée pour l’exploitation d’une entreprise. Il existe deux formes de fiducies d’utilité privée[78]. La première est destinée à procurer indirectement un avantage à un bénéficiaire et comporte un objet de nature privée comme l’érection, l’entretien ou la conservation d’une chose corporelle[79]. Elle peut être constituée soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. La seconde forme, obligatoirement constituée à titre onéreux, peut englober des buts aussi variés que réaliser un profit au moyen de placements ou d’investissements, pourvoir à une retraite, ou procurer un autre avantage au constituant ou aux personnes qu’il désigne, aux membres d’une société ou d’une association, à des salariés ou à des porteurs de titre[80].
Le constituant, le fiduciaire et les bénéficiaires constituent les principaux acteurs de la fiducie. Le constituant est la personne qui est à l’origine de la fiducie, l’homologue du fondateur de la société. Il transfère ainsi de son patrimoine à un nouveau patrimoine qu’il constitue des biens qui seront affectés au projet, soit à l’exploitation d’une entreprise. Son rôle est fort limité par la loi. Ainsi, après avoir participé à la constitution de la fiducie[81], l’administration du patrimoine est confiée au fiduciaire et le constituant ne conserve qu’un simple droit de surveillance[82]. Le constituant ne peut donc plus, dès lors, intervenir dans la désignation du fiduciaire ou des bénéficiaires, modifier l’affectation de la fiducie ou encore y mettre fin[83]. Le CcQ prévoit aussi la possibilité pour le constituant d’être lui-même bénéficiaire de la fiducie[84].
Une telle règle s’imposait dans le cadre de la fiducie à titre onéreux. En effet, tout comme l’actionnaire fondateur d’une société, il est normal que le constituant puisse, en contrepartie de l’apport effectué à la fiducie, participer à la plus-value de l’entreprise. Par ailleurs, il s’avérera extrêmement important dans le cadre d’une fiducie-entreprise de faire échec au principe énoncé à l’article 1293 CcQ, en vertu duquel une personne peut effectuer un apport à la fiducie sans acquérir les droits d’un constituant. Il devra donc être clairement stipulé dans l’acte de fiducie — si cela est la volonté des parties — que tout apport à la fiducie en contrepartie de la détention d’un jeton confère le droit de voter aux assemblées et de participer au partage des bénéfices et au reliquat de l’entreprise. Ce portrait tracé du constituant au sein d’une fiducie se marie extrêmement bien à celui du fondateur de la DAO dont le rôle est associé essentiellement au démarrage de l’entreprise : conception de l’application, lancement d’un jeton sur une chaîne de blocs publique et création de la DAO par l’élaboration d’un contrat intelligent, et levée de fonds (initial coin offering) pour attirer des investisseurs.
Le personnage central de la fiducie est le fiduciaire sur qui repose la charge de réaliser l’affectation prévue à l’acte constitutif. L’importance de ce personnage dans la structure fiduciaire tient au fait que c’est par son acceptation que prendra naissance la fiducie[85]. Son rôle est fondamental : il est chargé de l’administration exclusive du patrimoine et de la remise des biens à la fin de la fiducie[86]. Cependant, l’absence de fiduciaire n’entraînera pas l’extinction d’une fiducie. Des modes sont prévus pour permettre soit au constituant[87], soit au tribunal de combler les vacances[88]. Toutefois, dans le cadre d’une fiducie-entreprise de type DAO, il serait plus pratique de confier le pouvoir de destitution et de réélection d’un nouveau fiduciaire aux bénéficiaires-membres — détenteurs de jetons puisqu’ils sont, dans la situation, les actionnaires d’une société. Seules les personnes physiques pleinement capables et les personnes morales autorisées par la loi[89] peuvent être fiduciaires[90]. Les fonctions du fiduciaire cesseront par son décès, sa démission, sa faillite, l’ouverture d’un régime de protection à son égard, ou encore par son remplacement[91].
On constate donc que l’administration interne de la fiducie est plus souple que celle d’une personne morale et mieux adaptée à la DAO parce que le fiduciaire détient la maîtrise de tous les biens et qu’il en est l’administrateur exclusif. Il pourra donc toujours agir sans que ses pouvoirs aient à être attribués et confirmés par les statuts, les règlements ou encore par les résolutions du conseil d’administration, même si ce dernier n’est composé que d’une seule personne. Enfin, sous réserve de la fiscalité des fiducies qui n’est pas, a priori, conçue pour l’exploitation d’une entreprise[92], la fiducie n’est soumise à aucune autorité étatique, ni au contrôle d’aucun organisme de surveillance. Toutefois, celle qui exploite une entreprise à caractère commercial au Québec, autre que celle administrée par un assujetti immatriculé, est soumise à l’obligation d’immatriculation[93].
Le troisième et dernier acteur de la fiducie est le bénéficiaire, celui en faveur de qui est établie la fiducie. Le bénéficiaire est presque totalement exclu de l’administration de la fiducie aux termes du Code civil. Ce principe est en adéquation avec la DAO, où la seule interférence possible se traduit par son droit de surveillance des activités du fiduciaire et son implication dans le cas où il serait lui-même fiduciaire. Dans cette situation, il devra agir conjointement avec un autre fiduciaire, tout comme pour le constituant[94]. Dans le cas d’une fiducie-entreprise, il sera important de donner une plus grande place aux bénéficiaires. L’objectif poursuivi par le constituant n’est pas de conserver un contrôle sur les biens, comme c’est souvent le cas en matière de libéralités, mais plutôt d’avantager le bénéficiaire par la réalisation d’un profit. De plus, dans la plupart des cas, le bénéficiaire aura payé sa participation; il est donc normal qu’il puisse bénéficier d’un droit de regard sur l’administration. Une telle configuration pourrait être modelée dans l’acte de fiducie pour répondre aux besoins de la DAO. Par exemple, le rôle joué par le curateur pourrait se conjuguer à celui de fiduciaire par sa mission de supervision…
Dans une société par actions, les actionnaires élisent le conseil d’administration qui administre les affaires de la société. Les administrateurs ont ainsi toute la latitude nécessaire pour exercer leur fonction dans la mesure du respect de certains devoirs. Le rôle des actionnaires se limite donc à élire ou à destituer les administrateurs. Ce partage des compétences est fondamental et ne peut être modifié que par une convention unanime des actionnaires. La fiducie est aussi gérée par un organe d’administration indépendant du groupe en faveur de qui les revenus sont accumulés, soit en faveur des bénéficiaires. Pour ce faire, la loi[95] accorde au fiduciaire les pouvoirs les plus étendus à l’égard du patrimoine. Tout comme les administrateurs d’une société, les fiduciaires ont des droits et sont tenus à certaines obligations à l’endroit des bénéficiaires et des tiers[96]. C’est le régime de l’administration du bien d’autrui qui fixe ce cadre. Le fiduciaire a ainsi droit à une rémunération pour l’exercice de sa charge[97]. De même, il pourra ester en justice pour tout ce qui touche l’administration de la fiducie[98].
En ce qui a trait à ses devoirs de plein administrateur du bien d’autrui, le fiduciaire a l’obligation générale de conserver et faire fructifier les biens, d’accroître le patrimoine de la fiducie ou encore d’en réaliser l’affectation[99]. Plus spécifiquement, le fiduciaire se doit, comme l’administrateur d’une société, d’agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la fiducie[100]. Il doit donc éviter de se placer dans une situation pouvant engendrer un conflit d’intérêts[101] et agir avec impartialité en présence de plusieurs bénéficiaires[102]. La pleine administration se caractérise ainsi par un objectif de rentabilité dans un cadre de gestion libre contrôlé par l’obligation de prudence de la personne raisonnable. À l’égard des tiers, la responsabilité du fiduciaire est, par contre, beaucoup moins lourde que celle des administrateurs d’une société. En effet, le fiduciaire qui, dans les limites de ses pouvoirs, s’engage pour le compte du patrimoine fiduciaire, ne pourra être tenu personnellement responsable à l’égard des tiers[103]. Par contre, s’il agit en son nom personnel, il pourra engager personnellement sa responsabilité. Vu la généralité des termes en la matière, il sera extrêmement important de prévoir dans l’acte constitutif l’étendue des pouvoirs du fiduciaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 1292 CcQ, le fiduciaire partage avec les bénéficiaires et le constituant une responsabilité solidaire pour tous les actes fraudant les droits des créanciers ! Il y a là une différence importante avec la société par actions où les actionnaires ont une responsabilité limitée à leur mise de fonds. En l’espèce, le constituant et les bénéficiaires, s’ils s’immiscent dans les affaires de la fiducie, verront leur responsabilité engagée au même titre que le fiduciaire. Cette disposition n’est pas sans rappeler la défense d’immixtion des associés commanditaires[104] dans le cadre des sociétés en commandite.
Ces quelques données sur la gouvernance fiduciaire permettent de poser l’hypothèse que les avantages soulevés dans cette dernière section sont, a priori, assez concluants pour donner le feu vert à une étude exploratoire sur la fiducie d’utilité privée comme véhicule juridique permettant l’exploitation de la DAO[105].
Conclusion
Cette étude établit que les DAO ont été créées pour offrir une alternative aux véhicules juridiques traditionnels. Une alternative numérique, sur chaînes de blocs publics, donc à vocation internationale. L’organisation du futur sera détenue par une communauté d’individus soudés par un objectif commun. Elle sera aussi décentralisée, donc sans le contrôle d’une entité centrale et autogérée par des contrats intelligents. Ces modèles technologiques seront, à tout le moins en théorie, plus transparents et démocratiques que les modèles traditionnels de gouvernance en raison de la participation directe des membres à la gouvernance.
Pour encadrer une telle organisation, on ne peut recourir aux modèles sociaux dépassés et limités, puisqu’une DAO se distingue fondamentalement d’une société, capitaliste par nature. En effet, bien que la DAO puisse s’appliquer à tout type de projet, elle est vouée à des projets sociaux ambitieux[106].
Force est de constater que la décentralisation n’est pas un phénomène spontané qui survient automatiquement lorsque la gouvernance informatique est substituée à la gouvernance humaine. En d’autres termes, même si l’on fait disparaitre les personnes de la gestion, les asymétries informationnelles demeurent et le remplacement de la confiance entre les parties par la confiance en la technologie n’est pas magique — particulièrement lorsque les membres ne comprennent pas le langage informatique. L’affaire The DAO en fait nettement la démonstration !
Pour passer d’un modèle vertical (avec conseil d’administration et/ou une équipe de direction) à un modèle horizontal (géré par un contrat intelligent), il faut que la communauté (les investisseurs et les utilisateurs en plus des porteurs du projet) adhère et comprenne les règles de gouvernance inscrites dans le code. Un investisseur[107], qui a l’habitude des projets[108] décentralisés, propose de suivre certaines étapes pour réaliser la décentralisation « progressive » d’une DAO :
-
Développement du produit et adoption du produit par le marché;
-
Publication open source de la documentation du projet (livre blanc, actualisation de la documentation, implication de nouveaux membres, partage des décisions sur le produit avec le public);
-
Émission des jetons de gouvernance (vente à des investisseurs privés, distribution aux membres);
-
Vente de jetons au public (matérialisation du transfert du contrôle de la DAO et des éventuelles rémunérations).
Si ces différentes étapes sont respectées, la plupart des acteurs de la DAO auront accès à la même information. Le contrôle ne demeurera pas seulement entre les mains de certains privilégiés. Il y aura ainsi dilution de la propriété des jetons entre les fondateurs, les investisseurs et les membres du public. Toutefois, nous avons vu dans l’affaire The DAO qu’une importante décentralisation n’est pas toujours gage de succès pour une grande organisation.
Ce travail a aussi permis de conclure que la loi type proposée aux législateurs internationaux pour encadrer la DAO, bien que comportant des mesures intéressantes, est extrêmement surprenante en ce qui concerne le simulacre de gouvernance décentralisée proposée. Quel est l’intérêt de présenter aux législateurs de la planète un « nouveau modèle d’entreprise », s’il s’agit de simplement déguiser le modèle capitaliste en modèle décentralisé. Les auteurs proposent une structure calquée sur les sociétés — des entités centralisées et hiérarchisées — pour encadrer une solution technologique innovante développée pour « se distingue[r] d’une entreprise traditionnelle dans sa raison d’être même »[109].
Finalement, l’analyse de l’affaire bZeroX, LLC, conduit à s’interroger sur l’immunité conférée par la DAO à ses acteurs : développeurs et membres. La victoire du régulateur américain et la poursuite contre la DAO montrent que les autorités n’hésiteront pas à la poursuivre, qu’elle soit constituée en société ou non. Par conséquent, la tendance émergente vers une restructuration en société des DAO constitue peut-être, en partie, une reconnaissance de la protection insuffisante qu’elles procurent à leurs membres[110]. D’où l’intérêt d’étudier sérieusement la fiducie de droit civil, le trust de common law et bien d’autres véhicules encore pour inventer la prochaine génération d’organisations. Considérant leur adoption lente et progressive, les chercheurs pourront contribuer à la science émergente des DAO[111] et
aider à mieux comprendre les risques spécifiques de responsabilité pour les membres et les investisseurs lorsqu’ils opèrent à travers une DAO qui n’est pas enveloppée dans une entité juridique […], ne bénéficiant ainsi pas d’une personnalité juridique séparée ou de la responsabilité limitée [notre traduction][112].
Appendices
Notes
-
[1]
Pour les fins de ce texte, nous privilégions l’acronyme DAO.
-
[2]
Au sein de la chaîne de blocs,
[l]a confiance ne naît pas de la relation entre les parties […] mais de la technologie Blockchain elle-même qui permet l’enregistrement sécurisé et partagé d’informations de valeur qui peuvent être consultées par les membres du réseau et dont les modifications ou nouvelles entrées sont validées et enregistrées à travers un “protocole de consensus” qui en garantit la validité »
Fazil Boucherit, « Blockchain : une nouvelle économie basée sur la confiance » (18 mai 2020), en ligne (blogue) : <axys-consultants.com> [perma.cc/D8U9-VRQU] -
[3]
Il faut comprendre que les chaînes de blocs publiques sont libres d’accès et décentralisées, et que leurs acteurs (les mineurs, les validateurs, et les investisseurs) sont situés partout sur la planète. Par conséquent, ces chaînes de blocs permettent de transférer de la valeur partout sur le globe.
-
[4]
Office québécois de la langue française, « Organisation autonome décentralisée » (dernière modification en 2019), en ligne : <vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.caperma.cc/VZT3-AS2N].
-
[5]
Office québécois de la langue française, « Contrat intelligent » (dernière modification en 2019), en ligne : <vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca> [perma.cc/B8QE-SHMQ].
-
[6]
Les États-Unis (le Tennessee, le Vermont, le Wyoming et l’Utah), Malte et les Îles Marshall.
-
[7]
Coalition of Automated Legal Applications, Model Law for Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) (2021), en ligne (pdf) : <coala.global> [perma.cc/K7BY-TYT5] [Model Law].
-
[8]
Parmi les acteurs de la DAO, on retrouve les créateurs-fondateurs du projet, les simples participants (des investisseurs sans pouvoir décisionnel), les membres (des investisseurs qui possèdent des jetons de gouvernance et peuvent voter) et le curateur. Ce dernier remplit deux fonctions essentielles : 1) la vérification de l’identité de l’adresse publique de la personne présentant une proposition de vote, ainsi que l’adéquation entre l’opération soumise au vote et la finalité annoncée et 2) la protection de la DAO contre les attaques, telles que les attaques par majorité. Comme le pseudonymat est au coeur de la constitution de la DAO, la majorité de ces personnes ne se connaissent pas.
-
[9]
Le Web 3.0 fait référence à un Web décentralisé exploitant la technologie des chaînes de blocs. À la différence du Web 2.0, il permettrait de redonner le contrôle aux usagers sur leurs données.
-
[10]
Voir Samer Hassan et Primavera De Filippi, « Decentralized Autonomous Organization » (2021) 10:2 Internet Pol’y Rev à la p 5; Annie Maudouit-Ridde, « L’organisation autonome décentralisée (DAO) » (2018) 117:4 Bull Joly Bourse 177 à la p 177. La question de l’autonomie totale ou partielle est une des questions non résolues à propos de la DAO. Est-ce qu’elle doit fonctionner sans la moindre intervention humaine, de façon complètement autonome, ou est-ce que la DAO peut recourir à la participation de ses membres ?
-
[11]
Les chaînes de blocs privées ou de consortium pourraient accueillir des DAO, mais seules les chaînes de blocs publiques sont accessibles à tous.
-
[12]
Il n’est toutefois pas possible de coder des contrats intelligents avec Bitcoin; il existe d’autres chaînes de blocs publiques comme Cardano, Avalanche, Hyperledger et Solana.
-
[13]
Commodity Futures Trading Commission, « Order instituting proceedings pursuant to Section 6(c) and (d) of the commodity exchange act, making Findings, and imposing remedial sanctions » (2022) à la p 2, en ligne (pdf) : <cftc.gov> [perma.cc/M75M-6ERS]; Commodity Futures Trading Commission v Ooki Dao, WL 5321527 (Cal Dist Ct 2022).
-
[14]
Le cypherpunk est un mouvement au service de la vie privée qui se trouve à l’origine de Bitcoin, voir Ludovic Lars, « De PGP à Bitcoin et Wikileaks : l’histoire des cypherpunks », Journal du Coin (9 octobre 2022), en ligne : <journalducoin.com> [perma.cc/ 4774-MRH8].
-
[15]
Lawrence Lessig, « Code is Law: On Liberty in Cyberspace », Harvard Magazine (1 janvier 2000), en ligne : <harvardmagazine.com> [perma.cc/56EF-CRW7].
-
[16]
Pourtant, le langage informatique est incapable de traduire une notion subjective comme la bonne foi.
-
[17]
Bien qu’une décision à la majorité, dans certains protocoles, pourrait conduire à la mutabilité du contrat intelligent.
-
[18]
Par exemple, tous les acteurs de la DAO n’ont pas accès à la même information; le contrôle peut notamment se retrouver entre les mains de certains détenteurs de jetons privilégiés. Il en irait de même en présence de curateurs qui évalueraient les propositions en fonction de leur éthique et de leur jugement personnels.
-
[19]
Robbie Morrison, Natascha CHL Mazey et Stephen C Wingreen, « The DAO Controversy: The Case for a New Species of Corporate Governance? » (2020) 3:25 Frontiers 1 à la p 1.
-
[20]
Ibid, à la p 6.
-
[21]
Ibid, à la p 11.
-
[22]
Le pirate avait exploité la façon dont les contrats intelligents étaient codés sur la chaîne de blocs.
-
[23]
Quelques tentatives ont été faites pour empêcher la prise de cryptoactifs, mais le consensus de voix requis n’a pu être obtenu des membres en si peu de temps, voir Morrison, Mazey et Wingreen, supra note 19 à la p 6.
-
[24]
Ibid.
-
[25]
Stéphane Daniel et al, « Qu’est-ce qu’une DAO ou organisation autonome décentralisée ? » (5 mars 2024), en ligne : <cryptoast.fr> [perma.cc/K98Z-Z7ZE].
-
[26]
Ce qui peut poser un problème en termes de formation du contrat, notamment avec les notions d’erreur et de dol, voir Morrison, Mazey et Wingreen, supra note 19 aux pp 6, 11.
-
[27]
Daniel et al, supra note 25.
-
[28]
DeepDAO, un agrégateur de données et un outil d’analyse, a lancé le premier moteur de recherche spécialisé pour l’écosystème DAO qui permet aux utilisateurs de naviguer dans celui-ci. Construit sur la liste des DAO et des profils de gouvernance de DeepDAO permet aux utilisateurs et aux organisations de se retrouver dans une mer de données et de comprendre les réseaux, les jetons et les interactions des DAO. La plateforme répertorie et analyse les données organisationnelles, créant des profils personnels pour ses détenteurs de jetons de gouvernance DAO. DeepDAO divise ses données en quatre segments : organisations, personnes, frais et outils. Il offre aux utilisateurs un aperçu de toutes les décisions et votes qui ont lieu dans l’écosystème DAO, tandis que le segment des outils répertorie plusieurs dizaines d’outils pour créer et gérer ces organisations.
-
[29]
Morrison, Mazey et Wingreen, supra note 19 à la p 15.
-
[30]
Les créateurs-fondateurs ? Les simples participants ? Des investisseurs sans pouvoir décisionnel ? Les membres-investisseurs qui possèdent des jetons de gouvernance et peuvent voter ? Ou, encore, le curateur-tiers de confiance ?
-
[31]
Commodity Futures Trading Commission, Communiqué No 8715-23, « Statement of CFTC Division of Enforcement Director Ian McGinley on the Ooki DAO Litigation Victory » (9 juin 2023), en ligne : <cftc.gov> [perma.cc/F6LJ-RVXA].
-
[32]
« The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) won what it described as a “sweeping victory” in its case against Ooki DAO, in which the CFTC alleged that the decentralized autonomous organization (DAO) operated an illegal trading platform » (Kristopher B Kastens et Linda Butler, « Ooki DAO Default Judgment: Regulators Still Face Many Technical and Legal Challenges in Regulating Smart Contracts » (20 juin 2023), en ligne : <kramerlevin.com> [perma.cc/TH9K-FL5Z]).
-
[33]
Mais pas impossible considérant que les acteurs d’une DAO agissent sous des pseudonymes. Il existe, en effet, des outils permettant de masquer une transaction. De cette manière, il serait impossible de faire le lien entre l’expéditeur et le récepteur. De plus, certaines cryptomonnaies sont anonymes (Monero, Dash). Ce qu’il faut surveiller, ce sont les points de contact entre la chaîne de blocs et le système bancaire traditionnel. Dès que les cryptomonnaies sont transférées vers le système bancaire, les régulateurs peuvent utiliser plusieurs outils pour épingler les contrevenants, voir Corinne R, « L’anonymat sur la blockchain : mythes et réalités » (26 juin 2023), en ligne : <cryptonews.com> [perma.cc/878H-UKRD].
-
[34]
Kastens et Butler, supra note 32.
-
[35]
Il est très intéressant que, dans son analyse, la CTFC appréhende la DAO Ooki comme « un groupement non constitué sous forme de personne morale » [notre traduction] [nos italiques] et considère la DAO comme un sujet de droit (voir Commodity Futures Trading Commission, Communiqué No 8590-22, « CFTC Imposes $250,000 Penalty Against bZeroX, LLC and its Founders and Charges Successor Ooki DAO for Offering Illegal, Off-Exchange Digital-Asset Trading, Registration Violations, and Failing to Comply with Bank Secrecy Act » (22 septembre 2022), en ligne : <cftc.gov> [perma.cc/NP99-F36E] [Communiqué sur l’amende de la CFTC]. La CFTC affirme également que
[l]es actes, omissions et manquements des membres de l’association sans personnalité morale Ooki DAO (c’est-à-dire les détenteurs de jetons Ooki qui ont voté leurs jetons Ooki pour gouverner Ooki DAO, par exemple en dirigeant le fonctionnement du Protocole Ooki), ainsi que ceux des personnes autorisées à travailler pour le compte de Ooki DAO, ont été commis dans le cadre de leur fonction, de leur emploi ou de leur agence auprès de Ooki DAO. Par conséquent, conformément à l’article 2(a)(1)(B) du 7 U.S.C. et à l’article 1.2 du 17 C.F.R. [Code of Federal Regulations], la DAO de Ooki est responsable, en tant que mandant, de chaque acte, omission ou manquement des membres, dirigeants, employés ou agents agissant pour la DAO de Ooki [notre traduction]
Commodity Futures Trading Commission v Ooki Dao, WL 5321527 (Cal Dist Ct 2022) au para 60 [Plainte de la CFTC] -
[36]
La communauté dont parle le fondateur étant la DAO, voir Plainte de la CFTC, supra note 35 au para 3.
-
[37]
La CFTC impose une pénalité de 250 000 $ américains à bZeroX LLC, qui a proposé des transactions illégales d’actifs numériques hors bourse, permis des violations d’enregistrement et permis le non-respect du secret bancaire, voir Communiqué sur l’amende de la CFTC, supra note 35.
-
[38]
Florence Guillaume et Sven Riva, « Dao, code et loi : le régime technologique et juridique de la decentralized autonomous organization » (2021) 4 RD Inti Assas 206 à la p 207.
-
[39]
Ibid.
-
[40]
Nous sommes en accord avec les auteurs Kastens et Butler, voir supra note 32.
-
[41]
Ibid.
-
[42]
Ibid.
-
[43]
Dans cette affaire, le juge a accepté que la plainte soit publiée dans la fenêtre de clavardage d’assistance sur le site web de l’entreprise ainsi que sur son forum de discussion en ligne.
-
[44]
Voir par ex Model Law, supra note 7.
-
[45]
Arina Shulga, « Ooki DAO Is a “Person” That Can Be Sued », The National Law Review (13 janvier 2023), en ligne : <natlawreview.com> [perma.cc/4M5F-JNTN].
-
[46]
En juillet 2018, le Vermont est devenu le premier État américain à adopter une loi de responsabilité limitée ajustée aux compagnies basées sur la chaîne de blocs (É-U, S 269, An Act Relating to Blockchain Business Development, Gen Assem, Reg Sess, Vt, 2018 (promulgué)). Le 13 mars 2023, la loi sur les organisations autonomes décentralisées de l’Utah a été promulguée (É-U, HB 357, Decentralized Autonomous Organizations Amendments, 65th Leg, Gen Sess, Utah, 2023). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. À la différence des autres États qui ont adopté une législation permettant aux DAO de se constituer en sociétés autonomes à responsabilité limitée (SARL), l’Utah est le premier État à faire des DAO une entité juridique distincte – une organisation autonome décentralisée à responsabilité limitée (Robert B Lamb, « Utah Passes Innovative DAO Legislation », The National Law Review, (2 mars 2023), en ligne : <nationalreview.com> [perma.cc/Y3MY-TN2Q]). Voir aussi É-U, HB 1507, An Act to Amend Tennessee Code Annotated, Title 12; Title 47; Title 48; Title 61 and Title 66, relative to electronic transactions, 110th Gen Assem, Reg Sess, Tenn, 2018 (promulgué); É-U, SF 0038, Decentralized autonomous organizations, 66th Leg, Gen Sess, Wyo, 2021 (promulgué); Malte, Bill No C-689, Innovative Technology Arrangements and Services Act, 2018. Par ailleurs, en 2022, les Îles Marshall ont amendé la Non-Profit Entities Act pour reconnaître officiellement les DAO comme des SARL (Bill No 53ND1, Non-Profit Entities (Amendment) Act, 42nd Constit Reg Sess, 2021).
-
[47]
Selon Guillaume et Riva, les DAO constituent des sociétés numériques à portée mondiale constituées en quelques minutes, sans aucune référence au droit national (voir supra note 39). Leur particularité est qu’elles existent uniquement dans l’univers numérique de la chaîne en bloc sans être rattachées à un État. Ainsi, selon ces auteurs, il est possible pour les DAO de s’affranchir totalement des règles de droit — leur constitution et leur gouvernance peuvent reposer exclusivement sur le code informatique — tant que leurs activités (par exemple, la gestion d’actifs cryptographiques, le financement participatif, etc.) sont confinées à l’environnement dématérialisé de la chaîne de blocs. Les DAO sont toutefois rattrapées par le droit lorsque leurs activités entrent en contact avec le monde physique. Dans un tel cas, il devient difficile de concilier les règles de droit avec une solution technologique créée hors du droit. Ainsi, la portée juridique des contrats intelligents varie d’un État à l’autre. Pour certains États, les DAO existent non seulement selon le code informatique, mais aussi en vertu de la loi (voir supra note 38). Pour d’autres, le statut des DAO est moins clair. Qu’arrive-t-il lorsque les DAO sortent de l’environnement numérique et qu’elles ont un impact dans la juridiction d’un de ces États ? Pourront-elles être reconnues par le droit ?
-
[48]
Arts 2224, 2237 CcQ.
-
[49]
Model Law, supra note 7 à la p 6.
-
[50]
Ibid, art 4(1)(f).
-
[51]
Ibid, art 4(1)(e).
-
[52]
Model Law, supra note 7, art 4(1).
-
[53]
Selon la loi type, le mot « membre » désigne « toute personne ou DAO qui possède des droits de gouvernance dans une DAO », alors que le « participant » est défini comme « toute personne interagissant avec ou détenant des jetons natifs dans une DAO, à l’exception des membres » [notre traduction] (ibid, arts 3(18), 3(25)). Il existe donc une asymétrie entre ces deux types d’acteurs : une catégorie pouvant voter, l’autre étant sans pouvoir décisionnel.
-
[54]
Ibid, art 5(1). Par ailleurs, et sauf exceptions, « les membres ne seront pas tenus responsables des obligations encourues par la DAO, y compris, mais sans s’y limiter, les obligations en matière de travail et de fiscalité » [notre traduction] (ibid, art 5(2)).
-
[55]
Ibid, art 5(3).
-
[56]
Historiquement, il existe deux conceptions permettant de reconnaître la personnalité morale aux groupements : la théorie de la fiction et la théorie de la réalité. Alors que la théorie de la fiction reconnaît la personnalité juridique aux seules entités dont la personnalité juridique découle de la loi, la théorie de la réalité est fondée sur la reconnaissance par les tribunaux des conditions spontanées d’existence d’un groupement. Au Québec, cette théorie a eu droit de cité jusqu’en 1994, alors qu’en France elle demeure encore applicable aujourd’hui (Charlaine Bouchard, La personnalité morale démythifiée : contribution à la définition de la nature juridique des sociétés québécoises, Sainte-Foy (Qc), Presses de l’Université Laval, 1997 aux pp 26 et s).
-
[57]
Voir sur cette question Charlaine Bouchard, Droit et pratique de l’entreprise, t 1, 4e éd, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021 à la p 432 et s.
-
[58]
Voir Stephen D Palley, « How to Sue a Decentralized Autonomous Organization » Coindesk (20 mars 2016), en ligne : <coindesk.com> [perma.cc/W2FV-5FW4]; Shawn Bayern, « Three Problems (and Two Solutions) in the Law of Partnership Formation » (2016) 49:3 U Mich JL Ref 605 à la p 608; Lynn M LoPucki, « Algorithmic Entities » (2018) 95:4 Washington UL Rev 887. En droit américain, le partenariat existe à partir du moment où une « association of two or more persons to carry on as co-owners of a business for profit […], whether or not the persons intend to form a partnership » (voir Uniform Law Commission, « Uniform Partnership Act (1997) » (dernière modification en 2013) », art 202(a), en ligne (pdf) : <uniformlaws.org> [perma.cc/YFC5-2PTY]. Comme le rappelle Laila Metjahic, « [g]eneral partnerships are formed as an ongoing enterprise, whereas joint ventures are formed for a limited purpose. A partnership is formed to carry on the general business of one sort or another, and a joint venture is limited to a single transaction or course of transactions » (« Deconstructing the DAO: The Need for Legal Recognition and the Application of Securities Laws to Decentralized Organizations », (2017) 39:4 Cardozo L Rev 1533 à la p 1556, citant l’affaire Investment Associates v Summit Associates Inc, et al, 74 A3d 1192 (Conn Sup Ct 2013) [notes omises]).
-
[59]
C’est ce qu’explique Carla L Reyes :
[a]s a default entity, when a business venture with multiple owners fails to file paperwork to operate the business in some other form (such as an LLC or corporation), a partnership is automatically formed […]. Because DBEs frequently do not file formal documents electing another business entity, many may constitute partnerships
« If Rockefeller Were a Coder » (2019) 87:2 Geo Wash L Rev 373 à la p 391 -
[60]
« Some DAOs, created as a tool for two or more persons to carry on a joint association for the pursuit of profit, neatly fit the classic default business-entity form of a partnership. The DAO offers a clear example of such a venture » (ibid à la p 398).
-
[61]
Primavera De Filippi et Aaron Wright analysent cette proposition dans Blockchain and the Law: The Rule of Code, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2018 aux pp 141–42.
-
[62]
« [I]f courts construe the DAO and similar decentralized organizations as general partnerships, token-holders will also owe each other fiduciary duties as partners that they may not have considered upon investment » (Metjahic, supra note 58 à la p 1548).
-
[63]
« If characterized as a general partnership, decentralized organizations may struggle to attract members, especially those with significant assets. Large businesses, institutional investors, and other regulated commercial entities may be reluctant to invest in or otherwise support a decentralized organization for fear that membership would put other assets at risk » (De Filippi et Wright, supra note 60 à la p 142). Voir aussi Reyes, supra note 58 aux pp 398–99).
-
[64]
Art 2189, al 2 CcQ.
-
[65]
Art 2224 CcQ.
-
[66]
Art 2237 CcQ.
-
[67]
Bouchard, supra note 56.
-
[68]
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, arts 108–09; Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC (1985), c C-44, art 105.
-
[69]
Securities and Exchange Commission, Communiqué No 81207, « Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO » (25 juillet 2017) à la p 7, en ligne : <sec.gov> [perma.cc/CNZ5-68TA].
-
[70]
En cryptographie, une attaque à 51 % se produit lorsqu’un individu ou un groupe contrôle 51 % ou plus de la puissance de « hachage » (de validation) d’un réseau blockchain. Cet individu /groupe peut donc utiliser ce pouvoir pour créer des transactions invalides ou refuser des transactions légitimes.
-
[71]
« If Rockefeller were a coder developing a DBE [decentralized business entity], he would structure the DBE as a business trust » (Reyes, supra note 59 à la p 406).
-
[72]
Aline Grenon définit ainsi la fiducie en common law (trust) : « la fiducie existe lorsqu’une personne, appelée fiduciaire (trustee), détient des biens à titre de propriétaire, soit dans l’intérêt d’une ou de plusieurs personnes, appelées bénéficiaires (beneficiary ou cestui que trust), soit en vue de la réalisation d’un but particulier » (Common law en poche, vol 5, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1997 à la p 7).
-
[73]
Art 1260 CcQ.
-
[74]
Art 1266, al 1 CcQ.
-
[75]
Art 1267 CcQ.
-
[76]
Art 1270 CcQ.
-
[77]
Arts 1268–69 CcQ. Selon Jacques Beaulne, seule la fiducie d’utilité privée serait susceptible de servir à des fins commerciales (Droit des fiducies, 3e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015 à la p 81). Il s’oppose ainsi à l’opinion d’André Morissette et Marie-Josée Lapierre qui sont plutôt d’avis que les fiducies personnelle et d’utilité privée se prêtent à cette activité (« L’utilisation des fiducies dans un contexte commercial » dans Droit spécialisé des contrats, vol 3, Denys-Claude Lamontagne, dir, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2001 1 aux pp 1–96). Quoi qu’il en soit de ce débat, si en théorie l’exploitation d’une entreprise peut se faire tant par le biais d’une fiducie personnelle que par celui d’une fiducie d’utilité privée, cette dernière forme devrait être privilégiée. Il s’agit, en effet, de la forme la plus avantageuse pour en arriver à cette fin, compte tenu qu’elle peut être perpétuelle (art 1273 CcQ) et, dans certains cas, doit être constituée à titre onéreux (arts 1268–69 CcQ) contrairement à la fiducie personnelle.
-
[78]
Beaulne, supra note 77 à la p 81.
-
[79]
Art 1268 CcQ.
-
[80]
Art 1269 CcQ.
-
[81]
Art 1260 CcQ.
-
[82]
Arts 1287, 1290–91 CcQ.
-
[83]
Cependant, il est clair que par l’insertion de clauses spécifiques à l’acte de fiducie, le constituant pourrait se réserver certains pouvoirs comme celui de nommer ou de remplacer les fiduciaires (art 1276 CcQ) et celui d’élire les bénéficiaires (art 1282 CcQ). Il pourrait de plus se nommer lui-même fiduciaire, pourvu qu’il respecte la condition de l’article 1275 CcQ, soit d’agir conjointement avec un autre fiduciaire.
-
[84]
Art 1281 CcQ. De plus, dans le cas où il serait impossible de remettre les fruits ou les revenus aux bénéficiaires, les biens reviendront au constituant ou à ses héritiers selon l’article 1297 CcQ.
-
[85]
Art 1264 CcQ.
-
[86]
Art 1297 CcQ.
-
[87]
Art 1276 CcQ.
-
[88]
Art 1277 CcQ.
-
[89]
Seules les sociétés de fiducie constituées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, et détenant le permis requis peuvent se qualifier (RLRQ c S-29.02, art 1).
-
[90]
Art 1274 CcQ.
-
[91]
Art 1355 al 1 CcQ.
-
[92]
Il est important de consulter un fiscaliste.
-
[93]
Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1, art 21, al 8. On peut imaginer qu’il sera difficile pour la DAO de respecter cette obligation.
-
[94]
Art 1275 CcQ.
-
[95]
Art 1278, al 1 CcQ.
-
[96]
Art 1278, al 2 CcQ.
-
[97]
Art 1300 CcQ.
-
[98]
Art 1316 CcQ.
-
[99]
Art 1306 CcQ.
-
[100]
Art 1309 CcQ.
-
[101]
Arts 1310–15 CcQ.
-
[102]
Art 1317 CcQ.
-
[103]
Art 1319, al 1 CcQ.
-
[104]
Art 2244 CcQ.
-
[105]
Dans le même sens, voir Anne-Sophie Hulin, « De la fiducie de données en droit civil québécois : Étude exploratoire pour un outil en construction » (2021) 67:2 RD McGill 119 à la p 132.
-
[106]
Eric Seulliet, « Les DAO, des organisations du troisième type pour le futur », Harvard Business Review France (22 décembre 2023), en ligne : <hbrfrance.fr> [perma.cc/ 7N2F-XR2S].
-
[107]
Daniel et al, supra note 25 (« [c]ette route vers une décentralisation progressive a été développée par Jessee Walden sur le blog de a16z, l’un des plus grands investisseurs au monde dans les projets décentralisés »).
-
[108]
Bien que les DAO et la chaîne de blocs soient des technologies émergentes et que leur utilité à long terme demeure à être démontrée, les principaux usages de la technologie se présentent ainsi aujourd’hui : les DAO de financement pour le développement d’un projet, les DAO d’investissement (venture DAO) qui mettent en commun les actifs de plusieurs personnes et répartissent les profits dans le cadre d’occasions de financement, les DAO du Métavers qui permettent aux propriétaires de terrains et autres biens dans le monde virtuel de participer à la gouvernance et au développement de la plateforme (Decentraland DAO), et les DAO de gouvernance des protocoles (Uniswap) où l’objectif est de gérer le développement et l’évolution des protocoles sur la chaîne de blocs (Meghan Chen, « Introduction aux organisations autonomes décentralisées » (juillet 2022), en ligne : <fidelity.ca> [perma.cc/82RQ-E5FH]).
-
[109]
Seulliet, supra note 106.
-
[110]
Benjamin Bathgate et Madeline Klimek, « Is the Sun Setting on Perceived Dao “Immunity”?: Ooki Dao Is a Person Under the Commodity Exchange Act » (22 juin 2023), en ligne (pdf) : <mcmillan.ca> [perma.cc/6GRS-XG5R].
-
[111]
Joshua Tan et al, « Open problems in DAO » (31 octobre 2023), en ligne (pdf) : <arxiv.org> [perma.cc/S2V8-S45L].
-
[112]
Ibid à la p 36.