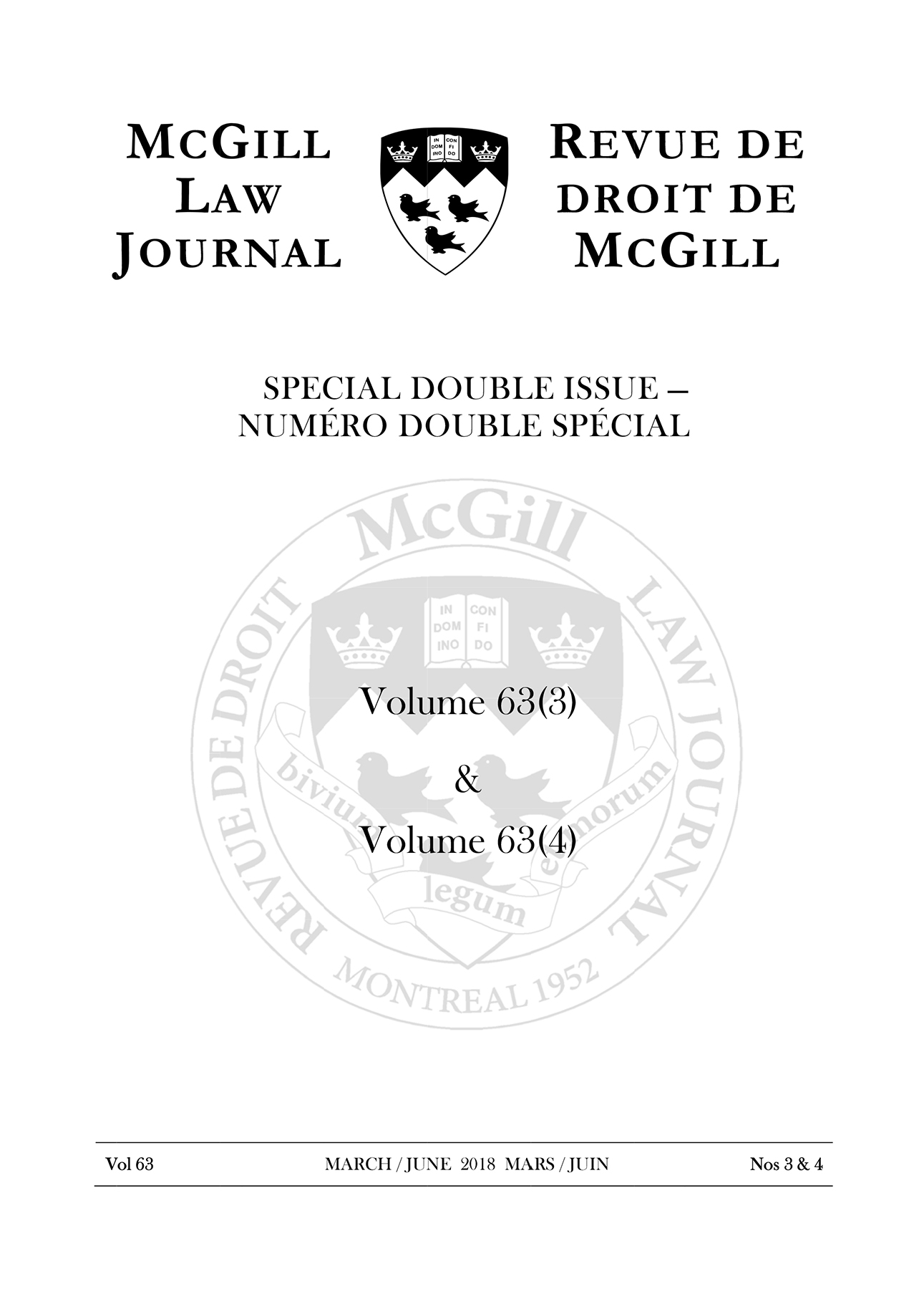Abstracts
Résumé
Ce texte porte sur l’interprétation des compétences concurrentes prévues à l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, disposition qui prévoit que « le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration ». L’analyse démontre que les tribunaux semblent ne pas tenir compte de la présence de l’expression « de temps à autre », qui limite l’exercice des compétences fédérales par le Parlement central. Cela a mené à une vision restreinte du pouvoir des législatures provinciales de légiférer dans leurs domaines de compétence. Le texte suggère qu’il devrait y avoir une démarcation entre la compétence fédérale et la compétence provinciale en matière d’immigration, et ce, à la lumière d’une interprétation littérale de l’article 95 informée par le contexte historique. Enfin, le texte propose une analyse qui permettrait de revisiter les précédents pertinents, tout en suggérant un nouveau cadre pour donner effet aux compétences concurrentes à l’avenir.
Abstract
This article deals with the interpretation of concurrent powers under section 95 of the Constitution Act, 1867, which provides that “the Parliament of Canada may from Time to Time make Laws in relation to Agriculture [...] and Immigration”. The analysis demonstrates that courts seem to disregard the presence of the expression “from Time to Time”, which limits the exercise of the federal powers by the central Parliament. This has led to a narrow view of the power of provincial legislatures to legislate in their spheres of jurisdiction. The article suggests that there should be a demarcation line between federal and provincial jurisdiction over immigration in light of a textual interpretation of section 95 informed by the historical context. Finally, the article proposes an analysis that would permit the reconsideration of the relevant precedents, while suggesting a new framework to give effect to the concurrent powers in the future.
Article body
Introduction
In each Province the Legislature may make Laws in relation to Agriculture in the Province, and to Immigration into the Province; and it is hereby declared that the Parliament of Canada may from Time to Time make Laws in relation to Agriculture in all or any of the Provinces, and to Immigration into all or any of the Provinces; and any Law of the Legislature of a Province relative to Agriculture or to Immigration shall have effect in and for the Province as long and as far only as it is not repugnant to any Act of the Parliament of Canada.
Article 95, Loi constitutionnelle de 1867[1]
Depuis l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), aujourd’hui intitulée Loi constitutionnelle de 1867, le cadre interprétatif relatif à l’exercice des compétences législatives a largement été établi, et les tribunaux se sont prononcés sur ces questions à de nombreuses reprises[2]. Par contre, l’exercice des compétences concurrentes, prévues à l’article 95, a reçu peu d’attention jurisprudentielle. Les tribunaux canadiens ont pratiquement refusé d’analyser cet article de la Loi constitutionnelle de 1867, n’y consacrant souvent que deux ou trois phrases, tout en favorisant une interprétation large de la doctrine de la prépondérance fédérale. Pourtant, une lecture attentive de l’article met en lumière une ambiguïté textuelle qui n’a fait l’objet d’aucune analyse tenant compte des mécanismes d’interprétation modernes.
Le présent article a pour objet de faire le point sur l’interprétation adoptée par les tribunaux en ce qui concerne les compétences concurrentes prévues à l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867. La jurisprudence semble avoir ignoré la présence de l’expression « from Time to Time » dans l’article 95, qui limite les compétences fédérales[3]. Cela a mené à une conception restreinte du pouvoir qu’ont les législatures provinciales de légiférer dans leurs domaines de compétence. Cet article démontrera qu’il devrait y avoir une démarcation entre la compétence fédérale et la compétence provinciale en matière d’immigration, et ce, en raison de l’historique menant à l’adoption de l’article 95, de sa formulation, ainsi que du besoin de préserver la cohérence interne de la Loi constitutionnelle de 1867. Finalement, une nouvelle interprétation constitutionnelle de l’article 95 sera proposée. Ce texte établira notamment une distinction entre l’article 95 et la compétence fédérale en matière de « naturalisation », que l’on retrouve à l’article 91(25). En somme, ce texte a pour but de démontrer que l’interprétation actuelle de l’article 95 est problématique, et d’initier une conversation académique sur la question.
L’article se divise en deux parties. Dans un premier temps, nous aborderons l’historique de la rédaction de l’article 95, de même que le recul des provinces dans leur champ de compétence en matière d’immigration (I), ce qui inclura la conception des constituants (A), l’interprétation sommaire des compétences concurrentes par les tribunaux (B) et l’exercice de la compétence en matière d’immigration sur le terrain (C). Cette première partie emprunte donc notamment une méthodologie historique et littérale[4] qui mettra l’accent sur les sources primaires et l’évolution de la conception de cette compétence durant la période précédant la création de la fédération canadienne. L’article ciblera particulièrement les nombreuses ébauches de l’AANB et les discours dans la Chambre des Lords britannique. La position des Pères de la (Con)fédération[5] sera évoquée, quoique, étant donné les changements apportés aux ébauches de l’AANB, l’intention des constituants avant 1867 semble être moins pertinente dans ce cas-ci. Les décisions rendues depuis 1867 relativement à l’article 95 seront également examinées. Il importe de souligner que le présent article examinera la jurisprudence relative à l’immigration. Quelques arrêts portant sur l’agriculture seront évoqués dans le but d’éclaircir l’argumentaire utilisé par la Cour suprême du Canada et le Comité judiciaire du Conseil privé en ce qui a trait à l’article 95. En somme, cette partie consiste en une analyse critique des documents législatifs et juridiques, ainsi que de leur évolution.
Dans un second temps, nous proposerons une nouvelle interprétation des compétences concurrentes (II), qui préserve la cohérence interne de la Loi constitutionnelle de 1867 (A), en démontrant pourquoi les tribunaux pourraient revisiter les précédents relatifs à l’article 95 (B) et en proposant un nouveau cadre d’analyse pour les compétences concurrentes (C). En s’appuyant sur ce qui a été démontré dans la première partie, l’analyse proposée permettra de créer un cadre sur lequel les juristes pourront s’appuyer pour interpréter l’article 95 et lui donner effet à l’avenir. De plus, cette partie se veut une réponse aux préoccupations de stabilité juridique. En common law, la règle du précédent demeure importante et l’analyse que nous proposons doit nécessairement la prendre au sérieux à la lumière du cadre établi par la Cour suprême.
I. La compétence concurrente en matière d’immigration : histoire et recul des provinces dans leur champ de compétence
Dans les pages qui suivent, nous allons nous attarder à la dimension historique de l’article 95, ainsi qu’à l’approche qui a été adoptée en matière d’immigration depuis 1867. Nous allons d’abord tenter de comprendre la conception des constituants. Ensuite, nous poserons un regard sur l’interprétation judiciaire et l’exercice de la compétence en matière d’immigration, afin de vérifier si le tout s’harmonise à la conception qui a été, au final, adoptée par le constituant britannique.
A. La conception du constituant canadien et du constituant britannique
Dans le Renvoi relatif à la réforme du Sénat et le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, la Cour suprême nous rappelle que l’interprétation constitutionnelle d’une disposition ne peut ignorer toute considération historique[6]. Elle affirme explicitement que son cadre général d’interprétation est inspiré des « contextes linguistique, philosophique et historique »[7]. Il importe donc de considérer la conception du constituant canadien[8] et du constituant britannique relativement à l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui peut être fait notamment par un examen des débats qui ont précédé son adoption. Étant donné le peu d’information disponible sur les rencontres de Charlottetown, de Québec et de Londres[9], l’analyse sera axée sur les nombreuses ébauches des résolutions et du projet de loi, de même que sur la version finale de l’article à l’étude qui figure au sein de la Loi constitutionnelle de 1867. À cet égard, il est intéressant de noter comment Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet soulignent que, « dans la mesure où les travaux préfédératifs révèlent des versions antérieures d’articles de la Constitution, ils s’apparentent à l’historique législatif et sont plus fiables que de simples déclarations de personnalités politiques »[10]. Les changements apportés au texte dans les multiples versions de l’AANB et les discours au Parlement britannique démontrent l’importance de la formulation de l’article 95 qui a été incorporée dans la version finale de l’AANB.
1. La conception des constituants canadien et britannique
Le processus menant à la création de la fédération canadienne a duré plus de trois ans. C’est à Charlottetown, en septembre 1864, que les délégués du Canada-Uni ont proposé une union fédérale aux politiciens qui s’y étaient réunis pour discuter de l’union des Maritimes[11]. En octobre 1864, les délégués du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, et de l’Île-du-Prince-Édouard se sont rencontrés à Québec pour débattre et adopter les 72 résolutions qui jetèrent les bases d’un nouvel État fédéral[12]. Entre 1865 et 1866, les délégués ont dû faire adopter par leurs assemblées ou leurs gouvernements le plan négocié à Québec[13]. Un contingent restreint du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse, et du Nouveau-Brunswick s’est ensuite rendu à Londres, en décembre 1866, pour conclure les négociations[14]. Entre janvier et février 1867, le Cabinet britannique s’est également prononcé sur le plan, tout en l’adaptant de sorte qu’il prenne une forme législative[15]. D’ailleurs, les changements qui ont été apportés à l’article 95 de 1864 à 1867 illustrent que la conception qu’avaient les constituants de cet article a évolué au cours de cette période, et que les mots employés dans sa formulation finale sont importants.
En adoptant les 72 résolutions à Québec[16], les délégués avaient placé les compétences en matière d’immigration et d’agriculture dans les listes exclusives des deux ordres de gouvernement[17]. Cela dit, la 45e résolution prévoyait la chose suivante :
In regard to all subjects over which jurisdiction belongs to both the General and Local Legislatures, the laws of the General Parliament shall control and supersede those made by the Local Legislature, and the latter shall be void so far as they are repugnant to or inconsistent with the former.[18]
Les deux ordres de gouvernement pouvaient donc légiférer, mais la prépondérance fédérale s’appliquait, ces compétences concernant des « subjects over which jurisdiction belongs to both the General and Local Legislatures ».
Il importe de noter que, même à ce stade, les Pères de la (Con)fédération considéraient que la dimension locale des compétences en matière d’immigration et d’agriculture était importante. Si certains voulaient les attribuer au Parlement fédéral[19], d’autres voulaient assurer un contrôle exclusif aux législatures provinciales, ou encore prévoir des compétences concurrentes[20]. Oliver Mowat était d’avis que « [t]he items of Agriculture and Immigration should be vested in both Federal and Local Governments. Danger often arises where there is exclusive jurisdiction, and not so often in cases of concurrent jurisdiction » [nos italiques][21]. Charles Tupper, quant à lui, abondait dans le même sens, soulignant que « [w]e should confine the jurisdiction neither to one nor the other exclusively »[22]. Au final, les compétences octroyées aux deux ordres de gouvernement étaient purement concurrentes à cette étape de la rédaction, c’est-à-dire qu’il n’y avait aucun langage limitant les compétences fédérales[23].
Les résolutions qui ont été adoptées à Londres en décembre 1866 ne comportaient aucune modification importante[24]. En effet, l’ébauche qui a été rédigée durant cette Conférence, et envoyée au Secrétaire d’État aux Colonies le 26 décembre 1866, reprenait le texte des 72 résolutions en ce qui a trait à l’exercice de ces compétences concurrentes[25]. Les premières ébauches de la Constitution prévoyaient donc une compétence purement concurrente, étant donné qu’elles ne mentionnaient aucune limite aux compétences législatives des deux ordres de gouvernement. Ces derniers pouvaient donc légiférer en matière d’immigration, mais les lois provinciales auraient été « void so far as they are repugnant to or inconsistent with [federal legislation] »[26].
Un premier changement de forme est apparu dans le « Rough Draft » de l’AANB rédigé à Londres. En effet, celui-ci est marqué par l’émergence d’un langage distinct pour les compétences en matière d’immigration et d’agriculture, stipulant que « [t]he Legislature shall have exclusive power to make laws respecting the following subjects, with the exception of Agriculture and Immigration, in regard to which Parliament shall have concurrent jurisdiction »[27]. À cette étape de la rédaction, le texte prévoyait un caractère expressément concurrent. De plus, la clause établissant la prépondérance se retrouvait maintenant dans le même paragraphe que celui accordant au Parlement fédéral la compétence de légiférer relativement au maintien de la paix, de l’ordre, et du bon gouvernement[28]. Outre ces changements de forme, le « Rough Draft » prévoyait essentiellement la même chose que les résolutions de Québec et de Londres.
Le premier changement majeur est survenu à la première ébauche du projet de loi, écrite le 23 janvier 1867[29]. C’est à ce moment que le constituant a consacré un article distinct aux compétences en matière d’immigration et d’agriculture :
Notwithstanding anything in this Act, any Act of the Parliament of the United Colony may from Time to Time make Provision in relation to Agriculture in all or any of the Provinces, or in relation to Immigration into all or any of the Provinces, and in each Province Provincial Ordinances may make provision in relation to Agriculture in the Province or Immigration into the Province; but any such Provincial Ordinance shall have the Force of Law in and for the Province as long and as far only as it is not repugnant to any Act of the Parliament of the United Colony.[30]
Le changement semble avoir consolidé les compétences concurrentes dans un seul article, afin de bien les distinguer des compétences dites « exclusives ». Cette version semble également conférer une certaine primauté à l’autorité fédérale. Premièrement, elle énonçait que la compétence fédérale aurait préséance en cas de conflit. Deuxièmement, la primauté fédérale était confirmée par la nature distincte du pouvoir normatif conféré à chaque ordre de gouvernement. Ainsi, le pouvoir attribué aux provinces, à ce stade de la rédaction, était plutôt un pouvoir règlementaire similaire à celui que possèdent les municipalités[31], et le Parlement fédéral avait le pouvoir de légiférer. Cela dit, le pouvoir de légiférer octroyé au Parlement fédéral était limité, puisque sa compétence en matière d’immigration ne devait être exercée que « de temps à autre ». Le pouvoir règlementaire des provinces n’était pas assujetti à ce type de contrainte.
Les troisième et quatrième ébauches, rédigées par le Secrétaire d’État aux Colonies le 2 février 1867, soit à peine deux semaines plus tard, comportaient plusieurs changements. Les provinces étaient dorénavant dotées d’un pouvoir législatif équivalent à celui de l’autorité fédérale. Par ailleurs, les nouvelles ébauches incluaient un article distinct pour les compétences concurrentes :
Notwithstanding anything in this Act, any Act of the Parliament of Canada may from time to time make provision in relation to: —
Agriculture in all or any of the Provinces.
Immigration into all or any of the Provinces [...]
And in each Province provincial laws may make provision in relation to: —
Agriculture in the Provinces.
Immigration into the Provinces [...]
But any such Provincial Law shall have the force of law in and for the Province as long and so far only as it is not repugnant to any Act of the Parliament of Canada.[32]
Le constituant conférait ainsi des compétences législatives en matière d’immigration et d’agriculture aux provinces. Toutefois, ces ébauches incluaient également les compétences en matière d’immigration et d’agriculture dans la liste des compétences exclusives du Parlement fédéral[33]. En effet, les compétences concurrentes étaient prévues dans un article distinct et restreintes par l’expression « de temps à autre », mais elles étaient également incluses dans la liste des compétences exclusives au Parlement fédéral[34]. Les ébauches qui suivirent semblent démontrer que cette ambiguïté était le résultat d’une erreur de rédaction.
Effectivement, dans la dernière ébauche, qui date du 9 février 1867, ces compétences étaient encore une fois placées dans un article distinct, tout en étant retirées de la liste exclusive du Parlement fédéral – mettant ainsi fin à l’ambiguïté qui persistait dans les ébauches précédentes. Le rôle des provinces était, cette fois-ci, mis à l’avant-plan, et un langage limitatif, qui soulignait que la compétence fédérale ne devait s’exercer que « de temps à autre », était conservé. Les compétences des deux ordres de gouvernement ont été séparées en paragraphes distincts au sein du même article, comme dans la version précédente, ce qui permet de mettre l’accent sur le langage limitatif :
In each Province the Legislature may make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say,
(1) Agriculture in the Province:
(2) Immigration into the Province: [...]
And it is hereby declared that the Parliament of Canada may from Time to Time make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say,
(1) Agriculture in all or any of the Provinces:
(2) Immigration into all or any of the Provinces: [...]
And any Law of the Legislature of a Province relative to any Matter coming within the Classes of Subjects in this Section enumerated shall have effect in and for the Province as long and as far only as it is not repugnant to any Act of the Parliament of Canada [nos italiques].[35]
Dans cette nouvelle version, la compétence législative des provinces était réitérée. De plus, une lecture attentive permet de remarquer un contraste important, soit que l’autorité fédérale était limitée par la formulation « de temps à autre », contrairement aux compétences provinciales qui ne l’étaient aucunement.
La dernière version de l’AANB, introduite devant la Chambre des Lords le 12 février 1867[36] et ensuite adoptée par le Parlement britannique[37], conservait essentiellement le même langage. Le constituant a cependant enlevé les autres compétences qui étaient, dans la version précédente, incluses dans la liste de compétences concurrentes, et a consolidé le texte en un seul paragraphe :
In each Province the Legislature may make Laws in relation to Agriculture in the Province, and to Immigration into the Province; and it is hereby declared that the Parliament of Canada may from Time to Time make Laws in relation to Agriculture in all or any of the Provinces, and to Immigration into all or any of the Provinces; and any Law of the Legislature of a Province relative to Agriculture or to Immigration shall have effect in and for the Province as long and as far only as it is not repugnant to any Act of the Parliament of Canada [nos italiques].[38]
Cette version finale énonçait les compétences législatives des provinces en premier. Ces compétences n’étaient pas limitées par les mots « de temps à autre », alors que celles du Parlement fédéral l’étaient.
Le Oxford English Dictionary donne deux définitions de l’expression « from time to time » : « (a) At intervals; now and again, occasionally. (b) At all times; continuously, or for an extended period; in an unbroken succession ». Selon ce dictionnaire, le deuxième sens accordé à l’expression est aujourd’hui obsolète, son dernier usage enregistré remontant à 1679[39]. Nous soulignons également que le Law Reports: Weekly Notes (Chancery division, Probate division, Queen’s Bench division) du 18 juillet 1891 confirme la première définition de l’expression[40]. L’expression ne figure cependant pas dans les dictionnaires juridiques de l’époque qui ont été consultés[41].
Une revue de la jurisprudence permet de constater que certains arrêts ont confirmé la signification de cette expression. Bien évidemment, l’interprétation de cette expression peut varier dépendamment du contexte. Nous nous limiterons, pour les besoins de cet article, à l’arrêt de principe en la matière.
Dans l’arrêt Fischbach and Moore of Canada Ltd. v. Noranda Mines Ltd., la Cour d’appel de la Saskatchewan devait interpréter une clause contractuelle employant l’expression « from time to time ». Parmi les obligations prévues dans ce contrat, l’appelant devait livrer certains dessins au constructeur « from time to time as work progresses », question de permettre à ce dernier d’achever les travaux dans les délais prévus. Dans ses motifs, le juge Bayda posait la question suivante : « is this a case where those phrases are devoid of any sense [...]? »[42]. Il répondait par la négative, notant que « [t]he phrase “from time to time” is actually quite a well known phrase and has been interpreted judicially on several occasions »[43]. Ultimement, il concluait que cette expression signifiait « “as occasion may arise” », « “as and when it is appropriate so to do” », et « “as the occasion should arise” »[44]. Il poursuivait en considérant les facteurs pertinents permettant de déterminer quand il aurait été « approprié » pour l’appelant de livrer ses dessins[45]. C’est donc dire que le juge Bayda reconnaissait que l’expression « from time to time » impliquait quelque chose qui devait se faire à l’occasion, et qu’il était possible pour les tribunaux de déterminer les « facteurs » pertinents à cette analyse en tenant compte du contexte et du contenu obligationnel du contrat[46].
Certains arrêts sur la question ont aussi été rendus par la Chambre des Lords et la Cour suprême — ces tribunaux affirmant que cette expression implique également qu’un acteur de l’exécutif ou un individu qui se voit octroyer un pouvoir d’agir « de temps à autre » peut par la suite révoquer cette même décision si nécessaire[47]. Ces arrêts ne se penchaient donc pas sur l’aspect occasionnel de l’exercice d’un pouvoir en particulier, mais plutôt sur la possibilité de révoquer des décisions prises antérieurement.
Ce dernier aspect de l’expression « from time to time » ne fait pas l’objet d’une analyse dans le présent article. En effet, si les législatures ont le pouvoir de légiférer, ils peuvent aussi abroger leurs propres lois. La jurisprudence examinée ci-haut, et les différentes significations juridiques qui peuvent découler de cette expression en fonction du contexte, sont d’ailleurs confirmées par le dictionnaire Words and Phrases Judicially Defined in Canadian Courts and Tribunals[48].
En somme, l’adoption de l’article 95 avait pour résultats (1) des compétences législatives provinciales pleines et entières; (2) des compétences législatives limitées pour le Parlement fédéral; et (3) une clause de prépondérance s’appliquant dans les cas limités où le Parlement fédéral exercerait ces compétences concurrentes.
Même si peu de documentation nous permettant de clarifier l’intention du constituant existe, l’analyse des nombreuses ébauches suggère, à notre avis, que les provinces se voyaient attribuer un rôle prioritaire — et non limité — en matière d’immigration. Les débats du Parlement britannique viennent confirmer cette intention exprimée dans le texte de la Constitution.
2. Les débats relatifs aux compétences concurrentes
Bien que les négociations ayant mené à la (Con)fédération avaient pour but de créer un nouveau pays, le Parlement britannique continua d’exercer un pouvoir considérable vis-à-vis ses colonies[49]. Par conséquent, même si les débats ayant pris place entre 1864 et 1866 demeurent importants pour informer le contexte historique des dispositions finales, toujours est-il que le projet de loi présenté devant le Parlement britannique a été finalisé par le Secrétaire d’État aux Colonies[50]. Conséquemment, le discours de ce ministre devant la Chambre des Lords demeure, à notre sens, le meilleur indicateur de la pensée finale du constituant. En fait, entre le discours du trône de la reine Victoria le 5 février 1867[51] et l’adoption de la loi par le Parlement britannique le 8 mars 1867[52], il est le seul membre du Parlement — et du gouvernement — britannique à avoir évoqué la question de l’immigration, qu’il a brièvement abordée dans son discours sur le projet de loi :
But there is, as I have said, a concurrent power of legislation to be exercised by the Central and the Local Parliaments. It extends over three separate subjects—immigration, agriculture, public works. Of these the two first will in most cases probably be treated by the provincial authorities. They are subjects which, in their ordinary character, are local; but it is possible that they may have, under the changing circumstances of a young country, a more general bearing, and therefore a discretionary power of interference is wisely reserved for the Central Parliament [nos italiques].[53]
La compétence en matière d’immigration devait donc, à l’origine, relever prioritairement des législatures provinciales puisqu’elle était conçue comme étant de nature locale. Dans les faits, cela reflétait une certaine continuité, étant donné que les colonies exerçaient des compétences en matière d’immigration depuis 1761[54].
Bien que Lord Carnarvon ait évoqué la possibilité future d’un exercice de la compétence par le Parlement fédéral, il mettait clairement l’accent sur la nature locale de ces compétences. Selon lui, l’ingérence fédérale dans les matières concurrentes était justifiable lorsqu’une problématique avait une portée générale[55]. Ainsi, pour le constituant britannique, l’article 95 accordait des compétences aux deux ordres de gouvernement, mais l’exercice de la compétence en matière d’immigration de l’autorité fédérale formait, en quelque sorte, une exception.
B. L’interprétation sommaire des tribunaux et la « disparition » de la compétence provinciale en matière d’immigration
L’interprétation judiciaire de la compétence concurrente en matière d’immigration ne reflète pas le travail effectué par les constituants avant l’adoption de l’AANB. Au moment même où le Conseil privé commençait à articuler les doctrines du fédéralisme canadien[56], les tribunaux canadiens développèrent une doctrine vouée à vider l’article 95 de son sens. Nous allons d’abord poser un regard critique sur les décisions de tribunaux canadiens face aux lois provinciales et à la loi fédérale en matière d’immigration. Ensuite, nous nous attarderons sur la jurisprudence récente relative à l’article 95, ce qui nécessitera d’examiner brièvement l’interprétation adoptée de manière générale par le Conseil privé et la Cour suprême en ce qui concerne les compétences concurrentes.
1. L’opérabilité des lois provinciales
Comme l’expliquent Henri Brun et Eugénie Brouillet, l’article 95 n’a pas reçu beaucoup d’attention de la part des tribunaux canadiens. Les premières décisions ont été rendues en réaction aux lois adoptées par la Colombie-Britannique au début du XXe siècle qui avaient un caractère particulièrement anti-asiatique[57]. Comme nous le verrons prochainement, le Parlement fédéral avait également adopté des mesures de ce genre[58].
Les deux premières décisions portant sur l’article 95 ont été rendues en 1908 par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[59], et n’ont pas été portées en appel à la Cour suprême ou au Conseil privé[60]. D’abord, dans In Re Nakane and Okazake, la Cour devait se prononcer sur l’opérabilité d’une loi provinciale portant sur l’immigration qui semblait contrevenir au traité international conclu entre l’Empire britannique et le Japon en 1907. Au sens de la loi provinciale, un agent provincial pouvait imposer un test linguistique aux candidats qui immigraient dans la province[61]. Pourtant, le traité avec le Japon, ratifié par le Parlement fédéral, assurait la libre circulation des peuples[62].
Bien qu’ils aient cité l’article 95 en entier à l’appui de leur décision, les tribunaux ne l’ont pas interprété. En fait, la mention de l’article 95 se résume à un obiter dicta puisque l’article 132 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui établissait le pouvoir du Parlement fédéral de donner effet aux obligations naissant de traités conclus entre l’Empire britannique et des pays étrangers, avait préséance à l’époque[63]. Le Parlement fédéral pouvait donc légiférer pour donner effet aux obligations internationales de l’Empire britannique. Ce n’était pas avant l’adoption du Statut de Westminster et l’obtention de la personnalité juridique du Canada à l’échelle internationale que l’article 132 a perdu sa raison d’être[64]. Ainsi, l’analyse de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’aurait pas force de précédent[65].
Cela dit, cet obiter consacrait une phrase à l’interprétation de l’article 95, alors que les juges y concluaient que l’article 95 offrait la possibilité aux deux ordres de gouvernement de légiférer en matière d’immigration. En situation de conflit, ils notaient que la prépondérance s’appliquerait de toute façon[66]. Aucune analyse juridique ne cernait l’intention du constituant telle qu’exprimée dans le texte. En fait, à la lumière des commentaires de Lord Carnarvon et de l’interprétation de l’article 95 subséquemment effectuée par la Cour, certaines affirmations du juge Clement dans cette affaire nous semblent pour le moins ironiques :
The minds of our best men were long occupied in fixing upon the proper line of diversion between matters of general or Canadian concern and matters of more immediately local or provincial concern, and the result of their labours as embodied in the British North America Act should be loyally recognized and respected [nos italiques].[67]
Suite à cette décision, la loi provinciale était inopérante « as far as the subjects of Japan [we]re concerned »[68].
Dans Reference Re Narain Singh, une décision qui a également été rendue en 1908, des immigrants ont similairement été détenus en Colombie-Britannique et ont subi un test linguistique qu’ils ont échoué, ce qui aurait eu pour effet de leur interdire l’entrée au Canada. Les demandeurs ont alors contesté l’opérabilité de la loi provinciale. Les juges de la Cour d’appel ont confirmé la décision du juge d’instance et, par ce fait, son interprétation de l’article 95[69]. À l’instar de ce qui a été fait dans In Re Nakane and Okazake, le juge d’instance a cité l’article 95 en entier avant de l’interpréter en une seule phrase : « sec. 95 [...] gives the Dominion the power in terms, and in terms enacts that in a domain where the two legislations meet, and the field is not clear, the Dominion legislation must prevail »[70]. Le juge n’a donc pas relevé le langage limitatif de l’article.
Dans son analyse, le juge appliquait une interprétation large de la prépondérance. À cette époque, comme l’explique Luanne Walton, la prépondérance s’appliquait soit selon la doctrine de l’« occupied field », soit selon celle de l’« express contradiction »[71]. Selon la doctrine du « occupied field », dès que le Parlement fédéral légiférait sur un sujet relevant de ses compétences, les lois provinciales en la matière étaient automatiquement inopérantes[72]. Aucun conflit direct n’était nécessaire selon cette doctrine, et c’est cette dernière qui a été favorisée par le juge d’instance :
Then sec. 30 [of the federal law] enacts: “The Governor in council may, by proclamation or order, whenever he considers it necessary or expedient, prohibit the landing in Canada of any specified class of immigrants, of which due notice shall be given to the transportation companies. [...] The remainder of the field is thus, as it were, pre-empted, shewing, in my opinion, that the Parliament of Canada intended to deal exclusively with the question of immigration into Canada [nos italiques].[73]
Une discrétion reconnue au gouverneur en conseil a donc été interprétée comme occupant le champ en matière d’immigration[74]. Le juge ignorait ce faisant l’importance que revêt l’existence d’un article distinct pour l’exercice des compétences concurrentes. Il justifiait son choix d’une interprétation large de la prépondérance en argumentant que la jurisprudence du Conseil privé créant la doctrine de la prépondérance pour les articles 91 et 92 était « inferential only », c’est-à-dire que le texte de la Constitution ne la prévoyait pas explicitement[75], contrairement à ce que prévoyait la deuxième moitié de l’article 95[76].
La doctrine de la prépondérance a évolué depuis cette décision, et a été clarifiée dans la trilogie de 2015[77], ce qui implique, à notre avis, qu’une interprétation moins large de celle-ci pourrait être adoptée à l’avenir[78]. Nous reviendrons sur l’impact de cette trilogie dans la dernière section de cet article. Par contre, à ce stade, il nous importe de souligner que ces arrêts ont constitué l’état du droit pendant pratiquement tout le XXe siècle[79].
Ces décisions eurent pour conséquence de rendre la loi de la Colombie-Britannique de 1908[80] inopérante, parce que le Parlement fédéral avait occupé le champ de compétence[81]. Il est aussi important de noter qu’à cette époque le gouvernement fédéral exerçait généreusement son pouvoir de désaveu[82]. Ainsi, la capacité de légiférer de la Colombie-Britannique était limitée par les tribunaux, ainsi que par l’ingérence du gouvernement fédéral[83]. De 1884 à 1908, la législature provinciale de la Colombie-Britannique a adopté neuf lois en matière d’immigration[84], et le gouvernement fédéral a exercé son pouvoir de désaveu à chaque fois[85]. La seule exception est survenue en 1907, lorsque le lieutenant-gouverneur de la province décida d’exercer son pouvoir de réserve—laissant ainsi le projet de loi entre les mains du gouverneur-général[86]. Cela dit, après qu’elle eut adopté la loi en question en 1908, les tribunaux ont mis fin à toute prétention de la province d’exercer sa compétence en matière d’immigration[87].
2. La validité de la loi fédérale
Dans In Re The Immigration Act and Munshi Singh, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a dû se prononcer sur la validité constitutionnelle de la loi fédérale sur l’immigration, et plus particulièrement sur la discrétion que cette dernière accordait au gouverneur en conseil d’exclure et d’expulser certains individus du Canada (incluant des sujets britanniques)[88]. La Cour a d’abord conclu, par l’entremise de motifs seriatim, que la répartition des compétences dans l’AANB était exhaustive, et que les seules compétences résiduelles attribuées au Parlement impérial étaient le pouvoir de désaveu, ainsi que le pouvoir de légiférer de manière expresse pour le Canada par l’entremise du mécanisme établi dans la Loi sur la validité des lois coloniales[89]. Puisque le Parlement britannique n’avait pas exercé ces pouvoirs relativement à l’immigration, la Cour concluait que le Canada pouvait refuser l’accès à des sujets britanniques.
Ne restait qu’à établir quel ordre de gouvernement pouvait exercer cette compétence. Le tribunal, saisi de cette question, a interprété l’article 95 de façon aussi sommaire que dans les décisions relatives aux lois provinciales. Plutôt que de se baser sur le texte de l’article 95, les juges Macdonald, Irving, McPhillips et Galliher ont validé cet aspect de la loi fédérale en vertu de la compétence prévue à l’article 91(25), qui traite des « aubains »[90]. Seul le juge Martin voyait en l’article 95 le fondement constitutionnel exclusif de cet aspect de la loi fédérale. Cela dit, les juges Macdonald[91], Irving[92], Martin[93] et McPhillips[94] concluaient tous, directement ou indirectement, que cet aspect de la loi fédérale trouvait également son fondement à l’article 95. Le juge Martin précisait notamment la chose suivante à cet égard :
...it was conceded at the end of the argument (as it ought to have been at the beginning) that since the Federal Parliament has already occupied the common field of legislation conferred upon both the Federal and Provincial Parliaments by s. 95 of The B.N.A. Act, therefore the authority of the former must prevail.[95]
L’interprétation favorisée dans ce pourvoi était donc identique à celle articulée dans les décisions précédentes. La Cour d’appel suggérait que le Parlement fédéral et les législatures provinciales avaient des compétences législatives identiques en matière d’immigration. Cela étant, l’adoption de lois fédérales à cet effet rendait incompatible toute loi provinciale sur la question (étant donné que, par leur adoption, le gouvernement fédéral occupait le champ). Ici, les juges ne semblent avoir procédé à aucune analyse historique et littérale pour déceler le caractère juridique particulier de l’article 95. En fait, dans cette affaire, l’article 95 n’a même pas été cité dans son entièreté. Comme nous l’expliquerons dans la seconde partie, l’interprétation historique ne fut pas privilégiée avant la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui explique en partie l’approche alors adoptée par les tribunaux.
3. L’interprétation judiciaire récente de l’article 95
Entre 1914 et 1998, les tribunaux n’ont rendu aucune décision en matière d’immigration interprétant l’article 95[96]. Or, en 1998, dans l’affaire Fan, la Cour fédérale a interprété l’article 95 en une seule phrase qui tenait pour acquis que la compétence fédérale et la compétence provinciale en matière d’immigration étaient identiques, et que la prépondérance s’appliquerait en situation de conflit[97].
Ensuite, dans l’affaire Law Society (Colombie-Britannique) c. Mangat, le juge Gonthier offrit une interprétation tout aussi sommaire de l’article 95, affirmant en obiter:
Bien que j’aie décidé que, de par leur caractère véritable, les dispositions en cause ont trait à la naturalisation et aux aubains dont il est question au par. 91(25), l’immigration relève en général de la compétence concurrente du fédéral et des provinces[98].
Cela dit, tout en appliquant une interprétation large, mais modifiée, de la prépondérance[99], le juge Gonthier ajoutait, au sujet de l’immigration, qu’« il n’y a pas de ligne de démarcation claire entre la compétence fédérale et la compétence provinciale en la matière »[100]. L’interprétation était informée par les décisions rendues près de cent ans plus tôt (que nous avons mentionnées précédemment)[101]. Or, tel que nous l’avons démontré, nous sommes d’avis que l’interprétation de l’article 95 dans ces affaires était inadéquate.
Malgré le peu de jurisprudence en matière d’immigration, la Cour suprême et le Conseil privé se sont prononcés sur l’article 95 en matière d’agriculture à quelques reprises, mais toujours de manière très sommaire[102]. En 1932, le Conseil privé statuait simplement que l’article 95 conférait aux provinces le droit de légiférer « so long as [the laws] are not repugnant to any existing law of the Dominion »[103]. En 1948, la Cour suprême affirmait que « it is not within the competence of the respective provincial legislatures to enact legislation in this regard when Parliament has already covered the field »[104]. En aucun cas la limitation selon laquelle le Parlement fédéral ne peut légiférer que « de temps à autre » n’est relevée. Par exemple, un examen des mémoires déposés à la Cour suprême dans les affaires portant sur l’article 95 démontre que les avocats n’ont pas plaidé qu’il devrait y avoir une distinction entre les compétences fédérales et provinciales prévues à l’article 95 en raison de l’historique de son adoption et de sa formulation distincte[105]. Il importe de noter que cela n’a été fait ni avant ni après la mise de côté de la règle d’exclusion des débats parlementaires[106].
C. L’interaction sur le terrain et le développement d’un rapport de force favorable à l’autorité fédérale
Selon Davies Bagambiire, le Parlement fédéral a, depuis l’entrée en vigueur de la première loi fédérale sur l’immigration en 1869[107], occupé le champ relatif à l’immigration au Canada[108]. Seulement trois provinces, soit la Colombie-Britannique au tournant du XXe siècle et en 2015, le Québec depuis 1968, et l’Ontario depuis 2015, ont adopté des lois en matière d’immigration[109]. L’ancienne loi provinciale en Colombie-Britannique a été jugée inopérante en vertu de la prépondérance. Les lois provinciales plus récentes n’ont pas fait l’objet de contestation judiciaire[110]. Les pages qui suivent font état du développement d’un rapport de force favorable au Parlement fédéral dans l’exercice de la compétence en matière d’immigration. Nous procéderons en deux temps, et traiterons d’abord de la période précédant 1960, avant de procéder à une analyse des 60 dernières années.
1. L’exercice de la compétence en matière d’immigration jusqu’en 1960
Il est particulièrement intéressant de noter que la première loi fédérale en matière d’immigration, adoptée deux ans après la (Con)fédération, renvoie à ce qui était probablement la première entente intergouvernementale de l’histoire du Canada[111]. Le préambule de la loi prévoyait la chose suivante :
Whereas the concurrent jurisdiction given to Canada and to the Provinces by the 95th section of the British North America Act, 1867, is, according to arrangements arrived at by the different governments concerned, to be exercised as follows, namely,—the Canada Government to maintain an Immigration Office at London, in England, and to have other Offices in the United Kingdom as it may think proper, from time to time; and to maintain Quarantine stations [...];—the Provincial Governments to determine their policy concerning the settlement and colonization of uncultivated lands, as bearing on Immigration; and to appoint agents in Europe and elsewhere as they may think proper, who shall be duly accredited by the Canada Government [...]; conferences of delegates of the Canadian and Provincial Governments to be convened from time to time, at the office of the Minister of Agriculture, by the Governor in Council, at the request of one or more of the Provincial Governments or without such request [nos italiques].[112]
De nombreuses rencontres intergouvernementales portant sur l’immigration ont eu lieu dans les années suivant la (Con)fédération[113]. L’autorité fédérale de l’époque n’agissait donc pas de manière unilatérale[114]. Cela dit, aucune loi fédérale subséquente ne mentionna le rôle des provinces en matière d’immigration, sauf les lois postérieures à 1976 qui prévoyaient la négociation d’ententes intergouvernementales au besoin[115]. Autrement dit, avant cette date, le Parlement fédéral affirmait son rôle à la fois dominant et exclusif dans ce domaine, et la jurisprudence n’a fait qu’alimenter cette position.
Conséquemment, le Parlement fédéral a, jusqu’en 1960, occupé le champ de façon exclusive[116]. Selon Henri Brun et Eugénie Brouillet, la passivité des entités fédérées s’explique en partie par les difficultés économiques vécues par les provinces entre la Première Guerre mondiale et les années 1960[117]. Robert Vineberg offre une vision plus globale et explique que quatre facteurs principaux conditionnaient le retrait provincial en la matière. Le premier est que l’autorité fédérale souhaitait se concentrer sur le peuplement des Territoires du Nord-Ouest (qui englobaient à l’époque une grande partie du Manitoba d’aujourd’hui), ce qui la mena à exclure les agents provinciaux de la sélection de candidats qui s’effectuait par le biais des bureaux canadiens à l’étranger; le second correspond à la fin de la période d’immigration ouverte, conséquence des deux guerres mondiales; le troisième renvoi au désir plus général de l’autorité fédérale de s’imposer en la matière; et, finalement, le quatrième est lié aux problèmes économiques importants des provinces au début du XXe siècle[118].
Au surplus, Mireille Paquet suggère que ce retrait s’explique principalement par un désir provincial d’éviter toute action publique en matière d’immigration[119]. Elle s’appuie notamment sur l’analyse de Freda Hawkins, qui attribue en partie la position dominante du Parlement fédéral à son rôle historique dans l’édification du Canada; au lien existant entre l’immigration et les relations étrangères; au fait que, pour certaines provinces, l’immigration n’avait pas une grande importance, puisque ces dernières ne recevaient qu’un nombre négligeable d’immigrants chaque année; et au fait que les provinces ne voulaient pas s’impliquer en la matière puisqu’elles n’avaient pas les ressources nécessaires[120].
Sans être en désaccord avec ceux qui avancent ces positions, il faut noter qu’ils négligent de mentionner qu’au tout début de la (Con)fédération, le gouvernement fédéral avait également exercé de façon soutenue son pouvoir de désaveu, ce qui a créé un climat d’exclusivité fédérale en matière d’immigration[121]. Bien sûr, le désaveu fédéral n’a pas été utilisé jusqu’en 1960. Nous estimons qu’il a néanmoins joué un rôle dans le retrait des provinces en matière d’immigration parce qu’il signalait implicitement l’intention du Parlement fédéral de s’emparer de cette compétence[122].
C’est donc dire qu’une variété de facteurs, incluant la jurisprudence précédemment examinée et les gestes unilatéraux de l’autorité fédérale en la matière, expliquent le retrait provincial au fil du temps. Cependant, il ne faut pas, non plus, sous-estimer le rôle qu’ont joué les actions de l’autorité fédérale au tournant du XXe siècle. Tel que mentionné précédemment, les provinces étaient activement impliquées en matière d’immigration après 1867—ayant même eu des agents de sélection de candidats à l’étranger[123]. À l’époque, les provinces ne semblent avoir senti aucun besoin d’adopter des lois en la matière puisque le processus de naturalisation demeurait de compétence fédérale, sinon impériale[124]. Elles n’avaient qu’à faire la sélection informelle de candidats à travers leurs agents à l’étranger. C’est dire qu’il n’y avait pas de système complexe de sélection à l’époque. Seule la Colombie-Britannique devait absolument passer des lois afin d’imposer des critères de sélection.
Il faut d’ailleurs souligner une distinction importante au niveau juridique. L’interprétation de l’article 95 qui est proposée dans ce texte n’aurait pas empêché le contrôle fédéral de l’immigration dans l’Ouest canadien. En 1869, après avoir acheté la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest de la Compagnie de la Baie d’Hudson, l’autorité fédérale exerçait un contrôle exclusif sur ces terres[125]. Ainsi, le pouvoir normatif accordé au Parlement fédéral était identique à celui qu’il possède présentement relativement aux trois territoires[126]. La compétence en matière d’immigration relevait donc uniquement du Parlement sur ces terres[127]. Même si la province du Manitoba avait été créée en 1870, l’étendue de son territoire était limitée à l’époque[128]. De plus, W. H. McConnell affirme que le Parlement fédéral exerçait un contrôle important sur l’Ouest canadien en raison de la répartition des compétences qui, à l’époque, dérogeait à l’architecture égalitaire de la fédération canadienne :
When Manitoba was admitted in 1870, however, and when Alberta and Saskatchewan were admitted in 1905, the control of their public domain remained vested in the federal Crown. The dual goals of the settlement of the vast, empty interior of the country and the building of a transcontinental railroad, which confronted Macdonald, could be achieved, in the opinion of the government, only by a generous lands policy, centrally administered, with immigrant and other settlers and railroad magnates being the principal beneficiaries.[129]
Ce n’est qu’avec l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, en pleine dépression économique, que les provinces de l’Ouest se virent octroyer un contrôle sur les terres de la Couronne similaire à celui des autres provinces[130]. Bien sûr, après leur création, la Saskatchewan, l’Alberta et le Manitoba[131] auraient quand même pu exercer leur compétence législative en matière d’immigration, mais, comme nous l’avons démontré, un climat d’exclusivité fédérale émergeait alors[132]. Ce climat a d’ailleurs été renforcé par la jurisprudence de 1908[133].
Il faut aussi noter que l’analyse ici proposée ne remet aucunement en question le pouvoir du Parlement fédéral d’exercer la compétence prévue à l’article 91(25) de la Loi constitutionnelle de 1867, et d’exclure les « aubains » (particulièrement en temps de guerre)[134].
Cela étant, les difficultés économiques vécues par les provinces au début du XXe siècle, qui les ont incitées à abandonner leur compétence en matière d’immigration et à accepter l’ingérence fédérale en la matière, ne devraient avoir aucun impact sur l’interprétation constitutionnelle de l’article 95. En effet, comme l’a souligné le Conseil privé dans les années 1930, les difficultés économiques des provinces ne justifient pas, d’un point de vue constitutionnel, l’ingérence fédérale dans un domaine de compétence qui relève d’abord des provinces, à moins qu’il y ait des modifications constitutionnelles[135]. Toutefois, soulignons que cela n’affecte en rien la possibilité pour les provinces de prévoir des délégations administratives[136].
2. L’exercice de la compétence en matière d’immigration depuis 1960
C’est à partir des années 1960 que les provinces recommencèrent à s’intéresser à leur compétence en matière d’immigration[137]. La Révolution tranquille ayant modifié le climat politique de la province du Québec, cette dernière revendiqua un plus grand contrôle sur l’immigration, qui « ét[ait] considérée comme un outil potentiel pour améliorer l’influence économique de la province et [...] préserver, sinon amplifier, la langue et la culture française » [notre traduction][138]. Grâce à la négociation d’un accord administratif en 1971, le gouvernement du Québec put, à partir de ce moment, placer des agents de la province dans les bureaux canadiens à l’étranger[139]. De plus, plusieurs autres accords furent ensuite signés dans le but de donner une plus grande place à la province en matière d’immigration[140]. Finalement, en 1991, le gouvernement fédéral reconnut le rôle du Québec en matière d’immigration par l’entremise d’une entente visant à protéger ses intérêts linguistiques et culturels[141].
Aujourd’hui, le Québec exerce un contrôle exclusif sur la sélection d’immigrants économiques[142]. Le fédéral, quant à lui, conserve une position importante en matière de réfugiés et en ce qui concerne le programme de réunifications familiales. La sélection des réfugiés est, en pratique, une compétence partagée puisque le fédéral s’assure de consulter le gouvernement du Québec sur la question[143]. L’autorité fédérale a ultimement le pouvoir de déterminer qui est un réfugié au sens de la loi, et le consentement du Québec n’est pas requis si une personne obtient le statut de réfugié alors qu’elle est déjà en territoire québécois. Cela étant, les réfugiés qui ne sont pas encore au Canada, et qui souhaiteraient s’établir au Québec, doivent également satisfaire aux critères de sélection propres à la province[144]. En matière de regroupement familial, c’est l’autorité fédérale qui établit les critères de sélection et qui gère les demandes de parrainage. Si l’autorité fédérale juge que la demande est recevable, l’immigrant en question doit poursuivre ses démarches auprès du gouvernement du Québec[145].
Depuis 1990, le gouvernement fédéral a aussi conclu des ententes intergouvernementales avec les autres provinces qui continuent de régir de manière partiellement asymétrique l’exercice de la compétence relative à l’immigration[146]. Il est donc possible d’avancer, à l’instar de Mireille Paquet, qu’il y a eu, au cours des trente dernières années, un regain d’intérêt des provinces dans le domaine[147]. Par contre, contrairement au Québec, les autres provinces ne jouent aucun rôle formel dans la sélection de réfugiés, et ne sont pas impliquées dans l’application des critères de sélection établis par l’autorité fédérale en ce qui concerne le regroupement des familles. L’implication de ces provinces en matière d’immigration passe surtout par la sélection de certains immigrants économiques à travers le Programme des candidats des provinces (« PCP »), qui inclut l’Entrée express depuis 2015[148]. L’Entrée express est un programme assez unique puisqu’il permet aux provinces (hormis le Québec) de sélectionner des candidats prioritaires préalablement identifiés par le gouvernement fédéral. En sélectionnant certains candidats, les provinces augmentent considérablement les chances d’un immigrant d’être ultimement accepté par le gouvernement fédéral[149]. Certaines provinces ont également modifié leur PCP afin de favoriser la sélection de candidats ayant des liens familiaux dans la province[150].
À l’heure actuelle, les immigrants potentiels peuvent déposer leur candidature auprès des provinces. Lorsque ces dernières sélectionnent certains individus, l’autorité fédérale veille à ce que les candidats choisis remplissent les critères d’admissibilité prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les règlements pertinents (qui incluent notamment les règlements en matière de sécurité, de santé et de criminalité) avant de leur octroyer la résidence permanente[151]. En plus d’exercer cette fonction, l’autorité fédérale impose également un cap sur le nombre d’immigrants qui peuvent être sélectionnés par les provinces par le biais du PCP.
Si ce bref survol du rôle joué par différentes provinces en matière d’immigration permet l’identification d’une certaine asymétrie au sein de la fédération, cette dernière est tributaire du fait qu’il existe « quatre logiques dominantes d’intervention en immigration et en intégration » : d’abord, le Québec et le Manitoba favorisent un « mode d’intervention holiste », c’est-à-dire qu’elles se distinguent, entre autres, par des interventions plus importantes dans la sélection et l’intégration de leurs candidats[152]. Ensuite, l’Alberta et la Saskatchewan sont caractérisées par un « mode de passerelle », c’est-à-dire qu’elles choisissent leurs candidats en collaboration avec le secteur privé. L’accent est donc mis, au sein de ces provinces, sur la sélection de candidats pouvant combler certains besoins économiques[153]. Les approches de l’Ontario et la Colombie-Britannique, quant à elles, sont plutôt caractérisées par un mode d’intervention « réactif », étant donné qu’elles reçoivent des immigrants sans y mettre autant d’effort que les autres provinces. Leurs activités dans ce domaine sont relativement limitées puisqu’elles attribuent « une responsabilité large à la société civile et, dans certains cas, au marché »[154]. Finalement, le « mode attraction-rétention » caractérise l’approche adoptée par les provinces atlantiques, et a pour objectif la sélection d’immigrants qui resteront dans leur province d’adoption. Ces provinces perçoivent donc l’immigration comme étant cruciale au renouvellement et à la survie de leur population[155]. Malgré leurs différentes approches, toutes les provinces identifient l’immigration comme « une ressource incontournable », et plusieurs se sont récemment détachées de leur mode d’intervention traditionnel en la matière[156].
S’il est possible d’attribuer le rôle accru des provinces à une série d’accords bilatéraux, Robert Schertzer vient nuancer ce propos en soulignant le rôle grandissant—et plus récent—de la collaboration multilatérale à l’extérieur du Québec[157]. Plus précisément, ce multilatéralisme est incarné par le document Vision fédérale-provinciale-territoriale commune de l’immigration, adopté en 2012, qui consolide le contenu de certaines institutions et réunions multilatérales ayant pour objet, selon le cas, la dimension politique ou la dimension administrative de l’immigration[158]. L’attrait d’une telle avenue, du point de vue des provinces, réside dans le fait qu’elle leur permet de faire front commun face au gouvernement fédéral[159].
Cela étant, bien que les provinces exercent un contrôle sur la sélection de certains immigrants et que la dimension concurrente de la compétence se reflète dans la pratique[160], la compétence de l’autorité fédérale en matière d’immigration demeure plus vaste que celle des provinces. De plus, en vertu de l’interprétation de l’article 95 qui prévaut actuellement, le Parlement et le gouvernement fédéral auraient toujours la possibilité d’exercer la compétence fédérale en matière d’immigration de manière à exclure les provinces[161]. Ce fut d’ailleurs le cas en 2012, lorsque le gouvernement a annulé certains aspects des ententes qu’il avait signées avec le Manitoba et la Colombie-Britannique[162]. Plus généralement, notons que le gouvernement fédéral continue également à limiter le nombre de candidats provinciaux, et ce, malgré les demandes répétées des provinces d’augmenter ou d’abandonner ce plafond[163]. Puis, l’expansion du programme des travailleurs étrangers temporaires et la création du programme d’Entrée express illustrent la volonté de l’autorité fédérale de s’imposer de plus en plus et de contourner le PCP[164]. En fait, Robert Schertzer explique que l’importance grandissante du multilatéralisme favorise également la centralisation du pouvoir, puisque « l’agenda multilatéral est largement “déterminé par l’agenda fédéral” » [notre traduction][165].
Certains suggèrent que le gouvernement fédéral ne pourrait pas mettre fin à l’entente signée avec le Québec en 1991 puisque cette dernière contient une clause interdisant la modification ou la résiliation de l’entente sans le consentement des deux gouvernements. Cependant, comme le souligne à juste titre Marc-André Turcotte, il n’est pas certain que les tribunaux donneraient effet à cette clause[166], et il est fort probable que, dans de telles circonstances, le principe de la souveraineté parlementaire l’emporterait sur les clauses limitatives présentes dans les ententes signées par différents ordres de gouvernement.
L’histoire constitutionnelle démontre qu’il ne faut pas tenir pour acquis qu’un acteur gouvernemental agit dans sa sphère de compétence. Or, c’est ce que les tribunaux et les constitutionnalistes ont présumé au sujet de la compétence fédérale prédominante, voire exclusive, en matière d’immigration[167]. Aucun argument juridique n’a été soulevé depuis 1908 pour limiter l’exercice du pouvoir fédéral dans ce domaine[168]. Conséquemment, un rapport de force favorable à l’autorité fédérale en matière constitutionnelle s’est développé sur le terrain. Après 1960, les provinces ont dû se contenter de conclure des ententes intergouvernementales avec l’autorité fédérale[169] pour exercer une compétence qui, comme le démontrent la Loi constitutionnelle de 1867 et les débats du Parlement britannique, devait d’abord être du ressort de leurs législatures. Seuls le Québec, depuis 1968, l’Ontario et la Colombie-Britannique, depuis 2015, ont su exercer leur compétence législative en la matière, mais, tel que mentionné précédemment, la jurisprudence soulève des doutes quant à l’opérabilité de ces lois[170].
II. Vers une interprétation plus étoffée des compétences concurrentes : prendre la Constitution et le fédéralisme au sérieux
Dans les pages qui suivent, nous proposons une interprétation des compétences concurrentes qui nous semble plus fidèle au texte de la Loi constitutionnelle de 1867. Nous allons ensuite nous pencher sur les questions de stabilité juridique qui s’imposent dès que les tribunaux revisitent un précédent. Finalement, une interprétation qui respecte le cadre du fédéralisme canadien sera proposée pour l’exercice des compétences concurrentes.
A. Une lecture de l’article 95 qui maintienne la cohérence interne de la Loi constitutionnelle de 1867
Dans la première partie, nous avons démontré que le constituant envisageait en matière d’immigration une compétence qui allait s’exercer au niveau local, c’est-à-dire provincial. L’analyse historique démontre qu’elle s’est exercée autrement, et ce, bien que les provinces aient récemment occupé une partie du « champ » par l’entremise d’ententes intergouvernementales conclues avec le gouvernement fédéral. En effet, en vertu de l’interprétation constitutionnelle actuelle, l’autorité fédérale pourrait choisir d’exercer ses compétences de manière à exclure celles des provinces[171]. La présente section se penchera sur le regain d’intérêt de la Cour suprême pour l’interprétation historique; et proposera une approche littérale qui, de par sa contribution à la cohérence interne de la Loi constitutionnelle de 1867, permettrait une nouvelle interprétation de l’article 95.
1. L’interprétation historique de la Loi constitutionnelle de 1867
Les anciens juges de la Cour suprême Louis-Philippe Pigeon et Ian Binnie notent que la théorie qui cherche à retrouver l’intention des Pères de la (Con)fédération (« historical construction ») a été, en large partie, exclue du discours canadien portant sur l’interprétation constitutionnelle[172]. La prise en compte de l’historique entourant l’adoption d’une norme a rarement été privilégiée dans la jurisprudence, surtout depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, qui a favorisé la méthode téléologique et la méthode évolutive[173]. La méthode historique a néanmoins fait partie du cadre d’analyse interprétatif[174], et a fait un retour en force dans la jurisprudence de la Cour suprême[175].
Dans ses décisions récentes, la Cour s’est inspirée d’une interprétation historique en affirmant les « “objectif[s] sous-jacent[s]” » de nos textes constitutionnels pour protéger les institutions au coeur de notre démocratie[176]. Dans le Renvoi relatif à la réforme du Sénat, par exemple, la Cour considérait explicitement l’intention de certains Pères de la (Con)fédération et des rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1982[177]. Elle l’a fait également dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, lorsqu’elle abordait la question de l’importance du droit civil et du pacte menant à l’adoption de cette loi[178]. Et, tel que mentionné dans la première partie, elle affirmait explicitement que son cadre général d’interprétation est inspiré des « contextes linguistique, philosophique et historique »[179].
Ainsi, la règle d’exclusion, selon laquelle l’interprétation statutaire et constitutionnelle écarterait le recours à l’historique législatif, a été mise de côté par la jurisprudence[180]. Cette règle a d’abord été remise en cause dans le Renvoi relatif à la Loi anti-inflation[181], avant d’être rejetée dans l’arrêt Morgentaler :
L’ancienne règle d’exclusion touchant la preuve de l’historique d’un texte législatif a été graduellement assouplie [...], mais jusqu’à récemment, les tribunaux ont hésité à admettre la preuve des débats et des discours devant le corps législatif. [...] La principale critique dont a été l’objet ce type de preuve a été qu’elle ne saurait représenter l’« intention » de la législature, personne morale, mais c’est aussi vrai pour d’autres formes de contexte d’adoption d’une loi. À la condition que le tribunal n’oublie pas que la fiabilité et le poids des débats parlementaires sont limités, il devrait les admettre comme étant pertinents quant au contexte et quant à l’objet du texte législatif. En effet, il semble désormais bien établi qu’ils sont admissibles dans les affaires constitutionnelles car ils aident le tribunal à déterminer le contexte et l’objet du texte.[182]
Le présent article vise justement à justifier une nouvelle interprétation de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 à la lumière de documents historiques. Quoique la preuve historique ne devrait pas être déterminante[183], elle permet de comprendre le contexte dans lequel l’article final fut adopté.
Il va sans dire que l’approche interprétative actuelle de la Cour suprême présente des incohérences multiples d’une décision à l’autre. Effectivement, la Cour approche souvent les théories d’interprétation constitutionnelle comme si elle était placée devant un buffet, ce que Léonid Sirota et Benjamin Oliphant soulignent à juste titre dans leurs articles sur la question[184]. Cela étant, malgré ses commentaires indiquant le contraire, la Cour s’est montrée ouverte à recourir à une approche originaliste moderne dans plusieurs décisions[185]. Cette dernière théorie d’interprétation constitutionnelle n’est pas en contradiction avec une approche jurisprudentielle qui reconnaît une société changeante[186]. Il faut, comme le souligne Lawrence Solum, faire une distinction entre l’interprétation constitutionnelle et la « construction » constitutionnelle[187]. L’interprétation constitutionnelle implique une recherche du « contenu communicatif » ou de la « signification linguistique » du texte constitutionnel au moment de son adoption; alors que la « construction » constitutionnelle est l’activité qui, à partir de la signification linguistique d’une disposition, détermine son effet juridique par la création de doctrines de droit constitutionnel. Bien évidemment, la « construction » se produit également quand le texte constitutionnel est appliqué à de nouvelles situations ou à de nouveaux phénomènes.
Par exemple, dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance-emploi, la juge Marie Deschamps, écrivant pour la Cour, a rejeté une approche fondée sur les attentes originelles quant à l’application des articles de la Loi constitutionnelle de 1867[188]. Elle affirmait cependant que « [l]es débats ou les échanges de correspondance entourant la modification constitutionnelle sont pertinents pour l’analyse quant au contexte, mais ils ne peuvent dicter l’étendue exacte de la compétence législative » [nos italiques][189]. Autrement dit, selon la juge Deschamps, la preuve historique n’est pas déterminante, mais elle permet néanmoins d’éclaircir le contexte en matière de répartition des compétences législatives.
La méthode « évolutive » s’applique, selon elle, à l’étendue d’une compétence, qui peut changer à la lumière de nouveaux phénomènes. Son approche ne modifie pas cependant la répartition des compétences elle-même, comme le voudrait une méthode évolutive[190]. La juge Deschamps appliquait plutôt la compétence fédérale en matière d’assurance-emploi, prévue dans le texte de la Constitution, à de nouveaux phénomènes pour y inclure « certains changements factuels dans une société qui évolue, dont la participation grandissante des femmes sur le marché du travail dans le cas en l’espèce » [notre traduction][191].
Contrairement à ce que prétendait la juge Deschamps[192], son approche interprétative dans cette affaire était plutôt originaliste. Il importe de faire la distinction entre la méthode historique pure (« original intent »)[193] et la méthode littérale (« original public meaning »)[194], cette dernière se rapportant à l’approche originaliste moderne (« New Originalism »)[195]. Bien qu’elle délaissât clairement la première méthode, la juge Deschamps adoptait inconsciemment la seconde[196]. Notons aussi que cet arrêt ne constitue pas un cas isolé, la majorité de la Cour suprême reprenant notamment une approche similaire dans l’arrêt Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters[197].
À la lumière de ces faits, il nous semble juste d’affirmer que le contexte historique est pertinent dès lors qu’il est question d’interprétation constitutionnelle au Canada. En effet, ce contexte permet de mieux comprendre la signification originale des mots employés dans le texte de la Constitution, sans toutefois être contraignant lorsque des indicateurs textuels suggèrent une autre interprétation[198]. Or, comme nous l’avons suggéré, une analyse historique fait ressortir que la compétence en matière d’immigration devait d’abord être du ressort des provinces. Et ce fait explique notamment pourquoi le constituant britannique a utilisé les mots « de temps à autre », qui limitent la capacité législative du Parlement fédéral, à l’article 95.
2. L’interprétation littérale de la Loi constitutionnelle de 1867
Certains pourraient prétendre que les propos de Lord Carnarvon laissent la porte ouverte à une intervention plus large et plus permanente de l’autorité fédérale en matière d’immigration dépendamment de l’évolution de la fédération, et que l’article 95, à la lumière de l’intention du constituant, ne serait pas justiciable. Cela étant, comme nous l’avons soulevé précédemment, l’intention du constituant ne peut que mettre la rédaction en contexte en nous permettant de mieux comprendre pourquoi le constituant a choisi les mots précis que l’on retrouve dans la disposition à l’étude. Ultimement, c’est l’interprétation littérale qui doit prévaloir. En fait, la Cour suprême a, à de maintes reprises, réitéré la primauté de notre Constitution écrite[199]. Cette dernière méthode n’empêche pas les tribunaux de considérer le contexte actuel en donnant effet à la disposition au stade de la « construction » constitutionnelle[200].
Les méthodes historique et littérale sont donc complémentaires, mais les articles doivent être interprétés à la lumière du texte final de la Constitution. Par exemple, Lord Sankey, dans Edwards, écrivait la chose suivante : « If Parliament had intended to limit the word “persons” in s. 24 to male persons it would surely have manifested such intention by an express limitation, as it has done in ss. 41 and 84 »[201]. Comme l’explique Bradley Miller, le Conseil privé, dans Edwards, a mis l’accent sur « the internal evidence derived from the Act itself » pour en venir à sa conclusion[202]. Tel qu’expliqué par Lord Sankey, « the question is not what may be supposed to have been intended, but what has been said »[203]. Conséquemment, une analyse directe de la formulation de l’article 95, ainsi que du reste de la Loi constitutionnelle de 1867 qui informe son interprétation, semble nécessaire[204].
L’expression « from time to time » est utilisée à vingt-quatre reprises dans la Loi constitutionnelle de 1867[205]. En général, les articles l’utilisant décrivent la discrétion conférée à la gouverneure-générale et aux lieutenants-gouverneurs dans l’exécution de leurs fonctions, c’est-à-dire qu’ils permettent une intervention occasionnelle du pouvoir exécutif. Par exemple, l’article 11 dispose de la chose suivante :
There shall be a Council to aid and advise in the Government of Canada, to be styled the Queen’s Privy Council for Canada; and the Persons who are to be Members of that Council shall be from Time to Time chosen and summoned by the Governor General and sworn in as Privy Councillors, and Members thereof may be from Time to Time removed by the Governor General. [nos italiques][206]
Ces articles suggèrent tous que l’exercice de la discrétion accordée ne se fait pas de manière constante, mais bien de manière occasionnelle. Dans certains cas, la Constitution ne traite pas de l’exercice d’un pouvoir qui se manifeste « de temps à autre », mais plutôt d’un changement qui doit s’opérer « de temps à autre ». Par exemple, l’article relatif au serment d’allégeance prévu à l’annexe cinq de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce que « [t]he Name of the King or Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland for the Time being is to be substituted from Time to Time, with proper Terms of Reference thereto » [italiques dans l’original, nos soulignements][207]. Dans tous les cas, le constituant confère un pouvoir discrétionnaire qui s’exerce occasionnellement.
Cependant, il incombe de reconnaître que dans tous les articles à l’exception des articles 93 et 95 ce pouvoir n’est accordé qu’à un seul acteur (généralement issu de la branche exécutive), et n’entre jamais en conflit avec le pouvoir accordé à un autre acteur constitutionnel. Il va sans dire que ce fait rend difficile toute comparaison entre l’article 95 et les autres articles employant la même formulation.
Par contre, il nous semble logique d’attribuer à l’expression « de temps à autre » une portée semblable, mais distincte, dans le contexte du fédéralisme. Seuls deux articles portant sur la répartition des compétences législatives utilisent cette expression, soit les articles 93 et 95. L’article 93 donne aux provinces une compétence exclusive en matière d’éducation, mais cette dernière est assujettie à des limites visant à promouvoir la diversité religieuse[208]. Le quatrième alinéa stipule que :
In case any such Provincial Law as from Time to Time seems to the Governor General in Council requisite for the due Execution of the Provisions of this Section is not made, or in case any Decision of the Governor General in Council on any Appeal under this Section is not duly executed by the proper Provincial Authority in that Behalf, then and in every such Case, and as far only as the Circumstances of each Case require, the Parliament of Canada may make remedial Laws for the due Execution of the Provisions of this Section and of any Decision of the Governor General in Council under this Section [nos italiques].[209]
Cet article confère donc au Parlement fédéral le pouvoir d’intervenir en matière d’éducation afin de donner effet aux protections religieuses offertes par la Constitution. En somme, le législateur fédéral peut intervenir pour remédier aux lacunes provinciales en matière de diversité religieuse—un sujet qui était particulièrement sensible au moment de la (Con)fédération[210].
De plus, il faut souligner que la capacité de l’autorité fédérale de légiférer en la matière n’est pas expressément limitée, l’article 93 précisant que « the Parliament of Canada may make remedial Laws for the due Execution of the Provisions of this Section and of any Decision of the Governor General in Council under this Section »[211]. L’article 95 diffère à cet égard, car il limite le pouvoir de légiférer : « the Parliament of Canada may from Time to Time make Laws in relation to Agriculture in all or any of the Provinces, and to Immigration into all or any of the Provinces » [nos italiques][212]. Il convient également de réitérer que les compétences législatives des provinces ne sont aucunement limitées par l’emploi de l’expression « de temps à autre » au sein de l’article 95. Or, ces mots, comme le démontrent également les débats ayant pris place au Parlement britannique, doivent recevoir un sens juridique.
Avant de procéder à la prochaine section, il importe de se pencher plus directement sur un contre-argument important, soit celui qu’une disposition comme l’article 95 n’est pas justiciable. Comme nous l’avons déjà noté, l’article 95 constitutionnalise une limite sur le pouvoir de légiférer, non pas une limite sur le pouvoir discrétionnaire accordé à un acteur de l’exécutif[213]. Comme toute limite aux compétences législatives de l’autorité fédérale, les tribunaux doivent y donner effet pour maintenir un juste équilibre entre les compétences fédérales et provinciales. Le fait que cette limite ne soit pas textuellement imposée à l’exercice des compétences concurrentes par les provinces milite fortement en faveur de sa justiciabilité. Accepter l’argument suggérant que l’article 95 n’est pas justiciable reviendrait à nier l’importance du contrôle de la constitutionnalité dans notre système, chose que la Cour suprême a rejetée à de nombreuses reprises[214]. Bref, contrairement à la Cour suprême de la Suisse[215], notre Cour suprême a le devoir d’interpréter et de donner effet à la répartition des compétences législatives, ainsi que d’invalider les lois fédérales qui ne s’y conforment pas.
B. Surmonter la « barre haute » du stare decisis
Il semble donc que l’article 95 ait été mal interprété par les tribunaux, surtout à la lumière des méthodes d’interprétation historique et littérale soulignées ci-haut. Néanmoins, il importe d’expliquer pourquoi les tribunaux, et plus spécifiquement la Cour suprême, devraient revisiter les précédents établis depuis 1908. Pour ce faire, nous aborderons d’abord la notion de primauté du droit, avant d’examiner la règle du stare decisis.
1. La loi fédérale en matière d’immigration et la primauté du droit
Les divers gouvernements canadiens ont tenu pour acquise leur compétence en matière d’immigration depuis 1908. De plus, la loi fédérale n’a pas été directement contestée depuis l’adoption de la première loi en 1869. Or, cette absence de contestation n’implique pas nécessairement qu’elle soit valide :
It is always with reluctance that their Lordships come to a conclusion adverse to the constitutional validity of any Canadian Statute that has been before the public for years as having been validly enacted, but the duty incumbent on the Judicial Committee, now as always, is simply to interpret the B.N.A. Act 1867, and to decide whether the statute in question has been within the competence of the Dominion Parliament.[216]
Par ailleurs, dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, la Cour suprême n’a pas hésité à déclarer inconstitutionnelles toutes les lois du Manitoba qui n’avaient pas été adoptées dans les deux langues officielles[217]. Dans l’affaire Re Aerial Navigation, Lord Sankey abondait dans le même sens :
The process of interpretation as the years go on ought not to be allowed to dim or to whittle down the provisions of the original contract upon which the federation was founded, nor is it legitimate that any judicial construction [...] should impose a new and different contract upon the federating bodies.[218]
La primauté du droit et de la Constitution permettrait donc au plus haut tribunal de déclarer invalide la loi fédérale sur l’immigration, dans la mesure où cette dernière empêche les provinces d’exercer leur propre compétence[219]. La Cour suprême serait ensuite en mesure de suspendre la prise d’effet de sa déclaration d’invalidité constitutionnelle pour une période de temps appropriée, question de donner aux législatures provinciales le temps nécessaire pour adopter leurs propres lois en la matière[220].
2. L’article 95 et la règle du stare decisis
Selon la règle du stare decisis, une décision tranchant sur une question de droit a valeur de précédent, et conditionne le raisonnement des tribunaux lorsqu’ils se penchent sur d’autres faits soulevant cette même question de droit[221]. L’interprétation de l’article 95 qui prévaut actuellement pourrait justement servir de fondement juridique dans un litige sur la validité de la loi fédérale en entier. La partie contestant la validité de la loi fédérale devra ainsi justifier le renversement des précédents.
La règle du stare decisis, issue de la common law, est composée de deux volets, soit le stare decisis vertical et le stare decisis horizontal. Dans le premier cas, la règle impose à un tribunal inférieur l’obligation de suivre les arrêts de tribunaux supérieurs. Dans le second cas, la règle impose au tribunal l’obligation de suivre les jugements ou les arrêts qu’il a précédemment rendus. Chaque volet a ses propres critères relativement à la remise en cause d’un précédent.
La Cour suprême a eu la chance de se prononcer sur la règle du stare decisis vertical dans les arrêts Bedford et Carter. Historiquement, ce volet de la règle a toujours été très rigide, c’est-à-dire que très peu de motifs permettaient à un tribunal d’écarter les précédents émanant de tribunaux supérieurs. Les décisions récentes de la Cour suprême marquent un changement majeur en la matière[222]. En effet, dans Bedford, l’ancienne juge en chef McLachlin affirmait la chose suivante :
... la règle du stare decisis propre à la common law est subordonnée à la Constitution et ne saurait avoir pour effet d’obliger un tribunal à valider une loi inconstitutionnelle [...]. [Donc,] une juridiction inférieure ne doit pas s’en tenir au rôle de “simple exécutant” qui constitue un dossier et tire[r] des conclusions sans se livrer à l’analyse du droit. [...] Rappelons que, selon moi, le réexamen est justifié lorsqu’une nouvelle question de droit se pose ou qu’il y a modification importante de la situation ou de la preuve.[223]
Cette approche a été réitérée dans l’arrêt Carter, la Cour suprême affirmant que la règle du stare decisis n’est pas « un carcan qui condamne le droit à l’inertie »[224]. La « barre est haute » pour réexaminer un précédent, mais dans certains cas « le réexamen est justifié »[225].
Un appel à revoir l’interprétation d’un autre article de la Loi constitutionnelle de 1867 à la lumière d’une preuve historique a été retenu par un juge du Nouveau-Brunswick en application de l’approche plus flexible développée par la Cour suprême en ce qui concerne la règle du stare decisis :
To my knowledge, in none of the cases dealing with section 121 has there been any evidence presented to the trier of fact, or to the appellate court, addressing the issues presented before me respecting the following topics: the drafting of the British North America Act, 1867, the legislative history of the Act, the scheme of the Act and its legislative context.[226]
Dans cette affaire, l’histoire et le contexte législatif ont permis au juge de première instance de mieux comprendre le texte de la Constitution, ce qui l’a amené à écarter un précédent datant de 1921.
Lorsqu’elle a été saisie de cette affaire, la Cour suprême a partiellement restreint les critères permettant d’écarter le précédent d’un tribunal supérieur qu’elle avait elle-même établis dans Carter et Bedford, tout en se livrant à sa propre analyse historique. Dans l’arrêt Comeau, la Cour suprême a statué que la preuve historique ne pouvait servir de justification aux tribunaux cherchant à écarter le précédent d’un tribunal supérieur :
Non seulement l’exception est-elle restreinte — la preuve doit « change[r] radicalement la donne » —, mais il ne s’agit pas d’une invitation générale à réexaminer les précédents qui font autorité sur le fondement de n’importe quel type de preuve. Comme le laisse entendre les arrêts Bedford et Carter, la preuve d’une évolution importante des faits législatifs et sociaux fondamentaux — « qui intéressent la société en général » — constitue un type de preuve qui peut radicalement changer la donne dans le débat juridique visé : Bedford, par. 48-49; Carter, par. 47. Ainsi, il a été jugé que l’exception s’applique lorsque le contexte social sous-jacent qui encadrait le débat juridique original examiné a profondément changé [italiques dans l’original].[227]
La Cour suprême a fermé la porte à la possibilité d’un réexamen historique des articles de la Constitution par des tribunaux inférieurs si les articles en question ont déjà fait l’objet d’un arrêt émanant d’un tribunal supérieur. Au nom de la stabilité juridique, la Cour considérait que dans l’éventualité où des erreurs de droit auraient été commises, ces dernières ne suffiraient pas pour que les tribunaux remettent en cause des précédents qui émanent d’instances supérieures.
En somme, les tribunaux inférieurs (ce qui inclut les tribunaux de première instance ainsi que les cours d’appel) ne pourraient pas adopter l’interprétation proposée par le présent article. L’argumentaire proposé pourrait certainement être mis de l’avant par les provinces souhaitant légiférer en matière d’immigration, mais il est fort probable que, même s’ils sont confrontés à la preuve historique étayée au sein du présent article, les juges refuseront d’écarter les précédents pertinents en vertu de la règle du stare decisis.
La seule décision de la Cour suprême en matière d’immigration n’a pas officiellement autorité de précédent, étant donné que l’interprétation de l’article 95 a été faite en obiter[228]. Par contre, les décisions de la Cour en matière d’agriculture—qui sont largement transposables au domaine de l’immigration—sont bel et bien des précédents liant les tribunaux inférieurs. Cependant, il convient de rappeler que l’interprétation de l’article 95 offerte par la Cour dans ces jugements est sommaire. En fait, selon nos recherches, aucune décision rendue par le Conseil privé ou la Cour suprême n’a conclu qu’une loi fédérale était valide en application de l’article 95. Cet article ne s’appliquait tout simplement pas. Néanmoins, les tribunaux inférieurs pourraient critiquer, en obiter, la force des précédents, et suggérer que, à la lumière de la preuve explorée au sein de cet article et de l’argumentaire mis de l’avant, les précédents applicables devraient être revisités. Une telle critique serait éminemment pertinente dans la mesure où la Cour suprême devrait alors entreprendre sa propre analyse de la question[229].
Cela étant, les critères applicables à la règle du stare decisis horizontal sont différents. Dans un tel contexte, la Cour suprême met l’accent sur les erreurs de droit, ce qui implique qu’elle pourrait elle-même revisiter ses précédents. Dans l’arrêt portant sur le Canadian Temperance Act, le Conseil privé expliquait d’ailleurs que :
Their Lordships do not doubt that in tendering humble advice to His Majesty they are not absolutely bound by previous decisions of the Board, as is the House of Lords by its own judgments. In ecclesiastical appeals, for instance, on more than one occasion, the Board has tendered advice contrary to that given in a previous case, which further historical research has shown to have been wrong [nos italiques].[230]
Même si le Conseil privé n’a pas souvent revisité ses précédents en matière constitutionnelle, il semble clair que ses juges encourageaient la considération de nouveaux arguments, et estimaient avoir le pouvoir de corriger ce qu’ils voyaient comme étant des erreurs de droit[231]. Puis, la Cour suprême s’est prononcée à quelques reprises sur les critères auxquels elle devait se conformer pour revisiter ses propres précédents. Dans l’affaire Craig c. Canada, le juge Marshall Rothstein, écrivant pour un banc unanime, expliquait que la Cour ne peut revisiter un précédent que si elle est convaincue « que la décision est erronée et qu’elle devrait être écartée »[232]. Ultimement, la Cour doit trouver un équilibre entre deux valeurs importantes, soit la justesse et la certitude[233].
Le présent article met en évidence ce qui nous semble être une erreur de droit à la lumière de la preuve historique qui, jusqu’à maintenant, n’a jamais été soulevée dans la littérature pertinente. D’ailleurs, notre recherche a indiqué que l’argument selon lequel la compétence du Parlement fédéral en matière d’immigration serait limitée par le texte même de la Constitution n’a jamais été plaidé.
Les décisions antérieures portant sur cette question devraient être écartées pour trois raisons principales. D’une part, les écarter donnerait effet au principe du fédéralisme tel qu’explicité par la Cour suprême et, d’autre part, la fédéralisation de l’immigration depuis les années 1960 démontre qu’une interprétation nouvelle n’aurait pas pour effet de détruire le système d’immigration canadien. Finalement, l’interprétation proposée, loin de miner la stabilité juridique, l’améliorerait dans ce domaine. Dans une éventuelle remise en cause de ses précédents, la Cour considérera assurément les analyses jurisprudentielles et doctrinales.
Sur le premier point, il faut noter que, dans l’arrêt Comeau, la Cour suprême s’est montrée réticente à adopter l’interprétation de l’intimé, notamment parce que cette interprétation aurait eu pour effet de miner le principe du fédéralisme. De son point de vue, l’interprétation proposée aurait mené à un déséquilibre dans la fédération, et aurait donné naissance à des lacunes constitutionnelles[234]. Contrairement à l’interprétation proposée dans Comeau, l’approche que nous suggérons vise, par la reconnaissance de « l’autonomie dont les gouvernements provinciaux disposent pour assurer le développement de leur société », à établir un meilleur équilibre constitutionnel dans la fédération[235].
Sur le second point, la fédéralisation graduelle de l’immigration que nous avons décrite dans la première partie démontre que l’interprétation proposée n’aurait pas pour effet de détruire le système d’immigration. Il pourrait y avoir des changements d’orientation dans chaque province, mais il ne faut pas perdre de vue que les provinces ont déjà investi une partie du « champ » par le truchement d’ententes intergouvernementales. Ces dernières sont donc déjà outillées pour prendre la relève dans la sélection de candidats à l’immigration. Conséquemment, la fédéralisation graduelle ayant pris place depuis 1960 vient donner du poids à l’argument constitutionnel mis de l’avant dans cet article.
Sur le troisième point, l’on pourrait soutenir que l’interprétation proposée ici contribuerait à améliorer la stabilité juridique dans ce domaine. Il est vrai, comme le relève Johanne Poirier, que les ententes intergouvernementales font généralement preuve d’une grande effectivité, et qu’elles « sont largement mises en oeuvre et respectées »[236]. Toutefois, en vertu du principe de la souveraineté parlementaire, ces ententes demeurent vulnérables face à une action législative unilatérale postérieure[237]. En effet, comme nous l’avons déjà souligné dans la première partie, le gouvernement fédéral a, en 2012, unilatéralement annulé certains aspects des ententes qu’il avait conclues avec le Manitoba et la Colombie-Britannique. L’interprétation proposée ici aurait pour effet, au minimum, de consolider constitutionnellement les gains faits par les provinces dans ce domaine, et de limiter l’incertitude juridique engendrée par des gestes unilatéraux.
De plus, l’approche proposée aurait pour effet de clarifier la situation juridique, particulièrement pour les acteurs concernés. Comme nous l’avons déjà noté, seules trois provinces ont adopté des lois en matière d’immigration, les autres ayant plutôt adopté des lois donnant à un ministre la possibilité de conclure des ententes avec l’autorité fédérale[238]. Cet état des lieux implique que le contrôle judiciaire de décisions administratives doit se faire en fonction d’ententes et de critères de sélection qui n’ont pas été codifiés par les législatures provinciales, et qui sont parfois difficilement accessibles[239]. En fait, il n’est pas entièrement clair que le contrôle judiciaire soit même juridiquement possible dans un tel contexte[240].
L’approche proposée obligerait les provinces à adopter des lois en matière d’immigration afin d’éviter un vide juridique. En fait, elles devraient déjà avoir adopté des lois en la matière en application des principes du droit public classique. La séparation des pouvoirs implique que l’exécutif ne peut légiférer par le biais d’une entente intergouvernementale, et que le droit interne d’une province ne peut, en principe, être modifié sans l’adoption d’une loi mettant l’entente en question en oeuvre[241]. Dans l’affaire The Manitoba Government Employees Association c. Manitoba et al, le juge Ritchie expliquait justement que les autorisations législatives générales attribuant à un ministre la possibilité de conclure des ententes intergouvernementales, telles que celles décrites ci-haut, ne donnaient pas automatiquement effet aux ententes, puisque cela constituerait « une délégation de pouvoirs législatifs équivalant à une renonciation de la législature à exercer son pouvoir fondamental d’adopter des lois »[242].
Cela étant, comme le note Johanne Poirier, la Cour suprême exprime des opinions contradictoires quant à la valeur normative qu’il faut accorder à ce genre d’ententes et aux critères à remplir afin de leur donner force de loi—chaque décision omettant de citer les autres, ou de revisiter les précédents pertinents en suivant les critères imposés par la règle du stare decisis horizontal[243]. Le résultat final semble être que, « lorsque les partenaires de la fédération ne contestent pas la valeur contraignante d’une entente, les tribunaux font montre d’un très grand degré de déférence pour les arrangements coopératifs »[244]. Par contre, le fait que ces ententes aient un statut juridique flou est source d’incertitude, et leur codification entraînerait une meilleure stabilité juridique en clarifiant les droits et les obligations de ceux voulant immigrer au Canada.
Malgré l’approche plus formelle mise de l’avant par la Cour suprême dans l’arrêt Craig, il faut souligner que la Cour revient souvent sur ses précédents de manière indirecte en révisant ou en modifiant sa jurisprudence antérieure. Parfois, c’est la méthodologie qui peut changer, alors que, dans d’autres cas, la Cour caractérise simplement les faits différemment afin de justifier l’atteinte d’un autre résultat[245].
En adoptant une approche plus indirecte, la Cour suprême et les tribunaux inférieurs pourraient clarifier ou nuancer la jurisprudence antérieure en définissant plus clairement la ligne de démarcation entre la compétence fédérale et la compétence provinciale en la matière. Il serait question ici de préciser la nature même de l’expression « compétence concurrente » au Canada, plutôt que d’écarter des précédents strictement parlant. Nico Steytler définit les trois types de compétences concurrentes explicites qui existent dans les fédérations du monde. D’abord, la compétence concurrente est « pure » lorsque les deux ordres de gouvernement ont les mêmes pouvoirs dans une sphère de compétence donnée, et ce, simultanément sur un même territoire. La compétence concurrente est dite « conditionnelle » lorsque le Parlement fédéral peut légiférer dans un domaine de compétence concurrente s’il satisfait certaines conditions. Finalement, la compétence concurrente est « complémentaire » lorsqu’elle confère au Parlement fédéral le pouvoir d’adopter une législation-cadre fournissant des principes généraux, que les entités fédérées peuvent ensuite compléter par l’adoption de lois plus détaillées qui leur sont propres[246]. Au Canada, l’interprétation judiciaire de l’article 95 a généré des compétences concurrentes pures, et ce, malgré les indicateurs historiques et textuels, qui suggèrent que les compétences concurrentes prévues à l’article 95 sont plutôt de nature conditionnelle[247]. Les tribunaux pourraient donc indirectement modifier ou clarifier les précédents en la matière en revoyant la notion de compétence concurrente.
C. Une nouvelle interprétation de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 : vers un rapport de force favorable aux provinces
Ayant conclu que les tribunaux pourraient revisiter les précédents en la matière, il importe maintenant de proposer un cadre d’analyse permettant de remplacer celui utilisé par les tribunaux pour donner effet à l’article 95, tout en tenant compte de l’impact de ce nouveau cadre sur le fédéralisme canadien.
1. Une nouvelle approche interprétative pour l’article 95
Nous avons soutenu, en proposant une interprétation historique et littérale, que les compétences prévues à l’article 95 sont des « subjects which, in their ordinary character, are local »[248], et que l’exercice de ces compétences par le Parlement fédéral ne devrait être qu’occasionnel. Dans l’arrêt Parsons, le Conseil privé précisait que les compétences législatives devaient être interprétées de manière à donner effet à chacune d’entre elles[249]. Une telle interprétation corrélative s’avère utile dans l’élaboration d’un cadre qui donnerait effet aux compétences respectives du Parlement fédéral et des entités fédérées.
En somme, une approche constitutionnelle originaliste moderne devrait être axée sur une méthode littérale informée par le contexte historique, le tout en respectant la primauté de la signification originale du texte (« original public meaning »). Ensuite, la Cour devrait, dans certaines situations, se tourner vers la « construction » constitutionnelle afin de créer des doctrines visant à donner effet au texte de la Constitution. En procédant à cette construction, la Cour peut, entre autres, tenir compte du contexte historique et des principes fondamentaux de la Constitution—chose qui serait particulièrement appropriée dans le cas présent (étant donné que le constituant semble avoir émis des commentaires pertinents qui pourraient informer l’exercice effectué par la Cour)[250].
Dans le but d’assurer la priorité des provinces dans leurs champs de compétence, il est essentiel d’imposer une présomption de compétence provinciale en matière d’immigration. Cet aspect du nouveau cadre serait fondé sur l’approche de la Cour suprême en matière de relations de travail, qui a été réitérée dans NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union. Dans cet arrêt, la juge Abella expliquait qu’une présomption provinciale en matière de relations de travail existe depuis longtemps[251]. Suivant cette logique, nous suggérons que l’article 95 établit, de par son langage limitatif explicite, une présomption provinciale en matière d’immigration, et que l’exercice de la compétence fédérale en matière d’immigration devrait constituer une exception, comme c’est le cas en matière de relations de travail. Autrement dit, la compétence fédérale devrait être interprétée de façon plus ou moins restrictive.
En matière de relations de travail, la présomption en faveur des provinces peut être écartée en appliquant un « “critère fonctionnel” servant à déterminer si une entité est “fédérale” », et donc assujettie à la réglementation du Parlement fédéral[252]. Le même type d’exercice serait pertinent en matière d’immigration, et l’intervention de l’autorité fédérale sur un enjeu donné pourrait être assujettie à la démonstration d’un quelconque intérêt national dépassant les préoccupations provinciales.
Pour écarter la présomption, les critères établis pour la doctrine de l’intérêt national, qui découle du paragraphe introductif de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, pourraient s’avérer utiles. Puisque le contexte suggère que la mesure doit être de « portée générale »[253], et que le texte prévoit que le Parlement fédéral ne peut intervenir que « de temps à autre », il faudrait se demander si la mesure, qui était à l’origine de nature locale, est devenue une mesure d’intérêt national; ou si les provinces, agissant seules, sont incapables de contrôler efficacement ce sur quoi le fédéral tente de légiférer[254].
Il nous faut souligner que l’approche proposée s’apparente à la notion de compétence concurrente « conditionnelle » expliquée précédemment. En effet, le texte de la Constitution démontre qu’il y a bel et bien une condition imposée sur l’exercice de la compétence législative accordée au Parlement fédéral puisque celle-ci ne peut être exercée que « de temps à autre ». Comme l’explique Nico Steytler, la condition que l’on retrouve plus souvent dans les fédérations à travers le monde est celle voulant que le Parlement fédéral puisse seulement légiférer lorsque la norme est dans l’intérêt national[255]. Règle générale, en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui caractérisent ce type de compétence concurrente, le Parlement fédéral peut agir lorsque les entités fédérées, en agissant de façon indépendante, sont incapables de contrôler efficacement ce sur quoi le fédéral a l’intention de légiférer. Dans un tel cas, les normes fédérales adoptées ne peuvent pas, bien évidemment, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’ordre national en question[256]. En adoptant une approche quasiment identique à celle établie dans Crown Zellerbach, la Cour suprême serait en mesure de formuler une approche qui a des racines dans la jurisprudence canadienne—ce qui assure une certaine stabilité juridique—tout en s’harmonisant aux approches observées dans d’autres systèmes fédéraux.
À notre avis, il serait possible d’argumenter que les compétences concurrentes prévues à l’article 95 seraient « complémentaires », mais cette position serait plus difficile à défendre puisque ce type de compétence concurrente semble être contraire à notre architecture constitutionnelle[257]. Le Canada est une fédération dualiste, et non pas une fédération officiellement « intégrée » comme l’Allemagne, où les compétences concurrentes « complémentaires » sont plus fréquentes[258].
Au final, suivant l’approche proposée dans ce texte, si l’autorité fédérale est en mesure de renverser la présomption provinciale, le libellé de l’article 95 est on ne peut plus clair que les lois provinciales qui entrent en conflit avec la loi fédérale doivent être déclarées inopérantes en vertu de la prépondérance fédérale[259].
En 2015, la Cour suprême confirmait que l’analyse fondée sur la doctrine de la prépondérance devait se faire en deux étapes. À la première étape, la Cour déclarera une loi provinciale inopérante s’il « existe un conflit d’application parce qu’il est impossible de respecter les deux lois »[260]. Une loi provinciale plus restrictive qu’une loi fédérale sera maintenue à cette étape, alors que, « [s]i la loi provinciale autorise la chose même qu’interdit la loi fédérale, il existe un conflit opérationnel »[261]. À la deuxième étape, la Cour déclarera une loi provinciale inopérante si elle « entrave la réalisation de l’objet de la loi fédérale »[262]. Dans la trilogie, elle expliquait que ce deuxième volet de la doctrine de la prépondérance avait une portée limitée. Elle semblait même signaler la possibilité de s’en débarrasser éventuellement, quoique la portée de ses commentaires demeure vague pour l’instant[263]. Les juges Abella et Gascon, écrivant pour la majorité dans l’affaire Lemare Lake Logging, notaient la chose suivante :
Bien que l’on ne puisse considérer que le principe du fédéralisme coopératif impose des limites à l’exercice par ailleurs valide de la compétence législative, ce principe peut être invoqué « pour faciliter l’intégration des régimes législatifs fédéraux et provinciaux et éviter l’imposition de contraintes inutiles aux interventions législatives provinciales » [...]. Conformément à ce principe, en l’absence d’une preuve claire de l’intention du législateur d’élargir l’objectif de la loi, les tribunaux doivent s’abstenir de donner à l’objet de la loi fédérale une interprétation large qui aboutira à un conflit avec la loi provinciale. Ainsi que l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Marcotte, « il faut prendre garde de ne pas conférer à cette doctrine une portée trop large dès qu’il y a entrave à l’objectif fédéral » [...]. Ainsi, il ne faut pas étendre artificiellement la portée de l’objet de la loi fédérale au-delà de la portée que le législateur entendait lui donner. L’élargissement indu de l’objet que vise une loi fédérale est incompatible avec le principe du fédéralisme coopératif. D’aucuns pourraient éventuellement faire valoir que les deux volets de l’analyse fondée sur la doctrine de la prépondérance ne sont plus nécessaires ou utiles au plan analytique, mais nous ne sommes pas saisis de cette question dans le cadre de ce pourvoi [nos italiques].[264]
En d’autres mots, la doctrine de la prépondérance est maintenant plus circonscrite, et facilite le chevauchement entre les lois fédérales et provinciales en l’absence d’un objet fédéral clair.
Ce nouveau cadre donnerait effet au texte de l’article 95, et permettrait l’atteinte d’un équilibre entre les provinces et l’autorité fédérale en matière d’immigration. Conséquemment, une telle interprétation et construction constitutionnelle de l’article rendrait aux provinces ce qu’elles ont perdu depuis 1908.
En résumé, les tribunaux devraient, à notre avis, appliquer le cadre suivant quand ils sont appelés à interpréter une loi fédérale adoptée en vertu de l’article 95 :
Il existe une présomption provinciale à la compétence en la matière. Pour surmonter cette présomption, il faut passer à la deuxième étape.
Pour ce faire, il importe de vérifier si :
la mesure adoptée par l’autorité fédérale a des dimensions nationales ou concerne l’ensemble de la fédération; ou
les provinces, laissées à elles-mêmes, sont incapables de contrôler efficacement ce sur quoi le fédéral tente de légiférer.
Si l’une des deux affirmations mentionnées à l’étape 2 est vraie, la prépondérance s’applique en l’espèce si :
respecter la loi provinciale ainsi que la loi fédérale est impossible; ou
bien qu’il soit possible de respecter les deux lois, la loi provinciale va à l’encontre de l’objet fédéral clair.[265]
Ce cadre placerait les provinces dans une position de force en ce qui concerne leurs négociations avec le Parlement fédéral. Il est vrai que le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont légiféré en la matière, mais le statut juridique de ces lois reste nébuleux étant donné l’interprétation actuelle de l’article 95. Même si l’interprétation judiciaire plus récente de la prépondérance fédérale implique, à notre avis, que ces lois ne seraient pas déclarées inopérantes en application du principe du fédéralisme coopératif, toujours est-il qu’un geste unilatéral de la part de l’autorité fédérale pourrait limiter ou mettre fin aux initiatives provinciales en matière d’immigration. L’approche proposée fermerait la porte à cette possibilité en posant des limites à la compétence fédérale.
2. Une approche qui respecte le cadre du fédéralisme canadien
Les tribunaux devront également offrir une interprétation permettant de distinguer la compétence en matière d’immigration prévue à l’article 95 de la compétence en matière de « naturalisation et les aubains » qui relève exclusivement de l’autorité fédérale[266]. L’expression « naturalisation » implique le processus permettant à un ressortissant étranger d’obtenir la citoyenneté[267], tandis qu’« aubains » renvoie aux ressortissants étrangers qui n’ont pas encore obtenu la citoyenneté et qui résident au Canada[268]. Alors que l’article 91(25) porte sur l’octroi de la citoyenneté canadienne et la déportation des non-citoyens, l’article 95 porterait, entre autres, sur la sélection de candidats à l’immigration[269]. Les provinces seraient donc en mesure d’affirmer leur compétence sur tout ce qui porte sur l’immigration, mais qui ne porte aucunement sur le processus de naturalisation[270]. Bien sûr, les lois provinciales seraient assujetties aux critères additionnels qu’impose la Charte canadienne des droits et libertés[271].
L’approche proposée permettrait, au minimum, de protéger juridiquement ce que font présentement les provinces par le biais de multiples ententes intergouvernementales, et ce, sans qu’une modification constitutionnelle soit nécessaire. L’Accord du Lac Meech[272] et le rapport Beaudoin-Dobbie de 1992[273] prévoyaient justement la constitutionnalisation des ententes intergouvernementales en matière d’immigration, alors que l’Accord de Charlottetown prévoyait un mécanisme de constitutionnalisation temporaire[274]. Des initiatives de ce genre ne seraient pas nécessaires si l’interprétation avancée dans cet article était acceptée.
Cette approche est d’autant plus importante depuis la décision de la Cour suprême dans Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), où une majorité de cinq juges ont ultimement résisté l’occasion qu’ils avaient d’adopter le principe de loyauté fédérale en droit constitutionnel canadien[275].
La conséquence pratique de l’interprétation proposée devra faire l’objet d’un débat académique et jurisprudentiel. Nous nous permettons, toutefois, de faire certains commentaires plus directs à cet égard. D’abord, tel que nous l’avons mentionné, la compétence d’exclure les aubains du territoire canadien demeurerait une compétence exclusivement fédérale, ce qui implique que les critères d’inadmissibilité établis par le Parlement fédéral demeureraient pertinents[276]. Il pourrait également être argumenté que les résidents temporaires voyageant au Canada relèveraient de l’autorité fédérale, et ce, en raison de la nature transitoire du droit d’admission qui est conféré, ainsi que du fait que de telles situations se rapportent aux relations étrangères. Finalement, la sélection de réfugiés serait, à notre avis, une question d’intérêt national puisqu’il s’agit d’un phénomène relativement récent, qui a pris une ampleur considérable depuis l’adoption de la Convention relative au statut des réfugiés en 1951[277]. Bien que la conclusion de traités internationaux ne puisse passer outre la répartition des compétences législatives prévues dans la Constitution[278], le lien direct existant entre les questions relatives aux réfugiés et les relations étrangères du Canada pourrait justifier l’intervention du Parlement fédéral.
Au final, les immigrants économiques, le programme de réunification des familles, et les résidents temporaires tels que les étudiants étrangers relèveraient des législatures provinciales. Bien sûr, les provinces pourraient également légiférer sur les mêmes sujets que le Parlement fédéral en matière d’immigration, notamment sur les critères de sélection des réfugiés, et ce, parce que leur compétence n’est pas limitée par l’expression « de temps à autre ». Cela étant, toutes les normes provinciales demeureraient sujettes à la prépondérance fédérale.
L’approche proposée permettrait ultimement aux provinces de mettre de l’avant leurs préoccupations linguistiques et culturelles; de contrôler l’effet de l’immigration sur l’exercice de leurs autres compétences et leur économie; ainsi que de maintenir leur poids démographique dans la fédération.
Sur le premier point, il est clair que les revendications du Québec durant les négociations constitutionnelles des années 1980 et 1990 avaient pour but de protéger le caractère multinational de la fédération canadienne. Dès 1991, la province a mis en oeuvre une version unique du système de points, notamment en accordant plus de poids aux compétences en français des immigrants potentiels[279]. Cette nouvelle interprétation de l’article 95 permettrait donc à la province du Québec de consolider ses critères distincts en lui offrant la protection constitutionnelle qu’elle mérite dans une fédération multinationale. Bien évidemment, les autres provinces seraient également en mesure d’ajouter des critères de sélection si nécessaire, comme l’a fait le Manitoba en adoptant le mode d’intervention holiste que nous avons décrit[280].
Sur le deuxième point, Keith Banting note qu’en raison de la répartition des compétences législatives prévue dans la Constitution, « l’intégration à long terme des immigrants dépend fortement des politiques et des programmes provinciaux, tels que la réglementation du marché du travail, l’éducation et les services sociaux » [notre traduction][281]. En fait, il faut noter que la reconnaissance des qualifications professionnelles des immigrants doit nécessairement se faire au niveau provincial[282], et que l’immigration a un impact important sur les systèmes d’éducation et de santé des provinces[283]. Ces dernières seraient donc mieux placées pour gérer les coûts inévitables que l’immigration engendre en contrôlant les niveaux d’immigration et en réalisant la planification à long terme nécessaire pour assurer une bonne intégration de leurs candidats.
Dans certaines provinces, ce contrôle sur la sélection de candidats à l’immigration aurait potentiellement pour effet de diminuer le nombre d’immigrants sélectionnés chaque année, alors que dans d’autres le résultat serait inverse. En fait, contrairement aux États-Unis, la fédéralisation de l’immigration au Canada se traduit par des politiques plutôt favorables aux immigrants[284].
Comme le relève Mireille Paquet, les provinces canadiennes ont identifié l’immigration comme une solution aux nouveaux défis auxquels elles font face. Un rapport du gouvernement de la Saskatchewan explique bien les préoccupations économiques des provinces :
Immigration is an important factor in building and sustaining dynamic communities and economic growth in Saskatchewan. Attracting and retaining skilled workers, entrepreneur immigrants and international students plays an important role in growing our communities and expanding our province’s innovation, cultural diversity and trade development. Immigrants enhance our capacity for innovation by contributing new ideas and global perspectives. Immigration is vital to Saskatchewan’s future as a high growth, diverse, dynamic and vital society.[285]
Le contrôle provincial sur la sélection des candidats permettrait donc à certaines provinces d’obtenir leur « fair share of immigrants »—le contrôle fédéral ayant historiquement mené à une répartition inégale des immigrants entre les provinces[286].
Sur le troisième point, un rôle plus important en matière d’immigration permettrait aux provinces, surtout les provinces atlantiques (dont les politiques sont caractérisées par le « mode attraction-rétention »), de veiller à la survie de leur société et de sa santé démographique[287]. Bien sûr, les résidents permanents et les citoyens canadiens ont le droit, selon l’article 6(2) de la Charte, de se déplacer dans tout le pays. Malgré ce fait, nous estimons qu’une implication des provinces dans la sélection et l’intégration des candidats est plus susceptible d’inciter ces derniers à rester dans leur province d’accueil.
Étant donné que le nombre de députés à la Chambre des communes est établi selon le principe de la représentation proportionnelle des provinces, cette préoccupation pour leur démographie a également un impact sur leur représentation dans les institutions fédérales. Une plus grande autonomie (self-rule) en matière d’immigration permettrait aux provinces d’exercer un meilleur contrôle sur leur capacité de participer dans la gouvernance du pays en entier (shared-rule)—des éléments essentiels à la notion même de fédéralisme[288].
L’interprétation proposée est d’autant plus importante puisqu’il n’y a aucun doute que les provinces ont exprimé l’intérêt d’avoir un plus grand contrôle sur la sélection de candidats[289]. Mireille Paquet note justement que « les provinces continuent de revendiquer plus de pouvoirs, d’autonomie et de ressources auprès du gouvernement fédéral »—certaines cherchant à signer une entente semblable à celle qui a été conclue par le Québec[290]. Il est donc temps de reconnaître l’importance du contrôle « local », c’est-à-dire provincial, de l’immigration au Canada.
Conclusion
L’étude à laquelle nous avons procédé démontre que les précédents de 1908 relatifs à l’article 95 ont eu pour effet de contribuer à priver les provinces de l’exercice de leur compétence législative en matière d’immigration. L’évolution de la jurisprudence et les actions du gouvernement fédéral sur le terrain ont effectivement réduit la capacité législative des provinces. Bien sûr, ces dernières ont partiellement réinvesti ce domaine par le truchement d’ententes intergouvernementales. Néanmoins, la valeur juridique de ces ententes demeure faible, car un retrait unilatéral de la part du gouvernement fédéral pourrait complètement écarter le rôle des provinces. Comme nous l’avons souligné, la première loi en matière d’immigration reposait sur une entente intergouvernementale. Or, ce climat de coopération n’a pas duré puisque le Parlement fédéral a exercé la compétence en matière d’immigration de manière presque exclusive jusqu’à 1960. L’histoire témoigne qu’un retrait unilatéral des arrangements coopératifs de la part de l’autorité fédérale s’est produit, et pourrait se reproduire, ce qui rend les lois provinciales fondées sur des ententes intergouvernementales vulnérables sur le plan constitutionnel.
En prenant en considération le texte de l’article 95 ainsi que le contexte historique entourant son adoption, les tribunaux canadiens auraient l’occasion de démontrer qu’ils prennent au sérieux le fédéralisme et la place des provinces dans le cadre constitutionnel. Il est regrettable que les tribunaux aient évité toute analyse approfondie de cet article. Maintenant que la preuve de l’intention des constituants a été rendue disponible par une analyse de l’historique législatif, on ne peut plus l’ignorer. En fait, le contexte historique ne fait qu’illuminer ce qui est déjà dans le texte de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce contexte permet de mieux saisir l’importance des mots employés par le constituant britannique en ce sens que, si la compétence est concurrente, elle est sujette à des limites importantes. Au final, c’est aux provinces de réaffirmer leur place dans la fédération—une place qui leur a été enlevée et qu’elles ont abandonnée depuis plus d’un siècle.
Appendices
Notes
-
[1]
Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 95, reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 5. Il faut souligner que seule la version anglaise est officielle, puisque le mécanisme prévu à l’art 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’a jamais été utilisé pour rendre officielle la version française (Loi constitutionnelle de 1982, art 55, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11). La version française non officielle énonce la chose suivante :
Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada [nos italiques].
Pour plus d’information sur le statut des versions officielles en français, voir Hugo Choquette, « Translating the Constitution Act, 1867: A Critique » (2011) 36:2 Queen’s LJ 503.
-
[2]
Voir Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014 aux pp 462–83.
-
[3]
Loi constitutionnelle de 1867, supra note 1, art 95.
-
[4]
Voir Brun, Tremblay et Brouillet, supra note 2 aux pp 811–13, 818–20.
-
[5]
Voir Benoît Pelletier, « Le Canada n’est pas une confédération ! », Le Journal de Québec (3 septembre 2014), en ligne : <www.journaldequebec.com/2014/09/03/le-canada-nest-pas-une-confederation>, archivé à https://perma.cc/N5TK-TFJ3. Voir aussi Dimitrios Karmis et Wayne Norman, « The Revival of Federalism in Normative Political Theory » dans Dimitrios Karmis et Wayne Norman, dir, Theories of Federalism: A Reader, New York, Palgrave Macmillan, 2005, 3 aux pp 5–7.
-
[6]
Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32 aux para 13–20, 54–63, [2014] 1 RCS 704 [Renvoi sur la réforme du Sénat]; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21 aux para 46–62, [2014] 1 RCS 433 [Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême].
-
[7]
Renvoi sur la réforme du Sénat, supra note 6 au para 25; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, supra note 6 au para 19. Sur cette contextualisation, voir généralement Eugénie Brouillet, Alain-G Gagnon et Guy Laforest, dir, La Conférence de Québec de 1864 : 150 ans plus tard, Saint-Foy (Qc), Presses de l’Université Laval, 2016.
-
[8]
Nous entendons par cette expression la somme des politiciens des colonies de l’Amérique du Nord britannique qui ont formé la fédération canadienne en 1867.
-
[9]
Voir « The Charlottetown Conference, September, 1864 » dans GP Browne, dir, Documents on the Confederation of British North America, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2009, 32 aux pp 32–49 [« Charlottetown Conference, 1864 »]; « The Quebec Conference, October, 1864 » dans Browne, ibid, 55 aux pp 55–165 [« Quebec Conference, 1864 »]; « The London Conference, December, 1866 » dans Browne, ibid, 201 aux pp 201–29 [« London Conference, 1866 »].
-
[10]
Brun, Tremblay et Brouillet, supra note 2 à la p 204.
-
[11]
Voir Jacques Paul Couturier, Un passé composé : Le Canada de 1850 à nos jours, 2e éd, Moncton, Éditions d’Acadie, 2000 à la p 45.
-
[12]
Voir ibid.
-
[13]
Voir ibid aux pp 47–50; JM Bumsted, A History of the Canadian Peoples, 4e éd, Don Mills (Ont), Oxford University Press, 2011 aux pp 204–05.
-
[14]
Voir Robert Vipond, « 1867: Confederation », dans Peter Oliver, Patrick Macklem et Nathalie Des Rosiers, dir, The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, New York, Oxford University Press, 2017 à la p 88.
-
[15]
Voir « Memorandum for Consideration of the Cabinet by Lord Carnarvon, 2 February, 1867 » dans Browne, supra note 9, 264 à la p 264; Donald Creighton, The Road to Confederation: the Emergence of Canada, 1863-1867, Toronto, Macmillan of Canada, 1964 aux pp 419–21.
-
[16]
Ces résolutions sont le résultat des débats qui ont eu lieu entre le 10 et le 27 octobre 1864, à Québec (voir « Quebec Conference, 1864 », supra note 9 aux pp 55, 152–65).
-
[17]
Ibid aux pp 157–60 (les résolutions 29(35), 29(36), 43(4), et 43(5) sont celles qui concernent l’immigration et l’agriculture).
-
[18]
Ibid aux pp 161–62.
-
[19]
Les individus en question étaient George Brown et Thomas D’Arcy McGee, du Canada-Uni, ainsi que George Coles, de l’Île-du-Prince-Édouard (voir « Discussions in Conference of the Delegates from the Provinces of British North America, October, 1864 » dans Joseph Pope, dir, Confederation: Being a Series of Hitherto Unpublished Documents Bearing on the British North America Act, Toronto, Carswell, 1895, 53 aux pp 80–81 [« Discussions of the Delegates, 1864 »]).
-
[20]
Les individus en question étaient Oliver Mowat, du Canada-Uni; Edward Palmer, de l’Île-du-Prince-Édouard; ainsi que Jonathan McCully, Robert Dickey et Charles Tupper, de la Nouvelle-Écosse (voir ibid aux pp 80–81. Voir aussi Jamie Chai Yun Liew et Donald Galloway, Immigration Law, 2e éd, Toronto, Irwin Law, 2015 à la p 13).
-
[21]
« Discussions of the Delegates, 1864 », supra note 19 à la p 81.
-
[22]
Ibid.
-
[23]
Pendant les débats à l’Assemblée législative du Canada-Uni, Antoine-Aimé Dorion avait fortement critiqué l’approche préconisée au sein des Résolutions de Québec :
Now, among the other powers granted to the General Government is its control over agriculture and immigration, as well as the fisheries. An honorable member from Upper Canada (Mr. Mackenzie of Lambton), enquired very anxiously, yesterday, if it was possible that any act respecting agriculture could be affected by the General Government? Well, sir, it is as plain as can be that agriculture and immigration are to be under the control of both the local and the general legislatures. And the forty-fifth resolution says:—“In regard to all subjects over which jurisdiction belongs to the general and local legislatures, the laws of the General Parliament shall control and supersede those made by the Local Legislature, and the latter shall be void so far as they are repugnant to or inconsistent with the former.” What will be the operation of this provision? The Local Legislature will pass a law which will then go to the General Government; the latter will put its veto upon it, and if that does not answer, it will pass a law contrary to it, and then you have at once a conflict
Canada, Assemblée législative, Parliamentary Debates on the Subject of the Confederation of the British North American Provinces, 8e parl, 3e sess, (16 février 1865) à la p 259 -
[24]
Voir « London Conference, 1866 », supra note 9 à la p 216.
-
[25]
Voir ibid aux pp 216–17, 222, 224–25 (les articles des Résolutions de Londres relatifs aux compétences concurrentes sont les art 28, 41 et 44).
-
[26]
Ibid à la p 225.
-
[27]
« Rough Draft of Conference » dans Pope, supra note 19, 123 à la p 133, art 42 [« London Conference, Rough Draft »].
-
[28]
Voir ibid aux pp 130–34, arts 36(37), 42.
-
[29]
« Draft of a Bill for The Union of the British North American Colonies, and for Government of the United Colony » dans Pope, supra note 19, 141 aux pp 141–57 [« BNAA, First Draft »]. À ce stade, les délégués de la Conférence de Londres étaient encore présents dans la capitale, et ils y restèrent jusqu’à ce que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique obtienne, le 29 mars 1867, la sanction royale. Pendant cette période, ils ont participé aux débats entourant la modification des diverses ébauches, contribuant notamment à l’élaboration des compétences concurrentes (voir généralement Creighton, supra note 15 aux pp 417–30).
-
[30]
« BNAA, First Draft », supra note 29 aux pp 155–56, art 42.
-
[31]
Il faut souligner que le pouvoir normatif accordé aux colonies avant la (Con)fédération canadienne de 1867 était de passer des lois. Conséquemment, les mots « Act » et « Acte » sont utilisés par les législatures coloniales (voir par ex Revised Statutes of Nova Scotia, Third Series, 27 Vict, Halifax, J&W Compton, 1864; Statutes of Nova Scotia, 29 Vict, Halifax, Alpin Grant, 1866; Acts of the General Assembly of Newfoundland, 58 & 59 Vict, JW Withers, 1895; Consolidated Statutes for Upper Canada, 22 Vict, Toronto, Stewart Derbishire et George Desbarats, 1859; Statuts refondus pour le Bas Canada, 23 Vict, Québec, Stewart Derbishire et George Desbarats, 1861). Ainsi, tel qu’illustré par Creighton, l’usage du terme « ordinances » écartait, pour les provinces, un pouvoir législatif au profit d’un pouvoir réglementaire :
Up to then, in the Quebec Resolutions, the London Resolutions, and the local government resolutions passed by the Canadian parliament in the previous summer, the chief executive officer of each province had been invariably called the lieutenant-governor or governor. Now, in the new draft bill, he was styled by the humble designation of ‘superintendent’ and the local assemblies were empowered to pass ‘ordinances’ only
voir Creighton, supra note 15 aux pp 418–19 -
[32]
« Third Draft (of Conference) » dans Pope, supra note 19, 158 à la p 175, art 80 [BNAA, Third Draft]. La quatrième ébauche reprend d’ailleurs sensiblement le même vocabulaire (voir « Fourth Draft (of Conference): A Bill To provide for the Union and Government of British North America » dans Pope, supra note 19, 177 à la p 210, art 126 [BNAA, Fourth Draft]).
-
[33]
Voir « BNAA, Third Draft », supra note 32 aux pp 167–69, arts 52(33) à 52(34) (l’art 52 prévoyait d’ailleurs la chose suivante : « it is hereby declared that the Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all matters coming within the classes of subjects next hereinafter enumerated, that is to say:— [...] 33. Immigration. 34. Agriculture »); « BNAA, Fourth Draft », supra note 32 aux pp 190–92, arts 48(30) à 48(31).
-
[34]
Voir « BNAA, Third Draft », supra note 32 à la p 169, art 52(37); « BNAA, Fourth Draft », supra note 32 à la p 192, art 48(37). Il y avait également une deuxième clause de prépondérance prévue dans la liste exclusive du Parlement fédéral, ce qui nous permet de déduire que la chose était très ambiguë à ce stade.
-
[35]
« British North America: Draft of a Bill for The Union of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Government thereof as united; and for Purposes connected therewith » dans Pope, supra note 19, 212 à la p 238, art 104 [« BNAA, Final Draft »].
-
[36]
Voir R-U, HL, Parliamentary Debates, 3e sér, vol 185, col 278 (12 février 1867); An Act for the Union of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Government thereof; and for Purposes connected therewith, 1867 (R-U), 30 Vict, c 3.
-
[37]
Voir Creighton, supra note 15 aux pp 429–30.
-
[38]
Loi constitutionnelle de 1867, supra note 1, art 95.
-
[39]
The Oxford English Dictionary, 3e éd, sub verbo « time ». Il incombe aussi de noter que la traduction de l’expression « from time to time » qui prévalait au 19e siècle semble être « de temps en temps » (voir J Roemer, dir, A Dictionary of English Idioms with their French Translation, New York, George R Lockwood, Late Roe Lockwood & Son, 1853, sub verbo « time ». Un dictionnaire plus récent confirme que « From time to time » signifie « occasionally; now and again » (voir Frederick T Wood, dir, English Prepositional Idioms, London, Macmillan, 1967, sub verbo « time »).
-
[40]
Voir Oxford English Dictionary, supra note 39, sub verbo « time ».
-
[41]
Voir JJS Wharton, dir, The Law Lexicon, or Dictionary of Jurisprudence: Explaining all the Technical Words and Phrases Employed in the Several Departments of English Law, Including Also the Various Legal Terms Used in Commercial Transactions; Together With an Explanatory as Well as Literal Translation of the Latin Maxims Contained in the Writings of the Ancient and Modern Commentators, Buffalo, William S Hein & Co, 2002 (réimpression d’un ouvrage originellement publié en 1838); Archibald Brown, A New Law Dictionary and Institute of the Whole Law: For the Use of Students, the Legal Profession, and the Public, London, Stevens & Haynes, 1874.
-
[42]
Fischbach and Moore of Canada Ltd v Noranda Mines Ltd, 84 DLR (3e) 465 à la p 475, 1978 CanLII 1849 (Sask CA) [Fischbach].
-
[43]
Ibid.
-
[44]
Ibid. Voir aussi Cheryl Finch, dir, Words and Phrases: Judicially Defined in Canadian Courts and Tribunals, Scarborough, Carswell, 1993 à la p 4-401.
-
[45]
Fischbach, supra note 42 à la p 476.
-
[46]
Voir aussi Cheung v York Region Condominium, 2017 ONCA 633 au para 103, 139 OR (3e) 254 (dans sa dissidence, le juge Weiler de la Cour d’appel de l’Ontario explique la chose suivante : « The words “from time to time” modify the action of the Board. The words “From time to time” mean what the Board is doing is done “sometimes, not regularly” »); Liu v Hamptons Golf Course Ltd, 2017 ABCA 303 au para 10 (disponible sur CanLII).
-
[47]
Voir Lawrie v Lees, [1881] 7 AC 19 (HL (Eng)) aux pp 29–30 [Lawrie]; Wright v Incorporated Synod of the Diocese of Huron, [1885] 11 RCS 95 aux pp 98–99 (disponible sur CanLII); Comeau’s Sea Foods c Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1997] 1 RCS 12, 142 DLR (4e) 193.
-
[48]
Finch, supra note 44 aux pp 4-400–4-401.
-
[49]
Voir par ex The Colonial Laws Validity Act, 1865 (R-U), 28 & 29 Vict, c 63. Ceci ne changea pas de jure avant l’adoption du Statute of Westminster en 1931 ((R-U), 22 & 23 Geo V, c 4), ou encore de la Loi de 1982 sur le Canada ((R-U), 1982, c 11).
-
[50]
Voir Ged Martin, Britain and the Origins of Canadian Confederation, 1837–67, Basingstoke, Macmillan, 1995 à la p 282 (« [t]he difficulties, the suggestions, the amendments during the last week have been almost endless, wrote Carnarvon as he struggled to get the measure into legislative form »).
-
[51]
Voir R-U, HL, Parliamentary Debates, 3e sér, vol 185, col 1 (5 février 1867). Voir aussi Christopher Hibbert, dir, Queen Victoria in her Letters and Journals, Surrey, Sutton, 2000 à la p 197.
-
[52]
Voir R-U, HL, Parliamentary Debates, 3e sér, vol 185, col 1310 à la col 1322 (4 mars 1867); R-U, HC, Parliamentary Debates, 3e sér, vol 185, col 1547 (8 mars 1867).
-
[53]
R-U, HL, Parliamentary Debates, 3e sér, vol 185, col 557 à la col 565 (19 février 1867) (Earl of Carnarvon) [Carnarvon, UKHL Debates].
-
[54]
RA Vineberg, « Federal-Provincial Relations in Canadian Immigration » (1987) 30:2 Can Public Administration 299 à la p 300 [Vineberg, « Federal-Provincial Relations »]. Voir aussi Donegani c Donegani (1834, 1835), [1910] 1 CRAC 50 aux pp 76–77, [1901] 12 ER 571 (dans cet arrêt, le Conseil privé avait justement réitéré la nature locale du droit applicable aux aubains au Bas-Canada, lequel était la Coutume de Paris depuis l’adoption de l’Acte de Québec).
-
[55]
Voir Carnarvon, UKHL Debates, supra note 53, col 565.
-
[56]
Voir Paul Romney, Getting It Wrong: How Canadians Forgot Their Past and Imperilled Confederation, Toronto, University of Toronto Press, 1999 aux pp 111–12, 121–22, 147–48, 154–55, 162–65.
-
[57]
Voir Henri Brun et Eugénie Brouillet, « Le partage des pouvoirs en matière d’immigration : une perspective québécoise » dans Pierre Thibault, Benoît Pelletier et Louis Perret, dir, Les mélanges Gérald-A. Beaudoin : Les défis du constitutionnalisme, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2002, 55 à la p 63.
-
[58]
Voir Christopher Moore, The British Columbia Court of Appeal: The First Hundred Years, 1910-2010, Vancouver, UBC Press, 2010 aux pp 52–57.
-
[59]
Nous utilisons l’expression « Cour d’appel de la Colombie-Britannique » pour plus de clarté. Cependant, il faut noter qu’avant 1910, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique se nommait la « Cour suprême de la Colombie-Britannique – Division d’appel ».
-
[60]
Voir Re Nakane and Okazake, [1908] 13 BCLR 370, [1908] 8 WLR 19 [Re Nakane, avec renvois aux BCLR]; Re Narain Singh et al, [1908] 13 BCLR 477, [1908] BCJ no 33 (QL) [Re Narain Singh].
-
[61]
Re Nakane, supra note 60 à la p 372.
-
[62]
Voir ibid aux pp 372, 374–77.
-
[63]
Voir ibid à la p 374 (« [w]ith regard to their power to give effect to the Treaty, the answer is to be found in the 132nd section of the British North America Act »); Loi constitutionnelle de 1867, supra note 1, art 132.
-
[64]
Voir Canada (AG) v Ontario (AG), [1937] AC 326 aux pp 349–50, [1937] 1 DLR 673 [Canada v Ontario (1937)]; Re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, [1932] AC 304 à la p 312, [1932] 2 DLR 81.
-
[65]
En d’autres mots, il s’agit d’un obiter dictum.
-
[66]
Voir Re Nakane, supra note 60 aux pp 371–72, 374, 376.
-
[67]
Ibid aux pp 376–77.
-
[68]
Ibid à la p 376. Pour en savoir plus sur la suite des choses, dont la conclusion de l’accord Hayashi-Lemieux en 1908, voir Emily Carasco et al, Immigration and Refugee Law: Cases, Materials, and Commentary, Toronto, Emond Montgomery, 2007 à la p 21.
-
[69]
Voir Re Narain Singh, supra note 60.
-
[70]
R v Narain, [1908] 7 WLR 781 à la p 783, 1908 CarswellBC 11 [Narain].
-
[71]
Luanne A Walton, « Paramountcy: A Distinctly Canadian Solution » (2004) 15 NJCL 335 aux pp 339–41.
-
[72]
Ibid à la p 340 (« [t]his test provides that federal paramountcy should be applied wherever there is federal legislation dealing with an area, regardless of whether provincial legislation in the same area creates a conflict. For this rule to apply, Parliament’s “entry into the field” is sufficient to render provincial legislation inoperative »).
-
[73]
Narain, supra note 70 à la p 782.
-
[74]
Voir Re Narain Singh, supra note 60 à la p 480.
-
[75]
Ibid à la p 479.
-
[76]
Voir Narain, supra note 70 à la p 783.
-
[77]
Voir Alberta (PG) c Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 RCS 327 [Moloney]; ETR Concession Co c Canada (Surintendant des faillites), 2015 CSC 52, [2015] 3 RCS 397 [ETR Concession]; Saskatchewan (PG) c Lemare Lake Logging Ltd, 2015 CSC 53, [2015] 3 RCS 419 [Lemare Lake Logging].
-
[78]
En effet, nous estimons qu’une interprétation plus restrictive pourrait être adoptée (contra Law Society of British Columbia c Mangat, 2001 CSC 67 au para 72, [2001] 3 RCS 113, juge Gonthier [Mangat]. En effet, dans l’arrêt Mangat, le juge Gonthier avait également appliqué de façon large la prépondérance fédérale (Brun et Brouillet, supra note 57 à la p 64). Il reste donc à voir si la Cour suprême appliquerait le cadre qu’elle a établi dans la trilogie de 2015, ou si elle garderait un cadre distinct pour l’art 95).
-
[79]
Pour la première décision portant sur la compétence en matière d’immigration prévue à l’art 95 depuis les décisions du début du XXe siècle, voir Fan v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1998] 152 FTR 301, 44 Imm LR 298 [Fan, avec renvois aux FTR].
-
[80]
An Act to Regulate Immigration into British Columbia, SBC 1908 (8 Edw VII), c 23 [Act to Regulate Immigration, 1908].
-
[81]
Voir Narain, supra note 70 à la p 782.
-
[82]
Voir WPM Kennedy, The Constitution of Canada : An Introduction to its Development and Law, Don Mills, Oxford University Press, 2014 aux pp 415–30. Voir aussi Bruce Ryder, « Racism and the Constitution: The Constitutional Fate of British Columbia Anti-Asian Immigration Legislation, 1884–1909 » (1991) 29:3 Osgoode Hall LJ 619 à la p 648 (« [t]he federal Minister’s view that a province could promote but not prohibit immigration was a self-serving exercise in constitutional interpretation. This view had no support in the text of section 95 »).
-
[83]
Davies Bagambiire, « The Constitution and Immigration: The Impact of the Proposed Changes to the Immigration Power under the Constitution Act, 1867 » (1992) 15:2 Dalhousie LJ 428 à la p 434 [Bagambiire, « The Constitution and Immigration »]. Voir aussi Robert C Vipond, Liberty and Community: Canadian Federalism and the Failure of the Constitution, Albany, State University of New York Press, 1991 aux pp 140–42.
-
[84]
Voir An Act to Prevent the Immigration of Chinese, SBC 1884 (47 Vict), c 3; An Act to Prevent the Immigration of Chinese, SBC 1885 (48 Vict), c 13; An Act to Regulate Immigration into British Columbia, 1900 (64 Vict), c 11; An Act to Regulate Immigration into British Columbia, 1902 (2 Edw VII), c 34; An Act to Regulate Immigration into British Columbia, SBC 1903 (3 Edw VII), c 12; An Act to Regulate Immigration into British Columbia, SBC 1903-1904 (3 & 4 Edw VII), c 26; An Act to regulate Immigration into British Columbia, SBC 1905 (5 Edw VII), c 28; An Act to Regulate Immigration into British Columbia, SBC 1907 (7 Edw VII), c 21A; Act to Regulate Immigration, 1908, supra note 80. Voir aussi Ryder, supra note 82 aux pp 641, 653, 660–67.
-
[85]
Voir par ex Journals of the Legislative Assembly of the Province of British Columbia, 4e parl, 3e sess, vol 14 (12 janvier 1885) à la p 2 (le lieutenant-gouverneur) (« [i]t will be for you to consider whether, in view of the Chinese Immigration Act passed last session having been disallowed by the Dominion Government, it is advisable to repeat legislation on the subject during the present session »); Journals of the Legislative Assembly of the Province of British Columbia, 4e parl, 4e sess, vol 15 (25 janvier 1886) à la p 2 (le lieutenant-gouverneur) (« [t]he Act to prevent the immigration of Chinese, after having been in operation for a short period, was disallowed by the Dominion Government »); Journals of the Legislative Assembly of the Province of British Columbia, 9e parl, 3e sess, vol 31 (12 mars 1902) à la p 14 (« [a]nd whereas the Dominion Government has disallowed the Acts known as the “British Columbia Immigration Act, 1900,” and the “Labour Regulation Act, 1900” »); Journals of the Legislative Assembly of the Province of British Columbia, 9e parl, 4e sess, vol 32 (6 avril 1903) à la p 5 (« [w]e regret to be advised that the Dominion Government has disallowed certain Acts of last Session dealing with immigration and the regulation of coal mines, and of labour. We agree with His Honour that this legislation should be re-enacted, in the hope that the Dominion Government may, upon further consideration, recognise the wisdom of these enactments, and that the rights of the Province may prevail »); Journals of the Legislative Assembly of the Province of British Columbia, 11e parl, 2e sess, vol 37 (18 février 1908) à la p 54.
-
[86]
Voir Journals of the Legislative Assembly of the Province of British Columbia, 11e parl, 1re sess, vol 36 (25 avril 1907) à la p 123.
-
[87]
Voir Ryder, supra note 82 à la p 667 (il est intéressant de noter que, malgré les deux décisions de la Cour d’appel déclarant les législations provinciales inopérantes, le gouvernement fédéral a de nouveau exercé son pouvoir de désaveu en 1909).
-
[88]
[1914] 6 WWR 1347 aux pp 1347–48, [1914] 20 BCLR 243 [Re The Immigration Act]. Pour plus d’information sur le célèbre incident du Komagata Maru, voir Moore, supra note 58 aux pp 52–57.
-
[89]
Voir Re The Immigration Act, supra note 88 aux pp 1348, 1371.
-
[90]
Voir ibid aux pp 1350–51, 1366, 1374–75 (le juge en chef Macdonald parle d’un pouvoir fédéral « to exclude ». Le juge Irving parle d’un « right to make laws for the exclusion or expulsion of aliens ». Le juge Galliher le fait indirectement en citant Cain qui fait référence aux « aubains » (Attorney-General (Canada) c Cain, [1906] AC 542, 75 LJPC 81 [Cain]). Finalement, le juge McPhillips voit le fondement constitutionnel de cet aspect de la loi dans la compétence relative à la paix, l’ordre et le bon gouvernement, mais mentionne également Cain).
-
[91]
Voir Re The Immigration Act, supra note 88 à la p 1348 (« the Parliament of Canada is clothed with sovereign power in matters relating to immigration into any part of the Dominion »).
-
[92]
Voir ibid à la p 1351.
-
[93]
Voir ibid à la p 1356 (le juge Martin s’appuie sur ce qu’établit Re Narain Singh (supra note 60)).
-
[94]
Voir Re The Immigration Act, supra note 88 à la p 1372 (« [t]his is the more definitely pointed out when s. 95, dealing with “Agriculture and Immigration” is considered, where concurrent powers are conferred. And it is to be observed that this is the only section of the Act where provision against conflict is made »).
-
[95]
Ibid à la p 1356.
-
[96]
Voir R v Hildebrand, [1919] 3 WWR 286 à la p 290, [1919] 30 Man R 149 (CA) (dans cet arrêt, des immigrants avaient réclamé des droits en matière d’éducation en vertu de l’art 95 (ces derniers leurs ayant été promis par l’autorité fédérale au moment d’immigrer). Le pourvoi fut rejeté en raison de la compétence exclusive des provinces en matière d’éducation. Ce n’était donc pas un conflit entre deux lois en matière d’immigration. Conséquemment, bien que cet arrêt évoque l’art 95, la Cour, jugeant que ce dernier ne s’appliquait pas dans cette affaire, ne procéda à aucune analyse de l’art 95).
-
[97]
Supra note 79 au para 6. Pour d’autres décisions mentionnant l’art 95 rapidement sans que ce dernier soit nécessaire à l’analyse de la Cour, voir Zahid v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2015 FC 1263 au para 3 (disponible sur CanLII); Chaudan v British Columbia (Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training), 2016 BCSC 2142 au para 2, 48 Imm LR (4e) 75; Raturi v British Columbia, 2017 BCSC 9 au para 9, 49 Imm LR (4e) 138; Chazi c Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1703 au para 61, [2008] RJQ 2035.
-
[98]
Mangat, supra note 78 au para 52.
-
[99]
Voir ibid aux para 70–72.
-
[100]
Ibid au para 52.
-
[101]
Voir ibid au para 35 (le juge Gonthier cite les trois décisions de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rendues entre 1908 et 1914).
-
[102]
Pour d’autres arrêts où l’art 95 est mentionné brièvement sans être pertinent à l’analyse de la Cour suprême, voir Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721 à la p 748, 19 DLR (4e) 1; Chatterjee c Ontario (PG), 2009 CSC 19 au para 24, [2009] 1 RCS 624; Québec (PG) c Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39 aux para 22–23, 81, [2010] 2 RCS 536; Consolidated Fastfrate Inc c Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53 au para 29, [2009] 3 RCS 407; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66 au para 66, [2011] 3 RCS 837; Québec (PG) c Lacombe, 2010 CSC 38 au para 95, [2010] 2 RCS 453.
-
[103]
Lower Mainland Dairy Products Sales Adjustment Committee v Crystal Dairy Ltd (1932), [1933] AC 168 à la p 174 (HL (Eng)) [Crystal Dairy]. Voir aussi Saskatchewan (AG) v Canada (AG) (1949), [1949] AC 110 (HL (Eng)) [Saskatchewan v Canada]. Dans ces deux affaires, les lois provinciales en cause ont été déclarées invalides en partie parce qu’elles n’étaient pas des lois relatives à l’agriculture. Dans le premier cas, le Conseil privé a conclu que la loi prévoyait une taxe indirecte, alors que dans le second cas, les juges ont conclu que la loi n’était pas relative à la propriété et aux droits civils. Pour un jugement abordant des questions similaires, voir British Columbia (Milk Marketing Board) v Bari Cheese Ltd, [1997] 2 WWR 342, 26 BCLR (3e) 279.
-
[104]
Re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] RCS 1 à la p 20, [1949] 1 DLR 433, juge en chef Rinfret (appel rejeté, voir [1951] AC 179 (HL (Eng))). Cela étant dit, il faut noter que la Cour a conclu que la loi fédérale en question n’était pas valide, puisqu’elle ne pouvait être considérée comme une loi relative à l’agriculture. Pour d’autres arrêts où une situation similaire se présente, voir R c Dominion Stores Ltd, [1980] 1 RCS 844, 106 DLR (3e) 581 [Dominion Stores]; R c Eastern Terminal Elevator Co, [1925] RCS 434, [1925] 3 DLR 1 [Eastern Terminal].
-
[105]
Il nous a été impossible de trouver les mémoires déposés à la Cour d’appel de la Colombie Britannique. Selon nos échanges avec ce tribunal, ces derniers n’auraient pas préservé les mémoires. La Cour suprême du Canada possède encore les mémoires, mais ils sont extrêmement coûteux. Conséquemment, nous nous sommes limités à une analyse de cinq arrêts où l’art 95 a fait l’objet d’un litige, tant sur l’immigration que sur l’agriculture. Certains mémoires déposés au Conseil privé sont disponibles en ligne dans la collection « The Judicial Committee of the Privy Council Case Papers » de l’Institute of Advanced Legal Studies. Il suffit de dire que l’argument historique et textuel n’a pas été fait et que les précédents ne sont pas remis en cause (voir Eastern Terminal, supra note 104 (mémoire de l’appelant aux pp 1–21); ibid (mémoire de l’intimé aux pp 1–23); Dominion Stores, supra note 104 (mémoire de l’appelant aux pp 1–11); ibid (mémoire de l’intimé aux pp 1–17); Mangat, supra note 78 (mémoire amendé de l’appelant aux pp 1–40); ibid (mémoire des intimés (Mangat et Westcoast Immigration Consultants Ltd) aux pp 1–40); ibid (mémoire de l’intimé (Sparling) et de l’intervenant (Organization of Professional Immigration Consultants Inc) aux pp 1–28); Crystal Dairy, supra note 103 (mémoire de l’appelant aux pp 1–5); Ibid (mémoire de l’intimé aux pp 1–7) ; Saskatchewan v Canada, supra note 103 (mémoire de l’appelant aux pp 1–11); ibid (mémoire de l’intimé (Procureur général du Canada) aux pp 1–14); ibid (mémoire de l’intimé (Dominion Mortgage and Investments Association) aux pp 1–14).
-
[106]
Pour la première décision de la Cour suprême portant sur l’art 95 en matière d’agriculture, voir Eastern Terminal, supra note 104. Pour une décision après la remise en question de la règle d’exclusion, voir Dominion Stores, supra note 104. Pour la première décision de la Cour suprême du Canada portant sur l’art 95 en matière d’immigration, voir Mangat, supra note 78. Sur la question de la règle d’exclusion, voir Stéphane Beaulac, « Parliamentary Debates in Statutory Interpretation: A Question of Admissibility or of Weight? » (1998) 43:2 RD McGill 287.
-
[107]
An Act Respecting Immigration and Immigrants, LC 1869, c 10 [Act Respecting Immigration and Immigrants, 1869].
-
[108]
Bagambiire, « The Constitution and Immigration », supra note 83 à la p 433.
-
[109]
Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, c I-0.2.1; Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario, LO 2015, c 8; Provincial Immigration Programs Act, SBC 2015, c 37.
-
[110]
Voir Brun et Brouillet, supra note 57 à la p 64 (ce passage ne traite pas des lois en Ontario et en Colombie-Britannique, ces dernières étant relativement récentes).
-
[111]
Voir Robert Vineberg, « History of Federal-Provincial Relations in Canadian Immigration and Integration » dans John Biles et al, dir, Integration and Inclusion of Newcomers and Minorities across Canada, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2011, 17 à la p 19 [Vineberg, « History of Federal-Provincial Relations »].
-
[112]
Act Respecting Immigration and Immigrants, 1869, supra note 107, préambule.
-
[113]
Voir Vineberg, « History of Federal-Provincial Relations », supra note 111 aux pp 18–21.
-
[114]
Voir Brun et Brouillet, supra note 57 à la p 66.
-
[115]
Voir The Immigration Act, LC 1906, c 19; The Immigration Act, LC 1910, c 27; The Immigration Act, LC 1952, c 42; Immigration Act, 1976, LC 1976–77, c 52; Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, arts 8–10.1. Voir aussi Robert Vineberg, « Continuity in Canadian Immigration Policy 1947 to Present: Taking a Fresh Look at Mackenzie King’s 1947 Immigration Policy Statement » (2011) 12:2 J Intl Migration & Integration 199 à la p 214.
-
[116]
Les provinces ont cependant joué un rôle indirect après la Deuxième Guerre mondiale par l’entremise de services d’établissement, de services sociaux, et de soins médicaux offerts aux immigrants (voir Vineberg, « Federal-Provincial Relations », supra note 54 aux pp 305–06).
-
[117]
Brun et Brouillet, supra note 57 à la p 66.
-
[118]
Vineberg, « History of Federal-Provincial Relations », supra note 111 aux pp 20–24. Voir aussi Robert Schertzer, « Intergovernmental Relations in Canada’s Immigration System: From Bilateralism towards Multilateral Collaboration » (2015) 48:2 R Can Science Politique 383 à la p 390.
-
[119]
Mireille Paquet, La fédéralisation de l’immigration au Canada, Presses de l’Université de Montréal, 2016 aux pp 17–18 [Paquet, La fédéralisation de l’immigration]; Mireille Paquet, « Living in “Interesting Times”: Immigrants and Contemporary Provincial Citizenship Regimes » dans Mireille Paquet, Nora Nagels et Aude-Claire Fourot, dir, Citizenship as a Regime: Canadian and International Perspectives, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2018, 118 à la p 125 [Paquet, « Living in “Interesting Times” »].
-
[120]
Freda Hawkins, Canada and Immigration: Public Policy and Public Concern, 2e éd, Institut d’Administration publique du Canada, Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1988 à la p 180.
-
[121]
Voir Ryder, supra note 82 à la p 642. Voir aussi Department of Immigration and Colonization, Annual Report 1928-29, Ottawa, 1930 à la p 7 (« the responsibility and control of the selection of immigrants no matter by whom recruited must rest solely and exclusively with the Government of Canada »). Ce climat d’exclusivité fédérale est même illustré par les discours prononcés dans la législature de l’Ontario au moment où cette dernière adoptait sa loi sur l’immigration (voir Ontario, Assemblée législative, Journal des débats (Hansard), 40e lég, 2e sess, n° 109 (4 mars 2014) à la p 5662 (M Michael Prue) (« [t]he other jurisdiction that is shared is immigration, and most Ontarians, and most members of this Legislature, would probably be surprised to know that we have equal jurisdiction with the federal government in immigration »); Ontario, Assemblée législative, Journal des débats (Hansard), 40e lég, 2e sess, n° 132 (28 avril 2014) à la p 6854 (l’honorable John Gerretsen) (« [h]aving said that, I find it rather strange that we would even have a bill like this before the Legislature today, because I’d always assumed that immigration was purely a federal responsibility. Certainly, the federal government traditionally has been mainly involved in the whole immigration movement here in the province of Ontario and, indeed, through Canada »).
-
[122]
Il nous faut souligner que même si l’utilisation du désaveu semble abandonnée (en désuétude) en droit constitutionnel contemporain (voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 55, 161 DLR (4e) 385 [Renvoi sur la sécession]), ce pouvoir a par le passé été confirmé par la Cour suprême du Canada (voir Re Power of Disallowance and Power of Reservation, [1938] RCS 71, [1938] 2 DLR 8). De plus, il nous incombe de rappeler que le désaveu fédéral a été utilisé jusqu’en 1943 (voir Brun, Tremblay et Brouillet, supra note 2 à la p 422).
-
[123]
Voir Vineberg, « History of Federal-Provincial Relations », supra note 111 aux pp 18–20.
-
[124]
Voir Idil Atak, « Fascicule 19 : Immigration et Réfugiés », au no 10, dans Stéphane Beaulac, Jean-François Gaudreault-DesBiens et Frédéric Bérard, dir, JCQ Droit Constitutionnel; Carasco et al, supra note 68 aux pp 109–12.
-
[125]
Voir généralement Ninette Kelley et Michael Trebilcock, The Making of the Mosaic: A History of Canadian Immigration Policy, 2e éd, Toronto, University of Toronto Press, 2010 à la p 66.
-
[126]
Il faut toutefois souligner que les conventions constitutionnelles et la dévolution de pouvoirs ont accordé aux territoires des compétences similaires à celles des provinces canadiennes (voir Loi sur le Nunavut, LC 1993, c 28; Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, LC 2014, c 2; Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, LC 2014, c 2; Loi sur le Yukon, LC 2002, c 7).
-
[127]
Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest (R-U), 1870 reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 9; Vineberg, « Federal-Provincial Relations », supra note 54 à la p 316 (« as the Dominion government gained more experience than the provinces in immigration and in the years of the great migration at the turn of the century concentrated on peopling the federal territories of the west rather than the established provinces, the interests and activities of the provinces diminished and almost disappeared and did not revive until after the Second World War »).
-
[128]
Voir Canada, Bibliothèque et Archives, La Confédération Canadienne : Carte 1870, mise à jour mai 2005, en ligne : <www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-5006-f.html>, archivé à https://perma.cc/UM9N-M7N4.
-
[129]
WH McConnell, Commentary on the British North America Act, Toronto, Macmillan of Canada, 1977 à la p 409 [McConnell, Commentary BNAA].
-
[130]
Loi constitutionnelle de 1930 (R-U), 20-21 Geo V, c 26, reproduite dans LRC 1985, annexe II, no 26. Voir aussi Reg Whitaker, Canadian Immigration Policy Since Confederation, Ottawa, Canadian Historical Association, 1991 aux pp 3–4.
-
[131]
Le territoire du Manitoba est agrandi, mais encore limité à cette époque (voir Bibliothèque et Archives Canada, La Confédération Canadienne : Carte 1905, mise à jour mai 2005, en ligne : <www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-5010-f.html>, archivé à https://perma.cc/6F2T-94E4).
-
[132]
Même le Globe and Mail et le Toronto Star de l’époque publiaient des articles sur le désaveu fédéral de la législation en matière d’immigration (voir par ex « Mr. Martin’s Address: British Columbia Leader on Provincial Rights », The Globe (29 janvier 1903); « Excluding Orientals », The Globe (30 janvier 1903); « Mongolians in British Columbia », The Globe (20 septembre 1901); « Japanese Press and the West: Comments on the Disallowance of B.C. Law », The Globe (6 juillet 1905); « The British Columbia Act Invalid », The Globe (27 février 1908) 4; « Natal Act Entanglement », The Globe (6 décembre 1907); « Disallowance », The Toronto Daily Star (4 mai 1908) 6 (« Sir John Macdonald specified only three cases in which the power of disallowance ought to be exercised: When the Provincial legislation is illegal or unconstitutional; when in case of concurrent legislation it clashes with the legislation of the Dominion Parliament; and when it affects the general interests of Canada »); « To Disallow Both Acts: The Dominion Government Will Put Its Veto on British Columbia Legislation in the Interests of Imperial Affairs », The Toronto Daily Star (26 juillet 1901)).
-
[133]
Voir Ryder, supra note 82 à la p 642.
-
[134]
Voir Cain, supra note 90. Nous reviendrons sur la distinction entre la compétence en matière de « naturalisation et les aubains » et celle en matière d’immigration dans la seconde partie de cet article.
-
[135]
Voir généralement Canada v Ontario (1937), supra note 64; Canada (AG) v Ontario (AG), [1937] AC 355, [1937] 1 DLR 684; British Columbia (AG) v Canada (AG), [1937] AC 377, [1937] 1 DLR 691.
-
[136]
Voir Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48 aux para 75–76, 124–27, 428 DLR (4e) 68.
-
[137]
Voir Mireille Paquet, « Wicked problem definition and gradual institutional change: federalism and immigration in Canada and Australia » (2017) 36:3 Policy & Society 446 à la p 449 [Paquet, « Federalism and Immigration in Canada and Australia »]; Iain Reeve, Devolution and Recentralization in the Canadian Immigration System: Theory, Causes, and Impacts, thèse de doctorat en science politique, Queen’s University, 2014 à la p 59 [non publiée] (bien que l’Ontario et le Manitoba commencèrent à revendiquer un certain contrôle sur l’immigration pendant cette période, c’est vraiment le Québec qui a pris l’initiative à partir de 1960).
-
[138]
Reeve, supra note 137 à la p 56. Voir aussi Keith Banting, « Canada » dans Christian Joppke et F Leslie Seidle, dir, Immigrant Integration in Federal Countries, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2012, 79 aux pp 86–87.
-
[139]
Voir Brun et Brouillet, supra note 57 à la p 67.
-
[140]
Voir Jacques Brossard et Yves de Montigny, « L’immigration : ententes politiques et droit constitutionnel » (1985) 19:3 RJT 305 aux pp 313–21 (les auteurs abordent notamment l’entente Andras-Bienvenue, conclue en 1975, et l’entente Cullen-Couture, conclue en 1978).
-
[141]
Voir Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains, 5 février 1991, en ligne : <www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes/quebec/quebec-acc.asp>, archivé à https://perma.cc/P4KS-9MLV [Accord Canada-Québec, 1991]. Voir aussi Robert Vineberg, Responding to Immigrants’ Settlement Needs: The Canadian Experience, Dordrecht, Springer, 2012 à la p 37; Chris Kostov, « Canada-Quebec Immigration Agreements (1971–1991) and Their Impact on Federalism » (2008) 38:1 American Rev Can Studies 91.
-
[142]
Voir Atak, supra note 124 au no 22. Voir aussi Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 aux pp 93–94.
-
[143]
Voir Banting, supra note 138 aux pp 87–88; Atak, supra note 124 au no 35.
-
[144]
Voir Accord Canada-Québec, 1991, supra note 141, arts 17–20.
-
[145]
Voir ibid, arts 13–16; Atak, supra note 124 au no 31.
-
[146]
Voir Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 aux pp 13–14, 30–36. Pour les ententes modernes, voir Gouvernement du Canada, « Accords fédéraux-provinciaux/territoriaux », en ligne : <www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/ententes/federaux-provinciaux.html>, archivé à https://perma.cc/F7P7-G3FE.
-
[147]
Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119; Paquet, « Living in “Interesting Times” », supra note 119 aux pp 122–27. Voir aussi Davide Strazzari, « Immigration and Federalism in Canada: Beyond Quebec Exceptionalism? » (2017) 9:3 Perspectives on Federalism 56.
-
[148]
Voir Atak, supra note 124 au no 23; F Leslie Seidle, « Canada’s Provincial Nominee Immigration Programs: Securing Greater Policy Alignment » (2013) 43 IRPP Study 1.
-
[149]
Voir Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 à la p 259. Voir aussi Schertzer, supra note 118 à la p 406.
-
[150]
Voir Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 aux pp 190, 229, 237.
-
[151]
Voir ibid à la p 19; Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, arts 33–43.
-
[152]
Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 à la p 31, voir aussi ibid aux pp 57–104.
-
[153]
Voir ibid aux pp 159–97.
-
[154]
Ibid à la p 34. Voir aussi ibid aux pp 105–57.
-
[155]
Voir ibid aux pp 199–241.
-
[156]
Ibid aux pp 36, 253.
-
[157]
Schertzer, supra note 118.
-
[158]
Voir ibid aux pp 392–99.
-
[159]
Voir ibid à la p 399.
-
[160]
Voir Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 à la p 243.
-
[161]
Voir Québec (PG) c Canada (PG), 2015 CSC 14 aux para 18–20, [2015] 1 RCS 693, juges Cromwell et Karakatsanis [Québec c Canada] (« [o]n ne peut donc considérer que le principe du fédéralisme coopératif impose des limites à l’exercice par ailleurs valide d’une compétence législative »). Cela dit, « en dépit de cette fragilité, les ententes [intergouvernementales] jouissent d’une très grande effectivité, qui leur permet de remodeler les relations interfédérales, en marge du processus formel d’amendement constitutionnel ». Cette effectivité s’explique par le fait que « [l]es conséquences [d’une dénonciation fédérale] peuvent évidemment être malheureuses sur le plan de la diplomatie intergouvernementale » (Johanne Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien : les ententes intergouvernementales » [2009] Revue québécoise de droit constitutionnel 1 aux pp 11, 22 [Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien »]).
-
[162]
Voir Paquet, « Living in “Interesting Times” », supra note 119 à la p 126, no 4; Banting, supra note 138 à la p 105.
-
[163]
Voir Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 aux pp 101, 254.
-
[164]
Voir ibid aux pp 254–60. Pour plus d’information sur les programmes de travailleurs temporaires et d’Entrée express, voir Atak, supra note 124 aux no 19, 41.
-
[165]
Schertzer, supra note 118 à la p 400.
-
[166]
Marc-André Turcotte, Le pouvoir fédéral de dépenser : ou comment faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement, Montréal, Yvon Blais, 2015 aux pp 182, 475.
-
[167]
Voir Peter Hogg, Constitutional Law of Canada, Toronto, Carswell, 2015 à la section 26; Patrick J Monahan et Byron Shaw, Constitutional Law, 4e éd, Toronto, Irwin Law, 2013 à la p 122. Voir aussi WHP Clement, The Law of The Canadian Constitution, Toronto, Carswell, 1898 à la p 406; AR Hassard, Canadian Constitutional History and Law, Toronto, Carswell, 1900 à la p 152; McConnell, Commentary BNAA, supra note 129 aux pp 227–32; John George Bourinot, A Manual of the Constitutional History of Canada, Montréal, Dawson Brothers, 1888 aux pp 117–18; JG Bourinot, How Canada is Governed, 6e éd, Toronto, Copp, Clark Company, 1909 à la p 126; Bora Laskin, Canadian Constitutional Law, Toronto, Carswell, 1969 aux pp 990–91; KC Wheare, Federal Government, 4e éd, New York, Oxford University Press, 1964 aux pp 132–33; Gérald-A Beaudoin, Le partage des pouvoirs, 3e éd, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1983 aux pp 438–39.
-
[168]
Voir généralement les mémoires, supra note 105.
-
[169]
Voir José Woehrling, « Les droits et libertés dans la construction de la citoyenneté, au Canada et au Québec » dans Michel Coutu et al, dir, Droits fondamentaux et citoyenneté : Une citoyenneté fragmentée, limitée, illusoire ?, Montréal, Thémis, 1999, 269 aux pp 277–79.
-
[170]
Voir Brun et Brouillet, supra note 57 à la p 64; Liew et Galloway, supra note 20 aux pp 60–62.
-
[171]
Voir Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien », supra note 161 à la p 11.
-
[172]
Louis-Philippe Pigeon, « The Meaning of Provincial Autonomy » (1951) 29:10 Can Bar Rev 1126 à la p 1127; Ian Binnie, « Interpreting the Constitution: The Living Tree vs. Original Meaning » [2007] Options Politiques 104 à la p 104.
-
[173]
Voir Hunter c Southam Inc, [1984] 2 RCS 145 aux pp 155–56, 11 DLR (4e) 641; R c Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295 à la p 344, 18 DLR (4e) 321; Brun, Tremblay et Brouillet, supra note 2 à la p 1000; Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte].
-
[174]
En guise d’exemple, notre recherche démontre que plusieurs parties du discours de Lord Carnarvon dans la Chambre des Lords ont été citées depuis la remise en cause de la règle d’exclusion (voir Di Iorio c Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 RCS 152 à la p 200, 73 DLR (3e) 491; R c Hauser (1977), 7 AR 89 aux para 30, 150, 156, 80 DLR (3e) 161 (CSC); R c Gauthier, 1978 CarswellQue 791 au para 44 (WL Can); Renvoi relatif au projet de Loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont), [1987] 1 RCS 1148 à la p 1173, 40 DLR (4e) 18; R v Lutz (1978), 22 OR (2e) 300 à la p 312, 44 CCC (2e) 143 (CP Div crim); Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué), [1990] RJQ 2498 à la p 2518, (disponible sur CanLII) (CA Qc); Adler c Ontario, [1996] 3 RCS 609 au para 152, 140 DLR (4e) 385; Ontario Home Builders’ Association c Conseil scolaire de la région de York, [1996] 2 RCS 929 au para 70, 137 DLR (4e) 449).
-
[175]
Voir Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, supra note 6; Renvoi sur la réforme du Sénat, supra note 6.
-
[176]
Renvoi sur la réforme du Sénat, supra note 6 au para 31.
-
[177]
Ibid aux para 15, 29–31, 46, 58, 76, 79.
-
[178]
Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, supra note 6 aux para 46–62. Si la décision de la Cour aurait potentiellement pu être justifiée par une méthode littérale, le raisonnement de la Cour illustre que la méthode historique a été favorisée (voir J Gareth Morley, « Dead Hands, Living Trees, Historic Compromises: The Senate Reform and Supreme Court Act References Bring the Originalism Debate to Canada » (2016) 53 :3 Osgoode Hall LJ 745 à la p 787).
-
[179]
Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, supra note 6 au para 19; Brouillet, Gagnon et Laforest, supra note 7 à la p 9.
-
[180]
Voir Beaulac, supra note 106 à la p 301.
-
[181]
Voir ibid à la p 303; Renvoi relatif à la Loi anti-inflation, [1976] 2 RCS 373 aux pp 387–91, 68 DLR (3e) 452.
-
[182]
R c Morgentaler, [1993] 3 RCS 463 à la p 484, 107 DLR (4e) 537.
-
[183]
Voir ibid.
-
[184]
Léonid Sirota et Benjamin Oliphant, « Originalist Reasoning in Canadian Constitutional Jurisprudence » (2017) 50:2 UBC L Rev 505 à la p 565. Voir aussi Benjamin Oliphant et Léonid Sirota, « Has the Supreme Court of Canada Rejected “Originalism”? » (2016) 42:1 Queen’s LJ 107 [Oliphant et Sirota, « Has the SCC Rejected “Originalism”? »].
-
[185]
Voir ibid aux pp 158–60.
-
[186]
Voir par ex Lawrence B Solum, « What Is Originalism? The Evolution of Contemporary Originalist Theory » dans Grant Huscroft et Bradley W Miller, dir, The Challenge of Originalism: Theories of Constitutional Interpretation, New York, Cambridge University Press, 2011, 12 à la p 39; Jack M Balkin, Living Originalism, Cambridge (Mass), Belknap Press of Harvard University Press, 2011 à la p 3; Kerri A Froc, « Is Originalism Bad for Women? The Curious Case of Canada’s “Equal Rights Amendment” » (2015) 19:2 Rev Const Stud 237 à la p 264.
-
[187]
Lawrence B Solum, « Originalism and Constitutional Construction » (2013) 82:2 Fordham L Rev 453.
-
[188]
Voir Oliphant et Sirota, « Has the SCC Rejected “Originalism”? », supra note 184 à la p 151.
-
[189]
Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance-emploi, 2005 SCC 56, [2005] 2 SCR 669 au para 9.
-
[190]
Voir ibid au para 45 (« [d]’une part, aucune rubrique constitutionnelle n’est statique. D’autre part, l’évolution de la société ne peut justifier une dénaturation du pouvoir accordé par la Constitution à l’un ou à l’autre ordre de gouvernement. Les deux concepts ne sont pas contradictoires »).
-
[191]
Oliphant et Sirota, « Has the SCC Rejected “Originalism”? », supra note 184 à la p 152.
-
[192]
Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance-emploi, supra note 189 au para 9.
-
[193]
Cette méthode semble être favorisée, du moins partiellement, par Eugénie Brouillet (voir Eugénie Brouillet, « The Federal Principle and the 2005 Balance of Powers in Canada » (2006) 34 SCLR 307 aux pp 314–20). De manière générale, ses écrits appuient la méthode littérale mise de l’avant par le Conseil privé.
-
[194]
Voir Oliphant et Sirota, « Has the Supreme Court Rejected “Originalism”? », supra note 184 à la p 126.
-
[195]
Voir ibid.
-
[196]
Voir ibid à la p 151.
-
[197]
Supra note 102 aux para 33–44.
-
[198]
Voir Morley, supra note 178 à la p 795.
-
[199]
Voir par ex Consolidated Fastfrate, supra note 102 au para 40; Colombie-Britannique (PG) c Christie, 2007 CSC 21 au para 24, [2007] 1 RCS 873; Colombie-Britannique c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49 au para 65, [2005] 2 RCS 473.
-
[200]
Voir Randy E Barnett et Evan D Bernick, « The Letter and the Spirit: A Unified Theory of Originalism » (2018) 107:1 Geo LJ 1 aux pp 32–36.
-
[201]
Edwards v Canada (AG) (1929), [1930] AC 124 à la p 141 (HL (Eng)) [Persons Case].
-
[202]
Ibid à la p 127; Bradley W Miller, « Origin Myth: The Persons Case, the Living Tree, and the New Originalism » dans Huscroft et Miller, supra note 186, 120 aux pp 131–32 (la notion d’« arbre vivant » qui découle de cet arrêt implique plutôt l’idée que la Constitution canadienne inclut la constitution politique, qui peut évoluer en raison de nouveaux usages ou de nouvelles conventions constitutionnelles).
-
[203]
Persons Case, supra note 201 à la p 137, citant Brophy v Manitoba (AG) (1894), [1895] AC 202 à la p 216 (HL (Eng)).
-
[204]
Voir aussi Ontario (AG) v Canada (AG) (1911–12), [1912] AC 571 à la p 583 (HL (Eng)).
-
[205]
Loi constitutionnelle de 1867, supra note 1, arts 11, 14, 18, 24, 34, 38, 51, 52, 63, 67, 77, 82, 93, 95, 101, 106, 120, 131, 134, 143 et 144. Une recherche sur CanLII et Westlaw démontre que ces articles ont fait l’objet de peu de jurisprudence, et que l’expression « from time to time » n’a pas été interprétée par les tribunaux jusqu’à présent.
-
[206]
Ibid, art 11.
-
[207]
Ibid, cinquième annexe.
-
[208]
Ibid, art 93.
-
[209]
Ibid, art 93(4).
-
[210]
Il nous faut toutefois souligner que l’autorité fédérale n’est jamais intervenue dans ce contexte, et que, de nos jours, cette partie de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s’applique qu’à l’Ontario, alors qu’un régime modifié s’applique en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba (voir Zoë Oxaal, « Second-Guessing the Bishop : Section 93, the Charter, and the “religious government actor” in the Gay Prom Date Case » (2003) 66 :2 Sask L Rev 455; Landau v Ontario (AG), 2013 ONSC 6152 aux para 29–33, 293 CRR (2e) 257; Loi sur l’Alberta, 1905, 4 & 5 Edw VII, c 3, art 17, reproduite dans LRC 1985, ann II, no 20; Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict, c 3, art 22, reproduite dans LRC 1985, ann II, no 8; Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4 & 5 Edw VII, c 42, art 17, reproduite dans LRC 1985, ann II, no 21). Il incombe aussi de noter que cette partie de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s’appliquait pas aux provinces qui n’avaient pas un système d’écoles séparées au moment de leur entrée dans la fédération canadienne (voir Creighton, supra note 15 à la p 410).
-
[211]
Loi constitutionnelle de 1867, supra note 1, art 93(4).
-
[212]
Ibid, art 95.
-
[213]
En fait, il n’est pas entièrement clair qu’un pouvoir discrétionnaire accordé à un acteur de l’exécutif par la Constitution serait lui-même sans limites (Pour un exemple émanant de la Cour suprême de l’Inde, voir Nabam Rebia and Bamang Felix c Deputy Speaker et al, [2016] INSC 496 aux para 139-44. En ce qui concerne les limites inhérentes au pouvoir discrétionnaire conféré par une loi, voir Roncarelli c Duplessis, [1959] RCS 121, 16 DLR (2e) 689).
-
[214]
Voir Vriend c Alberta, [1998] 1 RCS 493 aux para 130–36, 156 DLR (4e) 385; Law Society of Upper Canada c Skapinker, [1984] 1 RCS 357 aux pp 366–68, 9 DLR (4e) 161.
-
[215]
Voir Andreas Lienhard et al, « The Federal Supreme Court of Switzerland: Judicial Balancing of Federalism without Judicial Review » dans Nicholas Aroney et John Kincaid, dir, Courts in Federal Countries: Federalists or Unitarists?, Toronto, University of Toronto Press, 2017, 404 à la p 405.
-
[216]
Toronto Electric Commissioners v Snider et al, [1925] 2 DLR 5 aux pp 5–6, [1925] 1 WWR 785.
-
[217]
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, supra note 102.
-
[218]
[1932] 1 DLR 58 à la p 65; [1931] 3 WWR 625.
-
[219]
Voir Loi constitutionnelle de 1982, supra note 1, art 52(1).
-
[220]
Voir Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, supra note 102 à la p 758; R c Boudreault, 2018 CSC 58 au para 98 (disponible sur CanLII).
-
[221]
Voir GP Browne, The Judicial Committee and the British North America Act: An Analysis of the Interpretative Scheme for the Distribution of Legislative Powers, Toronto, University of Toronto Press, 1967 à la p 3 [Browne, The Judicial Committee].
-
[222]
Voir généralement Runnymede Society, « The Erosion of Stare Decisis and the Rule of Law » (21 février 2018), en ligne : YouTube <www.youtube.com/watch?v=MxKF_6QnIIU&t=7s> (articles à paraître dans la Supreme Court Law Review en 2019).
-
[223]
Canada (PG) c Bedford, 2013 CSC 72 aux para 43–44, [2013] 3 RCS 1101 [Bedford].
-
[224]
Carter c Canada (PG), 2015 CSC 5 au para 44, [2015] 1 RCS 331 [Carter].
-
[225]
Bedford, supra note 223 au para 44.
-
[226]
R c Comeau, 2016 NBAC 3 au para 125. Voir aussi Malcolm Lavoie, « R. v. Comeau and Section 121 of the Constitution Act, 1867: Freeing the Beer and Fortifying the Economic Union » (2017) 40:1 Dal LJ 189.
-
[227]
R c Comeau, 2018 CSC 15 au para 31, [2018] 1 RCS 342 [Comeau CSC].
-
[228]
Voir Mangat, supra note 78 au para 52.
-
[229]
Voir Craig c Canada, 2012 CSC 43 aux para 11, 29, [2012] 2 RCS 489.
-
[230]
Ontario (AG) c Canada Temperance Federation (1946), [1946] AC 193 à la p 206 (HL (Eng)). Pour plus d’information sur le droit ecclésiastique, voir Gerald Bray, The Anglican Canons 1529–1947, Woodbridge (R-U), The Boydell Press, 1998 à la p xxi. Bien que la règle du stare decisis s’appliquait aux « ecclesiastical appeals », et ce depuis 1833 (voir ibid à la p xcviii), le tribunal faisait parfois exception lorsqu’une nouvelle preuve historique était apportée.
-
[231]
Voir Browne, The Judicial Committee, supra note 221 aux pp 14–20; Re The Farm Products Marketing Act, [1957] RCS 198 à la p 212, 7 DLR (2e) 257, juge Rand :
The powers of this Court in the exercise of its jurisdiction are no less in scope than those formerly exercised in relation to Canada by the Judicial Committee. From time to time the Committee has modified the language used by it in the attribution of legislation to the various heads of ss. 91 and 92, and in its general interpretative formulations, and that incident of judicial power must, now, in the same manner and with the same authority, wherever deemed necessary, be exercised in revisiting or restating those formulations that have come down to us.
-
[232]
Supra note 229 au para 25.
-
[233]
Ibid au para 27.
-
[234]
Voir Comeau CSC, supra note 227 au para 99.
-
[235]
Ibid au para 78, citant Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 58, 161 DLR (4e) 385.
-
[236]
Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien », supra note 161 à la p 30.
-
[237]
Voir ibid à la p 11. Sur cette vulnérabilité, voir aussi Johanne Poirier, « Fédéralisme coopératif et droits linguistiques au Canada : peut-on “contractualiser” le droit des minorités ? » dans Alain-G Gagnon et Pierre Noreau, dir, Constitutionnalisme, droits et diversité : Mélanges en l’honneur de José Woehrling, Montréal, Thémis, 2017, 317 aux pp 333–34.
-
[238]
Voir Ministry of International Business and Immigration Act, LRCB 1996, c 304; Government Organization Act, LRA 2000, c G-10; The Executive Government Organization Act, LRM 1987, c E170; The Executive Government Administration Act, LS 2014, c E-13.1; Executive Council Act, LRPEI 1988, c E-12; Loi sur le Conseil exécutif, LRN-B 2011, c 152; Public Service Act, LRNS 1989, c 376; Intergovernmental Affairs Act, LRNL 1990, c I-13. Sur la question des ententes intergouvernementales, voir généralement Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien », supra note 161.
-
[239]
Voir Sasha Baglay et Delphine Nakache, « Immigration Federalism in Canada: Provincial and Territorial Nominee Programs (PTNPs) » dans Sasha Baglay et Delphine Nakache, dir, Immigration Regulation in Federal States: Challenges and Responses in Comparative Perspective, Dordrecht, Springer, 2014, 95 à la p 109. Sur l’accessibilité des ententes intergouvernementales, voir aussi Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien », supra note 161 à la p 5.
-
[240]
Voir Baglay et Nakache, supra note 239 aux pp 111–12. Voir aussi Delphine Nakache et Catherine Blanchard, « Remedies for Non-Citizens under Provincial Nominee Programs: Judicial Review and Fiduciary Relationships » (2014) 37:2 Dal LJ 527.
-
[241]
Voir Renvoi relatif à la Loi anti-inflation, supra note 181 aux pp 432–35.
-
[242]
[1978] 1 RCS 1123 à la p 1143, 79 DLR (3e) 1.
-
[243]
Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien », supra note 161 aux pp 27–28. Voir notamment UL Canada Inc c Québec (PG), 2005 CSC 10, [2005] 1 RCS 143; Fédération des producteurs de volailles du Québec c Pelland, 2005 CSC 20, [2005] 1 RCS 292; Boucher c Stelco Inc, 2005 CSC 64, [2005] 3 RCS 279.
-
[244]
Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien », supra note 161 à la p 27. Voir toutefois Northrop Grumman Overseas Services Corp c Canada (PG), 2009 CSC 50 au para 11, [2009] 3 RCS 309 (dans cet arrêt, la Cour est encore venue brouiller les cartes en disant ce qui suit au sujet d’une entente intergouvernementale : « Il ne s’agit pas d’une loi. L’organe exécutif ne peut écarter des lois existantes en concluant des accords, bien que les accords qu’il ratifie puissent le lier [...] L’organe législatif, quant à lui, peut évidemment choisir d’adopter un accord, en tout ou en partie, et lui donner force de loi ». Il incombe aussi de souligner que, dans son arrêt, la Cour a omis de mentionner les arrêts clés de 2005).
-
[245]
Pour un excellent résumé de cette façon de procéder, voir Schmidt c Canada (PG), 2018 FCA 55 aux para 91–98, 421 DLR (4e) 530, juge Stratas.
-
[246]
Voir Nico Steytler, « The Currency of Concurrent Powers in Federal Systems » dans Nico Steytler, dir, Concurrent Powers in Federal Systems: Meaning, Making, Managing, Leyde, Brill Nijhoff, 2017, 1 à la p 9.
-
[247]
Nous aborderons cette question plus directement en proposant une nouvelle interprétation de l’art 95 au cours des prochaines pages.
-
[248]
Carnarvon, UKHL Debates, supra note 53, col 565.
-
[249]
Parsons v Citizens Insurance Company of Canada (1881), [1881] 7 AC 96 aux pp 108–09 (HL (Eng)).
-
[250]
Sur la question de la construction constitutionnelle, voir Randy E Barnett, Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty, Princeton, Princeton University Press, 2014 aux pp 128–29 :
To enhance legitimacy, therefore, vague terms should be given the meaning that is most respectful of the rights of all who are affected, and rules of construction most respectful of these rights should be adopted to put general constitutional provisions into legal effect. [...] I would further contend that when construction is needed, adopt one that (a) is consistent with the original meaning of the terms at issue and yet (b) furthers the constitutional principles of, for example, separation of powers and federalism, and enhances the legitimacy of the lawmaking process.
Voir aussi Barnett et Bernick, supra note 200.
-
[251]
Voir NIL/TU,O Child and Family Services Society c BC Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45 au para 11, [2010] 2 RCS 696.
-
[252]
Ibid au para 14.
-
[253]
Carnarvon, UKHL Debates, supra note 53, col 565.
-
[254]
Cette proposition s’inspire d’une approche précédemment adoptée par la Cour (voir R c Crown Zellerbach Canada Ltd, [1988] 1 RCS 401 aux pp 432–34, 49 DLR (4e) 161 (la Cour suprême suggère dans cet arrêt que le critère de l’incapacité provinciale est l’un des indices permettant de déterminer si une matière est d’intérêt national. Sans être obligatoire, la présence de ce critère implique nécessairement que l’intervention du Parlement fédéral est justifiable en vertu de la doctrine de l’intérêt national)).
-
[255]
Steytler, supra note 246 aux pp 9, 308–10.
-
[256]
Voir ibid.
-
[257]
Voir Johanne Poirier, « Pouvoir normatif et protection sociale dans les fédérations multinationales » (2001) 16:2 RCDS 137 aux pp 149–50.
-
[258]
Sur la distinction, voir Johanne Poirier et Cheryl Saunders, « Conclusion: Comparative Experiences of Intergovernmental Relations in Federal Systems », dans Johanne Poirier, Cheryl Saunders et John Kincaid, dir, Intergovernmental Relations in Federal Systems: Comparative Structures and Dynamics, Oxford, Oxford University Press, 2015, aux pp 445–47.
-
[259]
Cette application ferait écho à ce qui a été établi par la Cour dans la trilogie de 2015 (voir ETR Concession, supra note 77; Moloney, supra note 77; Lemare Lake Logging, supra note 77).
-
[260]
Moloney, supra note 77 au para 18.
-
[261]
Ibid au para 110.
-
[262]
Lemare Lake Logging, supra note 77 au para 17.
-
[263]
Voir notamment Eugénie Brouillet, « Le fédéralisme et la Cour suprême du Canada : quelques réflexions sur le principe d’exclusivité des pouvoirs » (2010) 3 Revue québécoise de droit constitutionnel 1 aux pp 19–20; Jesse Hartery, « Towards A Restrained Approach to Canadian Federal Paramountcy », (30 mars 2017), The Federal Idea, en ligne : <www.ideefederale.ca/ifcawp/wp-content/uploads/2017/09/Hartery_fr_v2.pdf>, archivé à https://perma.cc/443S-974Q.
-
[264]
Lemare Lake Logging, supra note 77 au para 23.
-
[265]
Sur la question de l’objet fédéral clair, voir Lemare Lake Logging, supra note 77 aux para 20–23, 26, 45, 67–68.
-
[266]
Voir Loi constitutionnelle de 1867, supra note 1, art 91(25). Voir aussi Liew et Galloway, Immigration Law, supra note 20 à la p 14.
-
[267]
Voir ibid aux pp 33–37.
-
[268]
Union Colliery Company of British Columbia v Bryden, [1899] AC 580, [1919] 12 CRAC 175 à la p 586; Cain, supra note 90 aux pp 546–47; Mangat, supra note 78 au para 33; Okadia v Canada (Minister of Employment and Immigration) [1983], 5 DLR (4e) 187, 55 NR 116.
-
[269]
Voir Brun et Brouillet, supra note 57 aux pp 62–73.
-
[270]
En fait, même si la jurisprudence portant sur l’interprétation de l’art 95 en matière d’agriculture est identique à celle sur l’immigration, les juges dans ces affaires ont quand même su faire la distinction entre les art 95, 91(2) et 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 (voir McConnell, Commentary BNAA supra note 129 aux pp 300–03).
-
[271]
Voir Brun et Brouillet, supra note 57 aux pp 73–85.
-
[272]
Voir « Documents du Lac Meech » (1992) 37:1 RD McGill 144 à la p 162.
-
[273]
Voir Bagambiire, « The Constitution and Immigration », supra note 83 aux pp 429–30.
-
[274]
Voir Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien », supra note 161 à la p 8, n 28.
-
[275]
Johanne Poirier, « Souveraineté parlementaire et armes à feu : le fédéralisme coopératif dans la ligne de mire ? » (2015) 44 RDUS 47 aux pp 129–30.
-
[276]
Voir Vineberg, « History of Federal-Provincial Relations », supra note 111 à la p 22. Voir toutefois Donald F Bur, Law of the Constitution: The Distribution of Powers, Toronto, LexisNexis, 2016 aux pp 1368–71 (l’auteur exprime l’opinion selon laquelle une province devrait être compétente pour expulser les aubains de son propre territoire).
-
[277]
Chantal Desloges et Cathryn Sawicki, Canadian Immigration and Refugee Law, Toronto, Emond, 2017 aux pp 392–94.
-
[278]
Voir Canada v Ontario (1937), supra note 64.
-
[279]
Voir Banting, supra note 138 à la p 87.
-
[280]
Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 à la p 99. Voir aussi Banting, supra note 138 aux pp 99–100, 105 (l’auteur traite notamment de la question linguistique).
-
[281]
Banting, supra note 138 à la p 85.
-
[282]
Voir ibid à la p 92.
-
[283]
Voir Paquet, « Federalism and Immigration in Canada and Australia », supra note 137 aux pp 448–49.
-
[284]
Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 aux pp 18, 27–28, 244. Sur la fédéralisation de l’immigration aux États-Unis, voir généralement Jennifer Chacon, « The Transformation of U.S. Immigration Federalism: A Critical Reading of Arizona v. United States » dans Baglay et Nakache, supra note 239, 199; Gary P Freeman et Stuart M Tendler, « United States of America », dans Joppke et Seidle, supra note 138, 192.
-
[285]
Saskatchewan. 2008-2009 Annual Report Advanced Education, Employment and Labour, Regina: Advanced Education, Employment and Labour, 2009 à la p 20. Voir aussi Mireille Paquet, « La construction provinciale comme mécanisme : le cas de l’immigration au Manitoba » (2014) 33:3 Politique et Sociétés 101 à la p 110.
-
[286]
Paquet, « Living in “Interesting Times” », supra note 119 aux pp 128–30, 135–37.
-
[287]
Voir Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 aux pp 199–200.
-
[288]
Ronald L Watts, « Comparing Forms of Federal Partnerships » dans Karmis et Norman, supra note 5, 233 aux pp 234, 240.
-
[289]
Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 aux pp 250–53; Schertzer, supra note 118 aux pp 398–99.
-
[290]
Paquet, La fédéralisation de l’immigration, supra note 119 à la p 253. Voir aussi ibid aux pp 106, 142, 146–47, 151, 154–55, 192, 194–96, 201, 239.