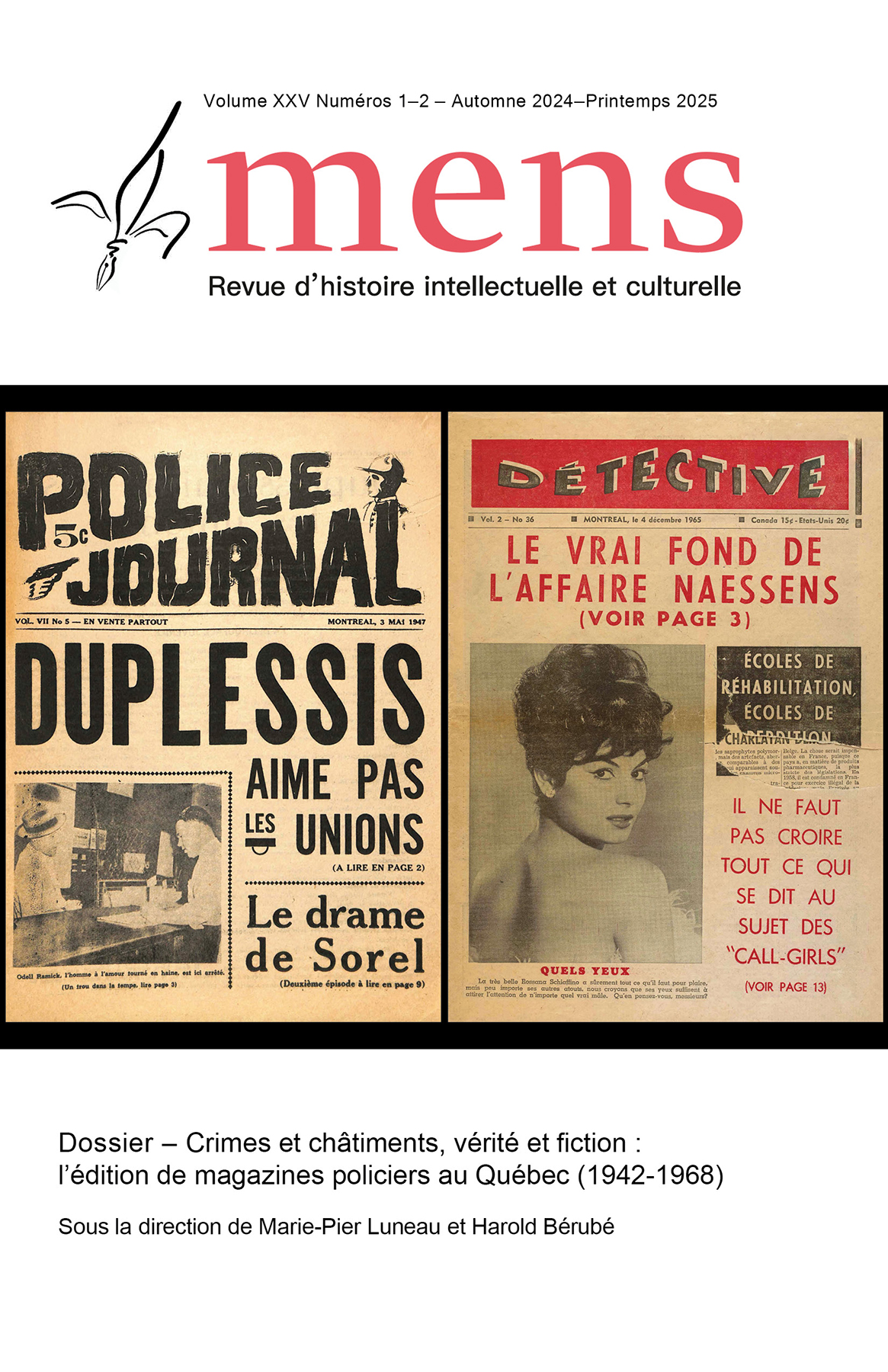Une quinzaine d’années se sont écoulées depuis la publication de l’ouvrage Québec en mouvements : idées et pratiques militantes contemporaines (Lux Éditeur, 2008), qui offrait un tour d’horizon des mouvements sociaux québécois du début des années 2000. Dans un nouvel ouvrage collectif, Pascale Dufour, Laurence Bherer et Geneviève Pagé proposent une mise à jour importante dans le champ des études sur les pratiques militantes. En introduction, les trois professeures en science politique expliquent que les mobilisations se sont considérablement transformées au cours des dernières années, notamment en raison du déclin de l’altermondialisme au profit des luttes contre les inégalités sociales. Divers groupes ont utilisé les médias sociaux pour promouvoir leurs revendications, ce qui a eu tendance à brouiller la distinction entre l’activisme en ligne et hors ligne. Du côté des « mouvements sociaux traditionnels » (Fédération des femmes du Québec [FFQ], centrales syndicales, etc.), les codirectrices de l’ouvrage observent certains obstacles liés à une perte de légitimité, à des conflits internes, ou encore à l’intégration de nouvelles préoccupations. Dans l’ensemble, l’espace protestataire est « plus fragmenté aujourd’hui, à la fois entre les mouvements et à l’intérieur de chacun d’entre eux » (p. 13), et présente une plus grande hétérogénéité sociale. Plusieurs actrices et acteurs sont désormais face au défi de trouver de nouvelles bases de solidarité, tout en tenant compte de questions qui sont désormais incontournables, comme la crise climatique. Les dix-sept chapitres rassemblés dans cet ouvrage livrent plusieurs pistes pour comprendre comment s’organisent les mouvements sociaux actuels, et ce, à partir d’une grande variété de perspectives et d’échelles. Pascale Dufour et Francis Dupuis-Déri, qui signent le premier chapitre, proposent un aperçu des luttes étudiantes entre 2012 et 2022. Cette période, qui s’ouvre par le « Printemps érable », correspond à une importante redéfinition du mouvement, tant en ce qui a trait aux structures qu’aux revendications. Selon Dufour et Dupuis-Déri, les modes d’organisation se sont transformés au profit d’un fonctionnement ad hoc, « c’est-à-dire à côté des associations locales et de leurs regroupements nationaux reconnus et financés » (p. 37). Depuis quelques années, ce sont les élèves du secondaire qui donnent un nouvel élan aux mobilisations étudiantes, notamment en participant aux grèves pour le climat. Les trois chapitres suivants sont consacrés aux luttes environnementales et pour les droits des animaux. À l’échelle provinciale, Sophie L. Van Neste, Zaïnab El Guerrab, René Audet et Hélène Madénian s’intéressent aux mobilisations en faveur de la « justice climatique ». Ces dernières se sont d’abord structurées en opposition à des projets d’extraction ou de transport des hydrocarbures en mettant en évidence les répercussions sur le cadre de vie local. Certaines luttes présentent toutefois une inclusion partielle et insuffisante des communautés autochtones et des personnes racisées ainsi que de leurs points de vue sur la crise climatique. Face à ce constat, le projet « Pas de justice climatique sans justice sociale » fait entendre des voix habituellement marginalisées dans le mouvement environnemental. À une plus petite échelle, Agathe Lelièvre et Laurence Bherer se penchent sur les pratiques de verdissement urbain et de dumpster diving à Montréal et à Québec. Celles-ci se distinguent par un fonctionnement autonome et peu institutionnalisé, répondant à des besoins locaux et visant des objectifs immédiats. Selon les autrices, cet « activisme tranquille » est à inscrire plus largement au coeur de « mouvements de réappropriation de la terre, de l’espace et de la nourriture marchandisés » (p. 73). Le quatrième chapitre, rédigé par Alexia Renard, permet de « politiser le véganisme » en montrant les continuités entre ce dernier et l’antispécisme. Au Québec, le mouvement végane et celui pour …
Pascale Dufour, Laurence Bherer et Geneviève Pagé (dir.). Le Québec en mouvements : continuité et renouvellement des pratiques militantes, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2023, 286 p.
…more information
Camille Robert
Université Concordia
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options