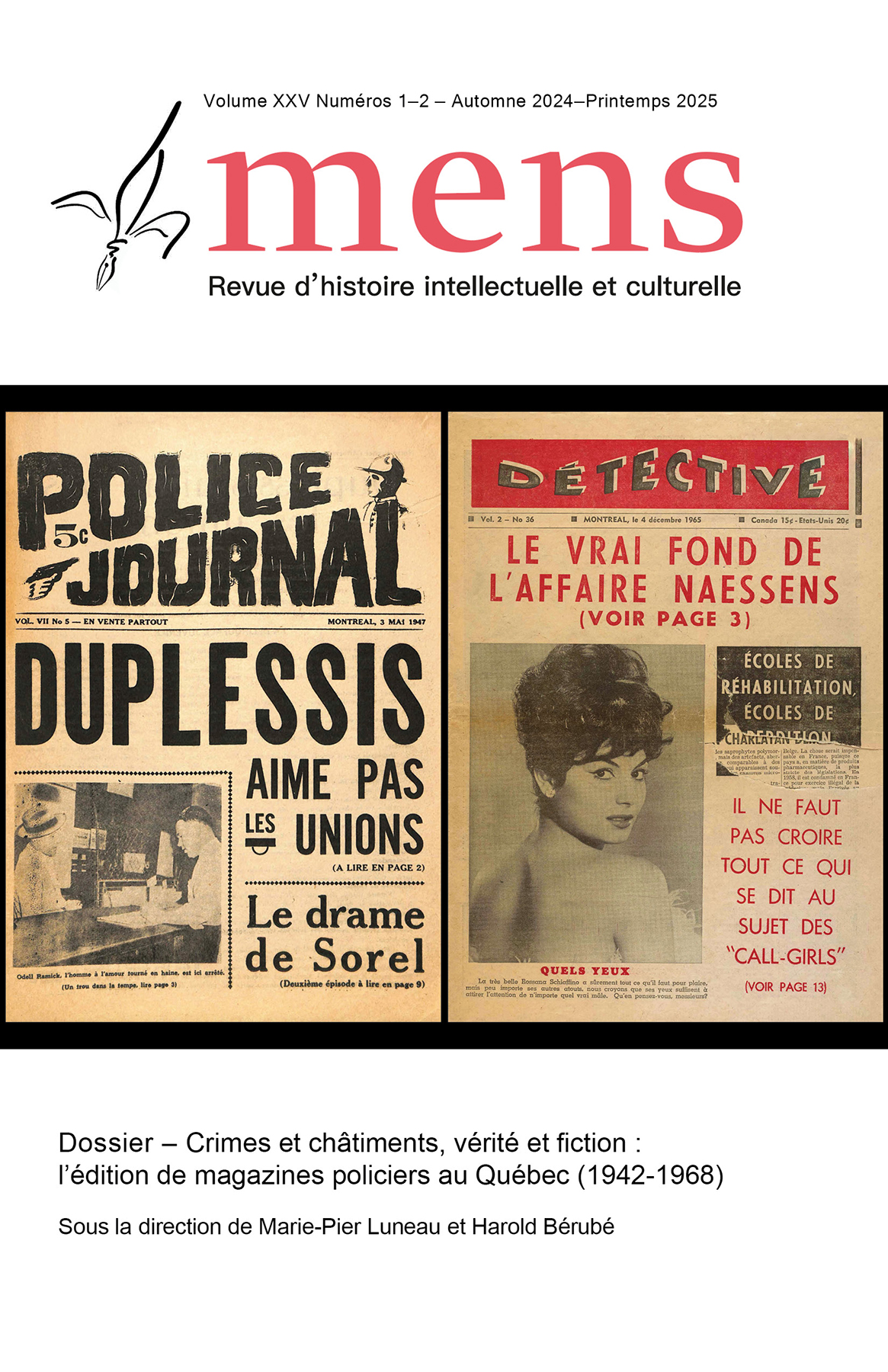Il est peu courant de lire un ouvrage épousant avec autant de précision les contours théoriques, méthodologiques et éthiques d’un champ d’étude que Histoires souveraines : poétiques du personnel dans les littératures autochtones au Québec d’Isabella Huberman. En fonction de l’essor actuel de la production littéraire autochtone en français et de la conjoncture politique, sociale et culturelle de renégociation d’une relation de nation à nation entre le Canada et les peuples autochtones, les études littéraires autochtones traversent une période d’examen critique de leurs fondements. Dans ce contexte d’assises instables, l’ouvrage d’Huberman s’impose comme un exploit intellectuel, méritant pleinement le prix Gabrielle-Roy qui lui a été attribué en 2024 par l’Association des littératures canadienne et québécoise. Pour atteindre la véritable réforme intellectuelle pouvant mener un jour à l’établissement d’une réelle relation avec les « savoirs autochtones » (ce que l’ouvrage d’Huberman a l’ambition d’instaurer), les études littéraires autochtones se consacrent délibérément à la déstabilisation des conventions, des réflexes et des automatismes propres à la recherche universitaire. L’exposé où la chercheuse dévoile son parcours subjectif et reconnaît les partis pris inhérents à la position qu’elle occupe est déjà un élément incontournable de la recherche en sciences humaines, bien que sa portée et sa nécessité soient accrues dans le cadre des études autochtones. Il s’agit à la fois de prendre conscience de l’inévitabilité de l’inscription dans une tradition intellectuelle coloniale et de souligner l’importance d’établir des relations vécues et authentiques en contexte autochtone. L’originalité d’Huberman réside dans le fait qu’elle explicite les raisons qui sous-tendent cette démarche : « J’affirme ma positionnalité afin d’expliquer où je me situe par rapport à l’héritage du colonialisme, mais aussi pour préciser mes choix théoriques et politiques et la façon dont cette étude s’inscrit dans mon histoire personnelle. » (p. 24) D’autres stratégies de défamiliarisation ponctuent le texte, comme l’utilisation mesurée des toponymes « Kebec », « Kanata » et « Île de la Tortue ». Bien que l’usage de telles marques textuelles soit fréquent en études autochtones, leur intégration dans les conventions linguistiques et les pratiques de recherche n’est pas encore systématique. Par exemple, la « pratique courante en études autochtones qui consiste à préciser la nation autochtone de la personne à laquelle on se réfère » (p. 15), visant à accorder une visibilité et une légitimité aux intervenants autochtones, n’atteint pas toujours cet objectif de manière uniforme. Ainsi, la forme moins habituelle et donc plus visible « Jo-Anne Episkenew (Métisse) » (p. 15) côtoie des formulations plus familières, comme « l’écrivaine anishinaabe Kateri Akiwenzie-Damm » (p. 122). De plus, l’usage non systématique de cette précision ramène rapidement l’ambiguïté dans la majorité de l’ouvrage où seul le nom des chercheurs autochtones comme allochtones est utilisé. Enfin, la stratégie ne touche pas les conventions de citation dans le corps du texte ni la bibliographie en fin d’ouvrage, alors que l’on pourrait juger pertinent de mettre en lumière les contributions autochtones. C’est dans de telles fluctuations que l’ouvrage reflète l’état actuel, transitionnel, du domaine de recherche. Un risque, que Huberman reconnaît elle-même, est que ces stratégies de défamiliarisation déplacent l’attention des oeuvres autochtones vers la chercheuse ; dans le contexte actuel des études littéraires autochtones, ce piège de la réflexivité est difficile à éviter. En ce sens, Histoires souveraines donne l’impression d’être un double ouvrage : l’un qui explore comment mener une recherche sur les oeuvres littéraires autochtones, et l’autre qui présente le produit de cette recherche. Ce « deuxième » livre n’est pas pour autant secondaire, et la part réservée aux oeuvres de Naomi Fontaine (Innue), de Natasha Kanapé Fontaine (Innue), d’An Antane Kapesh (Innue), de …
Isabella Huberman. Histoires souveraines : poétiques du personnel dans les littératures autochtones au Québec, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2023, 278 p., coll. « Expressions autochtones »
…more information
Pénélope Cormier
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options