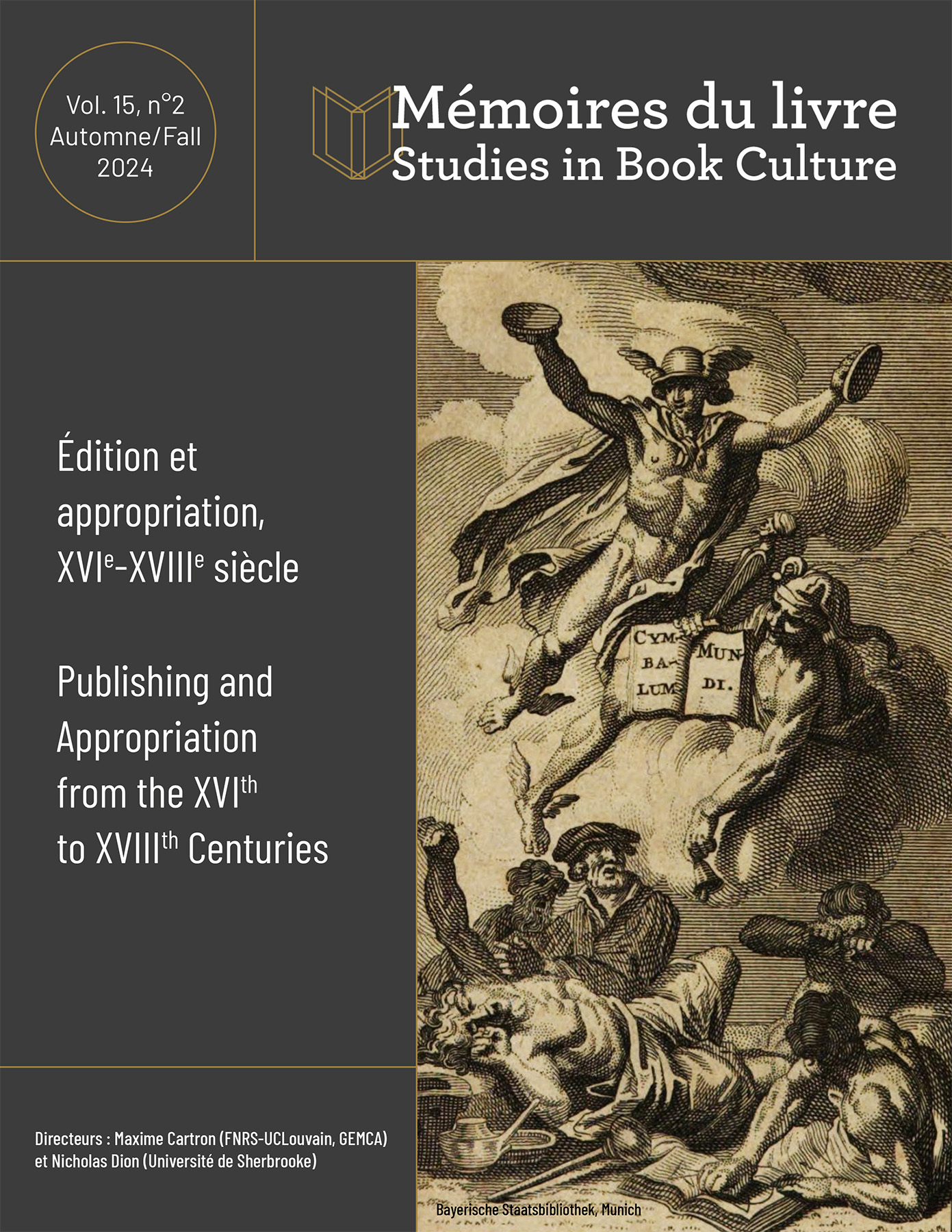Omniprésente dans la réflexion de Roger Chartier, la notion d’appropriation, par laquelle l’historien du livre cherche à réaliser « une histoire sociale des usages et des interprétations […] inscrits dans les pratiques spécifiques qui les produisent », s’avère d’une grande efficacité pour aborder les multiples aspects que comporte l’édition. En effet, rapprocher ces deux termes offre la possibilité de sortir d’une approche purement descriptive pour développer une herméneutique de l’imprimé en ce que, comme l’écrit encore Roger Chartier, « les livres, dans leur matérialité même, commandent la possible appropriation des discours ». C’est le pari que prend le présent numéro : considérer l’objet-livre en tant qu’objet sémiotique propre à encourager des lectures appropriantes. Dans un ouvrage plus récent, Guillaume Peureux allait aussi dans ce sens, en déplaçant le curseur de l’auteur aux lecteurs par le biais d’une « extension de l’auctorialité » aux « manières de lire ». Montrant qu’« à chaque étape de leur activité, les lecteurs tendaient à régénérer ou à réinventer le texte qu’ils avaient lu », il s’attaque à l’une des notions les plus centrales des études littéraires avec celle de « texte » : l’auteur qui, depuis « le sacre de l’écrivain » naguère analysé par Paul Bénichou, phagocyte le discours critique au point que les « traces de lectures laissées par les lecteurs de l’époque témoignent d’un rapport aux textes poétiques qui autorisait des interventions que nous n’oserions pas imaginer ». La méthode de l’histoire de la lecture est apte à rendre compte de l’importance, tout à fait conséquente au xviie siècle, de ces gestes de lecture qui nous semblent intrusifs à tort, et qui sont loin d’être réductibles à des phénomènes isolés. Tout au contraire, ils offrent l’occasion unique d’entrer dans la fabrique historique de la poésie. En sortant de l’uniformisation qu’induirait une approche faisant de l’auteur le garant univoque du sens, une étude des « modalités de publication, de dissémination et d’appropriation des textes » fait apparaître ces gestes et ces acteurs qui font aussi l’oeuvre, et que l’histoire littéraire et la génétique « traditionnelles » invisibilisent. Les notions de « texte » et d’« oeuvre », souvent envisagées d’un point de vue statique et hypostatique par la génétique et l’histoire littéraire, éclatent pour resserrer le regard sur la « socialisation des poèmes » et, de ce fait, sur le lien entre « genèse et vie sociale des poèmes ». S’intéresser aux interactions sociales impliquées par les interventions, les collaborations et toutes les opérations de « marquage » qui fondent l’appropriation des textes et des oeuvres, révèle les « énergies sociales et culturelles » qui habitent les lectures appropriantes. Ces gestes critiques, qui permettent de sortir de problématiques exclusivement esthétiques, ne reviennent pas pour autant à envisager les oeuvres et les textes uniquement en vertu d’une approche sociologique : il s’agit plutôt de mettre au jour les déterminations socioculturelles et matérielles des esthétiques littéraires, qui les configurent de fond en comble. Il nous a semblé que la force des analyses théoriques de Guillaume Peureux pouvait contribuer à l’étude de corpus autres que poétiques. C’est par conséquent dans cette lignée que le présent numéro explore le lien étroit qu’entretiennent, pour les oeuvres publiées entre les xvie et xviiie siècles, les deux notions d’édition et d’appropriation, et ce plus particulièrement en vertu de trois entrées théoriques. En premier lieu, les articles réunis ici abordent la dimension réversible de cette interaction, ce qui revient à travailler l’appropriation par l’édition et l’édition par l’appropriation, soit à poser que les implications heuristiques et herméneutiques engagées par le rapprochement de ces deux notions ne peuvent …
Édition et appropriation, xvie-xviiie siècleIntroduction[Record]
…more information
Maxime Cartron
FNRS-UCLouvain, GEMCANicholas Dion
Université de Sherbrooke