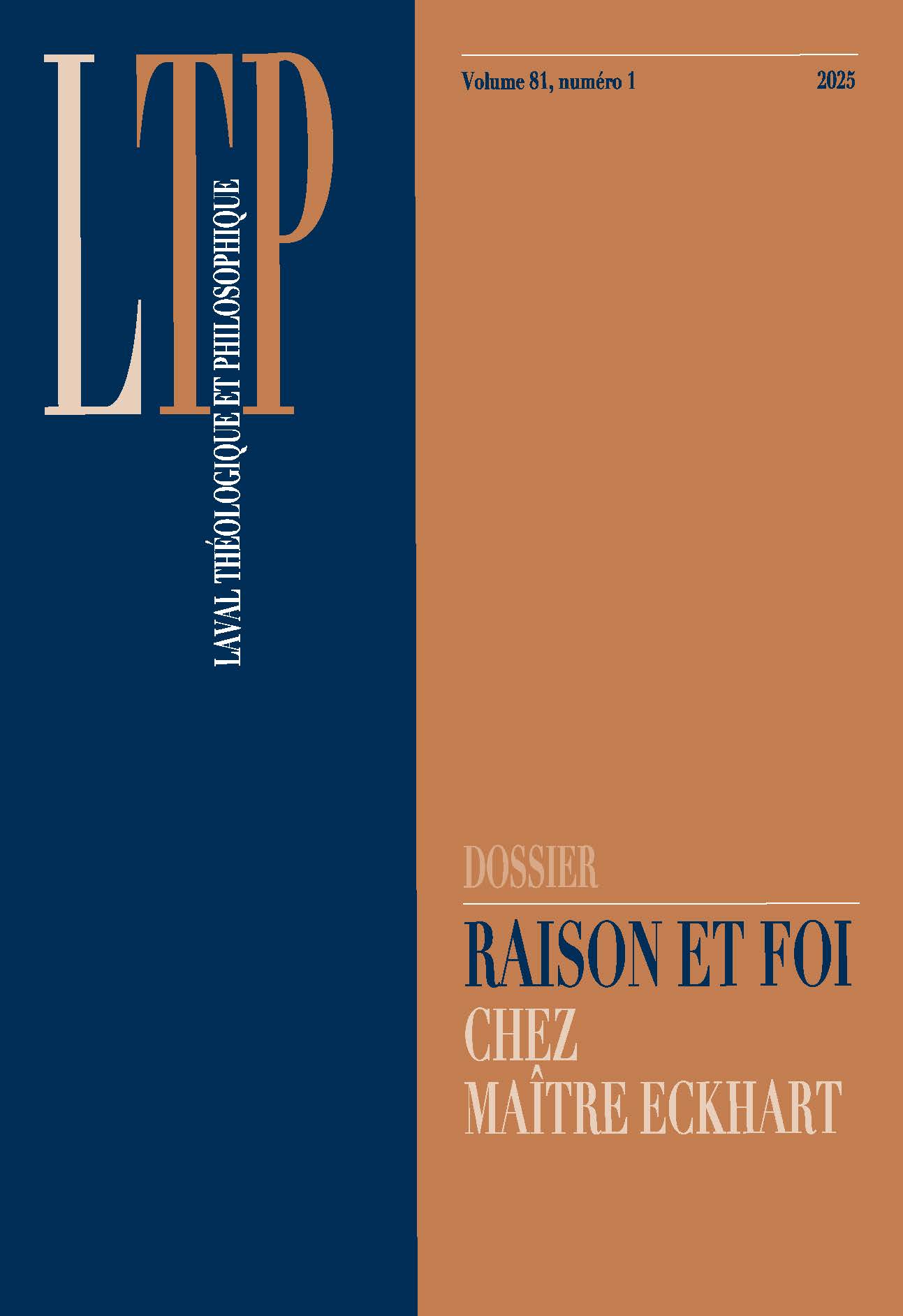La Faculté de philosophie de l’Université Laval célèbre cette année ses 90 ans d’existence. Alors que la plupart des unités d’enseignement et de recherche en philosophie sont des départements rattachés à d’autres entités administratives, la nôtre est l’une des rares au monde à bénéficier d’un statut « facultaire », qui lui confère une plus grande autonomie. Ce statut, auquel nous sommes profondément attachés, est le résultat d’un long parcours historique et reflète à la fois l’évolution culturelle et intellectuelle de la société québécoise et celle de l’Université Laval. Les premiers cours de philosophie ont été dispensés au Collège des Jésuites, l’ancêtre des collèges classiques, dès le milieu du xviie siècle. Et quoique l’année 1935 marque officiellement la naissance de la Faculté de philosophie, l’enseignement de notre discipline avait déjà été introduit à la fin du xixe siècle à l’Université Laval, dont l’octroi d’une charte royale en 1852 officialise la fondation. L’Université est alors une université catholique constituée de quatre facultés : arts, médecine, droit et théologie. L’enseignement de la philosophie se fait à cette époque sous l’égide de Rome. De fait, c’est en 1879 que l’encyclique Aeterni Patris du pape Léon XIII confère à notre université sa charte pontificale. L’Université Laval peut alors décerner des grades dans les sciences ecclésiastiques : la théologie, le droit canonique et la philosophie. Ainsi, à son retour de Rome, Mgr Louis-Adolphe Pâquet (1859-1942), futur doyen de la Faculté de théologie (1904-1938) — et décrit comme le « maître le plus autorisé » de la philosophie thomiste — enseigne, à la fin du xixe siècle, à raison de quelques heures par mois, des cours préparatoires à la licence en philosophie, surtout aux séminaristes. Après la guerre de 1914-1918, de plus en plus de laïcs se joignent aux étudiants de théologie afin de préparer la licence de philosophie. Au même moment, la ville de Québec voit sa population bondir de 70 000 habitants en 1900 à 100 000 en 1921. À cette époque, étudiants et professeurs peuvent déjà venir à l’université en tramway ! Cependant, la capacité d’accueil du Séminaire de Québec est en voie d’être saturée et l’Université, alors située dans le secteur historique de la ville, se porte acquéreuse du terrain sur lequel nous nous trouvons. En 1920, la souscription publique organisée par le Séminaire connue sous le nom de « L’aide à Laval » récolte plus de deux millions de dollars. Ces fonds permettent d’engager d’importantes réformes et conduisent notamment à la création de l’École normale supérieure, dotée de deux sections, lettres et sciences, rattachées à la Faculté des arts. La plupart des facultés, écoles et départements qui composent la structure actuelle de notre université sont issus de cette réforme. En 1926, le Conseil universitaire consent à la création d’une École supérieure de philosophie qui sera rattachée à la Faculté des arts et placée sous la direction de Louis-Adolphe Pâquet. Le nombre d’heures consacrées à la philosophie est rehaussé (cent heures réparties sur vingt-cinq semaines) tout comme le nombre d’inscriptions (entre vingt-cinq et trente annuellement). On y enseigne alors la logique, la métaphysique, la cosmologie, la psychologie, la morale et l’histoire de la philosophie. À la suite de la réforme des études ecclésiastiques promulguée en 1931 par le pape Pie XI (« Deus Scientiarum Dominus »), qui impose de nouvelles exigences en matière d’enseignement, l’École devient, le 12 avril 1932, l’Institut supérieur de philosophie, rattaché à la Faculté des arts. L’une des premières tâches est alors de pourvoir ce nouvel institut du personnel nécessaire pour mener à bien sa mission d’enseignement et, dès l’année suivante, l’Institut dispense une dizaine …
1935-2025 : La Faculté de philosophie célèbre ses 90 ans d’existence ![Record]
…more information
Pierre-Olivier Méthot
Doyen de la Faculté de philosophie, Université Laval, Québec
Ce texte est une version remaniée de l’allocution prononcée à l’occasion du dévoilement de la programmation des activités du 90e anniversaire de la Faculté de philosophie le 21 janvier 2025. Je remercie le personnel de la Division de la gestion des documents administratifs et des archives de l’Université Laval pour leur accueil et leur disponibilité.