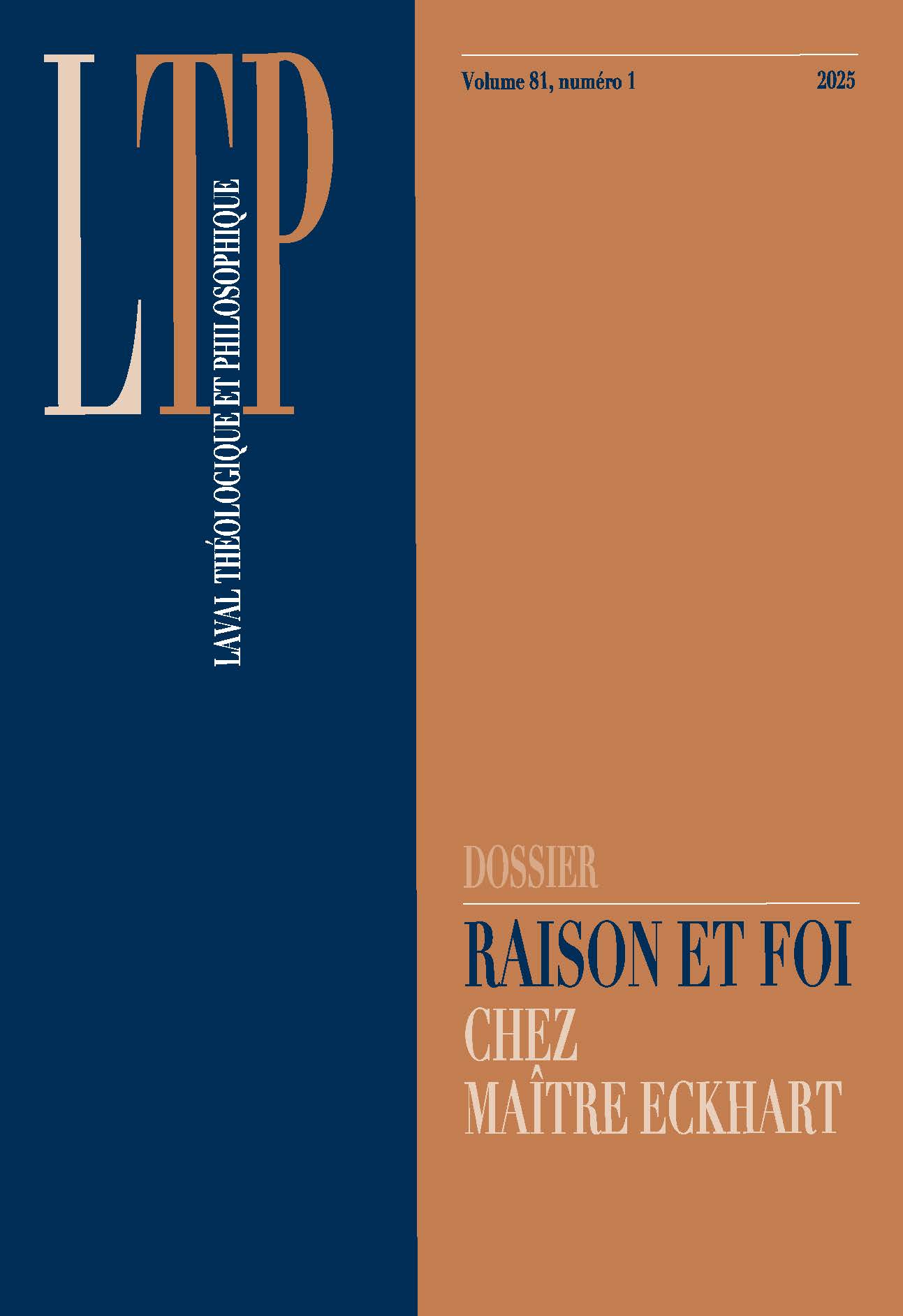On connaît l’attitude de Socrate vis-à-vis de ses interlocuteurs — véritable modèle, voire archétype de tout dialogue philosophique : si ceux-ci arrivent à le réfuter, loin de s’en offusquer, il les remercie, car la vérité est toujours préférable à l’erreur, et le philosophe n’a de plus haut désir que celui de vérité. C’est dans cet esprit que j’accueille l’étude critique que Guillaume St-Laurent a consacrée à mon livre paru en 2021, La phénoménologie comme manière de vivre (ci-après PMV). Exhaustive et pénétrante, son étude a bien mis en évidence les tensions de fond de cet ouvrage, me forçant ainsi à réexaminer les prémisses de ma pensée. Pour cette raison, je tiens à lui exprimer ici toute ma reconnaissance. Pour bien lui répondre, il m’aura fallu mieux me comprendre. L’objet du présent essai est donc d’offrir à St-Laurent cette réponse longtemps mûrie. Mais j’aimerais d’entrée de jeu élargir la portée de notre débat. Car au-delà du défi que pose la critique de St-Laurent pour ma propre philosophie (et celles de Husserl, James, Bergson et Heidegger, dont je me réclamais dans PMV), c’est en fait à la possibilité même de l’expérience mystique, du moins lorsque celle-ci est définie comme expérience de l’Être ou de l’Absolu (voir section I), que l’auteur s’attaque, et donc aussi, par conséquent, à toute forme de « philosophie mystique », c’est-à-dire à toute tentative de dériver une métaphysique ou une éthique à partir de l’expérience mystique comme telle. Une réponse est donc de mise, non seulement au nom du « phénoménisme ontologique » et de l’éthique du laisser-être (Seinlassen) que je défendais dans PMV, mais plus largement au nom d’un tel projet de conciliation entre le discours philosophique et le silence mystique. C’est cette réponse surtout que je m’efforcerai ici d’esquisser. À cet effet, il conviendra d’abord de préciser ce qu’il faut entendre par « expérience mystique » (section I). Dans PMV, mon intérêt se portait avant tout sur la signification de l’épochè phénoménologique dans le cadre de la philosophie husserlienne. Bien que la thèse principale de cet ouvrage fût que l’épochè phénoménologique correspond essentiellement à une conversion de type mystique, la mystique comme telle n’était abordée qu’indirectement. J’aimerais ici me passer de ce cadre exégétique et aborder la « chose même » sans détour, indépendamment donc des enjeux relatifs à la philosophie husserlienne. Cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas question de phénoménologie dans le présent article ; au contraire, les ressources de la phénoménologie sont indispensables pour faire le pont entre l’expérience mystique et la raison philosophique. Mais en prenant mon point de départ dans l’expérience mystique comme telle — à supposer qu’il y ait une telle chose (c’est justement ce que je tenterai de clarifier dans la prochaine section) —, je serai mieux à même de faire ressortir la portée universelle du présent débat. En un deuxième temps (sections II-V), je m’efforcerai de répondre une à une aux objections principales de St-Laurent, tout en les recadrant par rapport à la problématique plus générale qui est présentement la nôtre. Rappelons d’emblée brièvement ces objections, qui sont de trois ordres : Ces objections sont fortes et méritent que nous les considérions chacune sérieusement. Ultimement, c’est du sens même de la philosophie dont il y va dans ce débat — de là sa portée universelle. Quoi qu’il en soit, la philosophie ne peut rester indifférente envers la mystique, si tant est que cette dernière élève une prétention au sujet de la réalité ultime. La philosophie étant mue fondamentalement par un désir de vérité, et de vérité ultime …
Vit-on jamais autre chose que l’Absolu ?Réponse à G. St-Laurent[Record]
…more information
Philippe Setlakwe Blouin
Collège Champlain-St. Lawrence, Québec
La rubrique « En réponse » présente des textes rédigés par des auteurs et autrices d’ouvrages ayant fait l’objet d’un compte rendu (recension ou note critique) dans le LTP. Elle leur donne la possibilité de répondre à d’éventuelles critiques ou, plus simplement, d’entamer un dialogue avec l’auteur ou autrice du compte rendu.