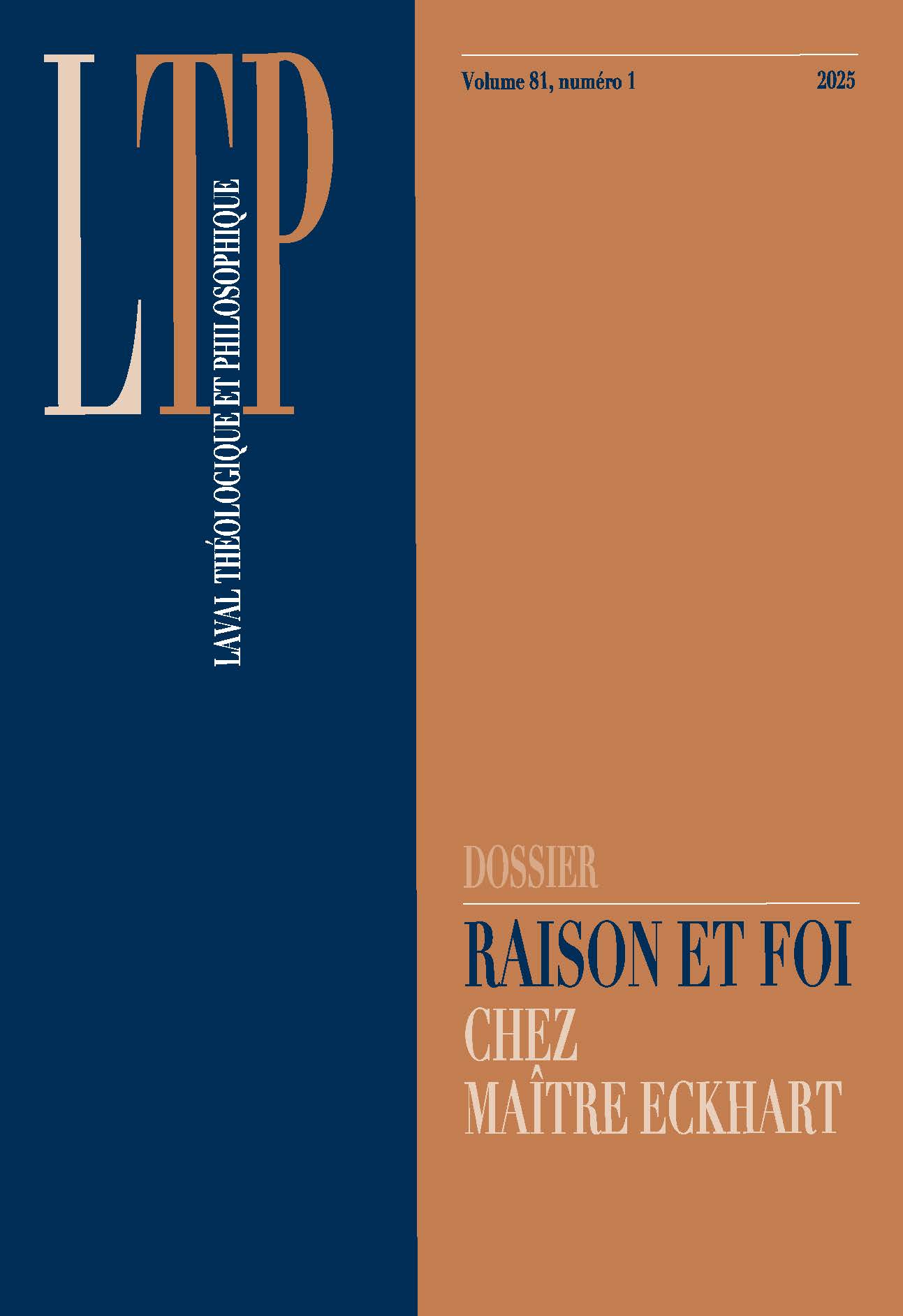Joseph Moingt, considéré comme un grand théologien par de nombreux contemporains, est décédé à l’été 2020, laissant une oeuvre immense dont les richesses restent à découvrir et à déployer. La revue Recherches de science religieuse (RSR) a consacré un numéro à son travail théologique sous le titre « L’oeuvre de Joseph Moingt » (110, 1 [2022]). Le succès qu’a connu le numéro a encouragé les responsables de la revue et ceux des Facultés Loyola Paris (anciennement Centre Sèvres) à organiser un colloque afin de lui donner une suite. Ainsi est née le livre La théologie de Joseph Moingt qui rassemble les contributions des intervenants au colloque. Tout en explorant plusieurs aspects de la pensée de Moingt, l’ouvrage familiarise le lecteur avec le « questionnement inquiet » et la recherche incessante du théologien. Du même geste, il l’invite à penser, lui aussi, sa foi en vérité. Bien que certaines contributions du livre reprennent dans leurs grandes lignes le contenu des articles du numéro des RSR, le livre garde son originalité. Les neuf contributions qui composent le collectif sont réparties en deux sections. La première porte sur les « étapes de la pensée de Joseph Moingt, ses apports à la théologie » (p. 7-71). Isabelle Chareire en signe le texte introductif dont le but est de « poser le cadre dans lequel se sont déployées la pensée et l’oeuvre de Joseph Moingt et d’en dégager les moments significatifs » (p. 9). Elle identifie quatre périodes dans le parcours du théologien : les années Lyon-Fourvière, les années RSR, l’exploration des motifs du croire à travers Dieu qui vient à l’homme, et enfin, la foi critique développée dans ses derniers écrits. Ce parcours met en lumière la longue trajectoire de vie et de réflexion théologique de Moingt. Pour sa part, Joseph Doré témoigne de sa « collaboration intellectuelle » avec le théologien (p. 25-37). Son témoignage est suivi par une étude de Michel Fédou mettant en lumière l’apport de Moingt au renouveau des études patristiques, surtout à travers son étude de la théologie trinitaire de Tertullien. Il relève aussi qu’au fil du temps Moingt a de moins en moins recouru aux écrits des Pères, des anciens conciles et des auteurs ecclésiastiques qu’il avait pourtant étudiés avec minutie. Il privilégie la lecture des Écritures, surtout les récits évangéliques, et encourage les chrétiens à s’y référer afin de créer de nouveaux langages pour dire leur foi. Claire-Anne Baudin clôt la première partie en présentant « l’apport de Joseph Moingt à la christologie » (p. 56-71). Elle expose « sa réflexion tout d’abord au sujet de la Résurrection du Christ, puis de la préexistence du Christ, et enfin de l’incarnation du Christ » (p. 57). Baudin revient ainsi sur les points majeurs de la pensée christologique de Moingt. La deuxième section du livre est consacrée aux questions ouvertes par la pensée de Moingt et aux débats qu’elle a suscités. Les textes de Joseph Famerée et de Jean-Pol Gallez portent sur les éléments de son ecclésiologie. Le premier interroge Moingt sur sa compréhension de la sainteté et de la catholicité, deux notes qui donnent à l’Église sa particularité (p. 75-91). Le second réfléchit à ce que devient l’Église dans l’histoire lorsqu’elle est confrontée à la « foi critique » à laquelle convie le théologien (p. 93-108). La dernière partie de son texte reprend un débat qu’il engage avec Famerée sur l’usage de la « terminologie (conceptualité) sacerdotale pour fonder […] les ministères ordonnés ou pastoraux, alors que le Nouveau Testament ne le fait pas » (p. 106). Enfin, Christoph Theobald, Pierre Gisel et …
Patrick C. Goujon, Alain Thomasset, dir., La théologie de Joseph Moingt, sj. Journée d’études Centre Sèvres, Facultés Jésuites de Paris. Paris, Médiasèvres (coll. « Théologie », 210), 2023, 151 p.
…more information
Pacifique Kambale
Université Laval, Québec
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options