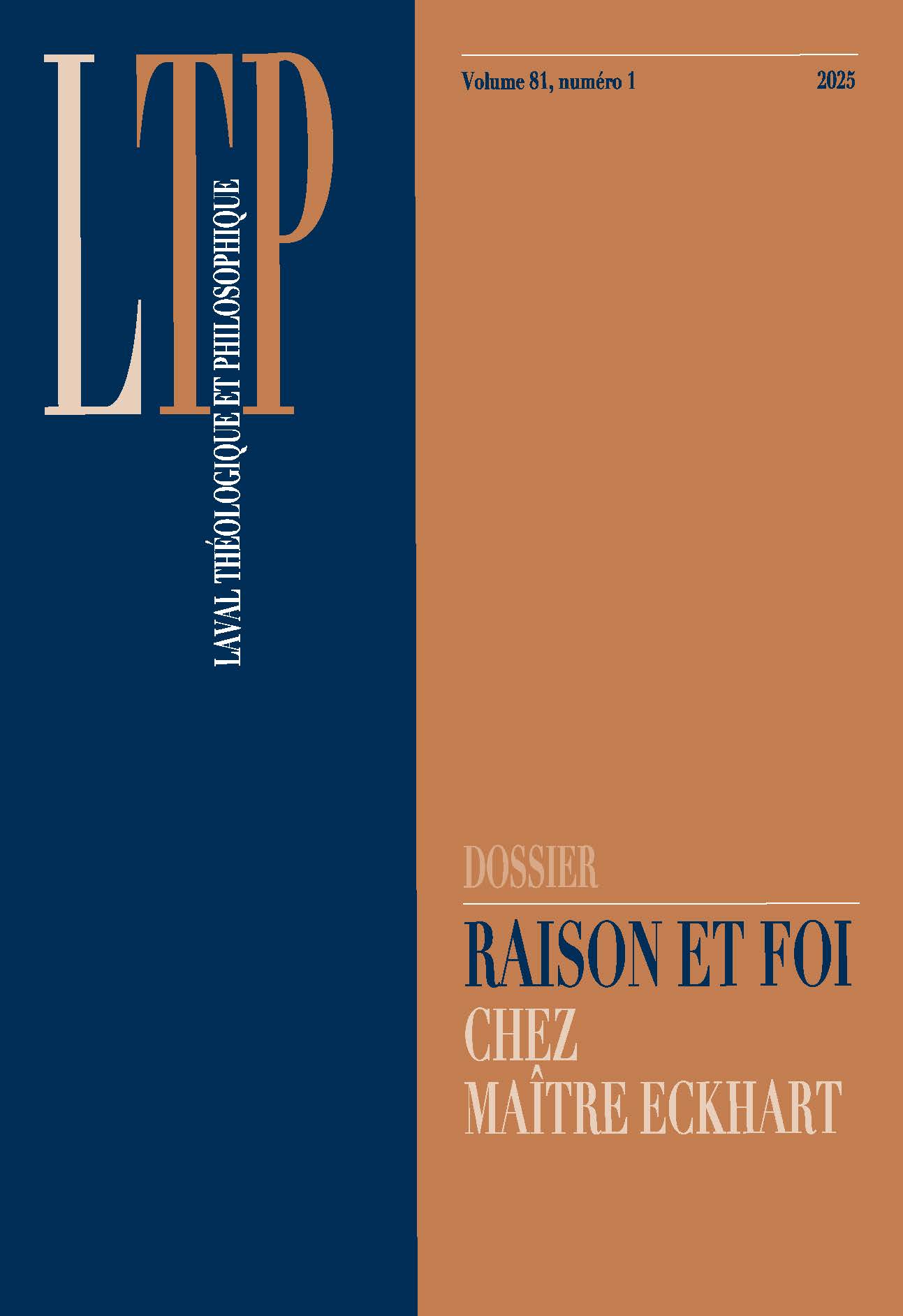Alors que plusieurs ont débattu les genres littéraires des Évangiles, Nicholas Elder s’intéresse à un aspect novateur : les pratiques médiatiques qui ont façonné la naissance et la diffusion des Évangiles. Le livre est structuré en trois sections principales, chacune abordant un aspect distinct du processus médiatique des Évangiles : la lecture, l’écriture, et la circulation des textes. Pour chaque activité, Elder déconstruit un « mythe » courant et propose une analyse détaillée fondée sur une vaste documentation issue non seulement de la littérature gréco-romaine (comme Cicéron, Fronton, Pline le jeune, Flavius Josèphe), mais aussi des papyri placés en annexe, des sources parabibliques et patristiques, enrichissant ainsi notre compréhension des Évangiles. La première section de l’ouvrage s’attaque au mythe selon lequel la lecture des Évangiles dans l’Antiquité se pratiquait systématiquement à haute voix et en groupe. À travers des exemples tirés de la littérature gréco-romaine, Elder montre que cette idée est réductrice puisque les pratiques de lecture étaient diverses et que la lecture silencieuse est attestée par plusieurs sources. Elder rattache chaque Évangile à des pratiques de lecture spécifiques. Par exemple, l’Évangile de Marc se présente comme une annonce orale, εὐαγγέλιον (Mc 1,1) étant de l’ordre d’une proclamation publique. Elder souligne d’abord les éléments qui montrent comment Marc puise dans des traditions orales préexistantes. Puis, il montre comment Marc a été réutilisé oralement et textuellement par la suite. À l’inverse, Matthieu (1,1) se désigne comme Βίβλος, un livre, qui selon Elder était destiné à être lu et commenté en synagogue. Luc se présente comme un texte écrit pour Théophile, privilégiant ainsi la lecture personnelle comme modèle pouvant être suivi par d’autres lecteurs par la suite. Enfin, l’Évangile de Jean, moins explicite, s’auto-identifie par le terme générique de document (βιβλίον) en Jn 20,30. Il semble inciter à une lecture plurielle, évoquant son existence parmi une multitude de traditions médiatiques si vaste qu’elles ne peuvent pas toutes être consignées dans cet Évangile. La deuxième section explore les modalités d’écriture des textes évangéliques. Elder réfute l’idée que l’écriture était toujours par dictée. Composer un texte impliquait une diversité de pratiques : dictée orale, écriture par la main de l’auteur, révisions manuscrites, et collaboration avec des secrétaires ou des esclaves, en particulier pour faire des copies. Elder démontre que la composition des Évangiles est à comprendre au sein de cette diversité de pratiques. Cette variété d’approches révèle que la transmission écrite était souvent influencée par des pratiques orales. En analysant plus particulièrement la question de la citation dans les Évangiles, Elder montre que Marc, en particulier, utilise les citations de manière peu précise, ce qui suggère qu’il pourrait être davantage une transcription d’une performance orale qu’un produit littéraire révisé. L’exemple donné est Ex 23,20, Ml 3,1 et Is 40,3 attribué globalement à Isaïe en Mc 1,2-3. À l’inverse, Matthieu et Luc montrent des signes clairs d’une composition écrite, notamment dans leur rapport aux citations bibliques : Matthieu et Luc semblent « corriger » les citations de Marc, les rapprochant du texte de la Septante et ajoutant parfois la suite du texte cité. Jean, pour sa part, s’intéresse moins aux citations directes qu’aux images et aux figures des Écritures d’Israël, ce qui témoigne d’une démarche qui relève de l’oralité ainsi que d’autres à la narration écrite. Dans la troisième partie, Elder traite de la circulation des textes dans l’Antiquité. La vision traditionnelle est un processus linéaire qui, suite à la mise à l’écrit, va vers des révisions par des amis, des performances orales et la publication pour un large public. De nombreux exemples montrent que les textes sont, au contraire, souvent diffusés de manière accidentelle …
Nicholas A. Elder, Gospel Media : Reading, Writing, and Circulating Jesus Traditions. Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2024, xvii-326 p.
…more information
Sébastien Doane
Université Laval, Québec
Access to this article is restricted to subscribers. Only the first 600 words of this article will be displayed.
Access options:
Institutional access. If you are a member of one of Érudit's 1,200 library subscribers or partners (university and college libraries, public libraries, research centers, etc.), you can log in through your library's digital resource portal. If your institution is not a subscriber, you can let them know that you are interested in Érudit and this journal by clicking on the "Access options" button.
Individual access. Some journals offer individual digital subscriptions. Log in if you already have a subscription or click on the “Access options” button for details about individual subscriptions.
As part of Érudit's commitment to open access, only the most recent issues of this journal are restricted. All of its archives can be freely consulted on the platform.
Access options