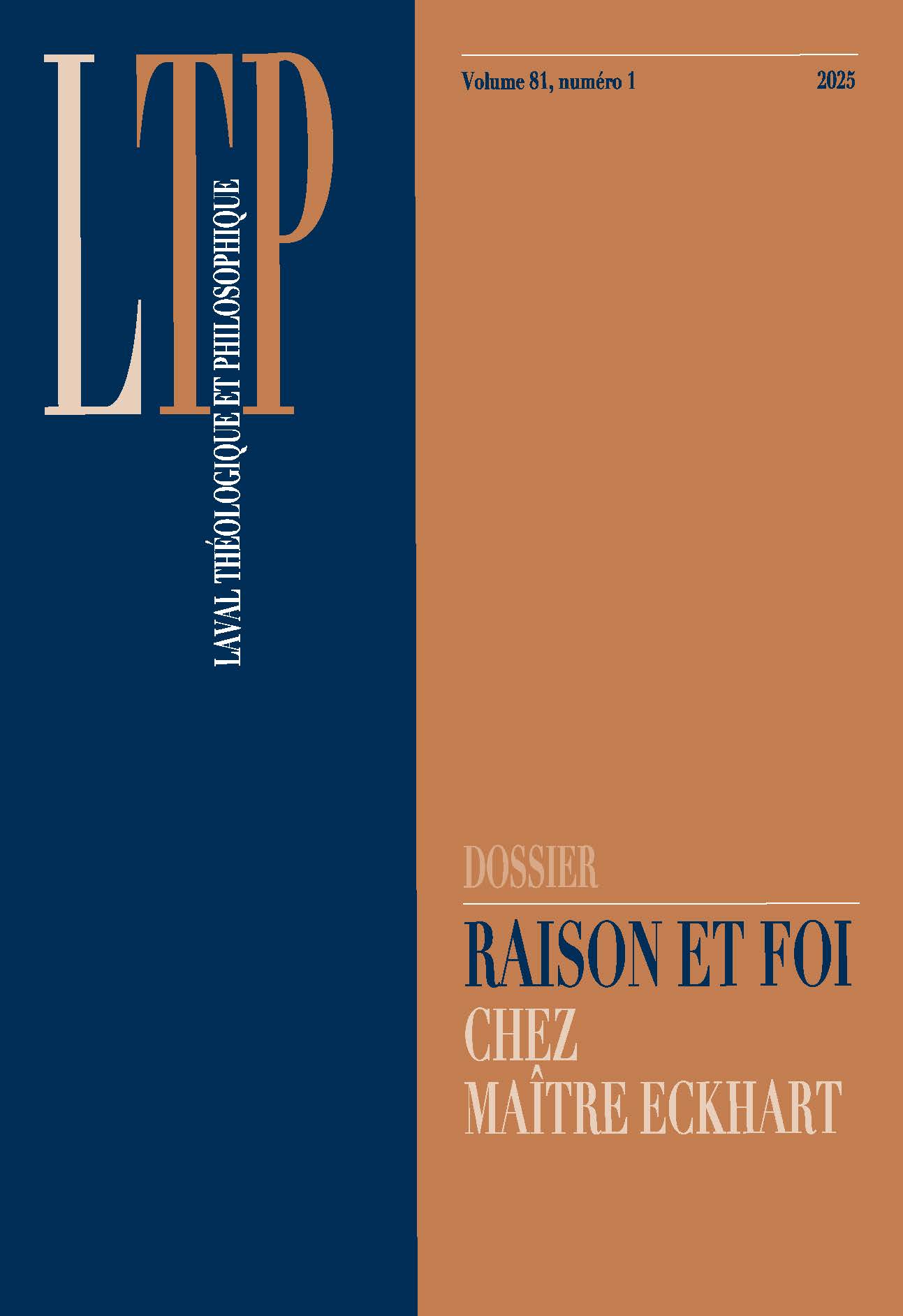Yves-Marie Blanchard (dans la suite : YMB), théologien et bibliste bien connu, nous offre un nouveau livre sur la Vierge Marie. Dans une introduction très dense et bien informée, il nous dit d’abord dans quelle perspective il se propose de relire principalement les textes du Nouveau Testament « fondateurs de toute mariologie chrétienne », sans mépriser l’apport des apocryphes « certes dénués d’autorité proprement théologique », mais qui ont fort influencé « les traditions ultérieures, tant liturgiques, qu’esthétiques ou populaires » (p. 13). YMB entend le faire dans une perspective oecuménique (dialogue avec les Églises chrétiennes) et interreligieuse (dialogues judéo-chrétien et islamo-chrétien). Il fait appel pour cela à un changement récent de paradigme dans la manière de théologiser, une « innovation probablement de celles qui n’arrivent que tous les cinq siècles » et qu’on a qualifiée de « consensus différencié ». Il s’agit de la déclaration commune sur la justification (DCJ) signée à Augsbourg, le 31 octobre 1999, par l’Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale. On y proclame un accord fondamental sur la compréhension de la justification : « Nous confessons ensemble : c’est seulement par la grâce, par le moyen de la foi en l’action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l’Esprit Saint qui nous habilite et nous appelle à accomplir des oeuvres bonnes » (DCJ 15). Accord, mais qui reconnaît des différences dans le langage et les formes théologiques employés et des accents particuliers dans cette compréhension : « consensus différencié ». C’est cette méthode — et ce pourrait être la grande nouveauté de ce livre — que YMB veut appliquer à la théologie mariale : « unité quant à la confession du salut en la personne de Jésus Fils de Dieu, fils de Marie » (p. 11), mais laissant leurs accents propres à chaque tradition confessionnelle. En fait, cependant, dans toute son analyse des textes du Nouveau Testament qui parlent de Marie (Paul, Marc, Matthieu, Luc et Jean) et des textes apocryphes (en amont comme en aval des évangiles), YMB ne fera plus allusion à ce « consensus différencié ». Il n’y revient que dans sa dernière section sur « l’actualité de Marie », « au coeur des dialogues » (p. 130) avec la Réforme protestante, l’islam et le judaïsme. Entre son introduction et cette section, il présente très simplement, « sans érudition savante ni vulgarisation accommodante » (p. 10), ce que nous révèlent de la figure de Marie les textes du Nouveau Testament. Comme il se doit, il commence par la première mention de Marie dans le Nouveau Testament, celle de Paul en Galates 4,4 : « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sous la Loi… ». Modeste entrée en scène : Marie n’est même pas nommée, seule sa qualité de mère juive d’un enfant lui-même juif est soulignée. En fournissant une analyse serrée de ce texte de Paul aux Galates, l’auteur montre parfaitement les enjeux théologiques auxquels Marie se trouve mêlée, dans cette économie du salut, « centrée sur l’unique médiation du Christ, le Fils envoyé de Dieu » (p. 20). Quand il passe aux évangiles, et à Marc surtout, qu’on estime être le premier évangéliste, le discours devient, oserait-on dire, plus terre à terre. On passe à la famille humaine de Jésus. Une tradition commune, reprise quasi brutalement par Marc (3,20-21 et 31-35), mais adoucie en Matthieu (12,46-50) et surtout en Luc (8,19-21), inviterait « à relativiser dans l’imaginaire chrétien l’importance de la famille de Jésus » (p. 25), incluant …
Marie des Écritures[Record]
…more information
Jean-Paul Michaud
Université Saint-Paul, Ottawa