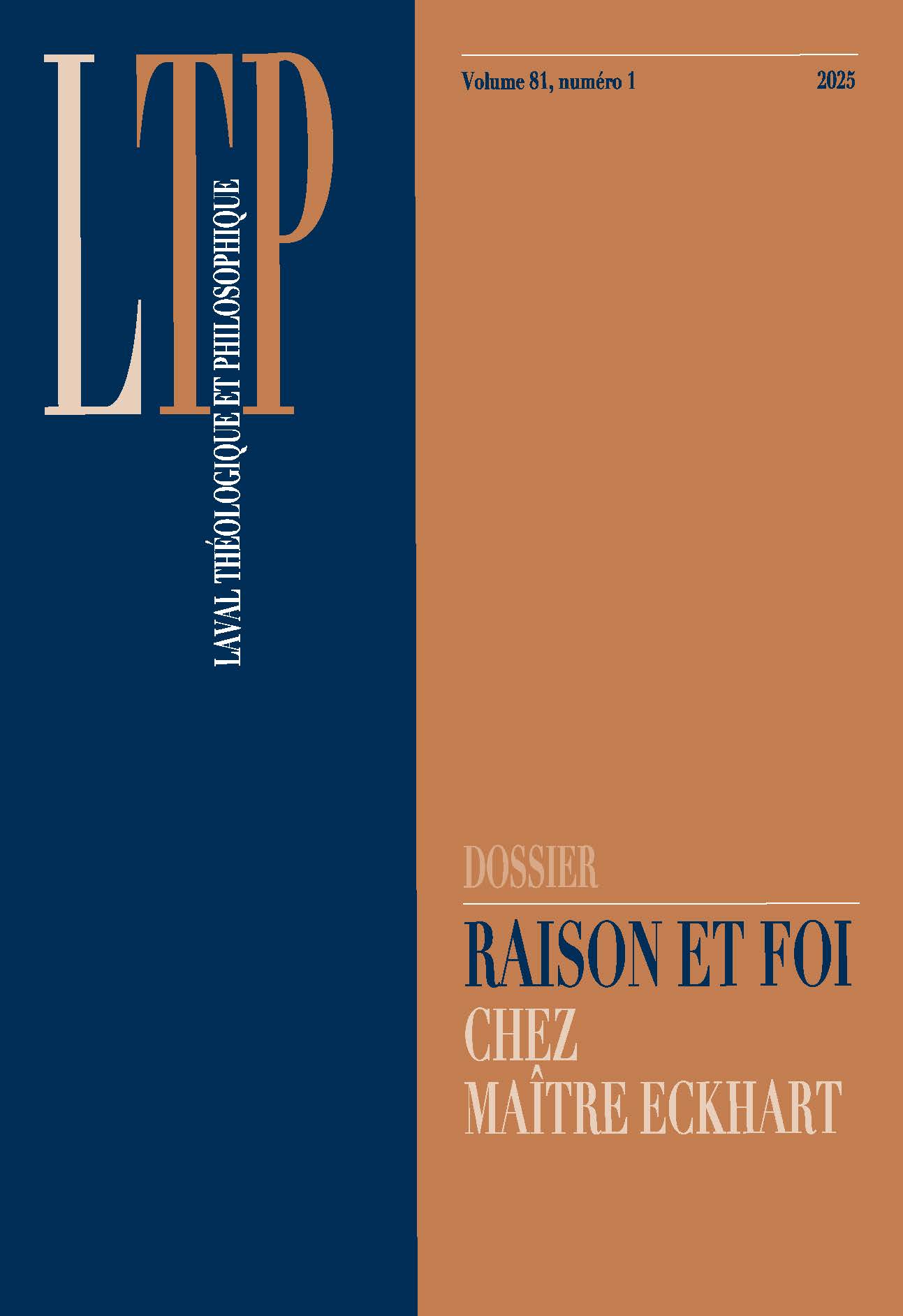Sept ans après son impressionnant commentaire de l’épître aux Hébreux, Jean Massonnet (JM) revient à ce texte dans une publication plus modeste, mais néanmoins importante. L’approche est différente. Il ne s’agit plus d’un commentaire suivi de toute l’épître. Après une brève introduction à ce texte « souvent trop méconnu parce qu’étrange et difficile » (p. 7), un premier chapitre présente rapidement des questions classiques d’introduction : auteur, destinataires, date de rédaction, situation géographique de la communauté visée. Déjà, dans ce premier chapitre, plusieurs options sont prises qui viennent d’une lecture attentive du texte. Si l’auteur inconnu de cette lettre (sur ce point, JM reprend sagement la position d’Origène : « Qui a écrit l’épître ? Dieu le sait ») est un helléniste cultivé qui s’exprime dans un grec excellent, la communauté chrétienne à laquelle il s’adresse, bien que capable de lire ce grec, est profondément enracinée dans le monde religieux juif centré sur le culte, et singulièrement les sacrifices. Il faut donc parler d’une communauté judéo-chrétienne. Mais l’insistance du texte à souligner, comme une sorte de mise en garde, l’inefficacité de ce culte sacrificiel laisserait entendre que cette communauté chrétienne est bien tentée de retourner au culte juif. D’autant plus que certains indices indiqueraient que ce culte est toujours offert dans le Temple de Jérusalem, au temps même de l’épître aux Hébreux. Parlant du rite du Kippour, lorsque le grand prêtre entre, une fois par an, dans le Saint des Saints, l’épître écrit que « le Saint Esprit indique que tant que la première tente — c’est-à-dire le Temple — subsiste, c’est là un symbole pour le temps présent : des offrandes et des sacrifices y sont offerts incapables de mener à la perfection, en sa conscience, celui qui rend le culte » (He 9,8-9). Autrement dit, en ce temps présent, celui où l’auteur écrit, le lieu des sacrifices, le Temple, n’aurait pas encore été détruit par les Romains en l’an 70 de notre ère. Ce qui amène JM, ainsi que d’importants commentateurs, à dater la rédaction de Hébreux dans les années soixante de notre ère. Un deuxième chapitre offre un résumé de toute l’épître et une structure empruntée dans ses grandes lignes à Albert Vanhoye (p. 34). Ce n’est là qu’une première lecture, bien qu’assez exigeante, mais sans qu’y soit souligné le rôle de chaque partie dans l’argumentation de ce grand discours théologique. En ce sens, une lecture assez décevante. Cette théologie ne sera discutée que dans les chapitres 4 à 9. C’est là qu’on retrouvera la pensée profonde de JM sur ce texte qu’il a longuement travaillé. Mais auparavant, un troisième chapitre répond à quelques questions encore préliminaires, signalant des constantes dans l’écriture de ce texte (alternance entre exposés et exhortations, référence constante à l’Écriture, tableaux contradictoires…) et répondant en premier lieu à une question plutôt surprenante : cette épître aux Hébreux est-elle vraiment une lettre ? Sans salutation, elle commence en effet par un prologue très solennel, qui fait penser à un exposé théologique de haut niveau. En fait, il s’agit bien d’un discours théologique, mais d’un discours adressé, d’un « discours d’exhortation » dit l’envoi final en 13,20-25 : logos tès paraklèseôs, (13,22), d’un sermon, comme ose traduire la TOB ! À la fois exposé théologique « qui demande un véritable effort de compréhension (aujourd’hui encore !) » (p. 40) et vigoureuses exhortations dévoilant la vie et les problèmes d’une réelle communauté. C’est dans les chapitres 4 à 9 que JM plonge dans la théologie de Hébreux et nous en offre sa propre compréhension. Sa lecture est celle d’un exégète de métier, …
Malaise autour de l’épître aux Hébreux[Record]
…more information
Jean-Paul Michaud
Université Saint-Paul, Ottawa