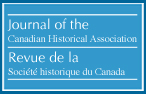Abstracts
Abstract
In compliance with the Third Period "line" of the Communist International (Comintern), the Communist Party of Canada (CPC) launched The Workers' Unity League (WUL) as a centre of "revolutionary" or "red" unionism in December 1929. Until it was "liquidated" during the winter of 1935-6, the WUL had a significance in Canada's Depression labour struggles far outweighing its maximum membership of between 30,000 and 40,000; a significance, moreover, that has yet to be fully acknowledged or analysed. This article seeks to look beyond the conventional view that presents the CPC as a Comintern cipher and the WUL (when it is considered at all) as a "sectarian", "adventurist", "ultra-left" organisation with no real interest in building stable labour unions. While there is no doubt that the two most crucial decisions concerning the WUL — to create it and to liquidate it — were taken in Moscow, neither the Comintern nor the CPC leadership in Toronto was in a position to supervise the implementation of the Third Period line on the ground. Within the broad parameters of the line, local organisers tended to operate as "good trade unionists" rather than "good bolsheviks", using every available opportunity to modify and adapt tactics to local realities. They used their room for manoeuvre to considerable effect, especially during the economic and political upturn of 1933-34, when the WUL led a majority of all strikes and established union bases in a host of hitherto unorganised or weakly organised industries. At the height of its power, however, the WUL knew that it had barely dented the essential mass production industries — auto, steel, rubber, farm machinery. This fact, coupled with the experience of defeat in several key strikes,forced the party to reconsider the WUL's future. Whether the WUL could have survived as part of a national union centre remains open to question. Indisputably, the Comintern terminated that option in 1935.
Résumé
En décembre 1929, en vertu des directives de la IIIe Internationale (Komintern), le Parti communiste du Canada (PCC) mit sur pied la Ligue d'unité ouvrière (LUO), pour servir de base à la diffusion du syndicalisme révolutionnaire. Avant d'être « liquidée », au cours de l'hiver 1935-1936, la Ligue a exercé sur les luttes ouvrières du pays une influence qui dépassa de beaucoup le nombre de ses membres (un maximum de 30 000 ou 40 000 individus). Sa signification est encore mal reconnue et mal comprise. Cette communication tente d'aller au delà de l'image conventionnelle du PCC comme une courroie de transmission du Komintern et de la LUO, quand on daigne s'y attarder, comme une organisation sectaire, aventureuse, ultra gauchiste et sans aucun intérêt pour la construction de syndicats ouvriers solides. Il ne fait aucun doute que les décisions les plus importantes concernant la Ligue furent prises à Moscou, celles de sa création et de son élimination, mais il n'en demeure pas moins que ni le Komintern ni la direction du PCC à Toronto n'étaient à même de superviser l’application de la ligne de la IIIe Internationale sur le terrain. C’est ainsi que, tout en acceptant les larges paramètres de la ligne, les organisateurs locaux purent travailler en « bons syndicalistes » plutôt qu'en « bons bolcheviks », en profitant de toutes les chances possibles pour adapter leurs tactiques aux réalités environnantes. Ils ont utilisé cette marge de manoeuvre avec un succès considérable, particulièrement au cours des soulèvements politiques des années 1933 et 1934. La Ligue d'unité ouvrière fut alors au centre de la majorité de l'ensemble des grèves du pays et elle établit des bases syndicales dans un ensemble de secteurs industriels auparavant mal ou peu organisés. Au sommet de son pouvoir, la Ligue savait pourtant qu'elle avait à peine entamé le secteur de la production de masse, que ce soit l'automobile, l'acier, le caoutchouc ou encore la machinerie agricole. Cette situation, à laquelle il faut ajouter la défaite de quelques grèves cruciales, a forcé le parti à repenser l'avenir de la Ligue. Elle aurait peut-être pu survivre, pour devenir une partie d'une centrale nationale. Mais en 1935, indiscutablement, le Komintern mit fin à cette alternative.