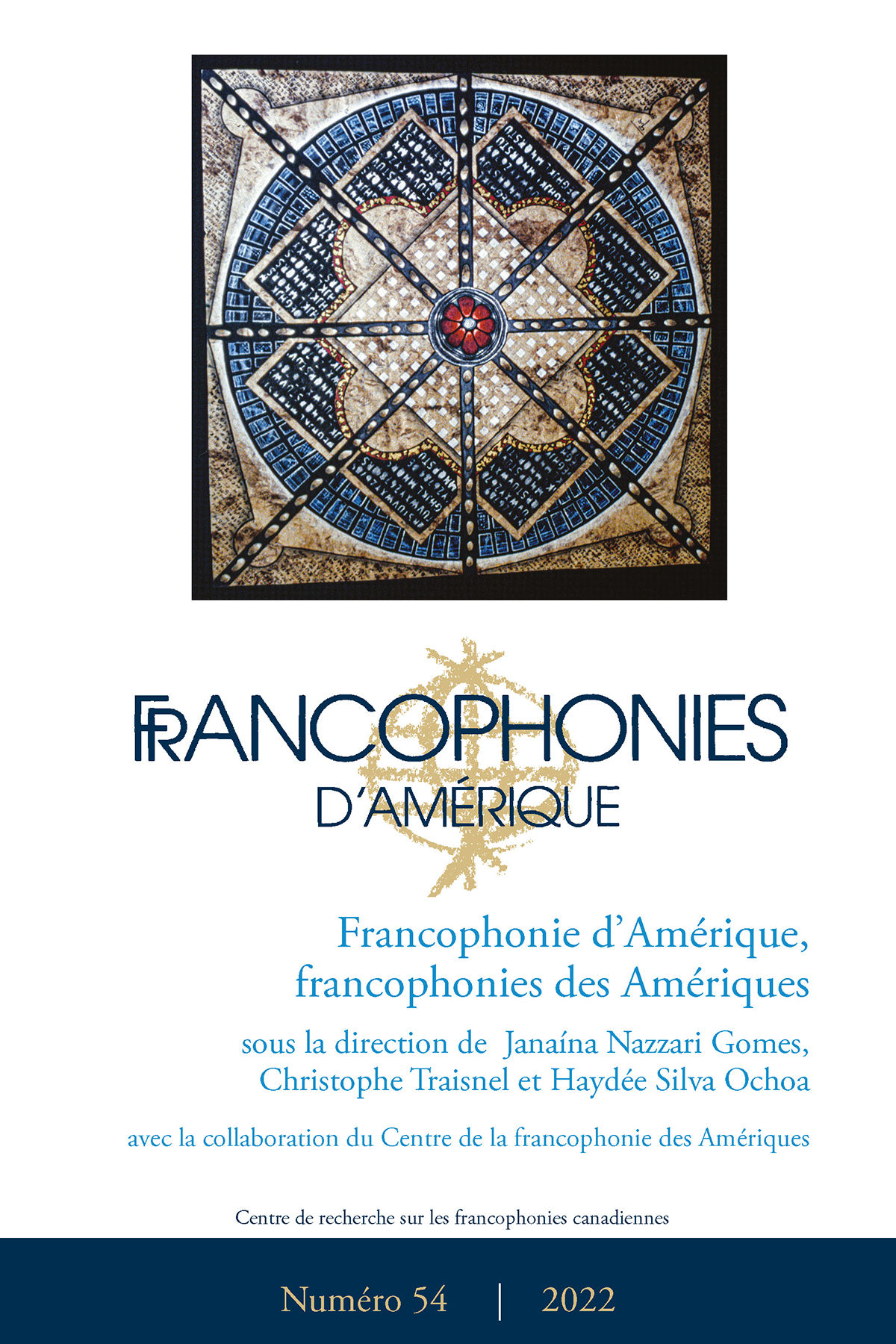La première section, « Des communautés à façonner », s’ouvre avec force sur une contribution de Nathan Rabalais, « L’identité dans la littérature franco-louisianaise : une troisième ère? ». L’auteur s’intéresse aux trois ères de la littérature francophone de la Louisiane, d’abord le xixe siècle, « une période très fructueuse pour la littérature d’expression française à la Nouvelle-Orléans » pendant laquelle « [l]es écrivains créoles […] ont produit un grand nombre de textes de tout genre » (p. 9); puis la « renaissance cadienne » à partir des années 1980, où l’identité cadienne est centrale (p. 13), et enfin l’époque actuelle, dont la poésie est peuplée d’identités multiples. Le chapitre suivant, « Nous rejetons les miettes : l’activisme politique et les francophonies canadiennes en milieu minoritaire », par Marcel Martel, est nettement moins convaincant. Dans ce texte de facture très scolaire, la première partie « s’intéresse aux efforts de l’État pour interagir avec les francophonies canadiennes », et c’est d’ailleurs là que l’on retrouve les passages les plus intéressants, qui portent sur le rôle que joue la GRC dans la répression des communautés minoritaires au pays. La deuxième partie présente un projet d’anthologie « des textes “fondateurs” des francophonies canadiennes qui témoignent d’une prise de parole collective » (p. 35). Même si c’est seulement dans cette section du travail que le lien avec la littérature est tangible, on a surtout l’impression d’avoir affaire à une demande de subvention. Le chapitre « 1866/68 : justice raciale, journalisme radical et poésie engagée en Louisiane francophone », signé par Clint Bruce, clôt cette première section de l’ouvrage. Le chercheur s’attache, avec succès, à « examiner le nouage entre politique et littérature à l’époque de la Reconstruction » (p. 44). L’étude se concentre autour de deux dates importantes : « 1866, très exactement le 30 juillet, jour fatidique du massacre du Mechanic’s Institute » (p. 44) où une cinquantaine d’individus, surtout des personnes noires, ont trouvé la mort aux mains de réactionnaires, et « 1868, année de l’adoption d’une constitution visionnaire en matière de droits civiques » (p. 44). Bruce s’intéresse particulièrement au journal La Tribune, « premier quotidien noir des États-Unis » (45), qui « aura […] inspiré une tradition de militantisme politique, héritage qui demeure vivace » (p. 48). Jonathan Livernois ouvre la section « Des figures engagées », avec un texte intitulé « Changements de code : Gérald Godin à la télévision québécoise ». Cette contribution se penche sur l’identité « feuilletée » (p. 74) de Godin, qui portait les chapeaux d’homme politique, d’homme de lettres et de journaliste. Plus particulièrement, l’auteur examine la « série de changements de codes, Godin passant de poète à journaliste à politicien, et ce, dans tous les sens » (p. 74). Suit Valérie Lapointe-Gagnon avec « Une plume de combat : l’écriture de soi comme mode d’action des femmes engagées en politique ». Sont au coeur de l’étude « la parole publique » et « l’expérience des pionnières engagées en politique », analysées à partir des récits autobiographiques de Judy LaMarsh, Thérèse Casgrain et Solange Chaput-Rolland. En conclusion, la chercheuse souligne que son corpus « peut […] devenir un manuel d’autodéfense pour les femmes en politique » (p. 102). La contribution suivante, bien que passionnante, est particulièrement brève – elle compte moins de cinq pages – ce qui frustrera assurément le lecteur ou la lectrice. « La littérature en première, en deuxième, en troisième lecture » d’Yvan Lamonde, dans l’esprit du collectif, propose un rapprochement, qui est le bienvenu, entre les disciplines de l’histoire et de la littérature. L’auteur s’en prend aussi aux …
Jonathan Livernois (dir.), Écrire pour gouverner, écrire pour contester, Québec, Presses de l’Université Laval, 2021, 250 p.[Record]
…more information
Isabelle Kirouac Massicotte
Université du Manitoba