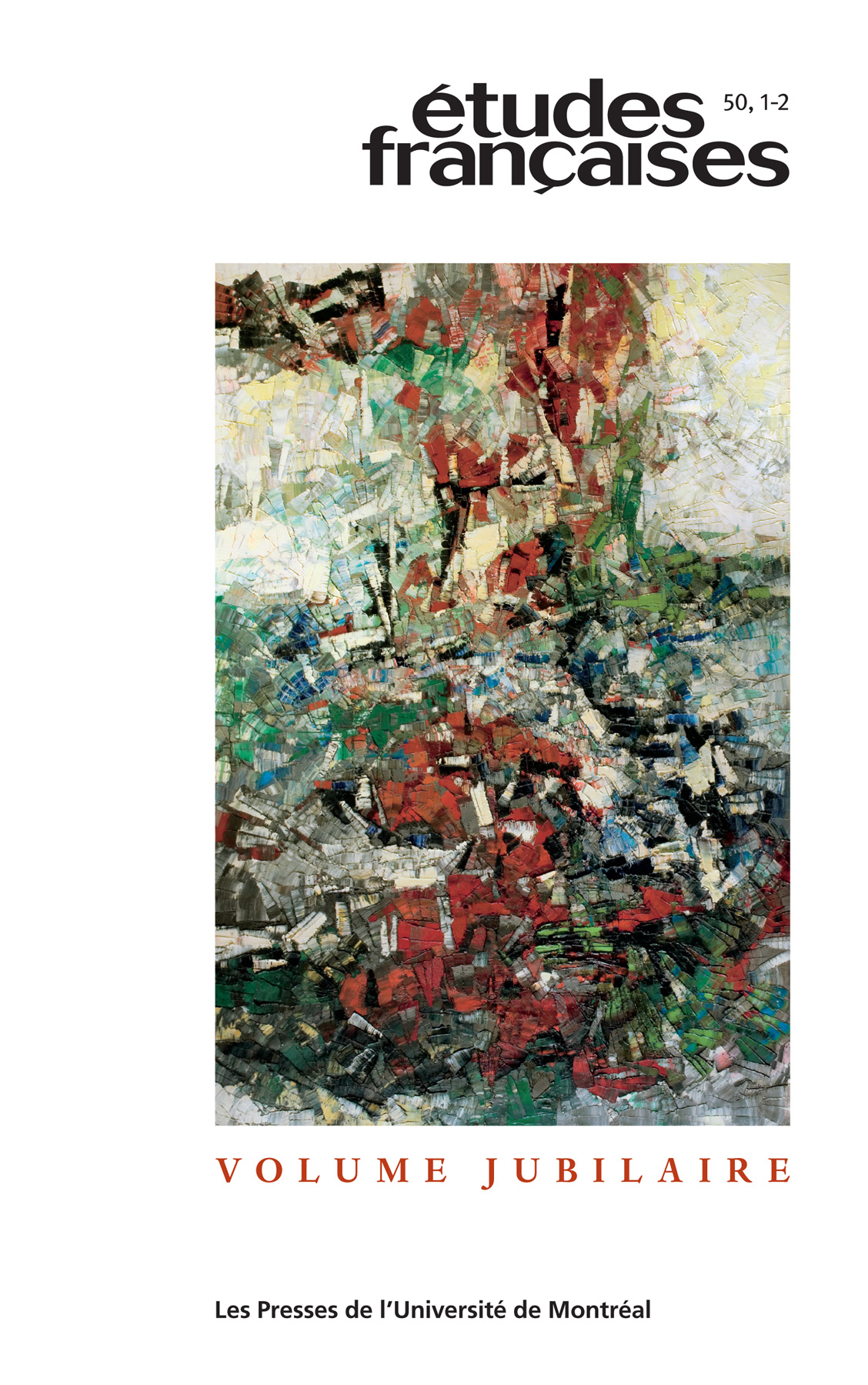Créé en 1966, grâce à la générosité d’un imprimeur montréalais, M. J.-Alex. Thérien, le prix de la revue Études françaises, d’une valeur de 2 000 dollars canadiens, est décerné aujourd’hui pour la première fois. Au 1er mars 1967, date limite pour l’inscription des candidats, le jury avait reçu 98 manuscrits, provenant de 24 pays. Ce jury est composé de M. G.-A. Vachon, président, de MM. Jacques Brault, Naïm Kattan et Paul-Marie Lapointe. Le prix littéraire que nous décernons aujourd’hui est intimement lié à la revue Études françaises et aux Presses de l’Université de Montréal, qui la publient. Maison d’édition universitaire, les Presses de l’Université de Montréal placent au sommet des valeurs intellectuelles la volonté de recherche. Elles sont au service de l’Université et prolongent l’oeuvre de celle-ci. Elles publient principalement des ouvrages et des revues destinés aux spécialistes des différents domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur. Les Presses ont également pour objectif de diffuser les connaissances, auprès d’un public non obligatoirement spécialisé, et contribuent ainsi à resserrer les liens qui unissent l’Université et la Cité. Attentives aux besoins du milieu québécois, soucieuses de faire connaître à l’étranger ce qui se fait au Québec, elles acceptaient en 1964 d’éditer la revue Études françaises. Celle-ci publie à la fois des études critiques et des textes de création ; elle donne, dans ses numéros spéciaux et dans les comptes rendus de ses livraisons régulières, un panorama de la vie littéraire québécoise ; elle accorde une attention particulière aux littératures qui se sont développées récemment, dans les pays de la francophonie. Pour encourager la création littéraire, dans ces pays, elle fondait le prix de la revue Études françaises. Les règlements du prix stipulent, en effet, que les candidats doivent avoir passé au moins la moitié de leur vie hors de France. L’attribution d’un prix littéraire reflète les tendances, le goût, la culture d’un groupe restreint de lecteurs réunis en un jury. Elle peut aussi exprimer les voeux secrets d’un milieu, d’une société. Est-ce un hasard si le prix de la revue Études françaises est le premier prix international décerné par un jury canadien-français ? Sa création en 1966 est un signe des temps : elle signifie que le Québec est conscient d’être porteur d’une culture qui lui est propre, façonnée par trois siècles d’histoire américaine, par des usages sociaux et linguistiques originaux, qui font qu’au sein même de notre pays, nous formons, plus que jamais, une société différenciée. Et cette culture, nous l’exprimons dans une langue que nous partageons avec le peuple de France, avec les pays dont le français est la langue maternelle, et avec tous ceux qui l’ont adoptée comme langue de culture. Cette situation peut rendre particulièrement difficile l’expression littéraire des sentiments et des rapports entre les êtres. Les écrivains de la « francité » ressentent, d’une manière particulièrement aiguë, l’écart qui intervient entre leur culture d’origine et la norme culturelle représentée par Paris. Il existe pourtant en Afrique noire et en Afrique du Nord, à Madagascar et à l’île Maurice, au Moyen-Orient, aux Antilles et au Canada, des littératures originales, d’expression française. Et l’exemple des Européens de toutes origines : Roumains, Irlandais, Espagnols, etc., dont l’apport à la littérature française contemporaine est bien connu, montre que la rencontre, et même le conflit de deux cultures, peut agir sur l’imagination littéraire à la manière d’un choc créateur. Le prix de la revue Études françaises a été créé à l’intention des écrivains francophones qui, pour faire leur oeuvre, doivent surmonter un problème de culture analogue à celui que vivent, depuis deux siècles, les Canadiens français. Plus …
Documents
Prix de la revue Études françaises[Record]
- Georges-André Vachon
Online publication: Aug. 19, 2014
A document of the journal Études françaises
Volume 50, Number 1-2, 2014, p. 185–189
Volume jubilaire
Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2014